Les mardis du Grand Continent et le programme Économie du Groupe d’études géopolitiques ont réuni autour de Thomas Piketty Cédric Durand, Laurence Fontaine et Ulysse Lojkine pour une discussion qui partait de son dernier ouvrage Capital et idéologie, Seuil, 2019.
L’occasion pour poser dans une salle comble de l’École normale superieure la question du renouveau scientifique de l’économie porté par Thomas Piketty et une partie de son école, ainsi que pour saisir plus précisément les coordonnées et le sens de la théorie des révolutions qui point dans son travail de long cours.

Ulysse Lojkine
Le champ couvert par votre dernier livre, Capital et idéologie, est immense, mais au-delà de la collection de faits, votre modèle est celui de « l’histoire raisonnée », dans la lignée de Smith, Marx, Weber ou Hayek. Elle consiste à regrouper l’infinie diversité des situations sociales en quelques grandes formes relativement stables, puis à montrer les raisons du passage de l’une à l’autre.
Vous appelez ces formes qui se succèdent des « régimes inégalitaires ». Parmi les régimes auxquels vous attachez le plus d’importance, se trouvent le régime ternaire, où la population est séparée entre les travailleurs et deux classes dominantes, clergé et guerriers ; ainsi que le régime propriétaire, c’est-à-dire le règne de la propriété privée et du libre contrat. Vous distinguez aussi le régime social-démocrate, société marchande mais capable de domestiquer la propriété.
Ce qui m’a particulièrement intéressé, au-delà de la description de chacun de ces régimes, c’est le moteur de leur succession. C’est le problème des causes du changement social, ou même des causes des révolutions, car le passage d’un régime inégalitaire à un autre implique des changements sociaux d’une telle profondeur qu’il peut être légitime de parler ici d’une théorie des révolutions.
Si l’on s’en tient aux réponses explicites à la question, vous attribuez le rôle déterminant à l’idéologie. Vous déclarez ainsi dans l’introduction :
[Les objets économiques] sont des constructions sociales et historiques qui dépendent entièrement du système légal, fiscal, éducatif et politique que l’on choisit de mettre en place et des catégories que l’on se donne. Ces choix renvoient avant tout aux représentations que chaque société se fait de la justice sociale et de l’économie juste, et des rapports de force politico-idéologiques entre les différents groupes et discours en présence. Le point important est que ces rapports de force ne sont pas seulement matériels : ils sont aussi et surtout intellectuels et idéolgiques.
Thomas Piketty, Capital et idéologie, Le Seuil, 2019, p. 20
En somme, les rapports de force entre des groupes aux intérêts différents existent, mais jouent un rôle second derrière celui des représentations de la société prise comme tout, d’un « on » qui « choisit » un régime inégalitaire plutôt qu’un autre. Vous considérez que ce choix collectif débouchant sur un changement social a lieu de manière privilégiée lorsqu’une forme sociale traverse une crise qui menace ses fondements. C’est « la rencontre d’évolutions intellectuelles et de logiques événementielles » (p. 48).
La société pourrait alors être considérée comme un grand individu expérimentant des institutions, et les révisant, à chaque crise, selon qu’elles ont ou non tenu leurs promesses. Vous insistez ainsi sans cesse sur la possibilité de « bifurcations » de grande ampleur, concept que vous reprenez à Deluermoz et Singaravélou. La révolution est donc pour vous faite de trois étapes : expérimentation, choix (à l’occasion d’une crise), bifurcation. Je voudrais donc savoir si vous êtes prêt à défendre ce modèle, sous cette forme stylisée que je dégage, et malgré les objections qu’on peut lui adresser, fondées sur les faits mêmes que vous rapportez dans votre livre 1.

Thomas Piketty
Je suis très heureux de revenir parler devant vous après la conférence de 2018 2. Tout d’abord, je suis tout à fait conscient des limites considérables de mon livre. J’ai eu pour but de décloisonner des travaux d’histoire, d’économie, de sciences sociales, j’ai donc lu beaucoup de choses mais cela n’a pas pu toujours me préserver des oublis, voire des erreurs.
Cela étant dit, revenons à vos objections. Je suis content que vous ayez lu mon livre comme un livre optimiste ; mais tel que vous le présentez, il serait plus naïf qu’optimiste. Le modèle Expérimentation-choix-bifurcation, que vous m’attribuez, impliquerait une rationalité et une consensualité dans le processus d’expérimentation collective que je ne peux pas entièrement reprendre à mon compte. Est-ce que la délibération apaisée d’un mardi du Grand Continent à l’Ecole normale supérieure permettra une transition apaisée vers le social-fédéralisme participatif ? Je ne le crois pas, je pense que ce seront des moments de crise, sociale, financière, politique, ou tout cela en même temps, qui donneront lieu à des changements. C’est toujours au sein de conflits considérables qu’a lieu l’apprentissage collectif.
Ce seront des moments de crise, sociale, financière, politique, ou tout cela en même temps, qui donneront lieu à des changements
Thomas Piketty
C’est ce que j’entends par l’expression de lutte des idéologies, que j’emploie à la fin du livre. Les idéologies des acteurs ont une autonomie relative, dans la mesure où leur position sociale ne leur fournit pas une théorie de la propriété, de la frontière, de l’impôt, de la démocratie. Ces idéologies sont déterminées par les leçons tirées de l’expérience, mais aussi par le répertoire d’idées que se sont approprié les protagonistes. C’est ici, par exemple, que les livres ont leur part, une petite part bien sûr. La crise offre justement à ces idéologies l’occasion d’un rôle historique, puisque son issue, toujours indéterminée, ne peut être garantie d’avance.
Revenons sur un exemple de crise, avec le déclenchement de la Première guerre mondiale, qui contribue au passage du régime propriétaire au régime social-démocrate. Ce qui caractérise le régime propriétaire avant 1914, c’est sa dimension internationale. Pour le comprendre, on peut partir du graphique suivant, qui montre l’évolution des actifs à l’étranger. Ce sont ces mêmes actifs qui intéressent Lénine dans son analyse des causes de la guerre dans L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme 3.

En 1914, les propriétaires français et britanniques ont accumulé dans le reste du monde des actifs de toute sorte. Beaucoup ont été acquis par la force pure et dure, comme le tribut imposé à Haïti par la monarchie française en 1825, qui fait partie de ce que possèdent encore les propriétaires français dans le reste du monde en 1914. Ces actifs à l’étranger incluent aussi le canal de Suez, le caoutchouc en Indochine, des chemins de fer un peu partout. La constitution politique des empires coloniaux est indissociable de ces acquisitions économiques.
Or ce processus d’accumulation aboutit à une contradiction. Les relations de propriété sont toujours difficiles, mais encore plus au niveau international, lorsque des pays versent des flux énormes de dividendes à d’autres pays. Les modèles des économistes, où de tels flux sont profitables à long terme à toutes les parties, ne parviennent pas à rendre compte de cette réalité conflictuelle. Dans les faits, ces paiements sont rendus possibles par la force militaire et par le processus de domination coloniale.
La France et le Royaume-Uni, de 1880 à 1914, récupèrent tant d’intérêts, de dividendes, de loyers du reste du monde, qu’ils peuvent se permettre un déficit commercial permanent, de 1 à 3 % par an du revenu national. Leur patrimoine à l’étranger leur apporte un tel flux de revenus (5 % par an pour la France, 10 % pour le Royaume-Uni) qu’ils peuvent continuer d’investir pour racheter le reste du monde. Imaginez une situation où, avec le loyer d’un appartement, le propriétaire rachète le reste de l’immeuble. C’est ici la même chose au niveau international, avec des sommes immensément importantes.
Ceux qui sont possédés finissent par se révolter, même s’il n’y a pas de loi mathématique pour en prédire la date.
Thomas Piketty
Première guerre mondiale ou non, on a du mal à voir comment cela aurait pu continuer indéfiniment. Ceux qui sont possédés finissent par se révolter, même s’il n’y a pas de loi mathématique pour en prédire la date. L’autre contradiction opposait les puissances impérialistes entre elles, car l’Allemagne était devenue la première puissance démographique et industrielle en Europe, mais était très en retard en termes d’expansion coloniale, et par conséquent d’actifs à l’étranger. Ce décalage a contribué aux tensions qui menèrent à la guerre, et à cet effondrement qu’on voit sur le graphique.
C’est donc bien la structure économique du régime propriétaire lui-même qui impliquait des logiques endogènes de crise. Il faut simplement ajouter qu’une fois que la crise se produit, le champ des possibles 4 – trajectoire social-démocrate, trajectoire communiste et d’autres – est ouvert.
Si nous avons cela en tête, nous pouvons nous tourner vers le présent, dont les contradictions sont différentes. Certes, les actifs à l’étranger de certaines puissances ne sont pas négligeables, c’est notamment le cas de l’Allemagne dont les forts excédents commerciaux donnent lieu à une accumulation de créances. Mais les niveaux sont moins importants, et nous ne sommes pas au bord d’une guerre entre nations européennes.
La contradiction principale se situe aujourd’hui dans le divorce entre classes populaires et moyennes d’un côté, élites de l’autre, qui est le résultat de la remontée des inégalités depuis les années 1980-1990, l’effondrement de l’Union soviétique et la période reaganienne. Certains veulent résoudre la contradiction de manière identitaire. Ainsi Trump, trente ans après la promesse reaganienne 5 dont l’échec est patent, invente un autre discours en rejetant la faute sur les Mexicains, sur les Chinois, sur tous ces gens qui volent le dur labeur de l’Amérique blanche.
C’est donc bien la structure économique du régime propriétaire lui-même qui impliquait des logiques endogènes de crise. Il faut simplement ajouter qu’une fois que la crise se produit, le champ des possibles – trajectoire social-démocrate, trajectoire communiste et d’autres – est ouvert.
Thomas PIketty
Mais il y a aussi d’autres débouchés possibles à la crise. Le parti démocrate aux États-Unis aujourd’hui, comme le parti travailliste au Royaume-Uni 6, n’est pas du tout dans la position d’il y a dix ou vingt ans. On assiste à un retour à des demandes de redistribution et de régulation, sous des formes nouvelles. Ces formes ne sont pas entièrement satisfaisantes, et ces partis ne sont pas au pouvoir, mais cela représente néanmoins un changement clair par rapport aux années 1990 et 2000. On voit bien ici que la crise est le fait de tendances profondes, mais que plusieurs idéologies opposées sont candidates à sa résolution.
Je voudrais m’attarder un instant sur la question européenne, où la même contradiction se manifeste aujourd’hui avec une netteté particulière. C’est ce que montrent ces données sur le vote du Brexit en 2016.

Ce sont uniquement les 30 % les plus favorisés en termes de revenus, d’éducation, de patrimoine, qui ont soutenu le maintien dans l’Union européenne, et les 10 % les plus favorisés l’ont même soutenu avec enthousiasme. Mais les 60 % restants ont voté contre. On l’a parfois expliqué par une idiosyncrasie britannique, mais si on regarde les référendums français de 1992 et 2005, on trouve une tendance analogue. En 1992, les 40 % les plus riches votaient nettement pour le oui et les 60 % restants votaient légèrement pour le non ; en 2005, il n’y a plus que les 20 à 30 % les plus favorisés qui votent pour le oui, cela ne peut plus contrebalancer les forces du non.

Des données si nettes, en 1992, 2005, 2016, dans deux pays aussi différents dans leur rapport historique à l’Union européenne, montrent que celle-ci est bien devenue l’objet d’un clivage très profond. Comment l’expliquer ? L’Union européenne a été le laboratoire par excellence de la libre circulation des biens et des capitaux, qui était censé mener à la prospérité partagée, mais qui n’a fait qu’accroître les inégalités.
Des données si nettes, en 1992, 2005, 2016, dans deux pays aussi différents dans leur rapport historique à l’Union européenne, montrent que celle-ci est bien devenue l’objet d’un clivage très profond.
Thomas Piketty
La conséquence en est la crise sociale et politique actuelle, qui est sévère. Il devient plus que difficile de croire que le problème, comme le disent certains, serait dans un défaut de pédagogie et que tout pourrait s’arranger par la délibération consensuelle. Si l’Union européenne ne change pas radicalement le cours de sa politique, la sortie de ces contradictions impliquera des tensions très vives, des déconstructions et des reconstructions. Je plaide cependant pour frayer une place à la délibération sur ce qui va suivre. Nous allons en passer par des crises et des moments de déconstruction, mais nous pouvons nous efforcer de contribuer à ce qu’elles prennent ensuite le meilleur chemin.
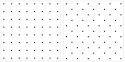
Laurence Fontaine
Ce livre pose les bonnes questions, et je considère qu’il s’agit d’une véritable réflexion historique. Certains historiens ont dit, dans leurs compte-rendus, que le livre s’aventurait dans tant de domaines qu’il risquait de ne pas plaire aux spécialistes de chaque question. Cela ne m’intéresse pas. Je ne veux pas discuter des virgules, mais bien du projet dans son ensemble.
Voici comment je le comprends 7. Vous avez voulu regarder les grandes inégalités dans le plus grand nombre de sociétés possibles, du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Pour organiser ces données, vous avez dû vous livrer à un profond travail de structure. Vous définissez d’abord un ensemble de sociétés que vous appellez trifonctionnelles. Cela correspond à ce que j’appelle les sociétés à statut, par opposition aux sociétés démocratiques. Elles incluent les sociétés d’ordres et de castes. On pourrait y adjoindre les sociétés à parti unique, où l’avant-garde prolétarienne, réputée seule détentrice de la vérité, constitue bien un statut à part. Les sociétés que j’appelle démocratiques, vous les qualifiez de propriétaires ou social-démocrates.
Sur la représentation de l’inégalité, je m’écarterais néanmoins de votre récit sur certains points. Je voudrais souligner que le marché implique l’égalité de statut, et qu’il est perçu comme tel. C’est pourquoi l’aristocrate ne va pas au marché, car on ne marchande qu’entre égaux.
Laurence Fontaine
Je pense que vous avez raison de procéder à ce travail de structure, mais aussi de le faire en attachant une importance particulière à l’idéologie. C’est en effet au niveau des représentations et des valeurs que se mesure le mieux le gouffre entre sociétés à statut et sociétés démocratiques.
Sur la représentation de l’inégalité, je m’écarterais néanmoins de votre récit sur certains points. Je voudrais souligner que le marché implique l’égalité de statut, et qu’il est perçu comme tel. C’est pourquoi l’aristocrate ne va pas au marché, car on ne marchande qu’entre égaux. C’est absolument impossible pour le membre d’une classe supérieur de s’abaisser à marchander, ils y envoient donc leurs gens. C’est inversement cette égalité de statut qui rend le marché créateur de démocratie.
Pour comprendre l’inégalité dans les sociétés à statut, il faut en passer par la charité. Je crois que c’est elle qui justifie l’inégalité sous l’Ancien régime, plus que la trifonctionnalité – il faut que certains travaillent, d’autres prient, d’autres guerroient. La charité est d’une tout autre nature que la redistribution des sociétés démocratiques. En effet, les sociétés à statut reposent sur le lien social, non sur l’État. Donc le noble donne ce qu’il veut, à qui il veut, quand il veut. Quand on passe aux sociétés d’impôt, ou sociétés d’égaux, je ne donne pas ce que je veux, pas quand je veux, et je ne sais pas ce que cela devient.
L’Ancien régime est travaillé par une égalité de statut souterraine, due à l’émergence du marché, qui apprend peu à peu aux gens à se considérer comme citoyens.
Laurence Fontaine
Comment, psychologiquement, les gens arrivent-ils à passer d’une société de charité à une société d’impôt ? Quand on travaille sur les textes qui circulent au XVIIIe siècle, on voit un discours émerger : les aristocrates ont fait une faute morale, ils sont devenus avares, ils ne donnent plus. On imagine donc une sorte de plancher à la charité, il faudrait obliger à donner, et on glisse ainsi progressivement vers l’idée d’égalité de statut universelle. On voit bien ici qu’il ne s’agit pas de lutte de classes bête et méchante, même si les rapports de force sont importants. C’est aussi ce qui explique que des aristocrates comme Condorcet, que, je crois, nous estimons tous deux, contribuent à changer la manière de penser la société et ses fondements.
Cette dynamique des représentations nous permet de mieux comprendre comment on en arrive à la Révolution française. L’Ancien régime est travaillé par une égalité de statut souterraine, due à l’émergence du marché, qui apprend peu à peu aux gens à se considérer comme citoyens.
Thomas Piketty
C’est en effet l’approche que j’ai voulu adopter : mettre les représentations au cœur de nos recherches, élaborer une économie politique et historique qui passe par les représentations pour atteindre le changement historique.
Jamais dans l’histoire une société n’a amélioré son espérance de vie ou son taux d’alphabétisation par les dons spontanés de millardaires.
Thomas Piketty
J’aime particulièrement ce que vous dites sur les sociétés de charité et les sociétés d’impôt. C’est important parce que beaucoup aujourd’hui voudraient revenir à la société de charité, où chacun décide combien donner et pour quoi. Le reste de la planète doit alors ramper aux pieds de Bill Gates pour le supplier d’améliorer la santé en Afrique. Or jamais dans l’histoire une société n’a amélioré son espérance de vie ou son taux d’alphabétisation par les dons spontanés de millardaires.
Laurence Fontaine
Si j’ai apprécié votre insistance sur le rôle des représentations, je dois dire que je ne suis pas aussi convaincue par votre recours aux données. Je m’explique. Pour étudier les sociétés démocratiques, vous comparez la part de la richesse et du revenu qui revient à différents groupes de la population : les 50 % les plus pauvres, puis les 10 %, 1 %, 0.1 % et même 0.01 % les plus riches.
Je crois qu’ici, on ne peut comprendre votre démarche sans mentionner une autre ambition du livre, non moins légitime, de donner à la gauche un programme, développé dans la dernière partie, et dont les analyses qui précèdent doivent montrer le bien-fondé. Cela m’amène à mon objection. Dans vos données, vous regroupez en une même catégorie la moitié la plus pauvre de la population. Ce qui me gêne, c’est qu’on ne sait pas qui sont les gens dans ces 50 %. Il me paraît difficile de construire un programme de justice sociale sans savoir qui ils sont, notamment parce que cette catégorie ne permet pas de distinguer entre les classes moyennes au sens large, et les pauvres. Or ce seuil est politiquement crucial. Si on lit l’Enquête sur les valeurs des Français qui se fait tous les neuf ans, on voit que tous réclament plus de participation dans l’entreprise, dans la vie démocratique – tous, sauf les plus pauvres, ceux qui ont des petits boulots, qui ne gagnent rien, ceux-là veulent juste de l’argent, la démocratie ce n’est pas leur souci.
En gommant ces situations singulières par la statistique, on s’empêche donc, politiquement, de prendre en compte le rôle que peut jouer le marché pour les exclus, les pauvres, les marginaux.
LaurenCe Fontaine
Cela recoupe mes propres travaux historiques sur le marché. En tant qu’historienne de l’Ancien régime, je me suis rendue compte que toutes les classes populaires allaient au marché. Dans une société de statut, une femme, un migrant, quelqu’un qui ne rentre pas dans ces cadres corporatistes, n’a d’autre moyen de gagner sa vie que de contourner ces cadres en allant sur le marché. En gommant ces situations singulières par la statistique, on s’empêche donc, politiquement, de prendre en compte le rôle que peut jouer le marché pour les exclus, les pauvres, les marginaux.
Thomas Piketty
Le vocabulaire asséchant des centiles n’a pas vocation à remplacer les autres manières de nommer les groupes sociaux. Peut-être que parfois je ne m’emploie pas assez à nommer les professions, les groupes qui sont derrière les chiffres. Il aurait fallu le faire plus, car cette richesse linguistique qui permet à chacun de se désigner lui-même, de décrire son identité, est indispensable, et on ne va pas remplacer la guerre des classes par la guerre des déciles. On a besoin pour décrire les groupes sociaux d’un vocabulaire propre à chaque époque, à chaque société, pour décrire les professions, les savoirs-faires, les cultures.
Le problème de ce vocabulaire, c’est qu’il ne permet pas de comparer les niveaux d’inégalité dans des sociétés différentes. Si on l’emploie avec prudence, le langage statistique trouve là sa fonction, celle de comparer l’incomparable, par exemple des sociétés où les noms mêmes des professions ne sont plus les mêmes. Il ne me paraît pas inutile de se donner les moyens de comparer la concentration de la propriété aux Etats-Unis aujourd’hui avec celle de la France de 1913 ou du Royaume-Uni de 1800. C’est comme cela qu’on peut essayer de tirer des leçons de ces expériences historiques, tout en étant conscient des limites de ce vocabulaire, qui n’a pas vocation à remplacer le langage plus concret. Dans l’Introduction, j’essaye d’ailleurs d’insister sur cette complémentarité entre langage naturel et langage mathématique.
On ne va pas remplacer la guerre des classes par la guerre des déciles
Thomas Piketty
Pourquoi regrouper les 50 % les plus pauvres au sein d’une même catégorie, sans seuil intermédiaire ? Quand on regarde la concentration de la propriété en France au XIXe siècle et jusqu’à aujourd’hui, même tous réunis, les 50 % les plus pauvres ne possèdent presque rien : 6 % de la propriété totale aujourd’hui, au XIXe siècle 2 %.

Il m’a donc paru commode de les réunir en une catégorie. Mais dans les bases de données que j’utilise, tous les centiles de la distribution sont disponibles. Je donne d’ailleurs à un endroit dans le livre la distribution complète :

On voit qu’il y a des personnes qui ne possèdent rien du tout, 1000 ou 2000 euros sur leur compte en banque tout au plus. Toujours parmi les 50 % les plus pauvres, on trouve aussi des personnes plus proches du patrimoine médian, qui est aux alentours de 100 000 euros par adulte. Ce peuvent être des gens en voie d’acquisition de leur logement, qui sont peut-être endettés d’autant. Ce groupe statistique contient donc en effet tout un continuum, même si je ne le rappelle pas à chaque fois dans les comparaisons historiques.

Cédric Durand
Je voudrais d’abord remercier Thomas pour ce livre. Nous étions très impressionnés par le précédent, on passe ici encore un cap. Dans une recension du Capital au XXIe siècle, l’American Entreprise Institute l’avait qualifié de « marxisme soft », s’inquiétant de la manière dont il pourrait transformer le discours public et définir le langage des batailles à venir. C’est bien ce qui a eu lieu, puisque vous avez contribué à mettre sur la table la question des inégalités, et cela pèse aujourd’hui dans les discussions, en particulier dans les pays de l’Atlantique Nord. Et voilà qu’au moment où le socialisme revient à la mode aux États-Unis, ce qui n’était pas arrivé depuis des décennies, vous arrivez à point nommé avec un livre qui s’attelle à la question : comment peut-on être socialiste au XXIe siècle ?
J’ai lu ce livre comme une étude des rapports de propriété, dans une perspective socio-économique et historique, à l’échelle des sociétés entières. La réunion de ces diverses dimensions en fait un livre tout à fait original, et on pourrait dire que c’est déjà un classique, car cette ambition n’avait pas été assumée depuis longtemps.
Au moment où le socialisme revient à la mode aux États-Unis vous arrivez à point nommé avec un livre qui s’attelle à la question : comment peut-on être socialiste au XXIe siècle ?
Cédric Durand
Néanmoins, cette insistance sur la propriété engendre une ambiguïté sur son rapport au concept de capital. Celui-ci apparaît dès le titre, mais vous le traitez de manière quelque peu impressionniste. Vous définissez le capital comme propriété, non comme une relation sociale. C’est ce qui vous fait arriver à une définition du capitalisme un peu étrange, comme la forme du régime propriétaire à l’âge de la grande industrie et du capital financier 8. Vous le décrivez aussi comme un mouvement historique qui repousse sans cesse les limites de la propriété privée et de l’accumulation d’actifs. Mais on en reste au niveau de la description. Pour comprendre la dynamique du capitalisme, il faudrait rapporter cette dynamique d’accumulation à ses causes que sont la concurrence et le marché. C’est la concurrence sur le marché qui force à investir, et c’est le mouvement chaotique d’accumulation qui en résulte qui à son tour produit des crises, des guerres.
Cette réduction du capitalisme à une question de propriété n’est pas sans conséquence dans la partie politique de l’ouvrage. Ce que vous proposez dans le domaine fiscal est très impressionnant et convaincant, mais ce n’est qu’une dimension du problème, qui demanderait à être complétée, notamment, par la question du mode de coordination et du marché. Par exemple, vous évoquez le rôle de la délibération collective pour décider des besoins. Or, si la décision est collective, elle ne peut être mise en œuvre par le marché, mais seulement par une forme de planification. Or ce terme de planification n’est pas présent dans votre livre, même si je pense que le concept y est implicitement.
Mais pour revenir à l’usage historique de ce concept de capital, prenons le cas de la Première guerre mondiale, et le ‘graphique léniniste’ que vous avez montré, qui montre l’évolution des actifs nets à l’étranger. Je lui accorde beaucoup d’importance et je le montre à mes étudiants. Vous commentez ce graphique en expliquant que les inégalités tendent à nourrir le nationalisme, pour cimenter par un ennemi commun l’unité sociale menacée, et que cela conduit à la guerre.

Tout cela est très juste, mais je ne peux suivre votre interprétation dans ses détails, pour deux raisons. Tout d’abord, quel est le rapport entre inégalités et accumulation impérialiste d’actifs à l’étranger, qui augmentent au même moment ? Sur ce point, contrairement à ce que vous disiez tout à l’heure, vous n’êtes pas très léniniste, car vous semblez faire des inégalités la conséquence de cette accumulation à l’étranger, entreprise surtout par les plus riches. Or on peut construire l’argument inverse, comme le fait Branko Milanovic 9. Il cherche à montrer, données à l’appui, que ce sont bien les inégalités domestiques qui sont la cause de ces déséquilibres qui conduisent à la guerre.
L’idée est la suivante. Les inégalités très fortes en Europe dans les années qui précèdent la Première guerre mondiale entraînent une accumulation du capital considérable qui ne trouve pas de débouchés où s’investir. C’est cette suraccumulation, comme l’appellent les marxistes, qui explique alors les investissements à l’étranger. Comme les droits de propriété y sont fragiles, ces investissements s’accompagnent d’une protection militaire pour les garantir, comme vous le décrivez très bien. Dans ce récit, ce sont donc bien les contradictions économiques internes de l’accumulation du capital qui sont le moteur du changement historique et institutionnel.
Le terme de planification n’est pas présent dans votre livre, même si je pense que le concept y est implicitement.
Cédric Durand
Ensuite, je pense que ce graphique sous-estime ce qui se passe aujourd’hui. Il représente les actifs étrangers nets, alors qu’aujourd’hui les actifs bruts sont extrêmement importants, c’est-à-dire que tous les grands pays ont une grande masse d’actifs à l’étranger, mais aussi de passifs. La situation contemporaine implique de plus des paradoxes spécifiques : ainsi la Chine, par le cumul de ses excédents commerciaux, atteint une position extérieure positive et importante, et pourtant, au lieu de recevoir des dividendes nets, c’est elle qui paye au reste du monde. À l’inverse, les États-Unis, comme on le voit sur le graphique, ont une position extérieure nette négative, c’est-à-dire qu’ils doivent de l’argent au reste du monde, et pourtant, ils en reçoivent chaque année. En somme, la contradiction est toujours vive aujourd’hui.
Thomas Piketty
Vous soulevez un point très important, dont je ne parle pas assez dans le livre. Quand on regarde ce graphique, on a en effet l’impression que la finance internationale était beaucoup plus développée en 1914 qu’aujourd’hui. Mais c’est en partie une illusion d’optique, car comme vous l’expliquez, le graphique montre seulement les actifs nets – ce que chaque pays possède dans le reste du monde moins ce que le reste du monde possède chez lui. C’est seulement de ce point de vue qu’on peut dire qu’on n’a jamais retrouvé les niveaux de 1914. Ce qui est nouveau aujourd’hui et qu’on ne voit pas sur ce graphique, c’est que, pour résumer, tout le monde possède tout le monde dans des proportions hallucinantes. Aujourd’hui, cette interrelation concerne même les petits et moyens propriétaires. Par exemple quelqu’un qui possède 50 000 euros en assurance vie en France, détient en fait des actifs boursiers ou des titres de dette en Allemagne, de même le propriétaire allemand détient des titres italiens composés d’actifs américains, etc.
Ce qui est nouveau aujourd’hui et qu’on ne voit pas sur ce graphique, c’est que, pour résumer, tout le monde possède tout le monde dans des proportions hallucinantes.
Thomas Piketty
Si on regardait, donc, les actifs financiers bruts au lieu des actifs nets, on verrait qu’ils ont atteint des proportions inédites par rapport à l’économie réelle. Or cette complexité du réseau des actifs bruts est peut-être la variable décisive, car elle indique la fragilité des souverainetés nationales face à la finance. C’est ce que tes travaux montrent bien, et si je le dis parfois dans le livre, il est vrai que je ne le mets sans doute pas assez en avant.
Cédric Durand
Ma deuxième objection porte sur la question des limites de la social-démocratie. Vous en évoquez certaines : elle n’a pas su envisager la propriété sociale des entreprises ou l’impôt progressif sur la propriété, pas assez promu l’accès égalitaire à la formation. Mais je pense qu’il faut envisager la question d’un autre point de vue, celui des contraintes auxquelles se sont trouvés confrontés les acteurs sociaux-démocrates, que ce soit en France, ou en Suède dont vous parlez beaucoup.
Je voudrais citer à ce propos un livre de Jonas Pontusson, Les Limites de la social-démocratie 10, qui porte sur le cas suédois. Les Suédois ont entrepris de créer une véritable social-démocratie, par la planification de l’économie, par la participation des travailleurs à l’entreprise, qui jouait notamment un rôle dans la fixation des salaires, et enfin par le plan Meidner : chaque année, progressivement, une partie du capital est socialisée dans le but que finalement, les syndicats contrôlent l’intégralité de l’économie.
Toute tentative de transformation sociale donne bien lieu à une bataille qui n’est pas qu’idéologique — vous avez raison à ce sujet d’évoquer Pinochet.
Cédric Durand
Cela a échoué, mais pourquoi ? Ce qui est intéressant, c’est que Pontusson n’insiste pas du tout sur les mêmes éléments que toi. Il distingue les forces de résistance du côté du capital et du côté du travail. Le capital, tout d’abord, pèse directement sur le débat public, et peut même employer la menace. Toute tentative de transformation sociale donne bien lieu à une bataille qui n’est pas qu’idéologique — vous avez raison à ce sujet d’évoquer Pinochet. Le capital peut aussi menacer de sa fuite, ce qui pose la question de sa libre circulation.
Du côté du travail, vous avez raison de montrer la responsabilité de projets insuffisamment élaborés ou précis, qui peuvent décevoir lorsqu’arrive le moment de la décision politique. Mais l’autre facteur, c’est une base sociale désarticulée ou divisée, et à ce sujet-là, votre livre est moins net. Je suis plus convaincu par le livre d’Amable et Palombarini, L’Illusion du bloc bourgeois, qui met précisément le doigt, je trouve, sur ce qui permet d’avancer. 11
Thomas Piketty
Je cite aussi le livre d’Amable et Palombarini 12 et je m’en sens très proche. Ils analysent avec finesse la décomposition de la coalition politique sociale-démocrate et les possibles recompositions. Dans les données que je présente sur l’évolution des électorats, il est vrai que je creuse bien moins profondément qu’eux le cas français contemporain, même si, en contrepartie, je considère une durée plus longue et plus de pays.
J’avoue que je ne connais pas le livre de Pontusson sur la Suède, mais cela m’intéresse, car c’est un cas riche, notamment l’expérience de socialisation graduelle de l’investissement par les syndicats, que j’aurais dû analyser plus profondément. Mais revenons à la raison de l’échec. J’insiste beaucoup dans le livre sur la crise bancaire de 1990-92. Je pense que c’est un moment très important. En effet, les sociaux-démocrates suédois auraient pu être une force pour une régulation transnationale du capitalisme, mais ils n’essaient pas une seconde de le faire.
C’est un bon exemple de l’incapacité de la social-démocratie, lorsqu’elle a été au pouvoir, à développer des formes politiques transnationales. Le discours est transnational, les débats le sont aussi, mais lorsqu’il s’agit d’organiser le prélèvement de l’impôt, le droit social, le droit du travail, on reste très étroitement à l’intérieur de l’État-nation. Les sociaux démocrates participent même directement dans les années 1980 à la libéralisation sans régulation des flux de capitaux, ce qui contribue à la crise bancaire de 1990-92.
Le discours est transnational, les débats le sont aussi, mais lorsqu’il s’agit d’organiser le prélèvement de l’impôt, le droit social, le droit du travail, on reste très étroitement à l’intérieur de l’État-nation.
Thomas Piketty
Ce qui est paradoxal, c’est que ce n’est pas cette libéralisation qui est alors mise en cause. Au contraire, puisque les sociaux-démocrates étaient au pouvoir dans les années qui précédaient, les conservateurs en profitent pour mettre en cause l’ensemble de l’édifice et infligent de sévères coups de canif au modèle économique. Les Suédois sont notamment les premiers à sortir les revenus du capital de l’impôt sur le revenu – c’est l’exemple qu’on nous a brandi en France pendant des années avant de le suivre finalement en 2017. Les Suédois tombent ainsi dans le syndrôme du petit pays qui pense que seul face aux grands méchants marchés financiers, il n’a d’autre choix que de marcher droit, sans quoi il encourt une autre crise bancaire.
C’est de cette manière qu’on arrive à une situation assez invraisemblable où ce sont les sociaux-démocrates eux-mêmes qui suppriment l’impôt sur les successions, dans le but, pour résumer, que le fondateur d’Ikea ne parte pas mourir en Norvège. On peut comprendre ce souci, sauf qu’à aucun moment les sociaux-démocrates suédois n’ont proposé à un autre pays européen de mettre en place un impôt commun, par exemple sur les successions. Le gouvernement fédéral américain, malgré tous ses défauts, a compris depuis un siècle que l’impôt progressif sur le revenu ou les successions devait être appliqué au niveau fédéral, sans quoi il se trouve aussitôt menacé par la concurrence entre les territoires.
On arrive à une situation assez invraisemblable où ce sont les sociaux-démocrates eux-mêmes qui suppriment l’impôt sur les successions, dans le but, pour résumer, que le fondateur d’Ikea ne parte pas mourir en Norvège.
Thomas PIketty
Il y a sur ce point en Europe des discussions très tôt, que je relate dans mon livre. Au printemps 1940 a lieu à Paris une réunion incroyable qui implique des tendances politiques opposées, avec aussi bien Hayek que Beveridge. Ils réfléchissent au contenu d’une possible fédération politique franco-britannique. À l’époque, elle est morte-née, mais ils réfléchissent à la forme qu’elle pourrait prendre pour la suite. Hayek défend un fédéralisme propriétaire, qui sanctuarise les inégalités et constitutionnalise le marché. Mais à côté de cela, des intellectuels comme Beveridge ou Barbara Wooton proposent un impôt fédéral sur les revenus ou les successions, un revenu maximum.
Ces espaces de discussion n’ont jamais été investis sérieusement par les sociaux-démocrates des décennies suivantes, en particulier en Suède, mais aussi en France ou en Allemagne. Ils ont laissé passer tous ces trains et ont finalement contribué puissamment à la logique propriétaire, notamment par le traité de Maastricht en 1992, sans aucune coordination collective et sans se donner les moyens de suivre les flux de capitaux pour enregistrer qui possède quoi. On se retrouve penauds vingt ou trente ans plus tard, sans savoir qui possède quoi, obligés d’annuler les taxes sur les propriétaires et de reporter la charge fiscale sur les classes moyennes et populaires. On s’étonne ensuite du résultat, mais on a commencé par jeter les bases d’un système qui entrave toute forme de justice ou de répartition de la charge fiscale.
Cédric Durand
Ma troisième objection porte sur la question européenne, et plus largement celle de l’internationalisation. Je trouve formidables tes graphiques sur les référendums européens. Quand on est confronté à ces faits, à moins de penser que les pauvres et les peu qualifiés sont complètement idiots, on doit convenir qu’il y a bien un problème avec l’Union européenne 13. Ceux qui n’ont pas intérêt à l’Union européenne votent contre elle lorsqu’ils peuvent le faire.
Vous semblez être d’accord avec ce constat et pourtant vous êtes parfois ambigu. Vous consacrez par exemple une section au rapport entre Hayek et l’Union européenne, où vous ne parlez presque que de Hayek. Vous admettez ensuite que l’Union européenne, elle aussi, donne une grande place au marché, mais vous l’exemptez de la comparaison en lui reconnaissant une souplesse, une ouverture à des directions nouvelles : « il faut dépasser l’idée d’un complot ordolibéral cohérent et invincible, et accepter de voir l’organisation actuelle de l’Europe comme un compromis instable, précaire et évolutif » (p. 825).
Pour qu’une politique de gauche émerge quelque part au XXIe siècle, il faut se libérer d’un certain nombre de contraintes. La première d’entre elles, inscrite dans les traités européens, est la liberté de circulation des capitaux.
Cédric Durand
Pour ma part, je ne veux pas parler de complot, mais, de nouveau, de contrainte. La gauche plurielle de Jospin, ou déjà Miterrand en 1983, ont fait face à des contraintes imposées par l’Union européenne. Ils ont pris leurs décisions en fonction de coûts immédiats qui auraient été extrêmement élevés s’ils y avaient désobéi. Pour qu’une politique de gauche émerge quelque part au XXIe siècle, il faut se libérer d’un certain nombre de contraintes. La première d’entre elles, inscrite dans les traités européens, est la liberté de circulation des capitaux. Sa suspension est un préalable à toute possibilité de transformation sociale. C’est ce qui n’est pas clair dans votre livre.
Thomas Piketty
Dans le passage que vous citez, je veux marquer le contraste entre la réalité de l’Union européenne actuelle et un projet propriétaire radical, celui de Hayek, tel qu’il est présenté dans Droit, législation et liberté (1982). Je l’ai lu pour la première fois dans le détail pour ce livre, et j’ai été impressionné par la sophistication de son idéologie propriétariste et la constitutionnalisation de son projet politique. La constitution qu’il propose interdit par exemple l’impôt progressif, et prévoit que les fonctionnaires, les retraités et toutes les personnes vivant d’argent public soient exclus du droit pour les élections à la première chambre. Quand à la seconde chambre, seule compétente à légiférer sur le droit fondamental selon Hayek (droit de la propriété et des entreprises, droit fiscal), elle a ses membres élus pour quinze ou vingt ans à un suffrage quasiment censitaire. Ce que je dis, c’est que comparée à un tel modèle, l’Union européenne représente un projet propriétariste nettement moins assumé, et a des marges d’évolution démocratique.
Il reste vrai que l’Union européenne requiert l’unanimité en matière fiscale. Sur ce point, il faudra bien en passer par des remises en cause unilatérales. De même, il n’y a pas d’autre solution que de se soustraire unilatéralement à la libre circulation des capitaux. Je le dis dans mon livre, et je suis désolé si vous avez trouvé que je n’étais pas assez clair à ce sujet.
Il me semble essentiel de proposer d’autres horizons que le simple retour à la souveraineté nationale.
Thomas Piketty
Rappelons d’ailleurs que le seul moment où les lignes ont bougé sur la question du secret bancaire suisse ces dernières années, c’est lorsque l’administration Obama a menacé les banques suisses de leur retirer leur licence bancaire aux États-Unis. Immédiatement, le gouvernement suisse a accepté de revoir sa loi sur le secret bancaire, pour transmettre les informations sur le contribuable américain – ce qu’ils n’ont fait qu’à moitié par la suite. Le changement substantiel de législation qui a été obtenu ne l’a été que sous la menace crédible d’une pénalité très forte.
Si l’Allemagne ou la France disait aujourd’hui au Luxembourg la même chose, celui-ci protesterait auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, qui répondrait que ces sanctions ne sont pas conformes aux traités. Je suis donc d’accord avec vous : c’est par erreur, ou à cause des rapports de force de l’époque, que nous avons signé ces traités, mais ce n’est pas parce que nous avons subi leurs conséquences depuis trente ans que nous devons nous résigner à leur lettre pour encore cinquante ans.
Ce que j’ajoute simplement, c’est qu’en même temps qu’on abandonne unilatéralement certaines règles, il faut impérativement proposer un autre cadre internationaliste qui permettrait de poursuivre les échanges, sous condition de règles et d’impôts communs, vérifiables et impliquant contre les réfractaires des sanctions dissuasives et immédiates. Je propose donc des traités de remplacement – je renvoie à ce sujet au livre coécrit avec d’autres, Changer l’Europe, c’est possible 14. C’est d’ailleurs ce qui me distingue de Bruno Amable. Il me semble essentiel de proposer d’autres horizons que le simple retour à la souveraineté nationale.
Sources
- Une recension plus complète de l’ouvrage de Thomas Piketty par Ulysse Lojkine est parue sur Le grand continent.
- Thomas Piketty, « De l’inégalité en Europe », in Une certaine idée de l’Europe, Flammarion, coll. « Champs », 2018
- Vladimir I. Lénine, L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme, Le Temps des Cerises, « Petite collection rouge », 2001 [1916]
- Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou, Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus, Seuil, coll. « L’Univers historique », 2016
- Pour une analyse plus précise de cette contradiction, nous renvoyons à l’article de Thomas Piketty « Gauche brahmane contre droite marchande » paru en français dans nos colonnes.
- Le débat a eu lieu avant l’élection de décembre.[ndlr]
- Laurence Fontaine, Le Marché. Histoire et usages d’une conquête sociale, Gallimard, coll. « NRF Essais », 2014
- Cédric Durand, Le Capital fictif. Comment la finance s’approprie notre avenir, Les Prairies ordinaires, 2015
- Branko Milanovic, Thomas Hauner et Suresh Naidu, « Inequality, foreign investment and imperialism », Stone Center Working Paper, 2017 – https://ssrn.com/abstract=3089701
- Jonas Pontusson, The Limits of Social Democracy. Investment Politics in Sweden, Cornell University Press, 1992
- Renvoyons à l’analyse du moment Macron par Bruno Amable et Stefano Palombarini dans cette revue.
- Bruno Amable, Stefano Palombarini, L’illusion du bloc bourgeois. Alliances sociales et avenir du modèle français, Paris, Raisons d’agir, 2017 M. Bouju, L.
- Cédric Durand (dir.), En finir avec l’Europe, La Fabrique, 2013
- Chancel, A.L. Delatte, S. Hennette, T. Piketty, G. Sacriste, A. Vauchez, Changer l’Europe c’est possible !, Points, 2019


