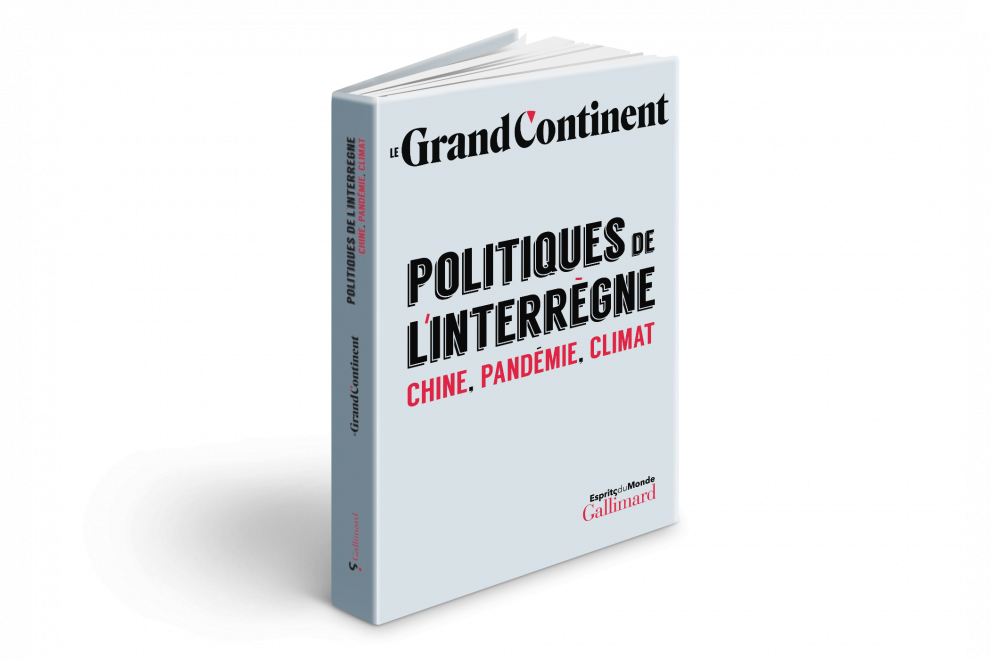Abonnez-vous à nos Lettres Restez informés des actualités du Grand Continent
Politiques de la planète
Comment ne pas voir que la crise écologique planétaire est aujourd’hui un enjeu politique ? Derrière le spectacle de plus en plus fréquent des incendies, inondations et canicules, on voit se déployer les arènes d’une politique de la Terre qui mobilise les experts, mais aussi les profanes. La planète n’est plus le décor passif et muet de l’histoire humaine, mais l’un des objets dont il faut se saisir pour partir à la conquête du pouvoir. Lors des grands sommets internationaux, dans le cadre des rencontres diplomatiques, des institutions multilatérales du commerce mondial, dans le discours des ONG, des think tanks géostratégiques, des candidats aux élections nationales et locales, dans les amphithéâtres universitaires, la Terre est partout. Qu’il s’agisse de préparer les systèmes sociaux aux conséquences du changement climatique ou d’en limiter l’impact, une compétition politique s’organise autour de la capacité à intégrer l’enjeu planétaire dans la construction du politique.
Qu’il s’agisse de préparer les systèmes sociaux aux conséquences du changement climatique ou d’en limiter l’impact, une compétition politique s’organise autour de la capacité à intégrer l’enjeu planétaire dans la construction du politique.
Pierre charbonnier
Et pourtant, même si la Terre est un enjeu de pouvoir, il est tout aussi évident que la course des événements n’a pas encore été infléchie. On se trouve dans un entre-deux historique, une « drôle de guerre » climatique, où les pièces sont posées sur l’échiquier des rapports de forces nationaux et internationaux, mais où aucune n’a encore été réellement jouée. Les équilibres idéologiques internes aux démocraties libérales sont en train de se réaligner sur le clivage entre un renouveau social, démocratique et écologique et un nationalisme identitaire, qui peut d’ailleurs lui aussi tirer profit d’un discours de réponse à la crise climatique en faisant l’apologie des frontières et de la sécurité. Pourtant, le statu quo libéral maintient encore sous cloche ce nouveau conflit dans la plupart des pays, précisément en brouillant le message et en jouant à la fois sur la nécessité de se réformer et de se protéger contre des menaces perçues comme extérieures.
Les accords commerciaux, les stratégies industrielles et les institutions de régulation de la finance internationale sont elles aussi largement « climatisées », pour reprendre le terme de Stefan Aykut et Lucile Maertens : il est ainsi de bon ton de conditionner les partenariats commerciaux à des clauses écologiques, de décourager ou de taxer les investissements sales ou encore de remettre en selle l’État stratège investisseur. Il en va de même pour les instances en charge de la sécurité globale et de la stabilité géostratégique 1. Mais de la même manière que sur la scène nationale, tous ces changements sont encore virtuels, essentiellement incantatoires : les émissions de CO2 continuent de progresser, et les dispositifs de protection et d’adaptation au changement climatique sont une bien maigre source de soulagement, généralement réservé aux plus riches.

Cet interrègne peut s’expliquer par l’absence d’un moteur social capable de réaliser la sortie de l’impasse climatique. Le productivisme implicite des modèles de croissance et de protection sociale, d’abord, entrave le développement d’une large adhésion démocratique aux principes d’une économie politique de l’anthropocène 2. En effet, une partie des emplois et de la condition sociale des personnes restent encore tributaires de l’économie des énergies fossiles, que ce soit directement dans les secteurs industriels, ou indirectement par l’intermédiaire des budgets des classes populaires contraintes par le prix de l’énergie, des carburants et de l’alimentation 3. La question du coût du changement de modèle, et de sa distribution sociale, reste l’obstacle principal à une activation réelle de la politisation de la planète. Par là on entend une politisation qui enclenche des transformations réelles dans les infrastructures de décision, dans l’ordre socio-économique, et in fine dans les formes de vie. Une politisation qui brise le plafond des discours d’alerte et l’économie de la promesse perpétuelle, à même d’entraîner une redéfinition en profondeur, au-delà de l’attachement ou non des individus à la cause de l’environnement, des rapports entre capital, travail, et biosphère. En l’absence d’une telle politisation transversale et efficace de l’enjeu planétaire, il est à craindre que la coalition fossile, qui dans sa version nord-américaine a porté au pouvoir Donald Trump, ait encore de beaux jours devant elle 4.
La question du coût du changement de modèle, et de sa distribution sociale, reste l’obstacle principal à une activation réelle de la politisation de la planète.
pierre charbonnier
De quoi manquons-nous ? Seule une médiation symbolique et sociologique semble à même de faire le lien entre la connaissance que nous avons de l’état du monde et les institutions que l’on invente pour se gouverner nous-mêmes, pour encadrer de façon durable et responsable le monde auquel notre destin est attaché. Longtemps, le pacte entre le processus de conquête de l’abondance matérielle et la construction juridique et politique de l’autonomie avait assuré ce lien. Dans la plupart des démocraties libérales, ce pacte a été pris en charge par l’économie politique capitaliste et par l’État sécuritaire : il s’agissait de rendre la nature productive pour délivrer les individus du manque et sécuriser les relations internationales par l’interdépendance économique. Au lendemain des décolonisations, ce pacte a été réinventé et relancé dans le cadre de l’État développementaliste 5 et du souci accordé à la souveraineté sur les ressources 6. Pourtant, il est désormais impossible de s’en tenir à cette formule qui a largement défini la modernité, car le couplage historique entre l’extension des frontières de la productivité et l’édification d’un socle de protections juridiques et sociales accordées aux individus vacille. Les gains de productivité sont de plus en plus difficiles à obtenir, ils le sont généralement au détriment de la qualité de vie et des conditions de travail des masses populaires, et la légitimation de l’ordre démocratique par la croissance menace constamment d’en éroder les bases. Mais les changements de paradigme n’adviennent pas par magie : la capture de l’imagination politique par l’économie des énergies fossiles, et plus largement de la productivité illimitée, plonge ses racines au plus profond de nos schémas de pensée et d’action 7.
Pour une part importante, cette confiscation de l’avenir est liée à la construction délibérée par les intérêts fossiles de ce que l’on pourrait appeler un discours de l’inévitabilité. La voiture individuelle et les schémas urbains qui lui sont liés, les procédés industriels qui sous-tendent les aspects les plus ordinaires de notre quotidien, tout cela a dû faire l’objet, dans l’histoire, d’un important investissement, qui perdure aujourd’hui 8). Mais la fossilisation de nos imaginaires politiques ne s’explique pas seulement par le lobbying de l’industrie des énergies : comme l’avait montré Pierre Bourdieu dès les années 1960, les politiques de productivité et de croissance ont également permis de neutraliser en partie les conflits de distribution entre la classe ouvrière et les investisseurs en rendant possible un « partage des bénéfices » qui semblait plus juste à tous 9. L’adéquation temporaire entre l’extension de la productivité et l’intérêt commun, voire une certaine forme d’universalité, appartient désormais au passé. Assez logiquement, il s’agit aujourd’hui de construire un autre substrat matériel sur lequel faire reposer la justice socio-économique, et d’en trouver la traduction institutionnelle.
La capture de l’imagination politique par l’économie des énergies fossiles, et plus largement de la productivité illimitée, plonge ses racines au plus profond de nos schémas de pensée et d’action.
Pierre Charbonnier
L’erreur serait pourtant, à ce stade de la réflexion, d’adopter une démarche dogmatique, qui définirait in abstracto une nouvelle théorie de la justice adaptée à l’anthropocène, indépendamment des rapports de forces sociaux et géostratégiques. En effet cette « climatisation » des politiques domestiques et internationales a fait subir à l’idéal écologiste des transformations fondamentales.
Le cadenas de l’abondance
Un petit retour en arrière est nécessaire pour les éclairer. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, la construction d’une gouvernance supranationale et l’édification de normes éthico-juridiques censées valoir pour l’humanité tout entière étaient censées répondre à la menace universelle et existentielle qu’avaient fait peser sur l’humanité (comme réalité et comme principe) les totalitarismes. On l’oublie souvent, mais la préservation de l’environnement a fait partie des missions de cet universalisme d’après-guerre 10, sous la houlette du directeur de l’UNESCO, et futur fondateur du WWF, Julian Huxley. Les actuelles Conférences des Partis (COP), au sein desquelles la coordination internationale de la lutte contre le changement climatique doit se mettre en place, sont les héritières lointaines de ces premiers efforts. Ils étaient adossés à un constat de crise éthique, à un discours de responsabilité à l’égard de l’avenir, de neutralité politique de la science, et attachés au principe universaliste qui oblige à surmonter les clivages d’intérêt lorsque le bien de l’humanité est en jeu. Mais comme chaque COP nous le rappelle amèrement, ce dispositif néo-kantien ne contribue en rien à la construction d’une paix perpétuelle décarbonée, tout simplement parce qu’il est en décalage avec les lieux de pouvoir effectifs où se décident les stratégies industrielles, les concessions minières, ou les flux financiers 11.
Alors que pendant la plus grande partie du XXe siècle l’idéal écologiste avait trouvé sa matrice dans ces dispositifs humanitaires-universalistes, il a été poussé au début du XXIe à chercher ailleurs ses justifications, et le modèle des procédures à défendre. C’est ainsi que, depuis quelques années, on voit poindre une politique des transformations planétaires qui ne mise pas tant sur la critique de l’anthropocentrisme ou la nécessité d’un nouveau code éthique que sur la redéfinition des liens entre capital, travail et nature.

Prenons à cet égard la publication du rapport de Nicholas Stern sur l’économie du changement climatique en 2006 comme repère historique. En définissant la crise climatique comme une défaillance des marchés, c’est-à-dire comme une trahison du principe libéral selon lequel la libre concurrence permet l’allocation optimale des ressources, et donc le moindre mal social, le Stern Report a popularisé un débat jusqu’alors technique sur les conditions de l’accumulation du capital dans un monde fini. Il a ouvert la porte à une rencontre jusque-là inhabituelle entre le débat sur la rationalité de l’économie néoclassique et la prise en charge politique de la planète.
Ce qui se joue depuis dans les arènes intellectuelles et politiques n’est pas simplement l’émergence d’une « mise en économie » de la crise climatique 12, mais la possibilité de faire de la rationalité économique le locus privilégié à partir duquel penser la construction des politiques planétaires. D’un point de vue strictement théorique, l’idée que le système des prix ne contient pas d’informations fiables sur l’état du métabolisme écologique remonte au moins à Thorstein Veblen, et peut-être plus tôt encore. D’un point de vue historique et social, en revanche, la nouveauté est réelle : après des décennies passées à vouloir responsabiliser les consommateurs, à invoquer une cause transcendante pour faire droit à d’autres êtres que les humains, le centre de gravité du débat s’est déplacé, et avec lui la capacité à traduire l’enjeu climatique dans le langage du pouvoir qu’est l’économie. Dans le paradigme humanitaire-universaliste, on était en quelque sorte contraints de faire un saut entre le langage de la science (les alertes lancées par les climatologues, et auparavant par les écologues spécialistes de biodiversité, de toxicologie, etc.) et celui des normes sociales. L’incapacité à infléchir les justifications du pouvoir, les définitions du bien commun, et à toucher aux leviers du changement réel, tenait à cet écart entre deux sphères trop hétérogènes. C’est ce qui a contribué à confiner si longtemps la cause écologiste dans le registre de la culpabilisation morale.
Désormais, la question écologique et climatique touche à ce qui constitue, dans les sociétés industrielles, commerciales et financiarisées, le code de l’ordre social – à savoir le capital et les institutions qui en garantissent la circulation et la distribution.
Pierre charbonnier
Désormais, la question écologique et climatique touche à ce qui constitue, dans les sociétés industrielles, commerciales et financiarisées, le code de l’ordre social – à savoir le capital et les institutions qui en garantissent la circulation et la distribution. Le débat sur les taxes carbone, les marchés de droits à polluer, sur la reconstruction d’un État investisseur et des politiques industrielles 13 sur le rôle des banques centrales ou d’éventuels dispositifs de planification 14, nourrit l’espoir d’une codification économique à venir du nouvel ordre planétaire, susceptible d’emporter la conviction du plus grand nombre. Naturellement, tout un spectre de positions idéologiques entre en compétition pour imposer des dispositifs plus ou moins favorables en fonction de la classe sociale considérée. Mais il semble du moins que l’on dispose du langage dans lequel traduire, pour la société, les nouvelles qui nous viennent des sciences de la Terre.
[Le monde se transforme. Depuis le tout début de l’invasion de la Russie de l’Ukraine, avec nos cartes, nos analyses et nos perspectives nous avons aidé presque 3 millions de personnes à comprendre les transformations géopolitiques de cette séquence. Si vous trouvez notre travail utile et pensez qu’il mérite d’être soutenu, vous pouvez vous abonner ici.]
D’une certaine manière, il s’agit pour la rationalité économique de trouver une forme de rédemption après avoir été si longtemps complice des crises du capitalisme contemporain. Les différentes variantes du Green New Deal développées aux États-Unis et en Europe, mais aussi l’orientation générale du quatorzième plan quinquennal chinois 15, entendent intégrer la sécurité planétaire aux réglementations qui encadrent les flux de capitaux, en particulier à travers une « transition énergétique », et à adapter l’organisation du travail à cette transition. Même du point de vue des options théorico-politiques en rupture plus nette avec ces principes, les enjeux se formulent essentiellement en termes économiques – que l’on parle d’un abandon intégral de la rationalité capitaliste ou d’une démarchandisation massive des secteurs stratégiques. En tout état de cause, l’intermédiaire économique permet de se figurer de façon beaucoup plus concrète que par le passé comment la structure sociale dans sa totalité va pouvoir être mise en mouvement et sortir de l’impasse climatique. Ce qui anime les concepteurs de ces différents scénarios économiques est la volonté de construire des alliances démocratiques (ou du moins électorales) au sein desquelles se rencontreraient les citoyens susceptibles d’y trouver leur intérêt. Alors que le simple spectacle des catastrophes écologiques semble ne pas être suffisamment efficace pour faire campagne pour le changement, un passage par des programmes de réindustrialisation, de taxation, de redistribution, de formation s’impose. Autant d’outils qui permettent de coder la crise planétaire non plus comme un fardeau, mais – au prix d’un petit arrangement avec la réalité – comme une opportunité, avec à la clé la redéfinition des lignes de clivages sociaux et idéologiques issus du passé 16.
C’est ce lien organique entre la construction de coalitions sociales et l’économie du changement climatique qui présente peut-être aujourd’hui les meilleures garanties de transformations réelles. Lorsque le romantisme contestataire s’estompe dans le rétroviseur, apparaît devant nous une écologie qui clive, qui politise, qui implique. Un réalignement des intérêts autour de la transition, la volonté d’embarquer dans les politiques de la Terre une partie des « perdants » de l’ordre néolibéral, tout cela forme le socle de conflits en cours et à venir, ainsi que la matrice d’un tournant réaliste de l’écologie politique 17.
C’est ce lien organique entre la construction de coalitions sociales et l’économie du changement climatique qui présente peut-être aujourd’hui les meilleures garanties de transformations réelles.
pierre charbonnier
Or c’est peut-être sur ce point précis que la promesse d’une codification essentiellement économique des enjeux touche paradoxalement à ses limites. Évidemment, nous avons la chance de lire de manière quasi quotidienne désormais les analyses extrêmement riches des économistes qui cherchent à identifier les mécanismes de régulation et de distribution de la richesse susceptibles de nous faire revenir dans les limites du système Terre. Mais a-t-on une idée véritablement plus précise, à travers ces travaux, des dynamiques politiques qui peuvent conduire à la sortie de l’impasse ?
Pour l’instant, on peut voir assez clairement comment un certain nombre d’intérêts économiques cadenassent l’avenir, et donc imaginer les rapports de forces susceptibles de la déverrouiller. Mais ces derniers restent la plupart du temps assez technocratiques : il s’agit des règles de fonctionnement des banques centrales, des logiques du lobbyisme, du chantage à l’emploi ou à la dévalorisation des actifs « échoués » de la part des investisseurs, autant de mécanismes qui mettent en scène avant tout les élites financières et politiques. Le contenu sociologique réel des groupes susceptibles de défendre et de porter l’un ou l’autre de ces projets de codification économique de l’anthropocène, lui, apparaît moins nettement. L’explication principale de cette inertie, de ce surprenant retard de la vie sociale 18 sur ses institutions les plus haut placées, tient au fait que peu de représentants politiques osent dire la vérité sur les conséquences de la crise planétaire.

L’accroissement du mal et la rationalité économique
On présente tour à tour cette crise sous l’angle d’une catastrophe en cours et vouée à s’aggraver, d’une catastrophe qui est de notre responsabilité, et en même temps comme l’occasion d’une régénération de l’égalité et de la justice sociale, comme un argument imparable pour taxer les riches et restaurer la démocratie. Le dilemme est réel, impossible à contourner : pour constituer le bloc social qui soutiendra la transition, il faut à la fois mettre la pression sur les affects politiques du plus grand nombre, extorquer l’adhésion en mettant en jeu la survie des enfants, et faire naître un sentiment d’espoir où résonnent les acquis des grandes luttes sociales du passé. Le prix à payer pour entretenir l’espoir est de taire ce que personne ne veut entendre, à savoir que l’intégration des limites planétaires à l’ordre social aura des conséquences pour tout le monde. Des conséquences qu’il s’agit de distribuer de la façon la plus juste qui soit, mais qui n’en sont pas moins difficiles à présenter de façon entièrement positive : il s’agit d’une lutte pour amoindrir les injustices liées à la perturbation du système Terre, et donc d’une lutte dans laquelle la prémisse inévitable est celle de l’accroissement du mal 19.
Le monde se transforme vertigineusement.
Comment naviguer dans l’interrègne ?
Retrouvez ce texte ainsi que de nombreuses contributions inédites dans le premier volume papier du Grand Continent.
Or la rationalité économique qui se met en place actuellement a pour fonction, parmi d’autres, de dissiper les effets de cette reconnaissance, qui est pourtant présente à l’état latent dans la société. En parlant d’une réorganisation des canaux de financement de l’économie et d’une redistribution des opportunités favorable à la classe moyenne, l’économie du changement climatique se satisfait trop souvent d’un mode de pensée qui adopte le point de vue des instances de gouvernement, qui se met dans le cockpit de décision globale pour commander à distance les leviers macro-économiques de la transition. Le coût brut des besoins de protection et d’adaptation est rarement évoqué. L’origine des fonds qui serviront à entretenir les infrastructures, les dispositifs de reproduction de la société, autant de secteurs non profitables, ou peu profitables, est poliment laissée dans l’ombre, pour laisser entendre que sous la houlette de l’expertise économique, coûts et bénéfices seront équilibrés. Pour ce qui est de l’investissement dans la transition, la raison économique peut naviguer avec ses outils et faire des promesses intéressantes, mais pour ce qui concerne les « grandeurs négatives », l’interrogation reste entière. La plus énigmatique de ces grandeurs négatives est bien entendu la question de la sobriété : traduit en termes économiques, le développement d’infrastructures publiques de transport, l’élimination de l’obsolescence programmée, le raccourcissement des chaînes d’approvisionnement, la chasse au gâchis, tout cela implique inévitablement une contraction de la sphère économique et de la logique d’accumulation. Or nous n’avons pas, me semble-t-il, de vision claire des conséquences politiques d’une telle contraction, qu’elle soit voulue ou subie, et nous avons encore moins en vue la composition de la coalition sociale qui fera le pari de ce scénario, c’est-à-dire qui acceptera de supporter les conséquences de cette contraction économique au nom d’un bien qui, lui, n’est pas quantifiable : la sécurité, la stabilité, la paix. Or c’est ce passage du quantitatif au qualitatif qui marque la sortie de l’univers économique de la calculabilité et de la prévisibilité à l’univers politique de la décision.
C’est un passage du quantitatif au qualitatif qui marque la sortie de l’univers économique de la calculabilité et de la prévisibilité à l’univers politique de la décision.
pierre charbonnier
Une bonne partie de l’effort réalisé par les économistes, ou disons plus largement du discours économique sur la crise planétaire, consiste à soutenir la faisabilité de la transition énergétique en montrant que son coût est à notre portée 20, que les bénéfices sont plus grands que les risques – surtout si ceux-ci sont mesurés et sécurisés par la puissance publique – que la majorité y gagnera, et qu’il ne s’agit pas de bouleverser le quotidien des citoyens. La stratégie est correcte. Mais si elle n’est pas encore gagnante, ce n’est pas seulement parce qu’elle est freinée par d’autres stratégies concurrentes comme celle du repli dans le déni et l’unilatéralisme, c’est aussi parce qu’elle laisse subsister le doute quant à la façon de gouverner les grandeurs négatives. L’indispensable rétrécissement de l’amplitude matérielle de nos modes de vie est généralement compris par une large partie de la population comme un rétrécissement de la liberté, des opportunités matérielles et symboliques d’émancipation. La sobriété, la soutenabilité, de ce point de vue, constitue un mur politique que l’on peut toujours essayer de contourner par des moyens idéologiques plus ou moins subtils, ou par des calculs d’intérêt, mais qui n’en est pas moins présent dans l’esprit de chacun. Que l’on le présente comme une question de « pouvoir d’achat », de « liberté de circulation », de « liberté de choix », ou toute autre expression qui encapsule le lien entre abondance et liberté, ne change rien à l’affaire : au-delà des recettes économiques inventées pour réorienter les flux de capitaux de la catastrophe vers la durabilité, il y a le problème réellement politique qui consiste à loger les aspirations de chacun dans le nouvel espace écologique disponible.
L’indispensable rétrécissement de l’amplitude matérielle de nos modes de vie est généralement compris par une large partie de la population comme un rétrécissement de la liberté, des opportunités matérielles et symboliques d’émancipation.
pierre charbonnier
La conclusion naturelle de cette observation est que le combat politique actuel doit concerner tout autant la réorganisation économique que la réorganisation des normes sociales de consommation, d’alimentation, de mobilité, de travail, d’inscription dans le groupe. Quasiment tout ce qui façonne la construction de la personne et le sentiment d’autonomie est susceptible d’être touché par cette réorientation. Le changement de dimension métabolique et énergétique de la société, dans la mesure où il touche aux rapports sociaux en général, et pas seulement aux habitudes de consommation des plus riches, concerne tout le monde : même s’il est absolument juste de vouloir faire payer les plus riches pour financer la transition, l’argent ainsi récolté sera investi dans des infrastructures et un modèle de développement qui changera la vie de tout le monde. Et tant que ce changement sera considéré comme un fardeau, il y a peu de chances que l’argument strictement économique des opportunités liées à la transition l’emporte : pour beaucoup, la sécurité apparente de l’ordre productif issu du passé offre encore plus de garanties que l’anticipation de risques considérés comme incertains et lointains.
Le défi qui consiste à réduire l’écart entre émissions réelles et engagements internationaux ne peut pas uniquement relever du design institutionnel et macro-économique. Ou plutôt : la rationalité économique en cours d’ajustement à l’anthropocène ne fait que pointer la difficulté du réencastrement socio-écologique en faisant apparaître un écart entre la définition des principes de régulation et les obstacles sociologiques réels qui s’opposent à ce qu’ils se traduisent en systèmes d’attitudes, de comportements, de normes, qui guident les choix et les représentations du collectif. Et de ce point de vue, il semble peu probable que la rationalité économique suffise à gagner la bataille politique, même si elle est évidemment une alliée essentielle.

Du calcul à la décision
L’une des principales sources de pessimisme, à ce sujet, est la dynamique intrinsèque des relations internationales. Les rapports de pouvoir militaires et géostratégiques tendent à alimenter une course à la croissance et à la sécurisation de l’approvisionnement en énergie et matières premières, et on peut estimer que plus ces relations sont mises sous pression, plus cette course s’accélère.
Il existe donc un lien organique entre l’état des relations internationales et la capacité à réorienter les modes de développement à l’échelle planétaire. Le langage de la confrontation, qui tend à faire grossir indéfiniment les arsenaux industriels et militaires des grandes puissances, rend très difficilement imaginable une tempérance globalement coordonnée des systèmes énergétiques et productifs. La conséquence est bien sûr que les pays qui sont déjà les plus riches, et donc les plus responsables de la crise climatique, aggravent le déséquilibre béant entre eux et la plupart des puissances petites et moyennes du Sud, qui elles n’ont pas à réaliser le même effort d’auto-limitation que nous. C’est là encore une preuve de l’écart qui subsiste entre la rationalité économique et politique : la détente diplomatique et commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui est absolument nécessaire à la construction de politiques planétaires, ne peut pas être le résultat d’un pur calcul économique. Elle relève de la volonté des acteurs politiques, c’est-à-dire d’une démarche orientée par la construction de la paix et de l’équilibre.
Que l’on se place au niveau des logiques sociales internes aux démocraties libérales du Nord, ou au niveau des relations internationales, on peut ainsi identifier des limites à l’approche prioritairement économique de l’enjeu planétaire. Autrement dit, nous ne sortirons pas de l’impasse climatique par la simple force du calcul et de la mobilisation des intérêts.
La composition des alliances sociales et géopolitiques qui vont être les forces motrices du changement engage aussi des éléments tels que le sentiment de peur, le sens de la responsabilité, la capacité à prendre des risques, à se défaire du poids du passé. Autant de mobiles de l’action qui débordent le cadre idéal du calcul des coûts et bénéfices, et qui ouvre de force un temps de la décision dans un espace de possibilités restreintes.
Sources
- Stefan C. Aykut et Lucile Maertens, « The climatization of global politics : introduction to the special issue », International Politics, vol. 58, no 4, 2021, p. 501-518.
- Ingolfur Blühdorn, « The legitimation crisis of democracy : emancipatory politics, the environmental state and the glass ceiling to socio-ecological transformation », Environmental Politics, 29:1, 2020, p.38-57, et Matto Mildenberger, « Carbon Captured, How Business and Labor Control Climate Politics », MIT Press, 2020.
- Pottier, Antonin, et al., « Qui émet du CO2 ? Panorama critique des inégalités écologiques en France », Revue de l’OFCE, vol. 169, no 5, 2020, p. 73-132.
- Thomas Oatley et Mark Blyth, « The Death of the Carbon Coalition », Foreign Policy, 12 février 2021.
- Voir par exemple pour l’exemple de l’Inde Chatterjee, E. (2020), « The Asian Anthropocene : Electricity and Fossil Developmentalism », The Journal of Asian Studies, 79(1), 3-24.
- Pour le cas du Brésil, voir Antoine Acker, « A Different Story in the Anthropocene : Brazil’s Postcolonial Quest for Oil (1930-1975) », Past & Present, 249(1), 2020, p.167-211, sur le Moyen-Orient, Philippe Pétriat, Aux pays de l’or noir. Une histoire arabe du pétrole, Paris, Gallimard, 2021.
- Andrea Coccia, « Contre la voiture », le Grand Continent, avril 2021.
- Voir à ce propos : Cara N. Daggett, The Birth of Energy. Fossil Fuels, Thermodynamics, and the Politics of Work, Duke University Press, 2019 ou encore Matt Huber, Lifeblood. Oil, Freedom, and the Forces of Capital, University of Minnesota Press, 2013.
- Le partage des bénéfices, expansion et inégalités en France [Travaux du Colloque organisé par le Cercle Noroit à Arras, les 12 et 13 juin 1965], Les Éditions de Minuit, 1966.
- Voir les chapitres que consacre à cet épisode Joachim Radkau dans The Age of Ecology. A Global history, Polity, 2014.
- Jessica F. Green, « Follow the Money. How Reforming Tax and Trade Rules Can Fight Climate Change », Foreign Affairs, 12 novembre 2021.
- Ève Chiapello, Antoine Missemer, Antonin Pottier, et al. (dir.), Faire l’économie de l’environnement, Paris, Presses des Mines, 2021.
- Mariana Mazzucato, Rainer Kattel et Josh Ryan-Collins, « Industrial Policy’s Comeback », Boston Review, 15 septembre 2021.
- Cédric Durand et Razmig Keucheyan, « L’heure de la planification écologique », Le Monde diplomatique, mai 2020, p.16-17 ; Maximilian Krahe, « Planifier pour répondre à l’incertitude », infra,p. 000. Pour une synthèse de ces différentes stratégies, voir Anusar Farooqui, Tim Sahay, Adam Tooze, Daniela Gabor, Robert Hockett, Saule Omarova, Yakov Feygin, « Investment and decarbonation », Phenomenal World, 18 juin 2021.
- Michel Aglietta, « Le 14ème plan quinquennal dans la nouvelle phase de la réforme chinoise », Revue GREEN : Géopolitique, Réseaux, Énergie, Environnement, Nature, Groupe d’études géopolitiques, no 1, septembre 2021.
- Stein Pedersen, Valentin Jakob, Bruno Latour et Nikolaj Schultz, « A conversation with Bruno Latour and Nikolaj Schultz : Reassembling the geo-social », Theory, Culture & Society, vol. 36, no 7-8, 2019, p. 215-230.
- Pierre Charbonnier, « Le tournant réaliste de l’écologie politique », le Grand Continent, 2020.
- Gilles Gressani, « Comprendre l’écosocialisme, une conversation avec Paul Magnette », le Grand Continent, septembre 2021.
- Pour un exposé lumineux de cette idée, voir Helen Thompson, « The geopolitical fight to come over green energy », Engelsberg Ideas, 5 mars 2021.
- Voir par exemple Adam Tooze, « Realism and NEt Zero : the EU case », 23 mars 2021. L’historien conclut son analyse de la « faisabilité » de la transition énergétique européenne par ces mots : « Investing in the clean energy transition and green modernisation may turn out to be one arena in which Europe can, in fact, offer its citizens a dynamic and promising future. »