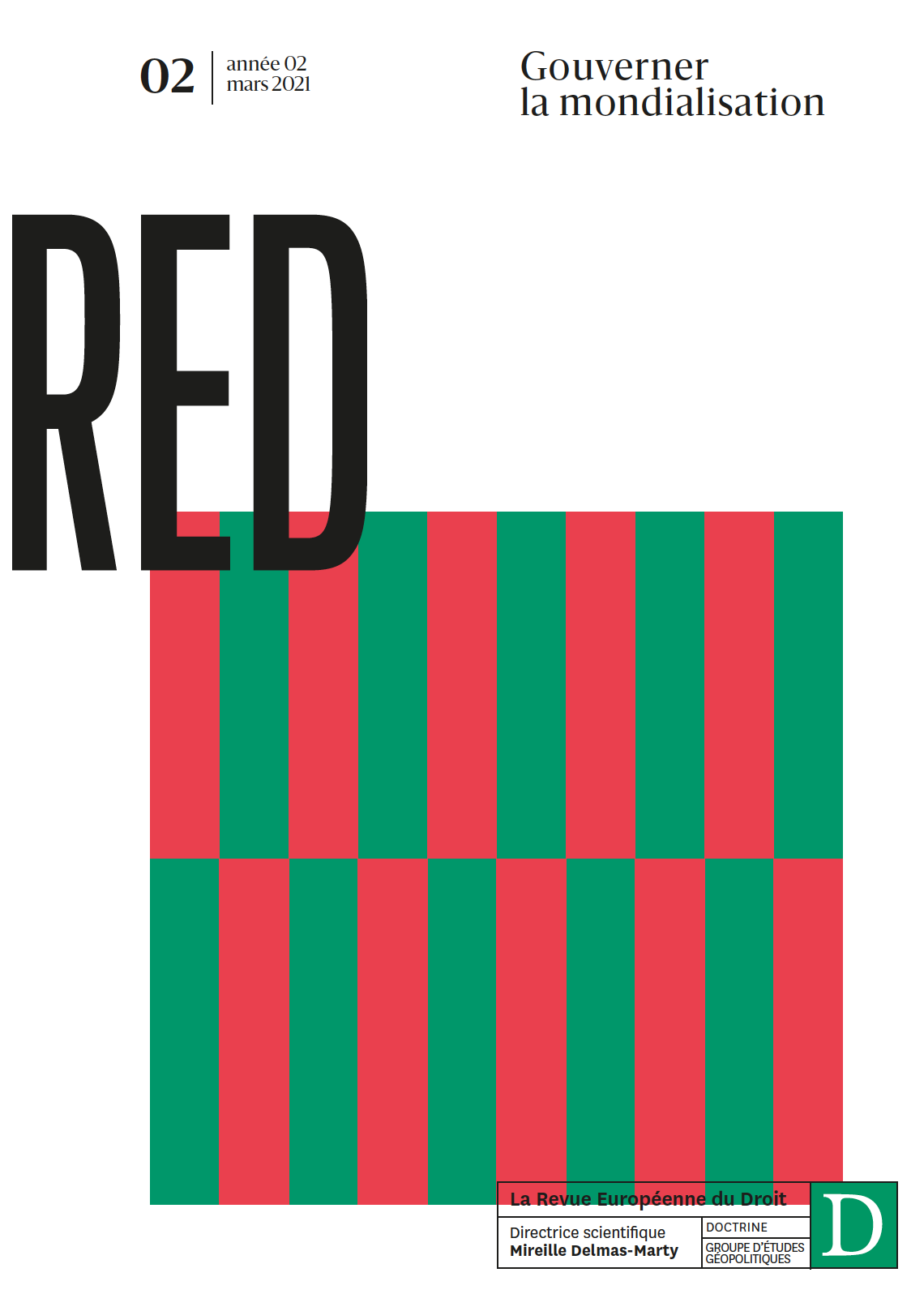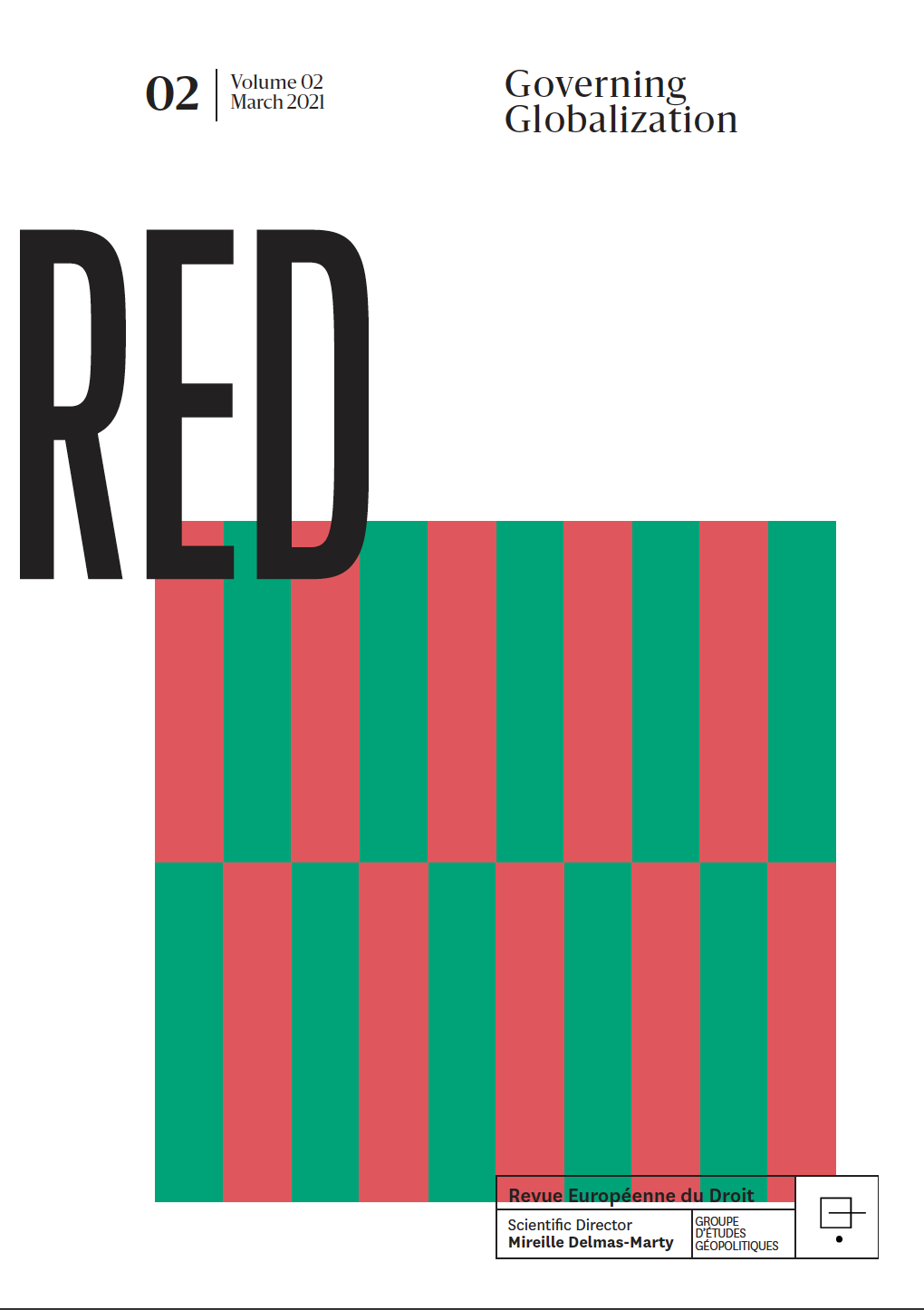Abonnez-vous à nos Lettres Restez informés des actualités du Grand Continent
Ce numéro est entièrement disponible en anglais sur le site du Groupe d’études géopolitiques.
S’interroger sur une gouvernance mondiale pourrait sembler, de prime abord, anachronique, l’heure n’étant plus guère aux grandes déclarations universalistes, ni à la globalisation des échanges, ni aux accords supranationaux, mais à la redécouverte des intérêts particuliers de l’« État-nation », au repli du chacun chez soi, voire à l’égoïsme du « Me First ». La crise – sans doute faudrait-il dire la polycrise – dans laquelle nous sommes engagés sous l’effet d’interdépendances économiques découplées des liens de solidarité, est avant tout le produit d’une certaine mondialisation, caractérisée par une fragilité structurelle héritée de transformations profondes et précipitées. Déjà s’esquisse un monde nouveau, amalgame hétérogène, instable et imprévisible, dont nul n’aurait pu anticiper les traits, les lignes de faille et les cassures. En témoignent non seulement les nouveaux protectionnismes et la crise du multilatéralisme, mais encore la multiplication des modèles politiques, sociaux et économiques alternatifs mais parfois incompatibles entre eux.
Ainsi se multiplient, sans prétendre à l’exhaustivité, les défis globaux, qu’ils soient liés aux pandémies vécues et annoncées, aux crises migratoires actuelles et futures, à la lutte contre les crimes contre l’humanité, aux crises financières et sociales, à l’évasion fiscale, sans oublier, avec la puissance du numérique, l’ambivalence des nouvelles technologies. Un tel ensemble, transformant l’humanité en une force capable de menacer son propre avenir, crée, de fait, une communauté (involontaire) de destin. Qu’on le veuille ou non, ces nouveaux défis appellent une concertation globale et, sans doute, une rupture avec les réflexes nationalistes et une redéfinition d’un régime de coexistence des communautés. Plutôt qu’une négation de ces réalités, la polycrise actuelle est l’occasion d’interroger, avant un nouveau départ, les concepts qui sous-tendent cette imperturbable course.
Encore faut-il prendre conscience de l’inadaptation croissante de la pensée juridique traditionnelle. À défaut d’une véritable idéologie commune qui ordonnerait les multiples espaces normatifs, disparates et parcellaires, nos sociétés semblent encore à la recherche du récit juridique, censé les refléter et / ou les apprivoiser, qui éviterait la double menace du « grand effondrement » et du « grand asservissement ».
Loin de se limiter à une globalisation des échanges économiques, la mondialisation appelle une redéfinition du régime de coexistence de communautés politiques hétérogènes, où le repère normatif (le « pôle Nord ») ne peut plus émerger dans les foyers historiques de valeurs communes. Au temps des communautés nationales, faites de mémoires et oublis partagés, les accords et les désaccords collectifs semblaient façonner les règles de droit et structurer les cadres politiques, stabilisés par des valeurs et des intérêts partagés, fussent-ils évolutifs et imposés. Or, devenues éphémères, ces « boussoles nationales » disparaissent l’une après l’autre sous le coup des forces corrosives de la mondialisation, incapables de relever les défis communs à l’humanité entière. Sans boussole, l’humanité voyage comme un bateau ivre, portée aux quatre vents du monde dans la nostalgie d’une mémoire disparue et de valeurs communes inexistantes. Où trouver alors les outils d’une telle recomposition et comment réinventer avec les divers acteurs une forme de gouvernance mondiale ?
Certes, les réflexions autour d’un droit « global » ne sont pas inédites. On les voit à l’œuvre dans les théories cherchant à construire un constitutionnalisme global, un droit administratif global, ou encore un ordre juridique transnational privé non-étatique. Si ces efforts, multiples et divers, peinent à aboutir, c’est parce qu’ils témoignent des tensions inhérentes, voire de l’irrationalité de toute tentative de trouver un appui dans des catégories bien ordonnées, issues d’histoires et mémoires idiosyncratiques, pour comprendre et agir dans un monde foncièrement désordonné, interactif, instable, non hiérarchisé.
Autrement dit, la complexité de défis inédits, ainsi que la diversité des modes de vie et d’intérêts en présence, rendent les transplantations juridiques, ou les extrapolations au niveau global des solutions nationales, inefficaces et, surtout, inopportunes.
Entre l’ordre hégémonique de cette monarchie universelle que Kant nommait « despotisme », et le grand désordre d’un monde non seulement divisé mais éclaté, les deux écueils de la mondialisation obligent à penser un universalisme contextualisé, où la raison juridique n’offrirait pas des solutions prêtes-à-porter, mais bien plutôt des outils de délibération et de fécondation réciproque (cross fertilization) capables de fonder l’unité dans la pluralité. Autrement dit, à défaut d’une impossible identité entre des systèmes normatifs nationaux unifiés, une véritable gouvernance mondiale des biens communs, si elle est possible, ne peut être que plurielle et instable, hybride et flexible.
À y regarder de plus près, cet appel à la mise en place d’une gouvernance plurielle n’est que le reflet d’une pratique courante, celle du « bricolage » juridique des acteurs de la mondialisation, c’est-à-dire la tentative de « globaliser » les ordres juridiques nationaux en les rapprochant sans les confondre, et de « contextualiser » les normes internationales en les adaptant aux réalités locales ; au catégorique, le bricoleur substitue le proportionnel, à l’intégration verticale il oppose la concertation horizontale, à l’identique il préfère le semblable. Ses incarnations en sont multiples.
Il s’agit, au fond, d’un effort de tolérance mutuelle apparent, par exemple en droit international privé, dont l’exercice de qualification et de reconnaissance repose sur une identification de la proximité des institutions dans la diversité de leurs manifestations, à condition toutefois que son résultat ne heurte pas les principes fondamentaux (ou l’ordre public international) du « reconnaissant », autrement dit que ce dernier puisse accueillir dans son ordre une solution différente sans nier par là même sa propre essence.
Il s’agit aussi de méthodes utilisées dans la mise en œuvre des instruments internationaux lorsque toute uniformisation est inenvisageable, telle la méthode dite « d’équivalence fonctionnelle », issue d’un mélange fécond de réalisme juridique et de fonctionnalisme systémique. Lorsque l’OCDE a pris l’initiative d’une Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers, ses rédacteurs, conscients des divergences profondes entre les cultures juridiques en matière pénale des États membres, se sont contentés de définir un système de principes de base et se sont tournés vers cette notion d’équivalence fonctionnelle afin d’aménager une marge d’adaptation nationale, et ce sans exiger l’uniformité et sans heurter des principes fondamentaux des systèmes juridiques des États membres, par exemple s’agissant des formes de responsabilité pénale des personnes morales.
Dans ce contexte, l’équivalence entre les mesures nationales est tout à la fois une méthode et un objectif, dont le succès dépend des méthodes de suivi et contrôle des mesures nationales, telles qu’elles sont écrites et telles qu’elles sont appliquées en pratique.
Il en est de même, en matière de droits de l’homme, de la « marge nationale d’appréciation », à l’origine absente de la Convention EDH mais très tôt dégagée par le juge européen dans des affaires où des mesures restrictives, voire dérogatoires, sont admises par la convention au nom de l’ordre public national : les juges tiennent compte du contexte (culturel, social, économique…) de chaque État afin d’assouplir les exigences d’une application uniforme et de préserver ainsi le principe de subsidiarité.
Ces exemples démontrent qu’harmoniser les différences (de façon ascendante, du niveau local au niveau global) et contextualiser l’universel (de façon descendante, en le diversifiant du global au local) ne signifie nullement l’abandon de toute rationalité axiologique. La gouvernance plurielle repose, d’abord, sur un ensemble de principes directeurs dont le respect est nécessaire pour qu’il soit possible d‘évaluer la proximité dans la diversité.
On trouve les traces d’une telle recherche dans la longue (mais quelque peu méconnue) tradition du ius gentium de l’antiquité romaine, reflet des exigences de la raison naturelle, soit des besoins communs à tous les humains en tant qu’êtres doués d’entendement. La tradition s’est prolongée au Moyen Âge à travers le ius commune, fruit d’une hybridation du droit romain, du droit canon et de lex mercatoria, appliqué comme méthode de raisonnement et guide d’interprétation des variations locales diversifiées et complexes.
Aujourd’hui, de nouvelles valeurs communes peuvent être pensées à travers l’intégration dynamique, en spirale, des différentes visions de l’humanisme : l’humanisme émancipé des Lumières, suggérant l’égale dignité des êtres humains, mais aussi l’humanisme relationnel, qui évoque l’humain dans ses relations de proximité et d’hospitalité, ainsi que l’humanisme émergent des interdépendances, qui reconnaît que l’humain appartient à la nature et n’en est pas maître, ajoutant à l’exigence de solidarité sociale celle d’une solidarité écologique face aux nouvelles capacités de nuisance de l’humanité. S’ajoutent à ces valeurs fondatrices celles qui découlent, comme le montrent des constitutionnalistes contemporains, de l’hybridation et de l’enrichissement mutuel et graduel d’identités juridiques organisées dans un réseau non hiérarchisé, un exercice de rapprochement par la fréquentation et la compréhension réciproque, la délibération, l’échange, l’accord et le désaccord.
Ce dernier point nous amène à l’exigence d’une gouvernance plurielle où la validité formelle, qui accompagne la définition de normes de rationalité délibérative communes, se combine à la validité axiologique qui admet des différences, à condition qu’elles soient compatibles entre elles. Cela implique un effort d’intégration et d’adaptation, et non le rejet ab initio des valeurs proposées. Cela implique également des exigences procédurales, visant à rendre la décision finale, dont elles ne préjugent pas, rationnellement acceptable : représentation équitable des parties, transparence dans la motivation des décisions, rigueur et cohérence dans l’usage des méthodes de pondération ; ainsi que, dans les domaines qui s’y prêtent, le respect des données scientifiques quand elles sont fiables.
Telles sont les conditions de possibilité d’une délibération rationnelle, qui substitue la contextualisation à l’uniformité et la compatibilité à la conformité pure et simple sans tomber dans l’arbitraire, grâce à un formalisme revisité par les logiques non standards, telles que les fuzzy logics (logiques floues) ou la topologie (logique des voisinages).
C’est en ce sens qu’une gouvernance plurielle permettrait l’émergence d’un récit de l’humanité comme une aventure commune, à la recherche d’un « équilibre dynamique » permettant de stabiliser les sociétés dans leurs rapports réciproques sans les figer dans leurs différences. En somme, de pacifier les humains sans les uniformiser. A cet égard, la construction de l’Europe est sans doute l’un des plus ambitieux des laboratoires d’observation et d’essai dont nous disposons pour construire des solidarités communes. C’est parce que l’Europe est floue qu’elle réussira peut-être à mettre en place un pluralisme ordonné. Valorisant par emprunts réciproques le meilleur de chaque tradition nationale (le statut du procureur européen en est un exemple), l’Europe souveraine inventerait ainsi un ordre souverain qui ne soit ni autoritaire ni uniforme, mais démocratique et pluraliste.
Utopie d’autant plus réalisable que l’Union européenne tente aussi d’inventer une autre façon de gouverner par le droit, non seulement en séparant les pouvoirs, mais en agrégeant les niveaux d’organisation (étatiques, infra et supra étatiques) et les catégories d’acteurs (publics et privés comme les ETN, ainsi que les acteurs civiques et scientifiques), dans une gouvernance encore régionale, mais substituant déjà des relations interactives et évolutives, donc complexes, aux relations hiérarchiques et stables de l’État-nation. C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’idée de « souveraineté » européenne : si la constitution d’une Europe « souveraine, unie et démocratique » permet de redonner au politique sa « capacité d’action » dans le contexte de la mondialisation, c’est parce qu’elle marque le passage d’une souveraineté solitaire, protégée mais aussi enfermée dans ses frontières, à une souveraineté solidaire, ouverte et augmentée, qui viserait à protéger, par-delà les seuls intérêts nationaux, de véritables biens communs mondiaux.
Méthodes
- Luis Arroyo Zapatero, Quelle méthode pour une harmonisation pénale ?
- Pavlos Eleftheriadis, Raison naturelle et fondements éthiques du droit européen
- Vincent Forray et Sébastien Pimont, Gouverner la mondialisation par le droit : l’hypothèse d’un nouveau droit naturel
- Astrid Mignon Colombet et Nicola Bonucci, Vers une gouvernance plurielle : l’équivalence fonctionnelle dans la lutte contre la corruption transnationale
- Jean-Marc Sorel, Le rôle de la soft law dans la gouvernance mondiale : vers une emprise hégémonique ?
- Christiane Taubira, Monde, mondialisation et mondialité
Acteurs
- Stephen Breyer, La Cour Suprême des États-Unis : pouvoir et contre-pouvoir
- David Djaïz, Une nouvelle architecture pour la mondialisation
- Bernard Hoekman et Petros Mavroïdis, Éviter un requiem pour l’OMC
- Dominique Rousseau, Pour une gouvernance mondiale démocratique
- Bernard Stirn, Participer à la gouvernance de la mondialisation par le droit : de nouveaux horizons pour les cours suprêmes nationales
Défis
- Yann Aguila et Marie-Cécile de Bellis, Un Martien aux Nations Unies ou réflexions naïves sur la gouvernance mondiale de l’environnement
- Edith Brown Weiss et Vicki Arroyo, La nécessité d’une approche ascendante pour la lutte contre le réchauffement climatique dans un monde kaléidoscopique
- Guy Canivet, Régulation par le marché et développement durable
- Laurent Cohen-Tanugi, Le droit est plus que jamais le langage nécessaire de la mondialisation
- Thierry de Montbrial, La gouvernance des biens communs comme levier politique
- Jorge Viñuales, Géopolitique de la transition énergétique
Ouverture
- Olivier Abel et Mireille Delmas-Marty, Une spirale des humanismes