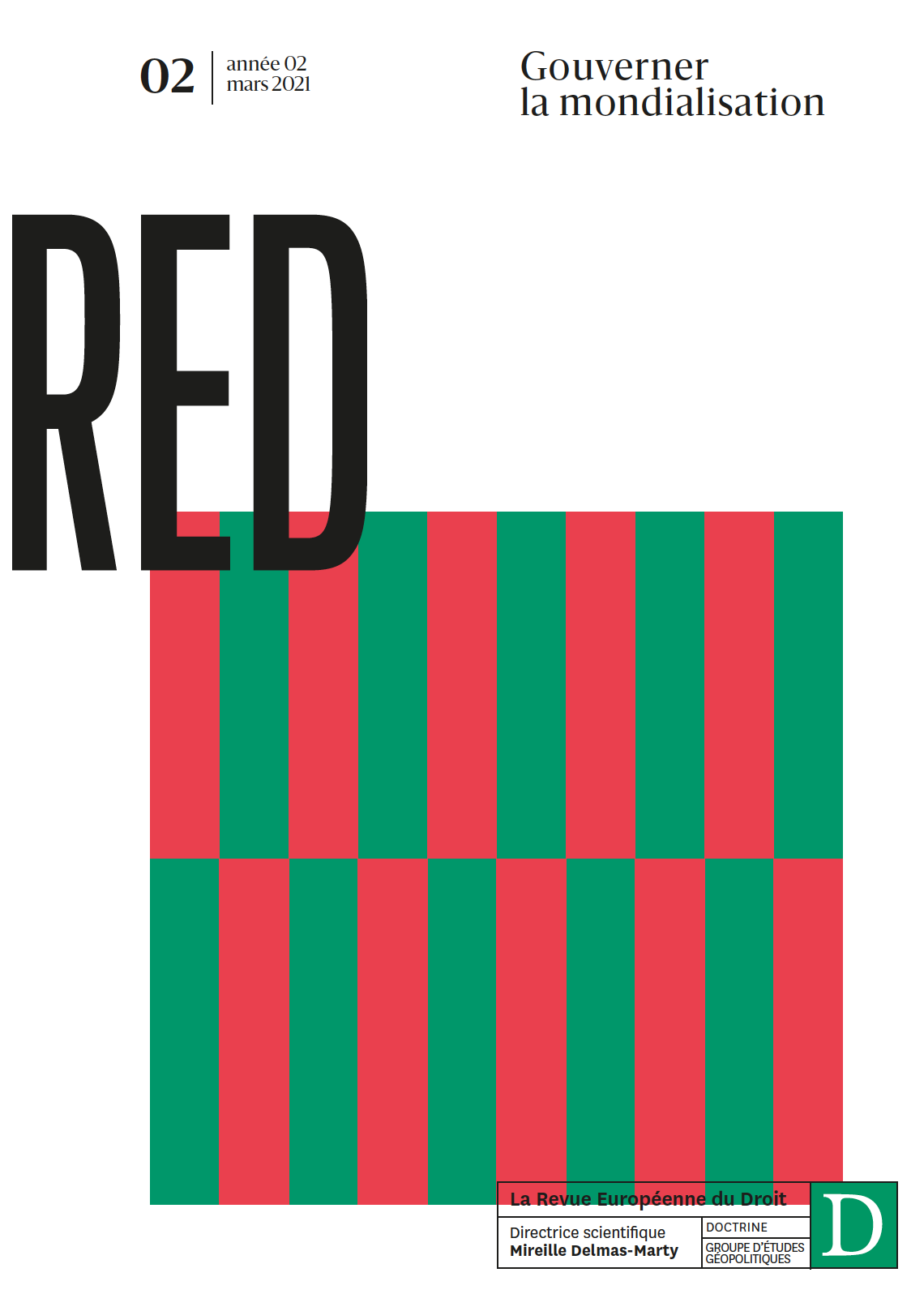Abonnez-vous à nos Lettres Restez informés des actualités du Grand Continent
Cette pièce de doctrine est disponible en version anglaise sur le site du Groupe d’études géopolitiques.
Il y a quelques années, la Présidente de la Cour suprême du Ghana est venue visiter la Cour suprême des États-Unis. Elle voulait savoir comment la Cour avait fait progresser et protégé les droits civiques en Amérique1. Elle semblait particulièrement intéressée par cette question : pourquoi le public américain fait-il ce que dit la Cour suprême ? Implicitement, elle voulait aussi savoir pourquoi, ou comment, la Cour pouvait agir comme un contre-pouvoir, en cas de désaccord sérieux. Cette question reste importante.
En termes abstraits, le pouvoir de la Cour suprême, comme celui de tout tribunal, doit dépendre de la volonté des citoyens de respecter ses décisions, même celles avec lesquelles ils ne sont pas d’accord et même lorsqu’ils estiment qu’une décision est gravement erronée. L’importance de ce respect est d’autant plus grande lorsqu’une décision de la Cour est fortement en contradiction avec les opinions des autres pouvoirs, et notamment du pouvoir exécutif.
Dans cet article, je m’attacherai à mettre en évidence l’importance de l’acceptation du public pour la sauvegarde du rôle du pouvoir judiciaire. Dans une première partie, je présenterai plusieurs exemples illustrant l’augmentation de l’acceptation par le public des décisions de la Cour, et donc un accroissement de son pouvoir. La deuxième et la troisième partie aborderont plus directement le pouvoir connexe de la Cour d’agir comme un contre-pouvoir sur les autres. Je décrirai enfin certaines difficultés connexes et potentielles qui pourraient survenir à l’avenir et quelques mesures que la Cour et le public pourraient prendre pour aider à les surmonter.
1. Un pouvoir
Comment se fait-il que certaines personnes suivent les suggestions, les réflexions, voire les ordres des autres ? Il y a longtemps, Cicéron a décrit une réponse à cette question centrale sur le pouvoir. Il pensait qu’il y avait trois façons possibles d’assurer l’obéissance de ceux qui vivent dans un État : 1) la peur du châtiment ; 2) l’espoir de récompenses ou d’avantages particuliers ; et 3) la justice. Cette dernière voie, la justice, permettrait de convaincre les gens que ceux qui gouvernent méritent l’obéissance. Que le point de vue de Cicéron s’applique ou non en général au gouvernement, il s’applique à la Cour suprême des États-Unis. Le pouvoir de la Cour de punir ou de fournir des récompenses (ou des avantages) est limité. Son pouvoir d’agir avec justice, du moins à mon avis, joue un rôle majeur pour obtenir le respect du public et son obéissance conséquente. L’histoire de la Cour illustre bien ce fait. Quelques exemples aideront à étayer ce point de vue.
En examinant ces exemples, il est important de garder à l’esprit la manière dont la loi confère à la Cour, au moins, un pouvoir juridique. Ce pouvoir trouve sa source principale dans la Constitution américaine ainsi que dans les opinions de ceux qui l’ont rédigée. La Constitution est un document succinct. Elle comporte sept articles et vingt-sept amendements. Elle crée une démocratie fédérale représentative, une séparation des pouvoirs gouvernementaux tant horizontalement (législatif, exécutif, judiciaire) que verticalement (État fédéral/États fédérés), un respect égal devant la loi, la protection des droits fondamentaux et la garantie de l’État de droit. Les rédacteurs de la Constitution avaient tout à fait le droit d’admirer leur création. Mais, comme Hamilton l’a souligné dans The Federalist n° 78, une branche du gouvernement doit avoir le pouvoir de s’assurer que les autres branches agissent dans les limites fixées par la Constitution. Sinon, le document n’aura que peu d’effet ; les Pères fondateurs auraient tout aussi bien pu l’accrocher aux murs d’un musée.
le pouvoir de la Cour suprême, comme celui de tout tribunal, doit dépendre de la volonté des citoyens de respecter ses décisions, même celles avec lesquelles ils ne sont pas d’accord et même lorsqu’ils estiment qu’une décision est gravement erronée.
Stephen Breyer
Quelle branche aura le pouvoir de déterminer quelles limites la Constitution fixe et quand les autres branches les dépassent ? Le pouvoir exécutif, à savoir le Président ? N’y a-t-il pas un risque que le Président décide simplement que toute action qu’il entreprend est conforme à la Constitution ? Qu’en est-il du Congrès ? Ses membres sont élus ; ils comprennent probablement la popularité. Mais que se passera-t-il si, par exemple, un accusé ou d’autres personnes bénéficiant de protections constitutionnelles ne sont pas populaires ? La Constitution, voire la loi en général, s’applique à ceux qui ne sont pas populaires tout comme elle s’applique à ceux qui sont populaires. Peut-on faire confiance au Congrès pour protéger ce dernier groupe, impopulaire ?
Reste la troisième branche, le pouvoir judiciaire. « Parfait ! », aurait pu penser Hamilton. Les juges comprennent le droit. Il est peu probable qu’ils deviennent trop puissants, car ils n’ont ni la bourse ni l’épée. C’est pourquoi le pouvoir judiciaire et la Cour suprême en particulier devraient avoir le dernier mot. La majorité des autres Pères fondateurs sont d’accord avec Hamilton. Et son point de vue était essentiellement celui que John Marshall et la Cour suprême ont adopté dans la célèbre affaire, Marbury v. Madison de 1803.
Cependant, la lettre de la Constitution et les intentions des fondateurs ne sont qu’en partie la source du pouvoir de la Cour Suprême ; seulement en partie parce que ni Hamilton, ni les autres, ne pourraient répondre à cette question critique posée par Hotspur dans le Henri IV de Shakespeare. Owen Glendower, un commandeur des Galles et un mystique, dit : « Je peux appeler les démons de la profondeur de la mer. » « Moi aussi » réplique Hotspur, « et d’ailleurs n’importe qui le peut, mais est-ce qu’ils viennent quand vous les appelez ? »
Cependant, la lettre de la Constitution et les intentions des fondateurs ne sont qu’en partie la source du pouvoir de la Cour Suprême : seulement en partie parce que ni Hamilton, ni les autres, ne pourraient répondre à cette question critique posée par Hotspur dans Henri IV de Shakespeare. Owen Glendower, un commandeur des Galles et un mystique, dit : « Je peux appeler les démons de la profondeur de la mer. » « Moi aussi » réplique Hotspur, « et d’ailleurs n’importe qui le peut, mais est-ce qu’ils viennent quand vous les appelez ? »
Stephen Breyer
1.A. Le manque de pouvoir
Vu la faiblesse matérielle des tribunaux, il n’est pas surprenant d’apprendre que lors d’une des premières grandes confrontations entre le Président et la Cour, c’est cette dernière qui a perdu. Une tribu d’Indiens, les Cherokees, habitaient une terre, garantie par traité, au nord de la Géorgie. En 1829, on y trouva de l’or, les Georgiens qui la convoitaient, ont pris le contrôle de la terre des Indiens. Les Cherokees et leurs soutiens ont trouvé un excellent avocat, Willard Wirt, qui a engagé des poursuites judiciaires qui se sont terminées devant la Cour Suprême, qui a tranché l’affaire.
La Cour Suprême jugea que la terre appartenait aux Cherokees et que l’État de Géorgie n’avait pas d’autorité sur cette terre. Mais la Géorgie a simplement ignoré la décision de la Cour. Et qu’a fait, Andrew Jackson, le Président des États-Unis ? Rien. Non, pire que cela. Apparemment il aurait dit, « John Marshall a pris sa décision ; laissons-le maintenant l’appliquer ». Jackson (et son successeur) a ensuite envoyé des troupes fédérales en Géorgie, mais pas pour faire appliquer le jugement de la Cour. Il a plutôt envoyé des troupes pour éliminer les Cherokees, forçant beaucoup d’entre eux à parcourir la « Piste des larmes » jusqu’en Oklahoma, où leurs descendants vivent encore aujourd’hui.
Quelle est donc la portée du pouvoir de la Cour suprême ? Et est-ce que les juges de la Cour elle-même avaient confiance en son pouvoir ?
En 1903, le juge Oliver Wendell Holmes, Jr. a résumé le problème dans une décision qui refusait en fait de faire appliquer la garantie du Quinzième Amendement selon laquelle les anciens esclaves pouvaient voter. Comment Holmes a-t-il pu faire cela ? Il écrit que la Cour a « peu de pouvoir en pratique de commander la masse des gens d’un État ». On dit que « l’immense majorité de la population blanche veut empêcher les noirs de voter » et si c’est exact, une décision ordonnant le contraire serait une « coquille vide ». Le soin de redresser un grand mal politique doit être confié aux législateurs et au pouvoir exécutif et non à la justice.
Où est donc le pouvoir judiciaire ?
1.B. L’affirmation du pouvoir
Passons maintenant à l’année 1954. Cette année-là, la Cour a estimé que la ségrégation raciale, largement pratiquée dans le Sud, violait la garantie du Quatorzième amendement selon laquelle la loi doit assurer à chaque « personne (…) une protection égale ». Sa décision, Brown v. Board of Education, semble bien fondée. Mais que s’est-il réellement passé ensuite, disons en 1955 ? Pratiquement rien. Et en 1956 ? Presque rien encore. Le Congrès n’a rien fait, le Président n’a pas levé le petit doigt, et le Sud ne s’est que très peu conformé à l’arrêt de la Cour.
Mais en 1957, un juge de première instance, à Little Rock, Arkansas, suivant la décision rendue par la Cour suprême, a ordonné à l’État d’inscrire neuf élèves noirs à Little Rock Central High School, une école entièrement blanche. Quand le jour de la rentrée est arrivé, au mois de septembre 1957, une grande foule hostile à l’intégration entourait l’école, le gouverneur de l’État a déclaré qu’il opposerait à l’intégration, et il a envoyé les policiers de l’État d’Arkansas pour empêcher que ces neufs élèves noirs ne rentrent dans l’école. Cette situation de blocage persista plusieurs jours. Toute la presse du monde était là. Que ferait le Président des États-Unis ?
Le gouverneur de la Caroline du Sud lui conseilla de ne rien faire. Il lui dit, « si vous envoyez les soldats à Little Rock, M. le Président, vous devez vous préparer à une espèce de guerre, il faudra réoccuper tout le Sud ou, au mieux, le Sud fermera toutes les écoles. » Mais l’Attorney General était d’un avis opposé ; il estimait qu’il fallait envoyer l’armée pour que force reste à la loi. Le Président a décidé d’envoyer 1.000 parachutistes de la 101e Airborne Division, que les français connaissent bien car ce sont les héros de la libération de la Normandie et de la bataille des Ardennes ; les parachutistes ont pris ces étudiants noirs par la main et sont rentrés avec eux à l’école. Alors, la Cour avait gagné ? Oui, mais avec la coopération du Président des États-Unis.
Et l’histoire ne s’arrêta pas là. Après quelques mois, les soldats fédéraux ont quitté Little Rock, et les autorités locales ont voulu renforcer encore la ségrégation raciale. Une autre affaire contre ces autorités, Cooper v. Aaron, arriva à la Cour suprême. La Cour rejeta les arguments des autorités locales et ordonna l’intégration immédiate. Mais une fois de plus, les autorités ne bougèrent pas ou, plus exactement, elles bougèrent mais dans le mauvais sens, en fermant toutes les écoles pour quelques mois : plus personne, ni noir, ni blanc, ne pouvait y rentrer. Mais cette situation ne pouvait pas durer. C’était à l’époque de Martin Luther King, des « freedom riders » et des « bus boycotts ». C’est en effet à ce moment-là que ces grands mouvements contre la ségrégation ont commencé. Tout le pays se passionna pour cette situation et, finalement, la ségrégation légale cessa dans le Sud en quelques années.
Un jour, j’ai demandé à Vernon Jordan, un grand défenseur des droits civiques, si la Cour avait réellement joué un rôle majeur dans la fin de la ségrégation. Après tout, même en l’absence de la Cour, n’y aurait-il pas eu une pression énorme pour mettre fin à ce système, de la part des leaders des droits civiques, du reste du pays, voire du monde entier ? Il a répondu qu’évidemment, la Cour avait joué un rôle crucial. Le Congrès, après tout, n’a rien fait. Au moins, la Cour a servi de catalyseur. Avec l’aide d’autres, elle a réussi à démanteler un pilier important, sinon du racisme, du moins de la face juridique du racisme. La Cour a joué, non pas le seul rôle, mais un rôle essentiel pour mettre fin à la ségrégation juridique. Avec l’aide du Président, des responsables des droits civiques et d’un grand nombre de citoyens ordinaires, la Cour a remporté une grande victoire pour le droit, pour l’égalité des citoyens et surtout pour la justice. Il ne m’est pas possible de démontrer que les décisions rendues en matière de ségrégation raciale ont incité le peuple à respecter les décisions de la Cour. Mais (peut-être avec Cicéron) je le crois.
Avec l’aide du Président, des responsables des droits civiques et d’un grand nombre de citoyens ordinaires, la Cour a remporté une grande victoire pour le droit, pour l’égalité des citoyens et surtout pour la justice. Il ne m’est pas possible de démontrer que les décisions rendues en matière de ségrégation raciale ont incité le peuple à respecter les décisions de la Cour. Mais je le crois.
Stephen Breyer
1.C. Une atmosphère de respect
L’autre exemple que je vais développer est celui de la décision Bush v. Gore rendue en 2000. Cette décision (rendue à cinq voix contre quatre) a déterminé qui était le Président des États-Unis. C’était évidemment une décision importante qui concernait chaque personne aux États-Unis. Je ne faisais pas partie de la majorité et j’ai rédigé une opinion dissidente. Mais comme a dit le Président du Senat (un Démocrate qui estimait également que la Cour s’était trompée), la chose la plus remarquable dans cette décision – et qui n’a pas souvent été relevée – était que, malgré son importance, malgré le fait que la majorité s’était fourvoyée, le peuple des États-Unis a néanmoins suivi cette décision sans protester, sans grandes manifestations ou émeutes. Et le candidat perdant, Al Gore, a dit à ses partisans : « Don’t trash the Court » c’est-à-dire « Ne maudissez pas la Cour ».
Cela suggère que le fait de s’incliner devant les décisions de la Cour est devenu une habitude parmi les citoyens des États-Unis. Ils trouvent cela normal. Tellement normal qu’ils ne s’en rendent même plus compte.
Vous avez donc un aperçu du pouvoir de la Cour, passons au rôle de contre-pouvoir de la Cour.
2. Un contre-pouvoir
Par « contre-pouvoir », j’entends les relations de la Cour avec les deux autres branches politiques que sont le Congrès et le Président. Je me concentrerai plus particulièrement sur le Président et ses ministres. Pour mieux comprendre ce sujet et se rendre compte des tensions potentielles entre ces trois branches, il faut se souvenir des matières qui sont soumises à la Cour.
2.A. L’interprétation des termes de la loi
Premièrement, la majorité des questions tranchées par la Cour suprême concerne l’interprétation des termes de la loi. Par exemple : est-ce que les « frais » incluent la rémunération des experts de la partie gagnante ? Il y a bien sûr de temps à temps des divergences d’opinion entre les juges de la Cour sur l’interprétation d’une loi. Ces différences ne sont pas de nature politique mais relèvent plutôt des conceptions du rôle de la jurisprudence, des différences en méthodes d’interprétation. Dans une affaire où le texte n’est pas clair, de telles différences d’écoles jurisprudentielles peuvent conduire à une différence de résultat.
A peu près tous les juges utilisent les mêmes outils d’interprétation : ils considèrent le texte, l’histoire, la tradition, les précédents, les objectifs de la loi (ou les valeurs qu’elle protège) et les conséquences pertinentes. Et chaque juge utilise tous ces outils. Certains juges accordent une place prééminente au texte et à l’histoire. D’autres adoptent plutôt une méthode plus téléologique en se concentrant sur les objectifs et les conséquences. Il existe également des différences à l’intérieur de ces deux grandes sensibilités – des divergences par exemple sur l’objectif d’une même disposition de loi. Quoi qu’il en soit, ces divergences qui encore une fois peuvent conduire à des résultats différents ont peu d’impact sur les relations entre la Cour et le Président. Non que ces interprétations n’importent pas aux yeux du Président mais s’il n’est pas d’accord, il peut toujours proposer une nouvelle loi. Il faut garder cela à l’esprit avant d’aborder les conflits possibles entre le pouvoir exécutif et le judiciaire.
En d’autres termes, un conflit politique peut toujours être résolu par les branches politiques alors que la Cour ne le peut pas. Ce n’est pas aussi simple car certaines lois sont de fait très difficiles à changer (comme les lois sur la discrimination). Les conflits sont donc moins graves dans ce cas de figure, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en ait pas. Cependant, les désaccords sur la signification des mots dans une loi deviennent souvent (après la décision de la Cour) une question politique que les branches politiques (et non la Cour) doivent résoudre.
2.B. L’examen des règlements promulgués par le pouvoir exécutif
Une deuxième catégorie d’affaires concerne l’examen des règlements promulgués par le pouvoir exécutif. Nous devons se demander, par exemple, si les procédures ont été respectées, si les citoyens ont été régulièrement consultés et si leurs observations ont été prises en compte ; ou si les explications du pouvoir exécutif ont été convaincantes. Si la Cour déclare inconstitutionnelle un acte administratif pris par le Président, cela ne suscite pas de crise majeure avec l’exécutif car ce dernier peut toujours prendre une nouvelle mesure corrigeant son irrégularité.
La Cour, par exemple, a récemment jugé illégales deux décisions du pouvoir exécutif, l’une concernant le recensement (posant la question de la citoyenneté) et l’autre abolissant un programme qui permettait à certaines jeunes qui n’avaient pas la nationalité américaine de rester aux États-Unis. L’exécutif a perdu les deux affaires devant la Cour suprême. Il lui restait néanmoins la possibilité de décider à nouveau s’il devait prendre ces mesures administratives, ou des mesures similaires, cette fois-ci en suivant légalement les procédures administratives requises. Ainsi, un grave désaccord entre la Cour et le Président est atténué.
2.C. Les « décisions constitutionnelles »
Un conflit sérieux entre la Cour et le Président est plus susceptible de se produire lorsque la Cour prend une décision constitutionnelle, par exemple lorsqu’elle applique aux actions présidentielles les limitations constitutionnelles qui accompagnent les mots très généraux de la Constitution, tels que « liberté d’expression » ou « liberté de la presse », ou simplement « liberté ».
Quand les conceptions divergent, c’est de facto celle de la Cour qui prime car on voit mal le Président ou le Congrès prétendre changer cette interprétation. Le risque de conflit ouvert entre la Cour et l’administration (au sens américain du terme) est cependant réduit quand (comme c’est souvent le cas) la question constitutionnelle qui nous est posée est moins de savoir si le gouvernement peut faire quelque chose, que qui dans le gouvernement peut le faire (par exemple, des États ou le gouvernement fédéral ; le Président ou le Congrès). D’autant que la Constitution ne dit pas aux citoyens ce qu’ils doivent faire mais elle pose des limites à ce que le gouvernement peut faire. Et nous, les juges, sommes les gardiens de la frontière constitutionnelle.
Il n’empêche que, malgré tous ces préalables, de graves désaccords constitutionnels peuvent survenir entre la Cour et le Président sur des sujets essentiels. Et notamment sur le maintien des libertés constitutionnelles en temps de guerre. Une fois encore, je partirai de cette citation de Cicéron : « inter arma enim silent leges », « Lorsque les armes parlent, le droit se tait ». Ce qu’a confirmé lors de la Seconde Guerre mondiale l’Attorney General du Président Roosevelt, Francis Biddle : « La Constitution n’a pas beaucoup gêné les présidents en temps de guerre » (du moins pas à l’époque). Ces mots impliquent de sérieuses limitations au pouvoir de protection de la Cour en temps de guerre.
Le risque de conflit ouvert entre la Cour et l’administration (au sens américain du terme) est réduit quand (comme c’est souvent le cas) la question constitutionnelle qui nous est posée est moins de savoir si le gouvernement peut faire quelque chose, que qui dans le gouvernement peut le faire (par exemple, des États ou le gouvernement fédéral.
Stephen Breyer
Par exemple, pendant la Deuxième Guerre Mondiale, la Cour Suprême a estimé que n’était pas contraire à la Constitution l’ordre du Président Roosevelt de déporter 70.000 citoyens américains d’origine Japonaise, de la côte Ouest plus vers l’intérieur du pays, dans des camps où ils étaient comme en prison. Dans cette affaire, Justice Black aurait apparemment dit aux autres lors du délibéré : « quelqu’un doit diriger cette guerre, Roosevelt ou nous. Et nous, nous ne pouvons le faire ».
Un tel refus de s’immiscer dans les affaires politiques de haute importance, y compris en temps de guerre, est aujourd’hui battu en brèche. Ce silence choisi et assumé par la Cour a cessé. Quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lors de la guerre de Corée, le Président Truman a voulu contrôler des usines d’acier dont les propriétaires étaient des personnes privées. La Cour a estimé au contraire que cette décision du Président, même dans ces circonstances, était contraire à la Constitution, et le Président s’est incliné. On répliquera que le Président Truman était beaucoup moins populaire que Président Roosevelt et que la guerre de Corée n’était pas la Deuxième Guerre mondiale. Certes, mais il n’empêche que la Cour a démenti Cicéron en montrant qu’elle pouvait agir comme contre-pouvoir, même en temps de guerre.
Ce chemin ainsi ouvert a été poursuivi dans quatre affaires plus récentes qui concernaient les prisonniers de Guantanamo. Vous imaginerez aisément que les requérants, les prisonniers, n’étaient pas très populaires aux États-Unis. Les défendeurs à ces causes, le Président et le ministre de la Défense, l’étaient beaucoup plus, et ils étaient puissants. Cela n’a pas empêché la Cour Suprême de trancher chacune de ces affaires en faveur du demandeur ; et le gouvernement, une fois encore, s’est incliné. Le Président George W. Bush a déclaré : « Je suis en total désaccord avec la décision de la Cour, mais je la respecterai ».
Vous mesurez à quel point les positions respectives des Présidents, des gouvernements, des juges et de l’opinion ont évolué depuis l’époque de l’affaire des Cherokees. On s’attend désormais à ce que les Présidents respectent les décisions de la Cour. La Cour est devenue un contre-pouvoir.
3. Quel avenir pour la Cour suprême ?
J’aurais aimé pouvoir m’arrêter là. En ce cas j’aurais décrit l’histoire d’un peuple qui marche vers la lumière en intégrant progressivement les valeurs de l’État de droit, qui comprend la nécessité de respecter les décisions de justice même dans des affaires d’État, même lorsqu’on les désapprouve sur le fond. Et réciproquement, l’histoire d’une Cour qui assume de plus en plus son pouvoir de protéger les droits, même en temps de guerre. Je ne prétends pas que cette évolution est linéaire et parfaite car l’histoire des États-Unis est faite de moments de tragédie et des moments de gloire, ni que la Cour ne cesse de se rapprocher de la maturité même si elle a gagné à présent la confiance des Américains. Une enquête du Pew Research Center a montré qu’en 2019, 62 % des Américains avaient une opinion favorable de la Cour Suprême (à peu près le même pourcentage qu’en 1985).
Malheureusement, les choses ne sont pas si simples et l’avenir n’est jamais certain. L’histoire n’est pas encore écrite, et de mon point de vue, les sujets de préoccupation ne manquent pas.
Pour quelles raisons peut-on penser qu’aussi bien les pouvoirs que le rôle de contre-pouvoir de la Cour sont menacés ? On constate tout d’abord dans le public une défiance grandissante à l’égard de toutes les institutions du gouvernement. Le Pew Research Center indique également qu’en 1958, 73 % des Américains estimaient que les décisions du gouvernement fédéral étaient la plupart du temps justes. En 2019, ce pourcentage est seulement 17 %.
Nous avons ensuite assisté à une évolution de la presse et des autres institutions qui analysent et commentent la production de la Cour. Leur point de vue est important parce c’est par leur intermédiaire que l’opinion a connaissance du travail de la Cour. Il y a quelques décennies, il ne serait venu à l’idée à d’aucun de ces commentateurs de mentionner à propos d’un arrêt le nom ou le parti du Président qui avait nommé un juge. Aujourd’hui, c’est courant. Plus récemment, les journaux systématiquement étiquettent un juge de « libéral » ou de « conservateur ». S’installe ainsi dans l’esprit des lecteurs que les juges, surtout à la Cour Suprême, sont d’abord des hommes politiques et non des juristes.
Comme je l’ai déjà dit, les divergences entre les juges relèvent de leur conception du droit et non de leurs opinions politiques. Je le constate tous les jours et pourrais donner nombre d’exemples. Mais si l’opinion est de plus en plus convaincue du contraire, il ne faut pas s’étonner que les partis politiques voient dans la nomination des juges une occasion d’étendre leur influence. Et si le public pense que les juges sont des hommes politiques « enrobés », leur confiance dans la justice ne peut que diminuer, entraînant avec elle le pouvoir (et le rôle de contre-pouvoir) de la Cour.
Que peut-on faire pour enrayer ce cercle vicieux ? J’aborderai d’abord les réponses internes, concernant les juges eux-mêmes, avant de développer quelques idées pour le pays en général.
3.A. En interne
Que pourrions-nous faire, nous les juges de la Cour suprême, pour maintenir ce capital de confiance et de respect de la part tant des pouvoirs publics que des citoyens ordinaires, que nous avons lentement conquis au fil des siècles ? En d’autres termes, que pouvons-nous faire pour maintenir l’autorité de la Cour ?
Permettez-moi de revenir une nouvelle fois à Cicéron. Si, selon la formule de Hamilton, nous n’avons ni la bourse, ni l’épée – c’est-à-dire que nous n’avons ni le pouvoir de faire peur, ni celui de distribuer des gratifications – il ne nous reste que la « virtus », c’est-à-dire la sagesse pratique et un sens de la justice. Seules ces « deux qualités » peuvent « inspirer la confiance des citoyens ». Mais quel contenu concret donner aujourd’hui à ces deux vertus cicéroniennes ? Je suggère de les décliner en cinq recommandations pour le juge.
1. « Do your job ! » Le travail d’un juge constitutionnel est d’interpréter (et d’appliquer) les termes du droit, qu’ils soient contenus dans une loi ou dans la Constitution. Parce que nous ne connaissons que des affaires qui ont donné lieu à des divergences d’interprétation de la part des juges inférieurs, le sens de ces termes est généralement ambigu et leur application incertaine. Pour faire ce travail, les juges, comme je l’ai déjà dit, ont des outils à leur disposition : le sens ordinaire des mots, l’histoire, la tradition, les précédents, les objectifs poursuivis par le législateur ou les valeurs inhérentes à une disposition constitutionnelle, et les conséquences au regard de ces objectifs. Certains juges préfèrent certains outils plus que d’autres mais ils les utilisent tous.
Le travail des juges consiste donc à lire les mémoires présentés par les parties, écouter les arguments oraux et suivre attentivement les débats à l’audience, discuter avec ses collègues, écrire une opinion et la soumettre aux critiques de ses collègues, et finalement rendre une décision publique avec le cas échéant, quelques opinions concurrentes ou dissidentes. C’est tout. La popularité, les soutiens, les critiques, l’avis des syndicats, du patronat ou des médias ne doivent pas entrer en ligne de compte. Le plus que ces groupes ou d’autres peuvent faire, est de présenter des arguments. Et il faut que le juge de la Cour suprême, comme d’autres juges, garde cela à l’esprit. Et j’ai pu vérifier au cours mes plus de trente années de carrière de juge, qu’à partir du moment où un homme ou une femme prêtent le serment de juge, ils ou elles ont à cœur d’honorer cette loyauté à l’État de droit (et non plus au parti qui les nommé).
2. Clarté. Cicéron a aussi affirmé que les gens ne pourraient « s’accoutumer à obéir à d’autres volontairement » que si « des hommes n’eussent pu les persuader par éloquence de la vérité de ce qu’ils ont découvert par raison ». Tous les juges ne peuvent atteindre à cette éloquence à laquelle fait référence Cicéron, mais on peut attendre d’eux qu’ils écrivent clairement. On dit que « la clarté est la politesse de l’homme de lettres » mais pour un juge de la Cour suprême, la clarté est plus qu’une politesse, elle est aussi une nécessité. Elle montre une clarté de pensée, ce que Boileau a si bien résumé : « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément ». La clarté aide à convaincre le lecteur que le juge a tranché l’affaire selon la raison et le droit, et non selon la politique.
Le juge doit aussi garder à l’esprit la nature de l’auditoire auquel il s’adresse. Un arrêt en matière de faillite, par exemple, aura un auditoire plus technique qu’une décision sur la discrimination raciale. La seconde exige une écriture plus simple et plus directe que la première.
3. Délibération. La délibération, comme l’a dit le Professeur Tavoillot2, se distingue de la conversation (qui ne cherche pas à emporter une décision), du bavardage, de l’éloge et de l’indignation. Pour un groupe de juges (comme ceux de la Cour suprême), elle consiste à prendre en compte les arguments pour et contre de chaque solution et peser les mérites de deux interprétations possibles (d’une phrase ou de l’application d’une phrase) dans le but de parvenir à une décision.
Selon Tavoillot, Aristote distingue entre la délibération des politiques (ou du peuple) qui porte sur l’action à entreprendre et celle des juges « qui évalue la justice des actions passées ». Cette distinction contribue souvent à caractériser le travail des juges d’appel. Les avis des juges accordent généralement de l’importance aux caractéristiques des actions qui ont eu lieu dans le passé. Mais elle est moins utile lorsqu’elle est appliquée à la Cour suprême, en particulier à ses décisions qui contribuent à déterminer la confiance que le public a, ou aura, dans l’institution judiciaire elle-même.
Il s’agit de décisions qui, par exemple, concernent l’interruption volontaire de grossesse ou le droit du travail pour les personnes homosexuelles, qui portent sur l’avenir autant (voire beaucoup plus) que sur le passé. Pour trancher de telles questions, comme je l’ai dit, chaque juge mobilise ses propres conceptions du droit qui peuvent conduire à des solutions différentes. Quelle forme doit prendre la délibération dans ces cas ?
Les procédures orales donnent parfois l’occasion à un juge d’exprimer, à travers ses questions, son point de vue mais le processus de délibération proprement dit commence lors des séances où les juges délibèrent sur les affaires et essayent d’arriver à une décision préliminaire. Lors de ces séances qui sont confidentielles (seuls les juges y participent), chaque juge livre son avis de manière argumentée à ses collègues. Le succès de ces délibérations tient en une phrase, au demeurant très banale : « Écoutez les autres ».
Certes, le propos n’est pas tout à fait libre. Il faut s’appuyer sur l’un des outils dont je parlais tout à l’heure (le texte, l’histoire, les traditions, les précédents, même les valeurs ou objectifs et les conséquences). Chacun arrive donc à la séance avec son point de vue mais doit rester ouvert à la possibilité d’en changer.
Je dirais volontiers que le plus difficile pour un juge n’est pas de se forger une opinion, mais de se montrer capable d’en changer. C’est très difficile de changer de position mais j’ai appris une méthode auprès du Sénateur Kennedy pour lequel j’ai travaillé au Sénat, que je trouve excellente. Lorsque quelqu’un campe sur ses positions, il faut lui demander d’expliquer en détail son point de vue, ce qui l’amène à énoncer une chose – parfois un détail – avec laquelle on est d’accord. On lui propose alors de partir de ce (petit) point d’accord pour l’agrandir autant que possible. Et de temps en temps on pouvait arriver à un accord plus général. (Le Sénateur ajouterait en parlant à son équipe : « Et ne vous arrêtez surtout pas au « crédit », c’est-à-dire au point de savoir à qui revient le mérite de l’accord ; le crédit est une arme ; s’il y a un accord, il y aura suffisamment de crédit pour tout le monde ; et si l’on échoue, qui le revendiquera ? »). La Cour n’est bien sûr pas le Sénat, ni un organe politique, il n’empêche que ces conseils restent pertinents.
4. Compromis. On arrive donc à une question importante mais qui prend un tour peut-être plus difficile pour un juge parce qu’il raisonne en termes de principes et non d’action comme un politique : jusqu’où peut-il parvenir à un compromis ? Il est probablement plus facile de trouver une réponse en France où il n’y a pas d’opinions dissidentes. Mais le système américain trouve son origine dans le système anglais dans lequel chaque juge donnait sa propre opinion. L’avantage du système américain est qu’une opinion dissidente peut mener l’auteur de l’opinion majoritaire à améliorer l’arrêt qui exprimera l’opinion de la Cour. De surcroît, bien peu de gens arriveraient à croire que nous sommes vraiment unanimes dans les grandes affaires. Cela veut dire concrètement qu’il faut chercher une majorité de cinq juges pour chaque affaire qui vient devant la Cour. La question de parvenir à un compromis est donc très importante.
Il y a différents moyens de trouver un compromis. Le premier consiste à trancher une question plus étroite, moins importante, que la grande question que soulève l’affaire comme la liberté d’expression et la liberté de religion. Imaginez un exemple hypothétique dans lequel un ministre d’un cabinet promulgue un décret, et le décret est contesté sur la base qu’il est interdit par la Constitution. Si le décret est aussi incompatible avec une loi ordinaire, un moyen d’arriver à un compromis serait de décider sur cette base, au lieu de trancher la grande question constitutionnelle, où il y aura peut-être de grandes divisions. Nous devrions poser la question de sorte à trancher la question plus étroite mais où il y a plus d’accord, au lieu d’une plus grande question ou il y aura des grandes divisions.
Il y a d’autres formes de compromis. On peut, par exemple, décider de rejoindre une opinion majoritaire avec laquelle en réalité on n’est pas d’accord. On peut écrire une opinion dissidente mais ne pas la publier, ce qui donne l’impression publique d’un accord là où il n’y en a pas de facto. Cela s’appelle « swallow the dissent », littéralement « avaler l’opinion dissidente ». Dans certains cas donc, le compromis n’est pas sur le fond mais sur sa publicité.
Quand et comment choisir de faire un compromis ? Chaque juge décide selon sa conscience. Mais il doit prendre en considération deux éléments. Premièrement, les différents auditoires auxquels est destinée sa décision (les autres juges, les avocats, et le public en général) qui sont intéressés par la position de la Cour en tant que juridiction, non par l’opinion personnelle des juges. Il n’y a qu’une Constitution des États-Unis. Il n’y a pas une Constitution selon Justice O’connor ou selon Justice Scalia ou selon moi-même. C’est ce que pense la Cour, la majorité, qui a le plus d’importance. Les opinions dissidentes risquent donc d’affaiblir la confiance du public dans la décision de la Cour.
Mais, d’un autre côté, s’il n’y a jamais d’opinions dissidentes, le public (ou, au moins le public informé), qui est bien conscient des différences de conceptions jurisprudentielles parmi les juges, doutera de la sincérité d’une décision qui à l’évidence ne reflète pas la diversité des juges.
Dans les deux cas de figure, la confiance en la Cour, comme interprète légitime du droit, est menacée. Où trouver le juste milieu ? Il s’agit d’une question qui regarde la conscience de chacun que je me garderai bien de trancher.
5. Élargir la perspective. Revenons sur cette minorité d’affaires qui touchent des désaccords politiques ou sociaux profonds qui traversent toute la société parce qu’elles concernent les mœurs plus que le droit technique. Comment les trancher ? C’est sous la plume de Montaigne que j’ai trouvé, grâce au Professeur Tavoillot, la meilleure métaphore pour rendre compte du travail des juges dans ce type d’affaires. Montaigne compare l’éducation des enfants au travail des abeilles. Ils « pilotent deçà delà les fleurs », ils élèvent ce qu’ils trouvent, et ils le transformeront « pour en faire un ouvrage tout sien : à savoir son jugement ». Ce jugement (continue Tavoillot) « porte sur l’action » consistant à « faire quelque chose » mais il « ne porte pas sur les finalités de l’action, mais sur les moyens de les atteindre ».
Le respect par les Américains des juges et de la justice est une question d’habitude et de coutumes.
Stephen Breyer
Cette description décrit très bien le travail des juges dans ces affaires. Comme les abeilles, ils ont butiné beaucoup de matière première dans l’analyse textuelle, dans l’histoire, les précédents, etcetera, qu’ils doivent transformer en jugement. Ce jugement est moins (ou n’est qu’en partie) une décision sur la justice des événements du passé. Il est plutôt une instruction donnée au droit (et donc les actions de justice) pour l’avenir.
Où trouver les « finalités » qui sont comme des boussoles qui doivent orienter les délibérations et la décision elle-même ? On les trouve, je crois, dans la Constitution elle-même et dans les valeurs qui sous-tendent ses dispositions, l’esprit de la Constitution. L’intégration raciale de Brown v. Board, par exemple, n’était pas simplement une conclusion logique de la disposition qui institue « l’égalité des personnes en droit » mais aussi la réaffirmation d’une valeur de fond, de l’égalité comme un droit de chaque personne, et, plus encore, de la justice elle-même.
Prenons d’autres exemples. A la différence de la France, aux États-Unis, le principe de laïcité n’est pas absolu. On le trouve énoncé dans deux dispositions de la Constitution. La première interdit toute atteinte à « la liberté de religion » et la seconde prohibe l’« établissement » d’une religion, c’est-à-dire, toute aide gouvernementale à une religion quelconque. Ces deux dispositions n’interdisent pas au Congrès d’ouvrir ses sessions avec une prière, mais s’opposent à toute subvention publique aux écoles religieuses. Mais comment ces dispositions constitutionnelles s’appliquent-elles aux monuments religieux (de l’installation par exemple des Tables de la Loi c’est-à-dire des Dix Commandements par l’État dans le jardin du Capitol au Texas ou dans un tribunal au Kentucky) ?
Pour répondre à ces questions, j’ai jugé utile de me référer à la finalité primaire de ces dispositions. À mon avis, elles reflètent en partie le grand compromis anglais du 17ème siècle qui a mis fin aux guerres de religion : « vous pratiquez votre religion (et l’enseignez à vos enfants) et je pratiquerai la mienne », en un mot le but est de minimiser les possibilités de conflits sociaux autour de la religion. Ce principe est essentiel dans un pays qui compte des dizaines de religions différentes. Pour trouver la solution, je me suis donc référé à l’esprit de la Constitution en recherchant sa finalité profonde.
Prenons à présent l’exemple de la liberté d’expression. Dans une perspective très générale, on peut considérer cette liberté comme (à tout le moins) la garantie d’une démocratie, en ce qu’elle permet que les différentes pensées, idées, points de vue et critiques, puissent être adressées par le public aux législateurs. Cette idée explique pourquoi les juridictions doivent se montrer plus strictes face à une volonté du gouvernement de restreindre une quelconque expression dans l’espace public que lorsqu’il s’agit d’une régulation économique ordinaire.
Une telle référence aux valeurs de fond rapproche les décisions de la Cour en direction de la Justice (avec un J majuscule). C’est de cette manière, et non en cherchant la popularité auprès de certains groupes ou avec l’opinion du moment, que la Cour conservera, voire augmentera, la confiance du public et, en conséquence, préservera son autorité.
Les exemples que je vous ai présentés illustrent la réflexion prémonitoire de Cicéron. Ils mettent en exergue l’influence du mouvement vers la justice.
3.B. À l’extérieur
Enfin, que pourrions-nous faire à l’extérieur, c’est-à-dire dans le pays, pour maintenir la confiance dans le pouvoir de la Cour ? Comme je l’ai dit en réponse aux questions de la Présidente de la Cour suprême du Ghana, le respect par les Américains des juges et de la justice est une question d’habitude et de coutumes. Une chose est certaine : cette habitude n’est pas spontanée (c’est peut-être le contraire qui l’est !), il faut donc créer collectivement l’habitude d’accepter la prééminence de droit. Cela comporte le respect des décisions des tribunaux, même quand elles vous affectent de plein fouet et même lorsque les juges se sont trompés (comment peut-il en être autrement lorsqu’une décision est prise à 5 voix contre 4, et que cette majorité varie ?). Faire autrement serait se faire justice soi-même. Mais comment expliquer au public que l’acceptation de l’État de droit avantage le peuple à long terme ? Pas aux juges ni les avocats : ils en sont déjà convaincus et ils y ont un intérêt mais ce sont les autres, c’est-à-dire la majorité des Américains qui doivent l’être.
Chaque mois, je vois s’illustrer la volonté des Américains de respecter l’autorité de la Cour et comment cette volonté contribue à maintenir notre nation unie. Je garde à l’esprit le fait que nous sommes une nation de près de 330 millions de personnes de toutes les races, de toutes les religions, de nombreuses origines nationales différentes, et ayant pratiquement tous les points de vue possibles. Je vois régulièrement ces groupes de personnes très divers qui essaient de régler leurs différends par la loi, plutôt que par des moyens plus brutaux. Je comprends alors l’espoir des fondateurs de voir la Constitution perdurer et devenir un trésor national.
Que pouvons-nous faire pour maintenir cette habitude, cette coutume, ce trésor ? Les juges et les avocats ne peuvent pas réussir seuls. Les 329 millions d’Américains qui ne sont ni avocats ni juges doivent comprendre la nécessité de maintenir cette habitude, et ils doivent l’accepter. Nous devons l’expliquer à nos enfants et à nos petits-enfants, en espérant qu’ils comprendront eux aussi son importance.
Lorsque je décris aux étudiants ce que je crois que nous pouvons faire, je souligne trois directions générales que nos efforts pourraient prendre.
La première, et la plus évidente, concerne l’éducation. Les générations futures doivent comprendre comment fonctionne notre système politique. Elles doivent savoir qu’elles font, et en feront partie. Elles doivent savoir ce qu’est l’État de droit et comment (depuis l’époque du roi Jean et de la Magna Carta) l’État de droit offre une protection contre les actions gouvernementales arbitraires, capricieuses, autocratiques ou tyranniques.
La seconde concerne la participation à la vie publique d’une nation dont la population est très diversifiée et qui repose sur un État de droit. Il existe de nombreuses manières différentes de participer à la vie publique. On peut participer à la vie d’une école ou d’une bibliothèque, participer à un projet d’amélioration du quartier, aider à apprendre aux enfants à lire, travailler à l’amélioration des parcs et des terrains de jeux. On peut voter, faire campagne, se présenter aux élections. Les possibilités sont infinies.
La troisième concerne la pratique. La Constitution crée des méthodes pour résoudre les différences par la participation, par l’argumentation et le débat, par la liberté d’expression, par une presse libre et par le compromis. Les étudiants et les adultes doivent cependant mettre en pratique les compétences en matière de coopération et de compromis pour les apprendre et les conserver.
L’éducation, la participation, la pratique de la coopération et du compromis visent à renforcer la confiance du public dans le fonctionnement de nos institutions démocratiques. L’homme qui exprime mieux cette leçon est, sans surprise, Albert Camus dans son livre La Peste. A la fin, il explique pourquoi il a raconté l’histoire de la peste qui a ravagé Oran, peut-être une allégorie des Nazis en France. Parce que, dit-il, je veux que les gens sachent comment ont réagi, pour le meilleur et pour le pire, ces citoyens d’Oran. Parce que je veux qu’ils comprennent ce qu’est un médecin : c’est un homme qui, sans théoriser ou discuter, simplement et directement apporte son aide aux autres. Mais surtout parce que le bacille de la peste ne meurt jamais. Il reste dans les meubles, les chambres, et les paperasses, pour émerger un jour et renvoyer ses rats, pour l’enseignement ou le malheur des hommes, dans une cité heureuse.
Je suis optimiste sur l’avenir de la Cour. Je crois qu’elle maintiendra son pouvoir, un pouvoir qui regarde en direction de la justice ; mais je ne peux en être certain. Ces histoires j’espère vous en auront convaincu. Mais j’espère aussi que mes remarques vous auront également convaincu que la préservation de pouvoir du droit est un projet important, qui exige de nous tous – juges, avocats, professeurs et citoyens – de l’entreprendre ensemble. Un projet important et peut-être même enthousiasmant.