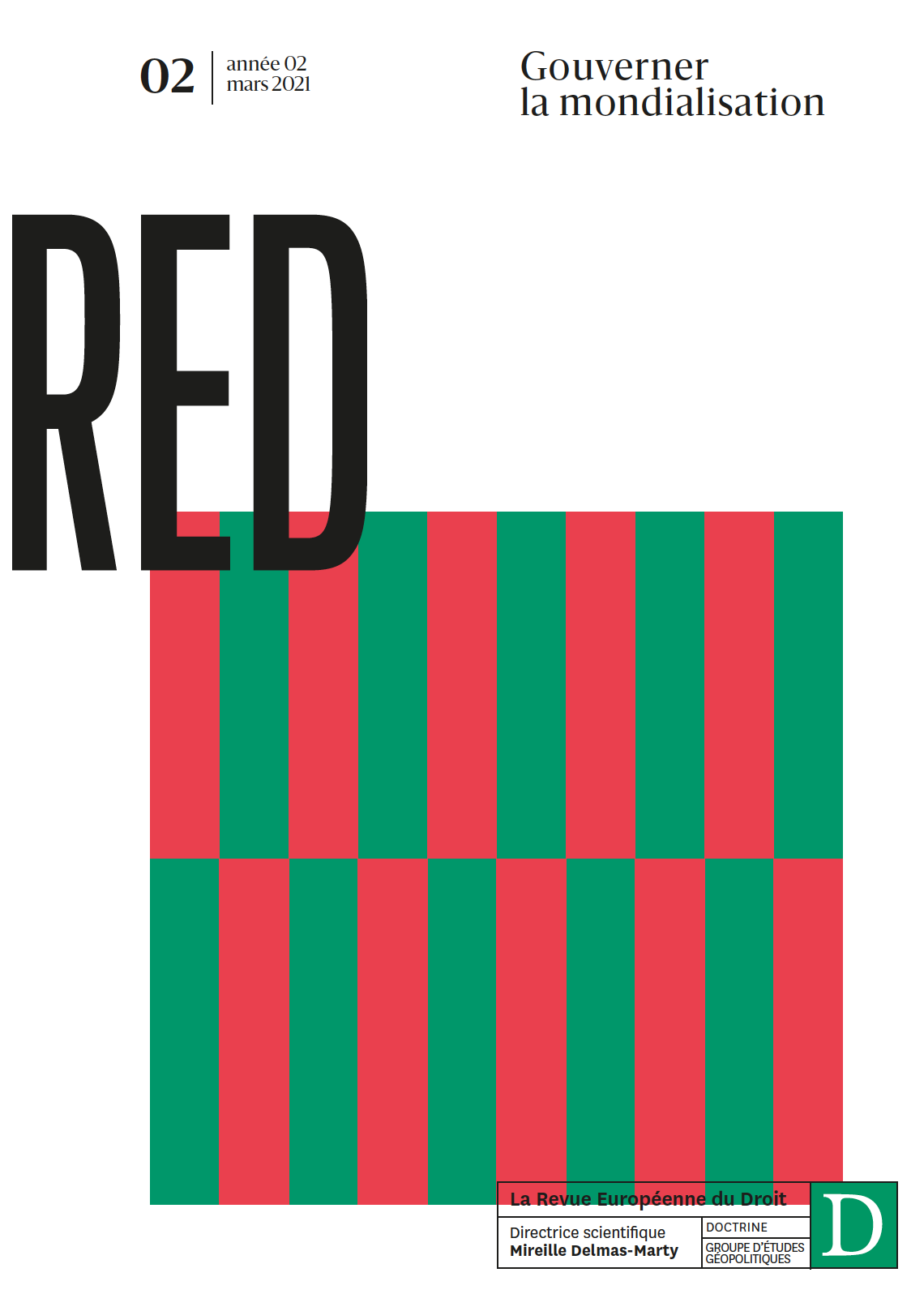Cette conversation est disponible en version anglaise sur le site du Groupe d’études géopolitiques.
L’instabilité de nos sociétés multiplie les crises (socioéconomiques, migratoires, climatiques, sanitaires…) qui s’enchevêtrent en une seule poly-crise, empilant les états d’urgence, des attentats terroristes de 2001 à la pandémie de 2020, tandis qu’une sorte de folie normative s’empare de nos sociétés. Il faut renoncer aux métaphores habituelles des systèmes de droit (fondations, piliers, pyramides de normes évoquant hiérarchie, verticalité et stabilité). Même les réseaux, qui suggèrent interactions et horizontalité, ne rendent pas compte de cette instabilité. D’où l’apparition de métaphores plus dynamiques, comme les nuages, puis les vents. Mais comment s’orienter parmi les diverses visions des humanités dans leur relation aux vivants, humains et non humains ? À première vue les humanismes se succèdent, se côtoient, se chevauchent, se combattent, dans un grand désordre. À moins de poser l’hypothèse d’une sorte d’enroulement en spirale, cette forme qui symbolise la permanence de l’Être dans son évolution. Dessinant un universel pluriel, la spirale des humanismes pourrait équilibrer et rééquilibrer les inévitables tensions. Pour tenter de saisir les dynamiques à l’œuvre, nous engageons une conversation au croisement de la philosophie et du droit.
Olivier Abel

Dans un texte bref et dense paru dans le Monde au printemps dernier, Mireille, vous appeliez à « profiter de la pandémie pour faire la paix avec la terre ». Je l’entends aussi, venant de vous, comme un appel à un nouvel humanisme, à l’échelle d’une mondialité fragile, et de ce que Jan Patočka appelait superbement « la solidarité des ébranlés ». Il ne faut certes pas trop vite vouloir donner un sens à cette crise, mais elle sonne comme un avertissement, une leçon : elle nous réapprend à faire face en même temps, pour reprendre les termes de Hannah Arendt, à l’imprévisible et à l’irréparable, que nos « systèmes » font tout pour éliminer, mais qui nous reviennent par notre point de vulnérabilité, notre simple condition corporelle. Et puis avec cette crise nous sommes en train, difficilement, d’intégrer dans nos schèmes cognitifs et éthiques le temps de réaction du système, qui fait que nous ne voyons pas les choses telles qu’elles sont mais telles qu’elles étaient un certain laps de temps auparavant, qui se compte en jours, sinon en semaines ; et c’est une leçon transposable à d’autres domaines, comme celui de la crise climatique : ce que nous voyons, pour le climat, correspond à une réalité qui date de plusieurs années, sinon de plusieurs décennies. Nous ne voyons, nous ne sentons pas encore la réalité actuelle. Et puis cette épidémie nous a montré le caractère dérisoire des frontières et des protections, elle nous apprend le caractère inséparable du prendre soin de soi et du prendre soin d’autrui, c’est à dire l’impossibilité de se sauver tout seul, la nécessaire solidarité, bref ce que vous ne cessez de déclarer : notre condition d’interdépendance.
J’aimerais, au-delà de ce que cette crise nous donne à penser, traverser avec vous dans cet entretien quelques unes des questions qui nous animent tous les deux : la sensibilité à l’urgence écologique et la nécessité de l’instituer, au sens quasi-politique du terme, le conflit des humanismes et la manière de convertir ce conflit en dialogue, en spirale productrice, le rapport entre les forces imaginantes de l’éthique et celles du droit, et enfin la fragilité extrême de nos démocraties face à des urgences qui la débordent de toute part. Dans tout cela, c’est la conversation des humanismes, à la fois leur pluralité et leur capacité à entrer dans un travail d’humanisation réciproque, qui nous servira de boussole.
Une boussole « inhabituelle », précisez-vous, car tout se passe comme si, en se mondialisant, les sociétés avaient perdu le nord. « Pendant longtemps, chaque communauté s’était fabriqué sa boussole. Chacune avait un pôle d’attraction symbolique imposé par les dispositifs juridiques, droit écrit ou coutumier, les rites, voire les commandements religieux. Selon la manière dont la mémoire et l’oubli avaient structuré son histoire, chaque communauté s’était organisée autour de ce pôle d’attraction. Mais la mondialisation se déploie en toutes directions. Littéralement déboussolés, nous errons dans la nostalgie d’une mémoire qui n’existe guère à l’échelle planétaire, ni même à l’échelle de l’Europe. Au lieu d’un pôle, nous aurions besoin d’un centre de gravité, ou d’attraction où se rencontrent des principes de gouvernance inspirés des divers humanismes juridiques »1.
Mais pour rester un moment encore sur la crise du coronavirus et ce qu’elle nous dit, ce dont elle est l’occasion, je pense à cette proposition de Bruno Latour qui dit que « nous sommes des interrupteurs » : à chacun de nous de voir ce qu’il arrête, ce qu’il commence, ce qu’il continue. En ce sens c’est un moment proprement critique, au sens grec du terme, c’est-à-dire le moment d’un « tri ». Il était bien temps de prendre, malgré nous, ce temps d’arrêt, et de ne pas tout reprendre comme avant, car nous étions emportés par le train fou d’une « volonté d’une puissance dépourvue désormais de sujet et qui fait de nous ce qu’elle veut »2. Nous ne parvenions pas à ralentir nos déplacements perpétuels, à sortir de nos addictions mortifères, de notre effrayant confinement communicationnel. Ce que nous redécouvrons, c’est que nous ne sommes pas seulement des cerveaux branchés, mais des corps vulnérables. Aujourd’hui c’est une épidémie, demain cela peut être la famine, l’eau. Nous sommes des sujets parlants mais aussi corporels, habitants et co-habitants le monde. Nous devons apprendre à cohabiter avec d’autres, avec d’autres formes d’humanité mais aussi avec d’autres formes de vie, de manière à former un monde durable. Greta Thumberg, que vous appelez joliment « le petit souffle », nous alerte vigoureusement, et à juste titre ; mais je me souviens de notre jeunesse de 1968, j’avais 15 ans, on disait la même chose et on pensait qu’on allait tout changer. Il ne faut plus être naïfs : les forces du productivisme-consumérisme sont d’une extrême puissance, et d’autant plus que c’est nous-mêmes qui avons ce pli, par tous nos modes de vie. C’est cela que je redoute, avec la crise actuelle, et ses conséquences catastrophiques en termes de faillites, de chômage, d’impossibilité de répondre à la diversité des clameurs : c’est de repartir comme avant, pire qu’avant, dans l’impossibilité de nous entendre sur les priorités, et de réorienter l’économie non pour parer au plus pressé mais en installant des caps de long terme.
Nous ne parvenions pas à ralentir nos déplacements perpétuels, à sortir de nos addictions mortifères, de notre effrayant confinement communicationnel. Ce que nous redécouvrons, c’est que nous ne sommes pas seulement des cerveaux branchés, mais des corps vulnérables.
Olivier Abel
Il me semble aussi que ce qui caractérise cette crise, c’est qu’elle est portée et amplifiée de manière inédite par la mondialisation communicationnelle. Nous avons la chance de vivre cette épidémie en restant connectés, mais sans cette instantanéité numérique, nous n’aurions jamais autant réagi. Tant mieux à certains égards, si on en fait cette occasion unique de réorienter notre société, mais cette connectivité pose des problèmes de gouvernance, et donc de démocratie, de procédures de droit qui entravent les rumeurs et les paniques. C’est comme si nous étions trop informés, surinformés, par rapport à notre capacité à agir, et il faut mesurer tous les effets dévastateurs de cette situation… Et vous, Mireille, qu’en pensez vous, comment la voyez vous, cette crise ?
Mireille Delmas-Marty

Je la vois d’abord comme l’occasion inespérée d’une pause dans une mondialisation galopante. Depuis une vingtaine d’années, nous avons vécu des crises mondiales quasi permanentes : crise sécuritaire avec les attentats terroristes, puis le désastre humanitaire des naufrages de migrants, et encore les crises financière, sociale (prenant en France la forme inattendue des « gilets jaunes »), climatique avec le dérèglement de l’écosystème, enfin sanitaire avec la crise actuelle. Confrontés à une telle avalanche, les collectifs humains ont imperturbablement poursuivi la même route. Maintenant qu’ils se sont immobilisés eux-mêmes face à une pandémie qui n’est pas la première mais qui, pour la première fois, est d’emblée perçue comme un fait social total à l’échelle planétaire, les humains sont- ils prêts à changer de cap pour éviter l’effondrement ?
Tout se passe en effet comme si nous étions entrés dans le « pot au noir »3, ce lieu maudit au milieu des océans où les vents contraires se neutralisent et paralysent les navires, ou se combattent et provoquent le naufrage. Sécurité vs Liberté, Compétition vs Coopération, Exclusion vs Intégration, Innovation vs Conservation, nos sociétés semblent tourner en rond comme des girouettes au gré des vents qui soufflent comme autant d’esprits des lois. D’où l’incohérence de certains choix politiques, par exemple à propos des services de santé : démantelés il y a peu au nom de la compétitivité ; puis encensés, tels des héros, pour leur coopération dans la « guerre » engagée contre le terrorisme et la pandémie au nom de la sécurité. A son tour la sécurité, érigée en droit quasi-absolu suspend l’ensemble des droits et libertés, à commencer par la liberté d’aller et venir, ou la liberté d’expression. Même le droit à la dignité humaine, juridiquement « indérogeable », est ouvertement bafoué en temps de pandémie quand des morts sont privés de sépulture, tandis que des vivants sont discriminés comme « population à risques », voire suivis par « traçage » comme des produits dangereux.
Impossible de rester silencieux devant des pratiques qui, pour préserver la survie de l’espèce, finiraient par détruire ce qui fait le propre de l’humanité. Mais que dire et surtout comment faire pour freiner cette course qui mène nos sociétés dans le pot au noir ?
L’urgence écologique et la refondation d’un humanisme juridique
Olivier Abel
Dans Une boussole des possibles, Gouvernance mondiale et humanismes juridiques, vous écrivez : « l’écocide […] n’est pas le crime ultime, s’ajoutant à tous les autres, mais le crime premier, le crime transcendantal, celui qui ruinerait les conditions mêmes d’habitabilité de la Terre ». Je voudrais repartir de cette considération qui appelle à repenser un humanisme profondément élargi, tel que l’humain ne soit plus le sujet roi d’un monde objet ou instrument, pliable à toutes les finalités et caprices des désirs humains — ni le sujet nul, superflu, vide et pliable à volonté par les Savoirs-Pouvoirs établis. Pour le dire d’un mot, l’espèce humaine toute entière est co-habitante du monde, dont elle ne saurait devenir un parasite trop puissant sans tuer ce dont elle se nourrit. C’est un paradoxe tristement banal que chaque population tend à augmenter, s’étendre et se densifier tant que le milieu le permet, jusqu’au point où elle détruit ce milieu. Le pire n’est pas sûr d’ailleurs, et c’est ce qui complique la chose : il se trouve aussi des symbioses à peu près équilibrées et durables. Quand on est trop fort pour son environnement, plutôt que de se protéger au maximum et monter à la catastrophe globale, il ne reste qu’à se déprotéger. C’est cet appel qu’il faudrait lancer à chaque humain, à chaque société, à l’humanité entière : « déprotégeons nous ! ». Il nous faudrait un humanisme de la déprotection, un humanisme de la vulnérabilité tranquille et résolue. C’est le contraire des sujets qui s’engoncent dans leurs prétendus droits, se bardent de protections et refusent de désarmer leur forme de vie, bref qui préfèreraient survivre à leur monde, car rien n’est au-dessus de leur survie ! Mais qu’est ce qu’un sujet qui survit à son monde ?
Vous parlez de l’habitabilité de la Terre, et je l’entends comme une résistance au laminage des habitats et formes de vie humaine, dans leur diversité, mais aussi au laminage des écosystèmes de milliers d’espèces vivantes, cette mondialisation-là accélérant les nouveaux virus et épidémies, amplifiant la crise climatique, la crise des ressources, l’exacerbation générale de la lutte pour la survie. Bref, cette crise est l’occasion de retourner autrement vers un monde qui nous a d’abord été donné à habiter, à cohabiter, à interpréter diversement, sans prétendre en faire notre œuvre ni notre propriété. Comment rapporter la croissance fallacieuse de nos échanges à sa condition de possibilité dans le fait qu’il y a des habitants, et penser l’économie dans les limites d’une écologie soutenable, dans le sens où la terre est notre habitat unique, et ultime ? La tâche est immense. Pour donner un petit exemple, ne faudrait-il pas, à côté du GIEC pour le climat, un Observatoire international, indépendant des puissances étatiques et économiques, capable de lister l’état réel des ressources minérales sur lesquelles le développement s’est appuyé ? Je ne pense pas seulement au pétrole, sur lequel l’opacité est organisée, mais tous les métaux, les terres rares, etc.
Vous écriviez aussi : « On voudrait échapper à l’alternative entre le rêve du surhomme des courants post-humanistes et la hantise de la catastrophe des courants écologiques ». Sortir de cette alternative c’est penser une humanité à la fois vulnérable et responsable, c’est-à-dire capable de prendre son destin en main, non pas seulement assumer le passé, mais mesurer les conséquences futures de son agir actuel. C’est ici que nous avons bien besoin des faibles et résistibles4 puissances du droit. Vous décrivez « la surpuissance des moyens techniques », qui pose cette question de manière aigüe : « à puissance inédite, responsabilité inédite », résumait Ricœur. Dans La condition de l’homme moderne, Arendt prolongeait la terrible remarque de Rousseau dans son Discours sur les sciences et les arts, de la disproportion entre le progrès moral et le progrès technique : nous ne comprenons plus ce que nous sommes cependant capables de faire. Pour sentir ce que nous faisons, nous avons besoin d’institutions qui nous le fassent sentir. Nous avons besoin de prolongements juridiques de notre éthique, à la hauteur de la puissance des prothèses techniques dont nous sommes dotés. Ne faudrait-il pas, par exemple, penser une forme juridique de responsabilité écologique internationale qui viendrait pondérer la brevetabilité des inventions, et équilibrer les gains escomptés de ces brevets par une sorte de responsabilité des effets sur l’environnement et sur les humains ? Comment le droit, à votre avis, peut-il nous aider dans cette passe difficile ? Comment poseriez vous le problème ?
Pour sentir ce que nous faisons, nous avons besoin d’institutions qui nous le fassent sentir. Nous avons besoin de prolongements juridiques de notre éthique, à la hauteur de la puissance des prothèses techniques dont nous sommes dotés.
Olivier Abel
Une dernière question sur ce sujet : la question écologique est complexe, il n’y a pas une politique écologique qui serait l’application sans discussion possible d’une vision scientifique de ce qu’il faudrait faire. Elle ouvre des scénarios divers et incertains, et on ne peut pas tout avoir en même temps. C’est pourquoi c’est aussi une question économique et sociale qui ouvre un nouvel espace de conflictualité : ce n’est pas « nous » contre « eux », mais nous-mêmes sous certains aspects et selon telle échelle de temps et d’espace, contre nous-mêmes selon d’autres aspects et échelle d’espace et de temps. Comment instituer juridiquement et politiquement cet espace de conflictualité ? Comment mettre en scène une conflictualité qui traverse chacun de nous, mais aussi où certains, dans l’espace mondial, ou dans la suite des générations, sont plus exposés que d’autres ?
Mireille Delmas-Marty
Il faudrait profiter de ce moment inédit où semblent ébranlés des dogmes aussi résistants que la souveraineté absolue des États, la croissance économique et son autorégulation par le marché, le dogme sécuritaire du risque zéro, ou l’anthropocentrisme qui place l’homme au centre du Monde.
Mais ne nous trompons pas de route. Il ne s’agit pas de remplacer un dogme par son contraire. Le monde d’Après n’est pas l’inverse du monde d’Avant. C’est un monde hyper connecté, fragilisé par la puissance de l’imprévisible. C’est pourquoi le changement de cap doit être un changement de la pensée : il faut renoncer aux certitudes de la pensée dogmatique pour les incertitudes d’une pensée dynamique, qui évoque la « pensée du tremblement » car elle oscille d’un vent à l’autre, d’un dogme à l’autre. En fait, c’est une pensée en mouvement. Poursuivant la métaphore nautique, on pourrait dire qu’elle « faseille » à chaque virage, comme les voiles sur un bateau qui « tire des bords » pour remonter contre le vent. Afin de s’adapter à l’imprévisible, la pensée dynamique doit accepter de « faseiller » et rester modeste. Reconnaissant ses erreurs au lieu de les cacher, elle apprend à les corriger, par une sorte de bricolage, ajustement et réajustement. C’est la condition pour tenter de relever le pari lancé par Edouard Glissant « qu’il est possible de durer et de grandir dans l’imprévisible5.
Nous avons déjà des instruments juridiques pour « durer dans l’imprévisible », et nous devons en être conscients pour apprendre à nous en servir.
Il faut renoncer aux certitudes de la pensée dogmatique pour les incertitudes d’une pensée dynamique, qui évoque la « pensée du tremblement » car elle oscille d’un vent à l’autre, d’un dogme à l’autre. En fait, c’est une pensée en mouvement. Poursuivant la métaphore nautique, on pourrait dire qu’elle « faseille » à chaque virage, comme les voiles sur un bateau qui « tire des bords » pour remonter contre le vent.
Mireille Delmas-Marty
Le premier instrument se nomme interdépendance. Il a fait son entrée en droit international, lors du 1er sommet de la Terre (Rio 1992) : « La Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance »6. Mais personne, ou presque, ne l’a vu. Il a ensuite inspiré une « Déclaration d’interdépendance » (que nous avions rédigée au sein du Collegium international d’éthique autour de Michel Rocard, Milan Kučan, Ruth Dreifuss et Mary Robinson, avec notamment Stéphane Hessel, Fernando H. Cardoso, Edgar Morin ou Peter Sloterdijk, et le fidèle Sacha Goldman). Nous l’avions présentée en 2005 à l’ONU, mais personne, ou presque, ne l’a lue. Nous l’avons à nouveau présentée en 2018, peu avant la disparition de Michel Rocard, au Secrétariat général de l’ONU, mais rien n’a bougé et quand le virus est arrivé, nous étions démunis.
Certes des avancées thématiques ont eu lieu, comme le préambule de l’Accord de Paris sur le climat qui souligne « le caractère planétaire des menaces à la communauté de la vie sur terre » mais le devoir de coopération qui en résulte pour les États est insuffisant. La pandémie démontrera cruellement à quel point les États, comme les êtres humains, sont devenus interdépendants, que ce soit pour se procurer des tests de dépistage, des médicaments et des vaccins, voire de simples masques de protection sanitaire. Oui, l’interdépendance humaine est désormais un fait incontestable qui devrait s’imposer comme un « mot d’ordre » et « guider notre transition vers le monde de demain »7. Encore faut-il en tirer les conséquences juridiques pour éviter le déni de réalité que pratiquent de nombreux dirigeants politiques, au nom de la souveraineté nationale.
Il faudra beaucoup d’énergie pour que les interdépendances, enfin reconnues, se transforment en une véritable solidarité, deuxième instrument pour durer dans l’imprévisible. Comme le démontrent les difficultés actuelles de l’Europe, il ne suffit pas d’inscrire le principe de solidarité dans les traités pour en garantir l’effectivité. Et pourtant, expliciter les « objectifs communs » qui sous-tendent les solidarités est déjà une étape importante qui ouvre la perspective d’un épanouissement mutuel. Cette notion est d’ailleurs apparue à l’échelle mondiale : d’abord les huit « objectifs du millénaire pour le développement » principalement axés sur la lutte contre la pauvreté, mais encore très vagues (OMD, Secrétariat général ONU, 2000) ; puis les dix-sept objectifs du développement durable (ODD, 2015). La méthode se précise avec des objectifs plus spécifiques, qualitatifs et quantitatifs, pour le climat (Accord de Paris, 2015), et peut-être à l’horizon d’un futur traité modèle sur les migrations … ou sur les pandémies.
Mais, pour être efficaces, les solidarités supposent la responsabilité juridique des acteurs les plus puissants, autrement dit, un état de droit opposable aux États. Bien que la création d’un État mondial ne soit ni faisable, ni souhaitable, il est en revanche faisable – et urgent – de transformer la souveraineté solitaire des États en souveraineté solidaire et leur irresponsabilité en responsabilités « communes mais différenciées ». Il resterait à prévoir la responsabilité des acteurs non étatiques quand ils exercent un pouvoir global, comme les entreprises transnationales (ETN). Certes leur « responsabilité sociale et environnementale » relève de la Soft Law (un droit flou car imprécis, mou car facultatif et doux car non sanctionné) ; mais le durcissement en Hard law s’annonce déjà. Sans attendre les projets de règlement européen et de convention ONU, il peut venir du droit national quand il élargit la notion d’intérêt social à certaines formes d’intérêt général (cf. en France, la loi 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre à l’égard de leurs filiales et sous-traitants8 ou la loi Pacte 2019 instaurant le statut des sociétés à missions9).
Il n’en demeure pas moins qu’à la différence des communautés nationales, la communauté mondiale émergente n’a, pour s’inscrire dans la durée, ni mémoire collective, ni histoire commune née d’un passé partagé. C’est pourquoi l’anticipation est le troisième instrument pour durer dans l’imprévisible, à mesure que l’humanité prend conscience de son destin commun. Or il y a plusieurs récits d’anticipation, et plusieurs destins possibles, selon le récit dominant.
L’anticipation la plus répandue, notamment parmi les jeunes générations, est le récit-catastrophe du Grand Effondrement. Devenu un courant de pensée, la collapsologie, il se développe « non pas comme un moment apocalyptique ponctuel, mais comme un processus inscrit dans la durée »10. C’est ainsi que le changement climatique, l’épuisement des ressources planétaires, ou plus largement la transgression des limites planétaires (planetary boundaries), et pour couronner le tout (si l’on ose dire) le corona virus, s’accompagnent d’une désorganisation progressive de la société.
La seule alternative apparente nous vient de la Chine qui a lancé le programme des « Nouvelles routes de la soie », activant à la fois le Tout marché des sociétés de la croissance, le Tout numérique des sociétés de l’innovation et le Tout contrôle des sociétés de la peur. Il prescrit les conditions de survie d’une espèce humaine suffisamment soumise, voire infantilisée, pour garantir, sans même avoir besoin de normes juridiques, la Grande harmonie ou la Grande paix. Il y a plus de deux mille ans, les Classiques chinois identifiaient déjà ce récit à l’Empire du Milieu régnant sur « tout ce qui vit sous le ciel » (tianxia). Aujourd’hui, alimenté par l’obsession sécuritaire et la folie normalisatrice, ce récit-programme du Grand Asservissement, légitimé par la crise sanitaire, menace de s’étendre à toute la planète.
À moins que surgisse un troisième récit, qui s’inspirerait du « contrat naturel » de Michel Serres et des modèles de Philippe Descola dans son Anthropologie de la nature, l’un et l’autre associant le destin de l’humanité à celui du monde vivant. À l’opposé d’une mondialisation déshumanisante, cette compréhension « écosystémique » de l’existence humaine rejoint le récit de la « mondialité » que le poète Edouard Glissant décrit comme « l’aventure sans précédent qu’il nous est donné de vivre dans un espace-temps qui, pour la première fois, réellement et de manière foudroyante, se conçoit à la fois unique et multiple, et inextricable ». D’où la nécessité pour chacun d’avoir à changer ses manières de concevoir, d’exister et de réagir, dans ce monde nouveau. La difficulté est immense pour les humains qui depuis des millénaires avaient été formés à tout le contraire, mais il n’y a pas d’autre voie : « aucune solution aux problèmes du monde sans cette énorme insurrection de l’imaginaire »11.
Ouvert au monde qui vient, ce récit-aventure est le seul récit d’anticipation qui accepte d’accueillir l’imprévisible. Reste à savoir si l’aventure pourra durer, c’est-à-dire résister à l’effondrement du monde vivant, sans céder à la puissance d’asservissement des grands acteurs de la mondialisation.
Mireille Delmas-Marty
Ouvert au monde qui vient, ce récit-aventure est le seul récit d’anticipation qui accepte d’accueillir l’imprévisible. Reste à savoir si l’aventure pourra durer, c’est-à-dire résister à l’effondrement du monde vivant, sans céder à la puissance d’asservissement des grands acteurs de la mondialisation. Reste surtout à savoir si elle nous conduira à grandir par humanisation réciproque.
La spirale des humanités et l’humanisation réciproque
Olivier Abel
Venons en à ce qui fait ici le cœur de notre conversation, ce que nous voudrions tous les deux appeler la spirale des humanismes. Vous avez défini plusieurs paradigmes humanistes, celui de l’appartenance traditionnelle et celui de l’émancipation individuelle, mais aussi celui d’aujourd’hui où émergent des interdépendances, qui dit la nécessaire solidarité planétaire, et celui de l’indétermination humaine, qui dit l’impossibilité de mettre la main sur ce qui définit les humains. Ces différents humanismes pointent des orientations différentes et même parfois opposées, et nous allons développer cela, mais je voudrais revenir auparavant sur le risque contemporain d’un conflit des humanismes, au sens ici d’un conflit des « humanités ». Car les grandes civilisations, comme les petites traditions, ont développé des humanismes divers, et qu’il n’est pas toujours facile de faire converser, tant cela demande un travail de traduction, d’hospitalité langagière mutuelle. Ricœur écrivait il y a cinquante ans que l’humanité a « pris » dans des humanités diverses. Ce phénomène de la pluralité des cultures est lié au phénomène connexe de leur mortalité, de leur finitude. Seule une culture folle, mortellement orgueilleuse, prétendrait être à la fois seule et immortelle. Les « humanités » doivent s’accepter parmi d’autres…
Dans un monde où la rivalité des grands blocs ne s’exerce pas seulement sur le champ géopolitique ou économique, mais géo-civilisationnel, si l’on peut dire, comment faire de la rivalité entre l’Occident, la Chine, le monde Indien et le monde Musulman, par exemple, non un cercle vicieux et mutuellement destructeur mais le cercle vertueux d’une conversation des humanismes, une spirale productrice d’humanisation réciproque ? Et je viens de parler de l’Occident, mais rien que pour nos sociétés européennes, elles ne proviennent pas d’une source unique, mais de toutes les « humanités », traditions, langues et littératures qui sont venues s’y mêler, depuis la pensée grecque et les écritures bibliques, les institutions romaines et la vie monastique, la Renaissance et la Réforme, le Baroque, les Lumières et le Romantisme, la tradition républicaine et la tradition socialiste, mais bien sûr aussi les traditions issues des vagues d’immigration qui ont suivi la période coloniale, et celles magnifiquement métissées des Outre-mer, traditions qui toutes sont inachevées12 ! Or ici aussi il y a un cercle vicieux qui tend à rompre tout lien vivant avec ces « humanités » qui nous ont portés.
C’est d’autant plus grave que le moteur éthique de la civilisation européenne me semble justement avoir été l’écart et la confrontation entre des traditions dont aucune n’a jamais réussi à faire taire les autres. C’est le conflit des humanismes qui a été fondateur et constitutif de l’Europe, au sens où les grandes traditions ici évoquées n’ont cessé de se corriger mutuellement, interdisant à la subjectivité européenne d’être jamais complètement unifiée, réconciliée avec elle-même. On pourrait le montrer avec la tension constante entre Socrate et Jésus. Il a souvent été remarqué, par Machiavel déjà, que l’Europe est travaillée par la contradiction entre une morale antique du courage et une morale chrétienne du pardon, l’une exaltant la confrontation et les essais de soi, les manières de se montrer, et l’autre le dévouement et l’insouci de soi, les manières de s’effacer. Une seconde tension fructueuse pourrait être pointée dans l’opposition entre l’éthique d’Aristote et la morale de Kant. Elles représentent, davantage que des systèmes philosophiques, des styles éthiques différents, l’un qui vise le bonheur, le bon, le bien commun, et l’autre qui cherche la règle minimale universelle qui nous interdise de faire mal. Il y en aurait bien d’autres de ces « différends » fertiles. Pour reprendre l’expression de Paul Ricœur, le « noyau éthico-mythique » de l’Europe a été mis en mouvement par de tels différends, et sa chance, c’est sans doute qu’aucun de ces différends n’a pu absorber ou éliminer tous les autres.
Quels sont ceux qui travaillent aujourd’hui notre société ? Pourrions nous les reformuler au plus près de ce qui nous arrive ? J’en vois trois ou quatre particulièrement prégnants, et qui me semblent très proches des vôtres.
C’est le conflit des humanismes qui a été fondateur et constitutif de l’Europe, au sens où les grandes traditions n’ont cessé de se corriger mutuellement, interdisant à la subjectivité européenne d’être jamais complètement unifiée, réconciliée avec elle-même.
Olivier Abel
Le premier de ces différends fondateurs serait la tension entre la tradition et l’innovation : ce qui le complique, c’est que les innovations les plus créatrices s’appuient sur l’ensemble des acquis sédimentés, que parfois même elles ne font que rouvrir autrement des strates archaïques ; et c’est qu’à leur tour elles vont se déposer et faire tradition, des traditions qui ont toutes jadis été des novations, des irruptions, des ruptures. Loin de les opposer platement, la corrélation vive entre tradition et innovation est ainsi à faire jouer dans toute son amplitude : il faut que la tradition n’étouffe pas les créations naissantes, et il faut que l’ancien ait de quoi résister au nouveau, si ce dernier doit prendre appui sur lui. Ce serait là un premier cercle vertueux, un élément dynamique de la spirale que nous recherchons, et capable de prendre le contre-pied de ce cercle vicieux que vous appelez le « pot-au-noir ». Prenons notamment garde aujourd’hui à notre présentisme, à la facilité avec laquelle nous jugeons le passé, sa malléabilité sous la puissance de nos bulldozers, et de notre capacité numérique à le réécrire, à le remanier et le refigurer sans qu’il puisse résister13. À la place de ce que j’appelle tradition, vous parlez de conservation, et ce terme dit aussi des choses très fortes : c’est le principe du politique selon Hobbes, l’instinct de conservation de la vie, et des acquis, c’est aussi bien l’idée d’accumulation qui rejoint l’idée de traditions sédimentées ; c’est aussi la grande idée du philosophe tchèque dissident Jan Patočka que les guerres du XXème siècle furent des guerres entre les forces de conservation du statu quo et les forces de transformation du monde.
Le second pointe la tension entre l’émancipation et l’attachement. L’éthique de l’émancipation, qui a eu tout au long de l’histoire moderne le monopole d’être à la fois notre moteur moral et politique, notre levier de critique sociale, notre grand récit collectif, ne suffit plus14. Il faut que la faculté de déliaison, de détachement, qui brise les chaînes, soit indissociable de la faculté de refaire alliance, de refaire lien. Il faut compliquer notre idéal d’émancipation par une logique ou une éthique de l’attachement, de la fidélité, de la solidarité. Et en effet, il a longtemps fallu, et il faut encore, se battre contre les servitudes, et notamment la « servitude volontaire ». Mais aujourd’hui, il faut aussi se battre contre l’exclusion et la solitude volontaire. Je pense qu’il y a actuellement une profonde incapacité à tenir les liens. Or il y a des liens qui libèrent. Le sens du libre attachement, de la pluralité des attachements et des fidélités, mais aussi de l’alliance fidèle qui ne lâche pas pour un oui ou pour un non, peuvent être un véritable levier de critique sociale. Nous devons désormais intercaler, entre les chapitres des déclarations d’émancipation et d’indépendances successives, et ce n’est pas fini, les chapitres trop inédits des déclarations d’interdépendance et de solidarité. J’adhère avec enthousiasme à votre idée d’une charte d’interdépendance ! C’est ainsi que je vois la tension vive entre ce que vous appelez l’humanité émancipée et l’humanité interdépendante.
En revanche, je voudrais comprendre pourquoi, dans les couples que vous proposez, qui opposent des valeurs contradictoires, mais qui sont toutes de véritables valeurs, vous placez l’exclusion en face de l’intégration. D’un point de vue descriptif c’est parfaitement exact, et je crois important de penser le « droit » et la possibilité d’un corps, aussi accueillant soit-il à rejeter un corps étranger, il n’y a pas de communauté sans immunité, c’est un besoin parfois et simplement vital, et c’est aussi le « droit » de résilier, de faire sécession. Mais est-ce que l’exclusion peut être une valeur ? Ne faudrait-il pas parler de la valeur de l’exil, du droit de partir, de quitter sa société ? C’est pourquoi la troisième de ces dialectiques fondatrices me semble être celle entre le clos et l’ouvert. S’il est certain que l’humanité a besoin d’échanges et d’ouverture, elle a aussi besoin de clôtures, de frontières, de choses qui ne s’échangent pas. Pour rester vivante, une culture a parfois besoin d’être un peu « sourde » aux autres, disait Lévi-Strauss. À côté de l’ouverture et des échanges, nous avons aussi besoin de protection, d’un minimum d’immunisation. Il faut donc une bonne dialectique entre l’ouverture et la clôture, et établir cette fine dialectique sur tous les registres : sinon, une ouverture totale déterminera une clôture totale. Surtout que, souvent, on appelle ouverture tout ce qui permet d’enfoncer le protectionnisme des autres, après avoir renforcé toutes les barrières protectrices possibles pour nous-mêmes ! Vu d’ici en effet le monde est ouvert. Mais vus du Sud, les murs sont de plus en plus hauts, et inaccessibles, et plus les marchés sont « ouverts », plus les sociétés sont « fermées ».
Pour en nommer une quatrième, avec vous je dirai l’importance de trouver une équation dynamique entre un principe responsabilité et un principe espérance. Certainement j’y reviendrai, non à partir de Hans Jonas ni à partir de Marc Bloch, pourtant tous les deux passionnants à lire15, mais plutôt à partir de ce que dit Hannah Arendt à propos de l’imprévisible et de la promesse. C’est ici me semble-t-il exactement la tension maximale à laquelle vous soumettez les forces, les formes et les principes du droit. En tous cas, pour moi, ces différentes tensions sont à la fois des exemples et des points d’appui pour la spirale des humanismes et de l’humanisation mutuelle que nous cherchons.
Mireille Delmas-Marty
Considérant que la chance de l’Europe est qu’aucun des différends qui l’ont traversée n’a pu absorber ou éliminer tous les autres, vous me demandez quels sont les différends qui travaillent aujourd’hui notre société, indiquant vous-même quelques exemples « particulièrement prégnants », qui vous semblent très proches des miens. J’y retrouve en effet les tensions que j’observe, mais pour que nous puissions établir des passerelles, je dois expliciter ma démarche et les tensions sur lesquelles je travaille depuis quarante ans.
Ayant commencé à m’engager sur les chemins de la répression16, puis complété l’étude des modèles de politique criminelle par celle des mouvements17, j’ai toujours privilégié les métaphores dynamiques, mais je ne savais pas que ce serait une marche aussi longue. Opposer les nuages ordonnés18 à la pyramide des normes m’a permis de montrer non seulement les interactions horizontales de systèmes de droit structurés de plus en plus souvent en réseau, mais encore leur instabilité. Les nuages m’ont suggéré la métaphore des vents comme souffles symbolisant l’esprit des droits19, puis la quête d’une boussole pour s’orienter parmi les vents contraires20. J’ai alors (enfin !) pris conscience des limites de l’écriture et entrepris, avec un ami plasticien-bâtisseur, d’explorer les cheminements entre la pensée et la matière en fabriquant un objet mobile représentant une boussole sans pôle Nord, dite « boussole des possibles »21. Conçue comme un objet/manifeste, cette boussole symbolise les tensions selon plusieurs plans de différentiation.

Au premier plan, il s’agit de différencier les vents principaux de la mondialisation (liberté, coopération, sécurité et compétition) et les « vents d’entre les vents » (intégration, conservation, exclusion et innovation). Une Rose des vents, massive et minérale, ancrée au sol, représente les vents de la mondialisation : « vents principaux » (sécurité, liberté, compétition, coopération) et « vents d’entre les vents » (exclusion, innovation, intégration, conservation). Puis une structure minimaliste en forme de cône supporte l’exacte projection graphique de la rose vers le ciel. Disposées par couples à l’extrémité de chaque branche, des figures emblématiques animées par les mouvements de l’air évoquent, sur un deuxième plan, les vents apparemment contraires de la mondialisation (Liberté vs Sécurité, Compétition vs Coopération, Exclusion vs Intégration, Innovation vs Conservation). Ainsi la Rose terrienne (Fig. 1), devenue une Ronde aérienne (Fig. 2) suggérant le désordre du monde, illustre le sentiment d’être « déboussolé » que nous avions perçu au début de notre entretien. Cela incite à rechercher une boussole inhabituelle car sans pôle Nord, dès lors qu’aucune direction ne saurait prédominer. En revanche, elle comporte un centre de rééquilibrage où, plongés dans l’eau nécessaire au monde vivant, se rencontrent les principes régulateurs qui, tels le fil à plomb des bâtisseurs de cathédrales, stabiliseraient la gouvernance du monde. À condition d’être inspirés des visions de l’humanité différentes dans l’espace et variables dans le temps22.
Nous avons « perdu le nord » parce que le choix d’un pôle d’attraction est désormais impossible. Vous montrez, par exemple, l’impossibilité de choisir entre innovation et tradition ou conservation ; également entre le clos (qui conduit à l’exclusion) et l’ouvert (qui permet les échanges et conditionne l’intégration). De même, le choix semble impossible entre sécurité et liberté : la sécurité sans la liberté devient totalitaire, mais la liberté sans sécurité aboutit au chaos. Enfin, la compétition sans coopération renforce les inégalités et attise les conflits, mais la coopération sans compétition peut tourner à l’immobilisme.
Pour dépasser ces oppositions, nous avons besoin de valeurs inspirées d’une vision commune de l’humanisme. Or chaque communauté a développé « sa » vision de l’humanité au fil de son histoire, disqualifiant les autres visions par le jeu de ces anathèmes dont les sociétés d’humains ont le secret : la seule vérité est la mienne, la seule identité acceptable est la mienne. À l’échelle planétaire, comme nous l’avons souligné, la communauté mondiale a peu valorisé son histoire commune.
C’est pourquoi il a fallu ajouter un troisième plan, pour relier la terre et l’air au feu solaire, source de la lumière et de l’énergie vitale : une « spirale des humanismes » survole la ronde des vents, portée par un axe tournant et oscillant sur une articulation située à la pointe du cône. Il ne faut pas se tromper sur sa signification. Symbole de la permanence de l’Être dans l’évolution, la spirale n’est pas le nouvel habit d’un impérialisme qui ne dit pas son nom. Témoignant de la pluralité des sociétés, elle se déploie, entre individus et collectivités, mais aussi entre humains et non humains, suggérant l’enroulement sans fin des formes de « la Relation ».
L’humanisme le plus familier en Occident, notre « grand récit collectif » comme vous le nommez, reste celui de l’Émancipation des individus qui s’affirme en Europe au XVIIIème siècle, au temps des Lumières. À l’échelle du monde, il inscrira les droits de l’homme et les libertés des citoyens (civiles, politiques, économiques, sociales et culturelles) dans une Déclaration « universelle » qui consacre l’égale dignité de chaque être humain (1948) et interdit les pratiques inhumaines ou dégradantes, y compris l’esclavage et la torture.
Maintenant que nous devons vivre ensemble, toujours plus nombreux, nous redécouvrons, mais à l’échelle mondiale, l’humanisme le plus ancien, celui qui reliait chaque humain à ses communautés d’appartenance plus ou moins proches(famille, tribu, voisinage, village ou cité, nation …).
Mireille Delmas-Marty
Maintenant que nous devons vivre ensemble, toujours plus nombreux, nous redécouvrons, mais à l’échelle mondiale, l’humanisme le plus ancien, celui qui reliait chaque humain à ses communautés d’appartenance plus ou moins proches (famille, tribu, voisinage, village ou cité, nation…). Non seulement il est encore vivant dans les traditions de nombreux peuples, mais vous dites très justement qu’il devrait nous inciter à « compliquer notre idéal d’émancipation par une logique ou une éthique de l’attachement, de la fidélité, de la solidarité ». Ce sera compliqué en effet, car il a fallu, et il faut encore, se battre contre les servitudes, et notamment la « servitude volontaire », qui rendent le « communautarisme » si suspect, comme s’il annonçait cet asservissement que nous refusons. Face à la multiplication des désastres humanitaires, écologiques et sanitaires, commence pourtant à se réinventer un communautarisme nouveau qui ne sépare pas les communautés en les opposant les unes aux autres mais les relie en les ouvrant les unes par les autres : « changer en échangeant avec l’Autre sans me perdre ni me dénaturer » disait Edouard Glissant. Au-delà du solidarisme et du convivialisme, le communautarisme se réinvente comme une aide à toutes les détresses (ATD). Concernant d’abord les personnes en situation de grande pauvreté (ATD Quart monde), il s’étend à toutes les détresses du monde (ATD Tout monde pourrait-on dire), qu’il s’agisse de l’aide aux migrants, aux exilés environnementaux ou aux malades privés de soins. Les ONG sont rejointes par de nombreux écrivains et artistes23 et, de façon plus surprenantes par des acteurs institutionnels aussi différents que le Pape (encycliques Laudato Si en 2015 et Fratelli Tutti en 2020) et le Conseil constitutionnel, qui redécouvrait dès 2018 la fraternité comme valeur opposable au délit dit de solidarité24. Même si les conséquences pratiques restent limitées, cette décision, qui dépénalise l’aide au séjour des migrants, associe désormais l’hospitalité à la fraternité.
Ce « communautarisme » nouveau réactive les valeurs traditionnelles sans préconiser pour autant un repli ou un enfermement. D’autant qu’il s’ouvre sur un nouvel humanisme, celui des Interdépendances au sein de la « maison commune », un humanisme qui refuse de placer les humains en surplomb, les reliant horizontalement aux autres humains (solidarité sociale) et aux vivants non humains (solidarité écologique). C’est celui qui répondra peut-être à votre question de savoir comment transformer la rivalité entre l’Occident, la Chine, le monde Indien et le monde Musulman, par exemple, « non en un cercle vicieux et mutuellement destructeur mais en un cercle vertueux d’une conversation des humanismes, ou plutôt en une spirale productrice d’humanisation réciproque ? »
À condition de faire aussi le choix de la liberté et de la responsabilité, donc de ce qu’on pourrait nommer un humanisme de l’Indétermination, qui conditionne notre créativité et notre responsabilité. C’est un choix difficile car il implique de renoncer à ce que vous nommez « surprotection », celle dont profite une petite partie de l’humanité, améliorée physiquement par les biotechnologies et augmentée dans ses capacités cognitives par l’intelligence artificielle. S’il répond au récit-catastrophe de l’effondrement, par l’aventure de la mondialité plutôt que par le récit-programme chinois des « Nouvelles routes de la soie », ce choix nous « déprotège », pour reprendre votre néologisme, chacun de nous devant renoncer à des excès auxquels le « productivisme-consumérisme » nous a habitués. En croisant les millions de données individuelles accumulées par les réseaux sociaux et les milliards de conversations enregistrées par les agences de renseignements, les démocraties se transforment déjà en un totalitarisme doux, d’autant plus redoutable qu’il exploite notre désir illimité d’avoir accès à tout, tout le temps, sans attendre : « obéissant à des pulsions narcissiques plus puissantes encore que le sexe ou la nourriture, nous passons d’une plate-forme et d’un appareil numérique à un autre, comme un rat de la boîte de Skinner qui, en appuyant sur des leviers, cherche désespérément à être toujours plus stimulé et satisfait »25.
Ainsi se forme au centre de la rose des vents, sur un 4ème plan, un réceptacle octogonal pour recueillir l’eau, élément primordial de la vie. Les huit côtés symbolisent chacune des valeurs primordiales que vous nommez « vraies ». Je dirais plutôt « communes », dans la mesure où elles sont inspirées par les différentes visions de l’humanisme : fraternité et hospitalité reliées à l’humanisme communautariste ; égalité et dignité, ou égale dignité, à l’humanisme d’émancipation ; solidarité sociale et écologique à l’humanisme des interdépendances ; enfin responsabilité et créativité conditionnent un humanisme de l’indétermination. Cet octogone des valeurs a vocation à devenir le centre d’attraction où se réconcilient les paires de vents contraires. À commencer par le couple « sécurité vs liberté » rééquilibré, par exemple face au terrorisme ou à la pandémie, par l’égalité qui limite la discrimination et la dignité qui interdit la déshumanisation, quelle que soit la gravité de la menace. De même que, face au changement climatique, la solidarité écologique devrait limiter les effets de la compétition, tandis que, face à la crise sociale, la solidarité humaine limiterait les risques de la coopération (la tragédie des biens communs). Et ainsi de suite pour les autres couples opposés.
De même que, face au changement climatique, la solidarité écologique devrait limiter les effets de la compétition, tandis que, face à la crise sociale, la solidarité humaine limiterait les risques de la coopération (la tragédie des biens communs).
Mireille Delmas-Marty
Reliées à la « spirale des humanismes », ces valeurs communes contribueraient à stabiliser la gouvernance du monde face à l’imprévisible. Mais comment concevoir une gouvernance démocratique qui stabiliserait les humains sans les asservir ? Sans doute faut-il partir de ce centre où se croisent éthique et droit.
À la croisée des puissances imaginantes de l’éthique et du droit
Olivier Abel
Vous avez raison, c’est bien vers la question des formes et aussi des orientations que pourrait prendre une gouvernance démocratique du monde que tout converge, c’est la clef de voûte de nos questions, mais avant d’y venir je voudrais m’attarder encore un instant sur ces différentes « humanités », et ce qui lie au plus profond le noyau éthique des sociétés et les forces imaginantes du droit. C’est justement parce qu’il existe une pluralité de noyaux éthico-mythiques, de noyaux civilisateurs, et que l’universalisme est contesté comme un impérialisme occidental, qu’il nous faut repartir d’un autre humanisme, plus modeste, celui que Levinas appelait « l’humanisme de l’autre homme », mais aussi celui de la pluralité des humanités, et de la pluralité des « esprits » des lois, si on peut appeler ainsi les « humanités juridiques ».
C’est bien cela qui nous autorise et même nous oblige à déconstruire le concept de colonie, pour distinguer le « droit légitime » des personnes et parfois des peuples à partir, à aller ailleurs, à migrer pour chercher asile et se réfugier, d’une part, et d’autre part « l’abus » qu’il y a à envahir de gré ou de force, en s’appuyant sur des moyens organisés et puissants, qu’ils soient politiques et militaires, économiques et financiers, culturels ou religieux. On voit bien l’asymétrie qui existe entre ces deux situations, et dont l’histoire pourrait multiplier les exemples. La géographie humaine à travers les millénaires et l’écologie toute entière ne sont qu’une succession de colonisations, mais plus ou moins brutales et écrasantes ou douces et fécondes. Le pire est d’envahir, mais tout en se séparant de ceux que l’on envahit, au moyen de ghettos ou de « territoires » séparés — mais aujourd’hui les réseaux en font largement office qui permettent à chaque communauté en archipel, déterritorialisée, de s’enfermer dans ses bulles imaginaires, en se protégeant de tout contact avec autre que soi. L’autre pire est sans doute de prétendre les assimiler au nom d’un universalisme salvateur que l’on impose par tous les moyens et sur tous les registres de la vie sociale.
Mais c’est évidemment une contradiction dans les termes ! Car il n’y a de véritable universalité que résistible, que l’on puisse ne pas accepter et refuser, à laquelle on puisse adhérer librement, comme on le voit chez le Kant de La critique du jugement. Pour Ricœur lisant Arendt, le jugement esthétique de Kant « constitue une avancée d’une extrême audace dans la question de l’universalité, dès lors que la communicabilité ne résulte pas d’une universalité préalable. C’est ce paradoxe de la communicabilité, instauratrice d’universalité »26. À une universalité de surplomb Ricœur oppose ici une sorte d’universalité de proche en proche, liée à cette communicabilité résistible. Une universalité qui ne tient pas tant à la prétention du propos à dire le seul vrai, non plus qu’à l’autorité du locuteur, qu’à la libre réceptivité des récepteurs.
Cette universalité résistible que nous cherchons, j’ajouterais qu’elle est aussi réitérative, au sens où l’universalité, comme le disait Husserl, le fondateur de la phénoménologie, est une tâche sans cesse à reprendre, à répéter, à réinterpréter, à réinventer. Le philosophe américain Michaël Walzer a écrit un très beau texte sur ce sujet il y a une trentaine d’années, dans la revue Esprit, pour montrer comment les véritables universaux sont réitératifs. Ricœur aussi d’ailleurs insistait sur la différence entre les grandes inventions techniques, qui sont irréversibles et cumulatives, et les grandes inventions éthiques, qui sont à réinventer à chaque génération, par une loi de fidélité créatrice.
Cette universalité résistible et réitérative je la dirai encore métaphorique, au sens où nous n’avons accès aux universaux qu’au travers de figures qui sont celles de langues et de cultures. Pour Ricœur nos « universels » sont toujours encore attachés et ancrés dans des contextes linguistiques, culturels, et ne sont pas susceptibles d’un pur concept qui serait entièrement dégagé de la gangue historique et de l’épaisseur langagière où s’exprime la visée. C’est ce qui les rend parfois difficiles à traduire dans d’autres langues et contextes. Ils sont inséparables des langues et de configurations culturelles qu’ils véhiculent et qui les véhiculent. Croire que l’on puisse s’installer de plain-pied dans l’universalité des Droits de l’homme, par exemple, serait justement manquer la nécessaire confrontation de nos universaux, qui ne peut les améliorer que par la rencontre des autres langues et cultures et leur mise mutuelle en état d’émergence. Il est absurde de vouloir séparer les concepts des métaphores qui les ont portés et qui leur donnent leur sens, leur visée inachevée.
Pour penser l’entrecroisement des diverses traditions juridiques dans l’imagination constituante aujourd’hui à l’œuvre, il faut ainsi les faire passer par une épreuve d’universalisation telle que les universaux communs ainsi obtenus ne soient ni imposés ni surplombants. En ce sens, les droits humains, les droits de l’homme et de la femme, les droits des citoyens et des apatrides, me semblent à bien des égards être un concept métaphorique, et réitératif, et résistible. On ne parle ici de droit qu’ « à la limite », de manière métaphorique, et ce sont davantage des idées régulatrices que des règles : les droits humains viennent border le droit tant au niveau infra-juridique des conditions élémentaires de la vie humaine qu’au niveau supra-juridique des divers idéaux qui animent nos sociétés.
Mais ce qui m’intéresse, ce sont les puissants effets imaginaires générés par le rapprochement et la tension entre les grandes orientations éthiques qui traversent nos sociétés. J’ai parlé de ce « noyau imaginant » pour l’Europe.
Entre le droit romain et la common law on a des conceptions éthiques de l’homme et de la société profondément différentes, qui n’ont cessé de prendre greffe les unes sur les autres. Le code Justinien et les sources médiévales n’ont eu de cesse d’intégrer l’idée folle d’une charité anonyme, l’idéal d’humilité dans la charpente du droit romain et le code de la chevalerie guerrière. La probité critique qui fait le cœur de l’ethos scientifique moderne a eu pour contrepoint l’enthousiasme des utopies socialistes et solidaristes, etc. Chaque fois, il a fallu rendre soutenable ce conflit entre des « imaginaires » qui auraient pu s’entre-détruire et n’ont cessé de se corriger mutuellement. Ce n’est donc pas en stérilisant ou neutralisant les traditions que l’Europe s’est constituée, mais en attisant leur différentiel.
Le code Justinien et les sources médiévales n’ont eu de cesse d’intégrer l’idée folle d’une charité anonyme, l’idéal d’humilité dans la charpente du droit romain et le code de la chevalerie guerrière. La probité critique qui fait le cœur de l’ethos scientifique moderne a eu pour contrepoint l’enthousiasme des utopies socialistes et solidaristes, etc. Chaque fois, il a fallu rendre soutenable ce conflit entre des « imaginaires » qui auraient pu s’entre-détruire et n’ont cessé de se corriger mutuellement.
Olivier Abel
Ce point, que je n’ai eu de cesse de souligner dans Le vertige de l’Europe, me semble vital face au nouveau modèle quasi-impérial que la Chine voudrait ouvrir pour « sa » mondalisation. L’alliance qu’elle est en train de nouer sur tous les plans avec une Turquie ambitieuse qui cherche encore sa place montre bien la stabilité inédite du modèle proposé, qui allie l’autoritarisme politique, un capitalisme sans règles sociales mais non sans pilotage, et un retour résolu à une tradition religieuse ou culturelle remaniée et unifiée au format d’un appareil idéologique d’État. En face, la division des pouvoirs et la faiblesse politique des gouvernances démocratiques, la faiblesse économique d’un capitalisme que l’on voudrait toujours mieux régulé, jugulé, bridé, et la faiblesse idéologique de sociétés qui n’ont cessé non seulement de saper les bases de leur légitimité, mais de les neutraliser, n’est apparemment pas à la hauteur face à cet Empire montant !
Je ne nie pas l’importance de ne pas se laisser naïvement intimider, et de reconstruire un rapport de force par lequel les puissances puissent se tenir en respect ; je ne nie pas non plus l’importance de trouver face à l’urgence écologique, un modèle économique et donc aussi technologique susceptible d’emporter l’adhésion des populations à des modes de production et de consommation soutenables. Mais le fond de la question est aussi dans nos formes de culture et d’imaginaire, et vous avez raison : face au Grand Récit néo-impérial que propose la Chine, qui s’impose de gré ou de force dans les décombres de la décolonisation, l’Europe doit proposer une autre forme de mondialité, un autre récit, précisément constitué par ce que Ricœur appelait « l’hospitalité langagière et narrative ». À cette condition, le multi-linguisme européen, et la multiplicité des mémoires enchevêtrées dans ce bout de continent, ne seraient pas une faiblesse, au contraire. Je voudrais soutenir ce caractère excentrique, périphérique et en archipel de l’Europe, d’une Europe ayant profondément renoncé au récit impérial pour prendre modestement appui sur l’incroyable diversité de ses sources, et se tourner tranquillement vers l’aventure du pluralisme méthodique que nous défendons ici, et de ce que j’appelais plus haut une déprotection de soi, condition pour retrouver la faculté d’agir à plusieurs et de sentir ce que nous faisons.
Face à l’ampleur des défis inédits qui se posent à l’humanité, il nous faut ainsi lancer des promesses non moins inédites, et nous avons pleinement besoin de toutes ces forces imaginantes, innovantes, tournées vers le futur, besoin de cet imaginaire instituant : mais j’insiste encore, ces forces imaginantes sont-elles possibles sans reprendre des appuis multiples dans les traditions, expériences et promesses passées, dans l’imaginaire institué ? Il me semble que c’est là une de nos grandes faiblesses contemporaines, ce refus de reprendre largement appui sur les traditions sédimentées, c’est-à-dire justement sur la pluralité des humanités.
Cela me permet de pointer une dernière tension, qui cherche peut-être sa place dans votre magnifique rose des humanités imaginaires ou boussole des possibles : celle entre les droits et libertés individuelles et les libertés et droits des communautés. Quand je dis communautés, je n’entends pas forcément des communautés exclusives, il existe le plus souvent un poly-attachement, une pluri-appartenance. La question est très inaudible en France, qui panique face à tout ce qui lui semble du communautarisme – même si la société française est de fait très communautarisée, et d’autant plus mal qu’elle le dénie. Mais c’est une question importante, sur laquelle des auteurs américains comme Michaël Walzer et d’autres ont beaucoup réfléchi, et qui me tient d’autant plus à cœur que les traditions culturelles se transmettent dans des milieux, et que la réduction de la transmission à la consommation culturelle en régime de marché, et à la communication en régime de libertés individuelles, privilégie systématiquement ce qui sépare l’individu de son milieu. Si les canalisations de la transmission culturelle ont été cassées, si les traditions culturelles (conditions de l’innovation et de la créativité, on l’a dit) sont si faibles, c’est qu’elles ont été laminées par deux fois, par une sorte de double rasoir. La forme républicaine de l’État-nation, d’abord, en donnant les mêmes droits et libertés à tous les citoyens, a cessé de reconnaître une quelconque validité à leurs appartenances, régionales, linguistiques, ethniques, religieuses, etc. Cela part d’un bon sentiment, mais une partie importante des formes de cultures traditionnelles, qui étaient aussi un trésor, ont été ainsi peu à peu marginalisées et éliminées. La forme ultra-libérale de la société de marché, ensuite, en réduisant les traditions ou confessions à des opinions, dont on est libre de changer comme de chemise, a ramené ces diverses formes de vie et de langage au marché des idées, un marché largement dominé par les GAFA, qui déterminent aussi des contenus imaginaires qui sont tout sauf innocents. On sait que pour Hannah Arendt la résistance des traditions, c’est-à-dire des appartenances communautaires, au remodelage totalitaire de l’« homme nouveau », était au cœur de son humanisme.
La forme ultra-libérale de la société de marché, ensuite, en réduisant les traditions ou confessions à des opinions, dont on est libre de changer comme de chemise, a ramené ces diverses formes de vie et de langage au marché des idées, un marché largement dominé par les GAFA, qui déterminent aussi des contenus imaginaires qui sont tout sauf innocents.
Olivier Abel
Qu’en pensez vous ? Quelle place donner aux droits et libertés communautaires dans la société française et en Europe ? Et quelle place donner, dans la rose des humanités, à la tension entre les droits et libertés individuelles et les libertés et droits des communautés ? Suffirait-il de penser méthodiquement la pluri-appartenance, qui reconnaît les appartenances mais qui refuse que les individus y soient incarcérés ?
Mireille Delmas-Marty
Il y a peut-être un début de réponse en ce sens dans la notion de « diversité culturelle » inscrite en 2001 dans la Déclaration Unesco, puis dans une convention en 2005. C’est sans doute la crainte du choc des civilisations qui a conduit l’Assemblée générale de l’Unesco, réunie en novembre 2001, moins de trois mois après les attentats de New York, à affirmer dans un Préambule que « le respect de la diversité des cultures, de la tolérance et du dialogue et de la coopération dans un climat de confiance et de compréhension mutuelles » est « l’un des meilleurs gages de la paix et de la sécurité internationales ». La diversité des cultures, « source d’échanges, d’innovation et de créativité », est donc, pour le genre humain, « aussi nécessaire que l’est la biodiversité dans l’ordre du vivant. » L’article 1 qualifie la diversité culturelle, reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes et futures, de « patrimoine commun de l’humanité ». Et l’article 2 affirme que le pluralisme culturel est la « réponse politique au fait de la diversité culturelle ». Il reste à savoir comment concilier le pluralisme des droits culturels (ou interculturels) et l’universalisme des autres droits de l’homme.
Les rédacteurs n’éludent pas totalement la question car ils reconnaissent une tension entre la diversité des cultures et la « conscience de l’unité du genre humain ». Mais leur réponse se limite à encourager le développement des échanges interculturels et à faire appel aux nouvelles technologies de l’information et de la communication : bien que constituant un défi pour la diversité culturelle (parce qu’elles réduisent les différences ?), les nouvelles technologies « créent les conditions d’un dialogue renouvelé entre cultures et civilisations ». En revanche, les rédacteurs ne disent pas comment surmonter l’apparente contradiction entre les deux pôles. D’une part, le pluralisme des droits culturels pourrait conduire au relativisme, s’il se contente de juxtaposer les différences, au mépris de tout universalisme. D’après le rapport présenté en 2019, à la 40ème session du Conseil des droits de l’homme27 : « L’un des principaux problèmes reste le relativisme culturel. À l’avenir il faudra continuer à distinguer entre les droits culturels qui amplifient les droits de l’homme et le relativisme qui les diminue au nom de la culture et qui est rejeté par le droit international ». Certes l’article 1 de la convention précise : « Nul ne peut invoquer la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la DUDH ou garantis par le droit international, ni pour en limiter la portée ». Mais il ne donne pas de mode d’emploi pour éviter le relativisme. Ni pour éviter le risque inverse que l’universalisme inhérent à la notion d’humanisme (DIDH et DIPén) soit pris à la lettre au point de nier le pluralisme et d’imposer la fusion de toutes les cultures et la disparition de toutes les différences au profit du modèle dominant qui ne serait que le nouvel habit d’un impérialisme qui ne dit pas son nom. Pour tenter une sorte de rééquilibrage, il faudrait d’une part « internationaliser » les différentes cultures, d’autre part « pluraliser » l’universel.
Internationaliser les différentes cultures c’est faciliter les interactions. Edouard Glissant définissait la différence comme « la particule élémentaire de toute relation » : c’est « par elle que fonctionne la Relation avec un R »28. Et il recommandait « d’ouvrir nos poétiques particulières les unes par les autres ». Or cette ouverture a été facilitée à mesure que l’accroissement des interdépendances nées de la mondialisation (internet, migrations) multiplie les interactions faisant des droits culturels de véritables droits « interculturels », la métaphore du langage permettant de distinguer, du plus modeste au plus ambitieux, trois degrés d’internationalisation.
Au premier degré, le dialogue améliore la compréhension, la connaissance sur l’autre et par l’autre. Il facilite le rapprochement et permet selon Glissant de « changer en échangeant sans se perdre ni se dénaturer ». Cette méthode est parfois féconde, comme je l’avais montré à propos du « dialogue des juges sur la peine de mort »29. Mais elle suscite une critique tout à fait pertinente de Sophie Guérard de Latour30 : la vision libérale « dessine davantage un modèle de cohabitation culturelle qu’elle ne prend au sérieux la possibilité d’un dialogue interculturel ». Elle ne permet pas de dépasser une vision « essentialiste » qui suggère des frontières nettes entre cultures libérales et traditionalistes (plus attachées à la religion et aux communautés), alors que chaque culture est traversée par divers courants d’interprétation et d’évaluation des croyances ». Et il est vrai que parfois le dialogue tourne court.
En revanche, la traduction (qui implique la recherche d’équivalences) va plus loin dans l’interaction. Elle rapproche les cultures en harmonisant les différences qu’elle contribue parfois à rendre compatibles. Véritable « miracle », selon Ricoeur, la traduction « crée de la ressemblance là où il ne semblait y avoir que pluralité »31. En effet, elle « respecte les différences, tout en recherchant des équivalences ». Certes, il nous arrive de buter sur les intraduisibles et les malentendus qu’ils provoquent, mais il reste possible de trouver des équivalents, même s’ils sont plus approximatifs et nécessitent un retour au dialogue pour décryptage. En voici un exemple, à l’article 1 de la DUDH, qui commence ainsi : « les hommes sont doués de raison et de conscience ». Au départ le texte évoquait seulement la raison, mais le délégué chinois a fait ajouter le terme d’inspiration confucéenne Liangxin. Or ce terme fut traduit très approximativement par Conscience, alors qu’il s’agit plutôt d’une sorte d’altérité. Même faible, et proche du malentendu (la liberté « de conscience », qui figure à l’art. 18 DUDH est traduite en chinois par un mot différent Yishi), l’équivalence a eu le mérite d’ouvrir un dialogue.
Enfin la créolisation, forme ultime d’interaction, fusionne les différences, mais ce n’est pas une simple mécanique du métissage. C’est un métissage, disait Glissant, « qui produit de l’inattendu »32. Produire de l’inattendu, c’est trouver, au-delà du dialogue et de la traduction, une signification vraiment commune, rejoignant l’idée que, même si toutes les valeurs ne se valent pas, toutes les cultures ont quelque chose à dire sur l’humanité. À condition de préciser que la créolisation, ainsi entendue, suppose la réciprocité : comme les autres droits de l’homme, les droits culturels procèdent d’un processus d’hybridation réciproque. Et il en va de même avec la notion de crime « contre l’humanité » qui se « créolise » en incorporant peu à peu plusieurs visions de l’humanité33.
On en vient alors à « pluraliser l’universel ». On retrouve ici la spirale des humanismes : l’humanisme juridique se veut universel, mais renvoie pour l’essentiel à la modernité occidentale. Le pluraliser invite à « débusquer les biais culturels qui confortent les processus d’oppression »34. C’est donc « déconstruire la prétention de toute culture dominante à incarner l’universel, afin de réhabiliter dans leur dignité propre les formes culturellement diverses de l’humanisme »35. C’est en somme accepter le caractère inachevé, incomplet, évolutif des cultures et exercer la raison critique, en tenant compte de l’évolution des sciences, techniques, savoirs, croyances. L’exemple de quelques grandes erreurs des cultures supposées les plus avancées est édifiant : hier on plaçait la Terre au centre du système solaire ; aujourd’hui beaucoup placent encore l’Humanité au centre de l’écosystème Terre.
Les divers humanismes se succèdent, se côtoient, se chevauchent, se combinent pour dessiner un universel pluriel, dont il faudra équilibrer les inévitables tensions.
Mireille Delmas-Marty
D’où l’idée que les différentes visions de l’humanité ne sont pas déterminées une fois pour toutes car elles sont caractérisées à la fois par rapport aux autres humains (individus ou communautés) et par rapport aux autres vivants non humains. Elles sont donc évolutives. Pour prolonger l’image de la spirale, je dirais que les divers humanismes se succèdent, se côtoient, se chevauchent, se combinent pour dessiner un universel pluriel, dont il faudra équilibrer les inévitables tensions. Il reste à trouver le « fil à plomb » d’une gouvernance démocratique, c’est-à-dire l’outil mobile qui freinerait les mouvements désordonnés du monde humain sans l’immobiliser, canalisant l’énergie dans la construction d’un équilibre dynamique.
Équilibrer : le fil à plomb d’une gouvernance démocratique
Olivier Abel
Revenons pour finir sur la crise de la démocratie. On sent une lente érosion qui à la fois nous démoralise individuellement et nous dépolitise collectivement, et donc à tous égards nous décourage. Il nous faudrait descendre dans le détail de cette fatigue de la démocratie et de cet épuisement moral, et je voudrais en quelques lignes vous faire partager mes perplexités.
Un peu partout dans le monde, des élections, plus ou moins manipulées par des rumeurs, mettent au pouvoir des majorités dangereuses. À cet égard, ce n’est pas « l’extrême droite néo-fasciste » qui est le fond du problème, c’est beaucoup plus généralement, dans tous nos pays simultanément, la tentation identitaire et sécuritaire des forces d’opinion les plus centristes et de « l’État profond… ». Ces majorités, je les dis dangereuses pour toutes les minorités, car les temps sont sombres, partout, pour les « minorités », quelles qu’elles soient, et nous touchons les limites de la démocratie électorale, lorsqu’elle favorise trop les majorités à l’encontre des minorités, et bafouent leurs droits élémentaires. Mais cela est finalement dangereux pour ces « majorités » elles-mêmes, comme l’histoire n’a cessé de le montrer.
Ce qui frappe aujourd’hui c’est une massive montée des ressentiments. Où sont nos affirmations, nos approbations, nos horizons d’attente ? Nous voyons le mal partout : où et comment partager le bon ? Nous ne sommes plus que réactifs, réagissant à tout ce qui nous inquiète, à tout ce que nous ne comprenons pas. Jusqu’où montera ce déluge du ressentiment ? Je voudrais m’attarder à ce qui fait selon moi l’un des ressorts essentiels de cet affaissement démocratique. Reprenons le panorama : quel rapport entre les crimes abjects des djihadistes, le danger que représentent à certains égards les « réseaux sociaux » pour la démocratie et la civilité, la question de la liberté d’expression et du blasphème, le durcissement quasi-guerrier de la laïcité, les gilets jaunes, les majorités dangereuses qui ont porté Trump ou Erdogan au pouvoir, et qui poussent à nos portes ? En fait nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, ces colères qui montent en miroir sans plus rien chercher à comprendre, nous ne savons et sentons plus ce que nous faisons.
Et je voudrais proposer ici une hypothèse. Nous avons globalement fait fausse route. Le drame des caricatures n’est que la partie visible d’un énorme problème, qui touche la fracture sociale, mais aussi le monde des entreprises et du chômage, nos administrations et nos Grandes Écoles, les réseaux sociaux, la vie ordinaire. Nous nous sommes enfoncés dans le déni de l’humiliation, de son importance, de sa gravité, de son existence même. Nous sommes sensibles aux violences, comme aux inégalités, mais insensibles à l’humiliation qui les empoisonne. Comme l’observait le philosophe israëlien Avishaï Margalit, nous n’imaginons même pas ce que serait une société dont les institutions (police, préfectures, administrations, prisons, hôpitaux, écoles, etc.) seraient non-humiliantes. Dans l’état actuel de rétrécissement des ressources planétaires, on aura beaucoup de mal à faire une société plus juste, et dans l’état actuel de durcissement des rapports de force il est peu probable que nous puissions faire une société sans violence ; mais pourquoi déjà ne pas essayer une société moins humiliante ?
Il faut dire que l’humiliation est une notion – et une réalité – compliquée. L’offense est subjective, et dépend au moins autant de ceux qui la reçoivent que de ceux qui l’émettent. Ce qui humiliera l’un laissera l’autre indifférent, et cela dépend même du moment où ça tombe. L’humiliation n’est pas quantifiable, mesurable, comme le sont les coups et blessures. D’où la tentation de dire que là où il n’y a pas de dommage ni préjudice il n’y a pas de tort. Ce n’est pas une affaire de droit mais seulement de sentiment ou de morale personnelle, donc circulez, il n’y a rien à dire. Et il est certain que certains sentiments d’humiliation peuvent être attisés et manipulés, jusqu’à en faire un instrument de crime.
Et pourtant, prenons un peu de recul et réfléchissons de manière plus large, car il ne faudrait pas réduire cette question de l’humiliation au seul contexte du débat sur les caricatures. L’humiliation est un fait social bien plus général, auquel nous sommes étonnamment insensibles. Si les violences s’attaquent au corps de l’autre, dans ses capacités et sa vulnérabilité, l’humiliation fait encore pire : elle s’attaque au visage de l’autre, dans son estime et son respect de soi : elle le fait blanchir ou rougir, et souvent les deux en même temps. Car l’humiliation se présente de deux façons, en apparence contradictoires. Par un côté, elle porte atteinte à l’estime de soi, en faisant honte à l’individu de son expression, de ce qu’il voudrait montrer et faire valoir, elle le rabroue et l’exclut du cercle de ceux qui sont autorisés à parler. Mais, par un autre côté, elle porte atteinte également au respect et à la pudeur, en dévoilant ce qui voulait se cacher, en forçant l’individu à montrer ce qui constitue sa réserve, en le surexposant au regard public, en lui interdisant de se retirer.
L’humiliation ruine non pas tant les échanges immédiats que le circuit long de la reconnaissance, que l’échange marchand ne saurait mesurer. C’est pourquoi les effets invisibles de l’humiliation sont si dévastateurs. Ils courent dans le temps, car les humiliés seront humiliants, et l’humiliation infecte de proche en proche tous les tableaux de la vie, si on ne l’arrête pas. Comme le remarquait Ariane Bazan, ils peuvent aller jusqu’à détruire méthodiquement toute scène de reconnaissance possible, toute réparation possible : la mère tuera tous ses enfants, comme le fait Médée rejetée par Jason. Lisant Euripide, Bazan concluait : « c’est à l’humiliation que répond la barbarie ». Les grandes tragédies sont des scènes de la reconnaissance méprisée, de la méconnaissance réciproque.
L’humiliation ruine non pas tant les échanges immédiats que le circuit long de la reconnaissance, que l’échange marchand ne saurait mesurer. C’est pourquoi les effets invisibles de l’humiliation sont si dévastateurs.
Olivier Abel
L’humiliation s’attaque au sujet parlant mais elle s’attaque aussi aux peuples : c’est l’humiliation du Traité de Versailles qui prépare la venue de Hitler au pouvoir, celle de la Russie ou de la Turquie qui y maintient Poutine et Erdogan, c’est la manipulation du sentiment d’humiliation qui avait propulsé la figure de Trump. Et cette histoire n’est pas finie. Les instrumentalisations machiavéliques de la peur et du ressentiment n’ont jamais atteint, dans tous nos pays simultanément, un tel niveau de dangerosité. Aux manipulations de la peur et de la xénophobie par les néo-nationalistes français, qui sacralisent la laïcité comme si elle n’était plus le cadre neutre d’une liberté d’expression capable de cohabiter paisiblement avec celle des autres, mais la substance même de l’identité française (une identité aussi moniste et exclusive que jadis l’était le catholicisme pour l’Action française), répond la manipulation cynique du sentiment d’humiliation des musulmans par les prédicateurs-guerriers du djihadisme, qui n’ont de cesse d’instrumentaliser le ressentiment, dans le monde et en France. Les djihadistes ici jouent sur du velours, car à l’humiliation ancienne de la colonisation militaire, économique, et culturelle, s’est ajoutée celle des banlieues et du chômage, et maintenant les caricatures du prophète, répétées à l’envi.
On a beaucoup entendu parler du droit de blasphémer : curieuse expression, de la part de tous ceux (et j’en suis) qui ne croient pas au blasphème ! Réclamer le droit de blasphémer, s’acharner à blasphémer, n’est-ce pas encore y croire, y attacher de l’importance ? N’est-ce pas comme les bandes iconoclastes de la Réforme ou de la Révolution qui saccagent les églises, dans une sorte de superstition anti-superstitieuse ? Tout le tragique de l’affaire tient justement au fait que ce qui est important pour les uns est négligeable pour les autres. Il faudrait que les uns apprennent à ne pas accorder tant d’importance à de telles satires, et que les autres apprennent à mesurer l’importance de ce qu’ils font et disent.
Ce qui m’inquiète aujourd’hui c’est le sentiment qu’il n’y a plus rien d’important, sauf le droit de dire que rien n’est important. Une société où tout est « cool » et « fun » est une société insensible à l’humiliation, immunisée à l’égard de tout scandale, puisqu’il n’y reste rien à transgresser, rien à profaner. Or la fonction du scandale est vitale pour briser la complaisance d’une société à elle-même. Pire, lorsque l’ironiste adopte un point de vue en surplomb, pointant l’idiotie des autres, il interrompt toute possibilité de conversation. On peut rire, mais encore faut-il que cela puisse relancer le pacte qui, au nom de notre histoire commune, et inachevée, autorise, au sens fort, la reconnaissance mutuelle.
Notre question est donc d’instituer un théâtre commun d’apparition qui fasse pleinement crédit à la parole des uns et des autres. C’est bien ce qui nous manque le plus aujourd’hui. Encore une fois : mon propos ne concerne pas seulement la question des caricatures, mais tous les registres de notre vivre ensemble et de nos institutions. Je tiens l’humiliation pour le ressort essentiel de la dépolitisation (au sens fort) de notre société.
Pour revenir à ce qui pourrait, face à cela, refonder le pacte politique, je voudrais revenir au courage de l’intelligence. Ce à quoi nos Anciens nous ont rendu attentifs, ce n’est pas seulement au machiavélisme de la « brutalité » et de la « dissimulation » par lesquels les despotes arrivent et restent au pouvoir ; c’est aussi à la « lâcheté » et à la « bêtise volontaire » des peuples qui s’abandonnent à ces facilités. Nous ne manquons pas de sécurité ni de communication !
Ce qu’il nous faut c’est le courage de nous confronter, et l’intelligence de ne pas croire avoir raison tout seul, sans même chercher à nous comprendre mutuellement, à comprendre ensemble ce qui nous arrive. En ce sens, l’intelligence n’est pas intellectuelle, c’est plutôt le fait d’avoir « des intelligences » en dehors de son milieu. C’est aussi sur cette question de l’intelligence que nous devons apprendre à mieux articuler le savoir et le pouvoir, les perspectives de la recherche scientifique et les orientations éthiques et politiques de la gouvernance : et cela d’autant plus que les progrès du savoir sont des progrès dans la conscience de ce que nous ne savons pas, de ce que nous devons accepter de ne pas maîtriser, de ne pas prétendre prévoir.
Et puis, pour replacer cette crise sur le long terme, on se souviendra que le passage du vieux régime « Empire » au régime moderne de l’« État-nation », qui fut celui de l’Europe moderne, ne s’est pas fait sans d’énormes massacres, déplacements de populations et génocides terrifiants – et peut-être même que les guerres de religion sont profondément liées à ces mutations de régimes théologico-politiques. Or nous sommes, par le fait de la mondialisation numérique et des flux migratoires, en train de passer du régime de l’État-nation à un autre régime, et cette mutation est un moment particulièrement dangereux, à la fois un temps de fragilité et un temps de dangerosité des sociétés, pour elles-mêmes et pour les autres. Dans cette société de réseaux mondialisés, nous devons être particulièrement attentifs à l’émergence des formes « mafieuses » que prennent les puissances politico-militaires, commerciales, financières ou même religieuses – quand la seule loi qui demeure est celle des « amis de nos amis », mélange ultra-contemporain de chaleureuse féodalité clanique et de cyniques connexions déterritorialisées.
J’ajouterai que nous avons besoin de penser tout autant un droit instituant, qui régule et oriente de l’intérieur les grands choix de nos sociétés, qu’un droit protestant, je veux dire qui résiste de l’extérieur contre les empiètements trop puissants de gigantesques pouvoirs sans contre-pouvoirs. Il me semble que la démocratie est menacée lorsqu’on n’est plus que dans l’un ou l’autre, avec un droit qui ne fait plus que justifier le système, ou un droit qui ne fait plus que résister, dénoncer, ou protester : des deux côtés le droit est déstabilisé, instrumentalisé. On a d’autant plus besoin d’un droit largement institué, difficilement instrumentalisable, que nous sommes dans un monde brutal, de rapports de force militaires, économiques, mais aussi médiatiques et culturels.
J’ajouterai que nous avons besoin de penser tout autant un droit instituant, qui régule et oriente de l’intérieur les grands choix de nos sociétés, qu’un droit protestant, je veux dire qui résiste de l’extérieur contre les empiètements trop puissants de gigantesques pouvoirs sans contre-pouvoirs.
Olivier Abel
Or, qu’on le veuille ou non « on est toujours barbare avec les faibles », comme le résumait extraordinairement Simone Weil : c’est pourquoi nous devons « armer » un minimum les faibles (avec des droits qui soient des contre-pouvoirs effectifs), et « déprotéger » les forts (avec des devoirs qui correspondent à une responsabilité effective). C’est-à-dire que nous devons faire en sorte que les faibles ne soient pas trop impuissants, et les forts pas trop insensibles – que les uns puissent encore agir (ce qu’il subissent), et que les autres puissent un peu sentir (ce qu’ils font).
Tels sont quelques-uns des éléments par lesquels je décrirais la crise de la démocratie. Et selon vous, comment la décrire, cette crise, comment la raconter, l’expliquer, et finalement la combattre ? Comment réinventer la démocratie, à partir de quoi ? Qu’est ce qui, dans les formes historiques de la démocratie, vous paraît important, prioritaire, devoir être absolument sauvé, et qu’est ce qui serait selon vous secondaire ou contingent ?
Mireille Delmas-Marty
Nous savions que la démocratie était fragile, mais nous pensions que le triptyque « démocratie, état de droit, droits de l’Homme » qui la caractérise résisterait aux dérives. Or nous découvrons qu’il peut facilement être détruit en quelques années dans la plupart des pays européens, et jusque dans notre propre pays : assassinats ciblés, société de surveillance, enfermement préventif, justice prédictive et internements de sûreté marquent un basculement vers un régime autoritaire. D’un droit pénal de la responsabilité, qui fonde la punition sur la preuve de la culpabilité et la proportionne à la gravité de la faute, nous basculons vers un « droit pénal de la sécurité », un droit policier, voire guerrier, qui traite le suspect en criminel en neutralisant la présomption d’innocence et le criminel en ennemi en remplaçant la responsabilité par une dangerosité indémontrable, ajoutant à la punition une « mesure de sûreté » à durée indéterminée. Mis en place à propos des délinquants sexuels (loi 2007), ce droit sécuritaire s’est étendu depuis 2015 au terrorisme.
Puis la pandémie est venue renforcer l’obsession sécuritaire et la folie normative s’est emparée de nos sociétés de la peur, d’autant plus facilement que la combinaison « traçage, affichage et puçage » permet de contrôler des « populations » humaines, assimilées à des produits dangereux. Puis les crises se sont multipliées. Alors que l’état d’urgence sanitaire était déclaré, le retour, tout récemment, des assassinats islamistes réactive nos questions tout en brouillant les réponses. Soutenant les propos du ministre de l’éducation nationale pour dénoncer « l’islamo-gauchisme qui fait des ravages à l’université », un groupe de plus d’une centaine d’universitaires (Le Monde 1er-2 nov 2020) demande la création d’une instance pour détecter les dérives islamistes, au motif qu’« il serait temps de nommer les choses ».
Eh bien oui, nommons-les, mais en sachant que toutes les dénominations n’ont pas la même fonction, ni la même signification. Certaines désignent des valeurs que l’on peut dire « éthiques » car elles nous tirent vers le haut, c’est-à-dire vers le dépassement de soi-même, comme une façon d’élargir l’horizon des possibles. Telle est la fonction de la devise française : « liberté, égalité, fraternité ». D’autres dénominations, comme « laïcité », sont des principes politiques, c’est-à-dire des principes d’organisation de la vie en société, qui, en devenant juridiques permettent le « vivre-ensemble ». Il en va de même à l’échelle du globe, essentielle en ces temps de mondialisation accélérée36. Selon Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité, le principe de laïcité a trois piliers : la liberté, de croire ou pas, de changer de religion, de pratiquer son culte ; la neutralité de l’État et des services publics ; enfin la citoyenneté, notion qui s’adapte à toutes les croyances et religions : « elle n’a pas à s’adapter aux religions, ce sont les religions qui ont à la respecter ».
Mais il y a aussi des manières de nommer sur un ton persifleur, comme « préchi-précha multiculturaliste », « doxa anti-occidentale » des pratiques que l’on veut disqualifier. On en arrive à des formules, comme « islamogauchisme » ou « islamophobie », qui expriment des idéologies opposées, mais ont la même fonction : frapper un individu ou un groupe d’anathème afin de le placer en dehors de la communauté, de l’ex-communier au sens littéral du terme. L’anathème, d’origine religieuse, sera-t-il le langage de nos sociétés mondialisées ? Pourrons-nous faire la paix, sur terre et avec la terre, si toute pensée non conforme à la nôtre est disqualifiée sans véritable débat ? Entre l’émancipation de la religion et l’intransigeance des tendances intégristes, se créent ainsi des tensions qui conduisent à l’incompréhension. De l’incompréhension au ressentiment puis à la colère et à la haine, on en vient très vite à la barbarie, c’est-à-dire à la déshumanisation, qui disperse les énergies et tend à abolir toute possibilité de vivre ensemble.
L’anathème, d’origine religieuse, sera-t-il le langage de nos sociétés mondialisées ? Pourrons-nous faire la paix, sur terre et avec la terre, si toute pensée non conforme à la nôtre est disqualifiée sans véritable débat ?
Mireille Delmas-Marty
Pour rassembler les énergies, et les canaliser au lieu de les disperser, plusieurs techniques juridiques offrent des instruments utiles mais d’usage complexe. D’une part, la liberté d’expression, valeur éthique, est inscrite en droit positif et protégée par la loi car elle est nécessaire à la démocratie. Mais la conformité à la loi ne suffit pas. Depuis l’Après-guerre, la loi n’a plus tous les droits. Elle doit respecter les conditions posées par les dispositifs supra législatifs (cf . Constitution) et supra étatiques (cf. la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, CESDH). Cela dit, l’état de droit n’impose pas la liberté d’expression comme valeur à protection absolue. Limitée à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen par l’obligation de « répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi », la liberté d’expression est aussi limitée par la CESDH : à titre temporaire par les dérogations prévues au cas de circonstances exceptionnelles et de façon permanente par les « restrictions nécessaires dans une société démocratique », assouplies par une « marge nationale d’appréciation » admise par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
Plus récemment est apparu le « vivre-ensemble ». D’abord sociologique et politique, ce concept a été invoqué par la France pour justifier la loi interdisant le port du voile intégral dans l’espace public. Faisant référence au philosophe Levinas pour montrer l’importance du visage comme élément du vivre-ensemble, sans penser alors au risque de contradiction avec le port obligatoire du masque sanitaire, l’argument, soutenu devant la CEDH, a été admis par les juges européens en 2014. La Cour a cependant souligné la « flexibilité de la notion » et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies est parvenu à une solution inverse en 2018, considérant qu’une notion aussi « vague et abstraite » ne pouvait justifier aucune restriction à la liberté religieuse.
La même année, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution instituant une journée internationale du vivre-ensemble, célébrée pour la première fois par l’Unesco en 2019. Présenté comme une « vision cosmopolitique de transition », le vivre-ensemble reste profondément laïque dans sa formulation car les religions sont saisies au niveau de l’individu et de ses choix plus qu’au titre de communauté culturelle37. Leur place est néanmoins plus importante en 2018 qu’en 2001, peu après les attentats du 11 septembre, lors de la Déclaration sur la diversité des cultures, qualifiée « patrimoine commun de l’humanité ».
Pour nécessaire qu’il soit, l’art de nommer les choses est donc un art difficile. C’est aussi un art dangereux quand il conduit à « faire remonter » c’est-à-dire à dénoncer, « les atteintes aux principes républicains et à la liberté académique » et à élaborer un « guide des réponses adaptées », un guide du politiquement correct, à l’intention d’universitaires dont le métier est de former des citoyens émancipés à l’esprit critique et de leur apprendre à penser par eux-mêmes.
Il est vrai que penser par soi-même est un défi quand toutes les crises s’entremêlent. En juin 2020, la France, en état d’urgence sanitaire, mais pas encore frappée par les attentats du mois d’octobre, avait voté deux textes contre le terrorisme. D’une part, la loi Avia obligeant, dans sa mesure phare, les opérateurs de plateforme en ligne et les moteurs de recherche à retirer dans un délai de 24 heures, réduit à une heure pour les contenus terroristes ou pédopornographiques, des contenus « manifestement illicites ». L’expression vise les incitations à la haine, mais plus largement les injures à caractère raciste ou anti-religieux. Constatant que les opérateurs seraient incités à retirer tous les contenus dès qu’ils sont contestés, y compris ceux qui sont licites, le Conseil constitutionnel censure ce dispositif le 18 juin 2020, au motif qu’il pouvait aboutir à une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui ne répondrait pas au triple test de la mesure « nécessaire, adaptée et proportionnée ». Le texte ne sera pas abrogé, mais privé de l’essentiel de sa substance. De même avec la loi, votée le 10 août 2020, pour instaurer des mesures de sureté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes après l’exécution de leur peine. Finalement, trois articles sur quatre sont censurés le 7 août par le Conseil constitutionnel, mais le glissement sécuritaire est admis dans son principe38.
Au stade actuel, on peut donc dire que le juge (national, européen ou à vocation mondiale) reste un rempart contre les dérives sécuritaires, mais un rempart qui s’affaiblit, au motif qu’empiéter sur le pouvoir législatif instituerait un « gouvernement des juges » synonyme de « déficit démocratique ». Or la démocratie ne consiste pas seulement dans la majorité des suffrages, qui peut très bien conduire à des despotismes « légaux ». Elle suppose la résistance des droits de l’Homme et de l’état de droit, et le rôle du juge est d’autant plus important que la banalisation de l’état d’urgence légitime un transfert du pouvoir législatif à l’exécutif.
Dans notre monde « fait de rapports de force politiques, militaires, économiques, mais aussi médiatiques et culturels », vous observez « la montée massive des ressentiments » et dénoncez « les formes mafieuses que prennent les puissances militaires, financières ou même religieuses ». C’est pourquoi le droit risque plus que jamais d’être instrumentalisé, soit pour justifier le système (fonction « instituante »), soit pour protester, résister au système (fonction « protestante »). À défaut de séparation réelle des pouvoirs, l’esprit démocratique pourrait prendre la forme d’une « gouvernance SVP » (Savoir, Vouloir, Pouvoir) : le croisement des Savoirs (les savants et les sachants, science et expérience), éclairerait les Vouloirs citoyens (de la cité à l’Etat-Nation, à l’Europe, puis jusqu’au Monde), qui encadreraient les Pouvoirs (politico-militaires avec les Etats, économiques avec les ETN, culturels…). Encore faut-il renforcer la responsabilité des acteurs les plus puissants et éviter l’asservissement des plus vulnérables. Si le récit-aventure est le plus adapté à l’esprit démocratique, la confiance qu’il postule implique que le droit renforce les responsabilités, et que des juges impartiaux et indépendants apportent une véritable garantie normative39, contribuant ainsi à l’organisation des solidarités et à la mise en œuvre des interactions entre les acteurs et entre les niveaux normatifs.
Pour nécessaire qu’il soit, l’art de nommer les choses est un art difficile. C’est aussi un art dangereux quand il conduit à « faire remonter » c’est-à-dire à dénoncer, « les atteintes aux principes républicains et à la liberté académique » et à élaborer un « guide des réponses adaptées », un guide du politiquement correct, à l’intention d’universitaires dont le métier est de former des citoyens émancipés à l’esprit critique et de leur apprendre à penser par eux-mêmes.
Mireille delmas-Marty
À mesure que se développe ainsi la complexité née de la mondialisation, l’indétermination progresse et les juristes (re)deviennent à la fois des jardiniers et des architectes. Jardiniers, ils apprennent à adapter les sociétés aux surgissements imprévisibles du monde qui les entourent. Architectes, ils imitent les bâtisseurs, des pyramides aux cathédrales, qui réussissaient à amortir les mouvements perturbateurs des vents en plongeant un fil à plomb dans un seau d’eau, afin de retrouver la rectitude, au propre et au figuré. Au figuré, si le fil à plomb symbolise la rectitude des bâtisseurs de cathédrales, il pourrait aussi symboliser la rectitude des constructeurs d’un monde commun et montrer comment passer du grand désordre d’une mondialisation dérégulée à une sorte de « pluralisme ordonné » qui rapproche les différences sans les supprimer, oscillant entre la diversité internationalisée (harmonisée) et l’universalité pluralisée (contextualisée). Pour qu’il y ait du commun il faut qu’il reste des différences, mais qu’elles deviennent compatibles, et pour rendre compatibles les différences, il ne suffit pas de les juxtaposer, encore faut-il les ordonner autour de valeurs communes engendrées par les processus d’humanisation réciproque que nous avons décrits.
Devant la permanence des crises, sanitaires, écologiques, sociales… et l’imminence des catastrophes qu’elles annoncent, la « diversité des clameurs », dont vous parliez au début de notre entretien, pourrait rapidement nous submerger si nous ne reconnaissons pas des valeurs, éthiques et/ou juridiques, suffisamment communes pour guider l’aventure humaine en évitant les deux écueils du Grand effondrement et du Grand asservissement. D’où la nécessité d’un rééquilibrage entre les libertés individuelles et les solidarités collectives ; entre l’esprit de responsabilité et l’esprit d’obéissance, entre l’indépendance et l’interdépendance. Or ce rééquilibrage, chacun de nous — vous l’avez dit en d’autres termes — devra le faire d’abord en lui-même pour renoncer aux modes de vie auxquels le « productivisme-consumérisme » nous a habitués. Ce sera difficile — le mot « renoncement » est d’ailleurs quasi absent du discours officiel —, tant sont fortes nos résistances, véritables « addictions mortifères ». Pour y parvenir, la peur n’est pas la meilleure conseillère, surtout la peur-exclusion, celle qui déshumanise en obéissant aux pulsions du paléocortex, notre vieux cerveau reptilien. En revanche, il faudra valoriser l’imagination, cette capacité jubilatoire du néocortex, particulièrement développée chez les humains, qui réassocie des éléments anciens pour en faire du neuf.
C’est pourquoi je voudrais faire un éloge des « forces imaginantes du droit »40, celles qui creusent dans la profondeur des histoires nationales ou accueillent le surgissement de nouvelles catégories, qu’il s’agisse, par exemple, de repenser l’appropriation des biens ou la représentation des personnes pour orienter cette communauté mondiale en gestation qui inclut désormais les générations futures et le vivant non humain. La notion de bien non appropriable, qui remonte aux anciens « communs », s’élargit aux nouveaux « biens communs mondiaux » que sont des biens aussi différents que la santé, la fiabilité de l’information, ou encore l’équilibre de l’écosystème Terre. Parallèlement, la notion de personne évolue au point de s’ouvrir à des êtres non humains, donc sans responsabilité, tels que la forêt amazonienne ou tel affluent du Gange en Inde. Depuis 2015, ces nouvelles catégories ont inspiré une grande vague de « procès climatiques ». Ces procès, et ceux qui suivront, montrent que l’imagination, quand elle est éclairée par les savoirs et stimulée par « l’émerveillement de faire partie de l’extraordinaire aventure d’être vivant »41, est un puissant moteur pour changer de cap. À condition d’avoir une boussole.
Une boussole des possibles
Olivier Abel
Comment penser l’émerveillement ? Comment accueillir l’imprévisible ? Nous rejoignons pour finir je crois la tension que vous proposez entre le principe responsabilité et le principe espérance. La promesse me semble ici la bonne catégorie, car je suis responsable de mes promesses, surtout si je sais que d’autres comptent sur moi, mais dans le même temps les promesses doivent toujours pouvoir être déliées, et elle ne nous prémunissent pas contre l’imprévisible ou l’inattendu, ni contre l’inespéré. Hannah Arendt montre l’impressionnant pouvoir de stabilisation qu’apporte dans les affaires humaines la faculté de promettre. On voit bien l’importance politique de la promesse, dans les contrats, les traités, les accords inviolables. Selon Arendt, les philosophies et les sociétés d’alliance acceptent cette imprévisibilité générale, et la promesse sert ici à poser des îlots de certitude dans un océan d’imprévisibilité : « lorsqu’on abuse de cette faculté pour recouvrir tout le champ de l’avenir et pour y tracer un chemin bien défendu de tous les côtés, elles [les promesses] cessent de lier et d’obliger, et l’entreprise se retourne contre elle-même »42. C’est cela qui peut nous inquiéter dans ce que vous appelez le Grand asservissement, par lequel les humains voudraient troquer la fragilité des promesses mutuelles par la solidité des grands récits-programmes qui voudraient remodeler le passé et prévoir le futur, de manière totalitaire. L’imagination du possible rouvre dans le passé des promesses enfouies, afin que, comme vous dites, l’imprévisible devienne l’inespéré !
Mireille Delmas-Marty
Certes l’imagination n’a pas réponse à tout. Vous demandiez « Jusqu’où montera ce déluge du ressentiment ? » Nous avons reçu à nouveau une terrible réponse avec la décapitation de Samuel Paty : le ressentiment peut monter jusqu’à la haine et la barbarie, c’est-à-dire jusqu’à la déshumanisation, si nous nous enfonçons jusqu’à ce que vous appelez le « déni de l’humiliation ». Mais l’imagination est sans doute plus puissante que la peur. Ce n’est pas « l’effroi de périr, écrivait Teilhard de Chardin en 1958, mais l’ambition de vivre qui a jeté l’Homme sur l’exploration de la nature et sur les routes de l’air ». L’ambition de vivre, c’est l’élan vital qui nous incite à « durer et grandir » dans l’infinitude du Cosmos, en dépit de la finitude humaine et des limites de la planète. C’est l’élan donné par le « petit souffle innomé venu de sa campagne », pour assister au Congrès des vents d’Edouard Glissant, ou la « petite espérance, cette toute petite fille qui tous les matins nous donne le bonjour » et que Charles Péguy compare au bourgeon, si fragile à l’extrémité de la branche qu’on le détruit sans effort, mais si nécessaire que sans lui l’arbre meurt.
Vous demandiez également « comment concevoir un théâtre commun d’apparition qui fasse pleinement crédit à la parole des uns et des autres » ? La parole elle-même n’y suffit pas et le discours est vite dépassé. Je vous ai dit, au cours de notre conversation, comment, après avoir publié de nombreux textes sur la mondialisation des systèmes de droit, j’ai ressenti les limites du discours rationnel et utilisé la métaphore des nuages pour représenter l’instabilité des systèmes de droit, puis imaginé une rose des vents pour représenter les vents contraires nés de la mondialisation et décrit leur ronde désordonnée. D’où l’idée, pour ajouter la perception sensorielle à la raison cognitive, d’inscrire les mots dans la matière, pour fabriquer une sorte de boussole. Une boussole inhabituelle car sans pôle Nord, mais comportant des figures mouvantes pour représenter les souffles qui animent le monde et indiquer les multiples directions possibles. Une « boussole des possibles », donc, conçue comme un théâtre où les vents de l’esprit rencontrent les vents du monde et où pourraient se raconter, se croiser et se reconnaître mutuellement les regards des humains sur le monde.
Tout cela a été possible par la rencontre improbable d’une juriste et d’un plasticien bâtisseur. Inspirée par la pensée, la matière a pris forme puis, à son tour, elle nous a donné à penser. De la pensée à la matière, le cheminement parcourt la symbolique des quatre états : la Terre, l’Air, le Feu et l’Eau.
La terre : une Rose des vents, massive et minérale, est ancrée au sol ; un réceptacle octogonal est creusé en son centre, tandis qu’une structure minimaliste en forme de cône supporte l’exacte projection graphique de la rose vers le ciel.
Inspirée par la pensée, la matière a pris forme puis, à son tour, elle nous a donné à penser. De la pensée à la matière, le cheminement parcourt la symbolique des quatre états : la Terre, l’Air, le Feu et l’Eau.
Mireille Delmas-Marty
L’air : des figures emblématiques sont disposées par paires opposées à l’extrémité de chaque branche. L’oiseau, en vol ou en cage, symbolise la paire Liberté/Sécurité ; les mains, qui se combattent ou s’enlacent, évoquent la paire Compétition/coopération ; la farandole, associative ou séparative, illustre la paire Exclusion/intégration ; enfin la sphère cérébrale et la sphère terrestre symbolisent la paire Innovation/Conservation. Soumise aux vents contraires du monde, chaque figure, se meut différemment, transformant la Rose terrienne en une Ronde aérienne, aussi désordonnée que le monde des humains.
Le feu : pour tenter de les stabiliser, une spirale survole ces figures mouvantes, portée par un axe tournant et oscillant sur une articulation située à la pointe du cône. Reliant la terre et l’air à l’infinitude du cosmos, la spirale évoque aussi le feu, matérialisé par un éclat de cristal qui réfléchit la lumière du feu solaire, de la lune et des étoiles. Il représente, perché en haut de la spirale, le « petit souffle innommé », citoyen du monde symbolisant l’élan vital des nouvelles générations43.
L’eau : l’articulation prolonge l’axe de la spirale et transmet les mouvements résultant de la Ronde des vents à un fil à plomb, symbole de la rectitude. La masse du fil à plomb est immergée dans l’eau, élément primordial contenu dans le réceptacle. Ce lieu stabilisateur est comme un centre de gravité où se rencontreraient, dans l’octogone des valeurs, Terre, Air, Feu et Eau.
À son tour, la matière donne à penser : sans le fil à plomb qui la tient érigée, la spirale s’affaisse, les humanismes disparaissent et c’est le Grand effondrement annoncé par les collapsologues. Mais sans les humanismes (les valeurs qu’ils engendrent, et les principes régulateurs qui les portent), le monde peut aussi s’orienter vers le Grand asservissement qui évoque les récits-programmes inspirés notamment des Nouvelles routes de la soie.
À moins de renoncer aux certitudes de la pensée dogmatique pour les incertitudes d’une pensée dynamique et de tenter une anticipation ouverte : ni prédire, ni prescrire, mais accueillir l’imprévisible quand il vient. La seule ambition de cette « boussole des possibles » est de suggérer au spectateur qui joue le jeu de l’analogie entre les vents du monde et les vents de l’esprit que le pire n’est pas inéluctable et qu’il est encore possible de trouver un équilibre dynamisé par la spirale des humanismes et stabilisé par le fil à plomb d’une gouvernance démocratique plongé dans l’octogone des valeurs et des principes régulateurs. Suggérer qu’il est encore possible, donc, d’imaginer un monde qui serait pacifié sans être uniformisé, harmonisé sans être unifié, stabilisé sans être immobilisé.
Sources
- Mireille Delmas-Marty, Sortir du pot au noir, L’humanisme juridique comme boussole, Buchet Chastel, 2019.
- Jan Patočka, Platon et l’Europe, Paris Verdier 1983, p.14 (texte rédigé en 1973, juste après le rapport du Club de Rome, auquel il fait brièvement référence).
- Mireille Delmas-Marty, Aux quatre vents du monde, Seuil, 2016 ; Sortir du pot au noir, Buchet Chastel, 2019.
- Les puissances du droit, c’est leur faiblesse et c’est leur force, n’ont pas le caractère imposable de la puissance technique (les concurrents ou adversaires doivent devenir commensurables ou disparaître) : le droit est par définition transgressable, sinon ce n’est plus du droit.
- Edouard Glissant, « La pensée du tremblement n’est ni crainte ni faiblesse mais l’assurance qu’il est possible de durer et de grandir dans l’imprévisible », La Cohée du Lamentin, Gallimard, 2005 p. 23.
- Préambule de la Déclaration de Rio, Sommet de la Terre, 1992.
- Enrico Letta, « l’interdépendance humaine guidera notre transition », Le Monde, 22 mai 2020.
- Loi n°2017-399 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre.
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
- La garantie normative, dir. Catherine Thibierge, à paraître Mare & Martin, 2020.
- Edouard Glissant, La Cohée du Lamentin, Gallimard, 2005 p. 23.
- Olivier Abel, Le vertige de l’Europe, Genève, Labor et Fides, 2019.
- Nous avons laissé « orwelliser » certains passés, le passé colonial, le passé catholique, par exemple, désormais à la fois occultés dans un amalgame total, dissimulés, défigurés, et je dirai enterrés vifs dans ce qu’ils avaient de vivant et de vécu : c’est historiquement simpliste et politiquement décourageant, car on ne peut plus prendre appui sur rien dans le passé, sinon sur un imaginaire amnésique et plaqué, qui empêche d’ailleurs toute véritable critique.
- Cf. Olivier Abel et Jean-François Lyotard, in « L’Émancipation comme problème 1789-1989 ». Autres Temps. Les cahiers du christianisme social. N°25, 1990.
- Il faudrait peut-être les lire sous la polarisation de l’imaginaire social (idéologie-utopie) proposé par Ricœur après Mannheim (Paul Ricœur, Idéologie et Utopie, Paris Seuil 1997, et Du texte à l’action, Paris Seuil 1986).
- Les chemins de la répression, PUF, 1980 ; Sur les chemins d’un Jus commune universalisable, à paraître Mare & Martin
- Modèles et mouvements de politique criminelle, Economica 1983, Les grands systèmes de politique criminelle, PUF, 1992
- « Au Pays des nuages ordonnés » in Pour un droit commun, Seuil, 1994
- Mireille Delmas-Marty, Aux quatre vents du monde, Seuil, 2016
- Mireille Delmas-Marty, Sortir du pot au noir, l’humanisme juridique comme boussole, Buchet Chastel, 2019.
- Mireille Delmas-Marty, Une boussole des possibles, Gouvernance mondiale et humanismes juridiques, éd du Collège de France, 2020.
- Mireille Delmas-Marty, Sortir du pot au noir, Buchet/Chastel, 2019 ; Une boussole des possibles, Éd Collège de France, 2020.
- Patrick Chamoiseau, Frères migrants, Seuil 2017 ; Osons la fraternité, dir M. Le bris et éd. Philippe Rey, 2018 ; Registre sur l’hospitalité du groupe Pérou, etc.
- Conseil Constitutionnel, avril, 2018.
- Bernard Harcourt, La société d’exposition. Désir et désobéissance à l’ère du numérique, Seuil, 2020.
- Paul Ricœur, Le Juste, Paris, Esprit, 1995, p. 148.
- Karina Benoune, Droits culturels : Rapport marquant le 10ème anniversaire du mandat, A/HCR/40/53.
- Edouard Glissant, L’imaginaire des langues, Gallimard, 2010.
- Mireille Delmas-Marty, Le pluralisme ordonné, Seuil, 2006, p. 53 sq.
- Sophie Guérard de Latour, « L’humanisme, une valeur à partager entre différentes cultures », Observatoire des politiques culturelles, 2017, p. 25s.
- Paul Ricœur, « Le paradigme de la traduction », in Le juste, Esprit, 2ème éd 2001, p. 135.
- Edouard Glissant, La Cohée du Lamentin, Gallimad, 2005.
- Mireille Delmas-Marty, Vers une communauté de valeurs, Seuil, 2011, pp. 81-98.
- Sophie Guérard de Latour, op.cit., p. 28.
- Ibidem.
- Voir Olivier Mongin et Jean-Louis Schlegel, « les défenseurs de la caricature à tous vents sont aveugles aux conséquences de la mondialisation », Le Monde, 4 novembre 2020.
- Gildard Renou, in Le vivre-ensemble saisi par le droit, dir Marie Rota, à paraître, Pedone, 2020.
- J. Alix, « Au tournant de la punitivité en matière terroriste », Lexbase, octobre 2020, à paraître.
- E. Nicolas observe « l’érosion de plus en plus rapide de la garantie normative des droits au profit de la montée en puissance de la garantie normative du vivant », in La garantie normative, dir. Thibierge, précité.
- M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit, 4 vol. Seuil, 2004-2011 ; Une boussole des possibles, précité.
- B. Morizot, « Il faut politiser l’émerveillement », Le Monde, 6 août 2020.
- Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris éditions Agora poche, 1983, p. 312.
- Mireille Delmas-Marty, « Au congrès des vents », Aux quatre vents du monde, précité, p. 127 s.