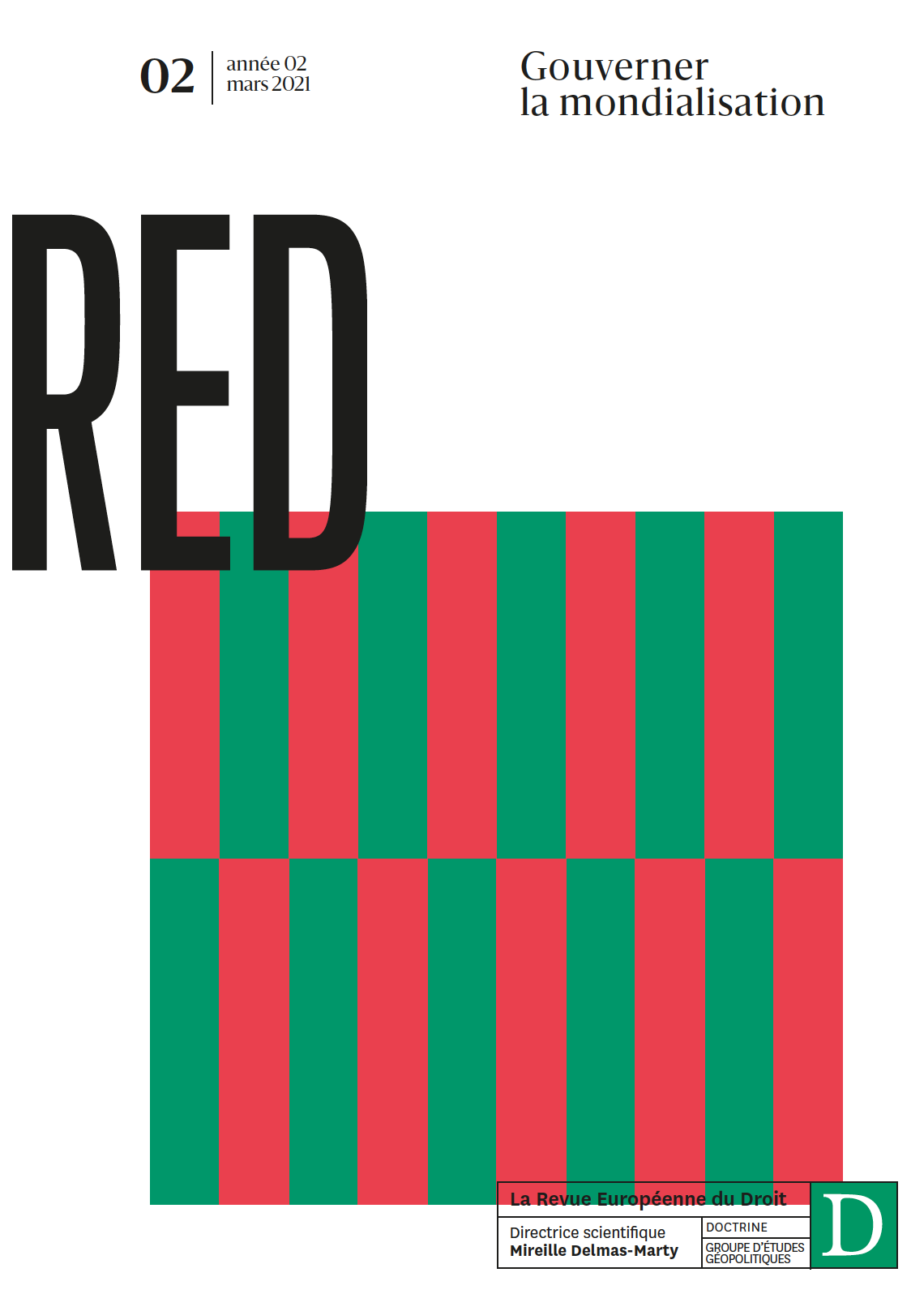Cet article est également disponible en version anglaise sur le site du Groupe d’études géopolitiques.
La fiscalité de l’économie numérique1 offre un excellent terrain d’observation des velléités de l’outil juridique à gouverner la mondialisation2 tout autant que des difficultés à rendre une telle perspective concrète.
D’un côté, l’incompréhension suscitée par le faible niveau d’imposition de grandes entreprises de l’économie numérique, dans des États où elles génèrent pourtant d’importants revenus, a puissamment contribué à la naissance d’un élan de coopération internationale inédit. Depuis une dizaine d’années, ce sont ainsi près de 140 pays qui réfléchissent, sous l’égide de l’OCDE, à la manière d’adapter leurs règles de taxation des entreprises à plusieurs phénomènes, intimement liés à la numérisation de l’économie, qui bouleversent les conceptions traditionnelles sur lesquelles reposent le droit fiscal international depuis un siècle. Ce mouvement a d’ores et déjà conduit à de significatives évolutions des règles comme des pratiques, à l’échelle mondiale, en particulier sur le terrain de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
D’un autre côté, lorsque l’attention se porte sur la question plus spécifique de l’imposition des bénéfices des grandes entreprises de l’économie numérique, la difficulté à faire converger les gouvernements vers des réponses juridiques communes reste frappante, et ce quand bien même les modèles d’affaire privilégiés par ces entreprises soulèvent partout dans le monde des problèmes identiques. Ainsi, malgré un consensus quasi-global sur les limites du système fiscal actuel, les initiatives purement nationales – et hautement politiques3 – se multiplient dans le plus grand désordre, suscitant levées de boucliers et menaces de représailles de la part d’États s’estimant victimes de pratiques discriminatoires. La perspective d’une réponse juridique uniforme à un enjeu clairement global reste ainsi, pour l’heure, très hypothétique.
Lorsque l’attention se porte sur la question plus spécifique de l’imposition des bénéfices des grandes entreprises de l’économie numérique, la difficulté à faire converger les gouvernements vers des réponses juridiques communes reste frappante, et ce quand bien même les modèles d’affaire privilégiés par ces entreprises soulèvent partout dans le monde des problèmes identiques.
Martin Collet
Avant de préciser les défis fiscaux que soulève le phénomène de numérisation de l’économie et la manière dont les États tentent d’y répondre, il est utile de rappeler brièvement d’où vient l’actuel système fiscal international afin de comprendre le constat d’inadaptation qu’il suscite aujourd’hui.
Un système fiscal mondial conçu dans les années 1920
La manière dont les États se répartissent le droit d’imposer les revenus des entreprises multinationales s’appuie encore aujourd’hui sur un modèle conçu par la SDN en 1928
De manière paradoxale, si la fiscalité a toujours constitué un attribut évident de la souveraineté, elle apparaît comme l’un des terrains les plus anciens de développement d’une forme de globalisation juridique. Dès les années 1920, la Société des nations (SDN) s’est lancée dans un ambitieux programme de réflexion sur la manière dont les États pourraient coordonner leurs compétences fiscales afin d’éviter certains « frottements » préjudiciables aux échanges économiques. Pour l’essentiel, la SDN entendait combattre les hypothèses de « double imposition », liées aux situations dans lesquelles deux États peuvent, sur la base de leurs règles domestiques respectives, revendiquer tout autant le droit de taxer un même profit ou un même patrimoine. S’agissant par exemple de sommes gagnées à l’étranger par un individu ou une entreprise, l’État dit « de source » peut légitimement souhaiter taxer ce revenu généré sur son sol, tandis que l’État « de résidence » prévoit généralement d’imposer l’ensemble des revenus des contribuables domiciliés sur son territoire, y compris les revenus de source étrangère.
Pour réduire ces risques, la SDN a publié en 1928 un premier modèle de convention dont, aujourd’hui encore, les dispositions guident, en substance, les conventions fiscales bilatérales que signent la plupart des pays du monde avec leurs partenaires économiques. Ces conventions consistent à répartir entre les États signataires les différentes formes d’enrichissement – voire de patrimoine – afin d’éviter les situations de double imposition. Ainsi, par exemple, les signataires s’accordent généralement pour laisser à l’État de source le droit de taxer les revenus dits « passifs » (revenus du patrimoine, en particulier) générés sur son sol – y compris s’ils sont perçus par des résidents de l’autre État signataire – tandis que, à l’inverse, l’État de résidence est seul habilité à taxer les revenus d’activités, y compris d’activités conduites dans l’autre État (sauf à ce que l’entreprise y dispose d’un « établissement stable », c’est-à-dire d’une implantation fixe et durable ayant une activité propre).
Pour l’essentiel, la SDN entendait combattre les hypothèses de « double imposition », liées aux situations dans lesquelles deux États peuvent, sur la base de leurs règles domestiques respectives, revendiquer tout autant le droit de taxer un même profit ou un même patrimoine.
MARTIN COLLET
De nouveaux modes de création de valeur
L’usage des technologies numériques rend difficile l’identification des lieux de création de valeur, tout autant que leur lieu de taxation.
Les évolutions récentes des modèles de création de valeur privilégiés par de nombreuses entreprises tendent à ébranler ce modèle traditionnel de répartition de la matière imposable entre États de source et États de siège. Pour le dire d’un mot, ces modèles rendent chaque jour plus difficile l’identification du ou des lieux de création de valeur d’une activité et, dès lors, la répartition des droits à taxer cette valeur entre les États concernés.
À cet égard, les grandes entreprises du numérique offrent assurément les exemples les plus frappants de ces difficultés – ce qui explique qu’elles soient devenues pour beaucoup le symbole d’évolutions, voire de dérives qui, à la vérité, ne leur sont pas propres. On pense ici aux entreprises qui, telles Facebook ou Google, génèrent d’importants revenus grâce aux services fournis à des utilisateurs et à de clients domiciliés sur le territoire d’États où elles n’ont parfois aucune présence physique. Or les 4500 conventions bilatérales qui, aujourd’hui, s’inspirent toutes peu ou prou du modèle proposé par l’OCDE (qui a pris, en cette matière, le relais de la SDN), accordent en principe au pays où l’entreprise est domiciliée – ou, au moins, dispose d’une installation fixe d’affaire (succursale, bureaux, usine, etc.) – le droit de taxer ces bénéfices. C’est ainsi, par exemple, qu’il revient seulement à l’Irlande d’imposer les profits réalisés en France par Google dès lors que ses activités lucratives de placement d’espaces publicitaires sont conduites par des employés effectivement présents dans les murs de la filiale européenne du groupe, installée à Dublin. Cette déconnexion entre, d’une part, le territoire sur lequel est créée – ou, du moins, réalisée – une bonne part de la valeur générée par l’entreprise et, d’autre part, son lieu de taxation apparait aujourd’hui, aux yeux de nombreux gouvernements comme des opinions publiques difficilement compréhensibles.
Mais là n’est pas la seule difficulté à laquelle les États sont confrontés, loin s’en faut. En effet, l’essentiel de la valeur produite par l’activité de bon nombre d’entreprises, y compris dans des secteurs « traditionnels » (l’hôtellerie et la restauration, par exemple) repose aujourd’hui sur des actifs dits incorporels – un algorithme pour Google et, plus souvent, une marque, des brevets, des savoir-faire, etc. – qui peuvent eux-mêmes se retrouver localisés à peu près n’importe où, auprès de filiales dédiées. L’affaire Starbucks, née en Grande-Bretagne en 2012 a bien mis au jour cette problématique. Malgré un chiffre d’affaires dépassant, entre 2010 et 2012, les 2 milliards de Livres sur le sol britannique, l’entreprise a réussi à n’y payer aucun impôt sur les bénéfices, en délocalisant l’intégralité de ses profits via une filiale installée aux Pays-Bas et chargée du contrôle des actifs incorporels du groupe pour toute l’Europe – actifs dont l’utilisation était facturée au prix fort aux distributeurs locaux, notamment britanniques4. De même, l’ensemble des grandes entreprises américaines de l’économie numérique bénéficiaient à la même époque de montages sophistiqués permettant – en toute légalité – de minimiser leur taux global d’imposition en localisant l’essentiel de leurs bénéfices auprès de filiales implantées dans des États accommodants (Caïmans, Bermudes…), après les avoir fait transiter par différents États-tunnels dont la législation et les conventions bilatérales autorisaient ce genre de pratique5.
Cette déconnexion entre, d’une part, le territoire sur lequel est créée – ou, du moins, réalisée – une bonne part de la valeur générée par l’entreprise et, d’autre part, son lieu de taxation apparait aujourd’hui, aux yeux de nombreux gouvernements comme des opinions publiques difficilement compréhensibles.
MARTIN COLLET
Enfin, s’ajoute une difficulté plus redoutable encore : celle tenant aux modalités d’identification de ce qui fait la valeur de certaines prestations – valeur qui doit pourtant être appréhendée afin d’être localisée puis taxée. Par exemple, s’il est clair que les revenus publicitaires de Google ou de Facebook sont liés aux informations récoltées auprès des utilisateurs (à travers leur historique de recherche, notamment), faut-il et, le cas échéant, comment valoriser cette participation des utilisateurs – ce « travail gratuit », comme l’avait qualifié le Rapport Collin-Colin6 – à la création de la valeur globale de la prestation vendue par Google ou Facebook à ses clients ? Et, au-delà, comment déterminer à coup sûr la « juste valeur » de certains actifs incorporels – l’algorithme de Google ou la recette du Frappuccino de Starbucks, par exemple – afin de déterminer leur niveau acceptable de rémunération ? Cette question du montant des « prix de transfert », c’est-à-dire des prix auxquels des entreprises d’un même groupe se facturent entre elles (et donc « hors marché ») des biens ou des services est évidemment cruciale pour les États : le niveau d’imposition dépend directement du niveau des bénéfices qui, lui-même, est fonction du montant des charges déduites par l’entreprise du fait des prix de transfert que lui auront facturés ses filiales et sa maison-mère.
Le projet BEPS face aux « défis de l’économie numérique »
Les progrès de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales restent ternis par l’incapacité des États à apporter une réponse commune aux défis de l’économie numérique
Face à ces constats, les États n’ont réagi qu’assez tardivement. Ils ont d’abord préféré concentrer leur attention sur les comportements les plus évidemment contestables lorsque, aux lendemains de la crise de 2007-2008, le besoin de retrouver des marges de manœuvre budgétaires s’est fait jour et tandis que, concomitamment, la presse révélait des pratiques massives de fraude fiscale abritées par quelques « paradis fiscaux » (le Liechtenstein, en particulier7). Agacés d’avoir été contraints d’apporter des aides financières énormes pour sauver des banques qui, dans le même temps (pour certaines en tout cas) facilitaient des fraudes fiscales réduisant d’autant les recettes publiques, les gouvernements ont rapidement mis en œuvre diverses mesures vigoureuses, à l’échelle étatique (comme avec la loi FATCA, aux États-Unis, en 20108) comme internationale (à travers les actions contre le secret bancaire et pour le développement des échanges d’informations entre administrations fiscales conduites par l’OCDE à l’invitation du G209).
Ce n’est que dans un second temps que l’attention s’est concentrée sur les différents processus permettant à de nombreuses grandes entreprises transnationales de réduire leur niveau d’imposition d’une manière certes légale mais problématique du point de vue des finances publiques comme, à bien des égards, de l’équité. C’est ainsi qu’en 2012, l’OCDE a convaincu le G2010 de la soutenir dans un projet baptisé « BEPS » (Base erosion and Profit shifting ou Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfice) qui, comme son nom l’indique, entendait mettre au jour certaines pratiques d’optimisation fiscale potentiellement contestables afin, idéalement, de proposer les moyens d’y remédier.
Dès l’origine, les entreprises de l’économie numérique – au premier rang desquelles les « GAFA » (Google, Amazon, Facebook, Apple) – étaient clairement dans le viseur des travaux de l’OCDE.
MARTIN COLLET
Dès l’origine, les entreprises de l’économie numérique – au premier rang desquelles les « GAFA » (Google, Amazon, Facebook, Apple) – étaient clairement dans le viseur des travaux de l’OCDE. La première des quinze « actions BEPS » se proposait ainsi de « relever les défis posés par l’économie numérique »11. Non pas que ces entreprises soient alors accusées d’adopter des comportements fiscaux spécialement « agressifs », en comparaison d’autres multinationales. Toutefois, au regard de plusieurs caractéristiques de leurs modèles économiques et de leurs politiques d’implantation – celles qu’on évoquait plus haut –, elles soulèvent, aux yeux des États, des risques d’« érosion des bases fiscales » d’une particulière acuité12.
Pourtant, lors de la publication en 2015 des différents Rapports BEPS et dans les années suivantes, la question de l’économie numérique fut reléguée au second plan. L’OCDE préféra se concentrer sur les terrains plus fertiles à l’élaboration de solutions consensuelles : création de normes « anti-abus » (afin d’anéantir l’intérêt du recours à certains montages fiscaux purement artificiels), développement des mécanismes de coopération entre administrations fiscales, multiplication des obligations de « reporting » par les entreprises, rédaction d’un « instrument multilatéral » innovant permettant aux États intéressés de modifier simultanément leurs conventions fiscales bilatérales afin d’intégrer les nouvelles armes anti-fraude proposées par l’OCDE, etc13.
De même, à l’échelle européenne, plusieurs directives inspirées des travaux de l’OCDE ont imposé aux législations nationales d’intégrer un arsenal d’armes anti-fraude et anti-évasion14. Certains États longtemps accusés de faciliter l’optimisation voire l’évasion fiscales (le Luxembourg et les Pays-Bas, en particulier) ont ainsi révisé leur législation et s’efforcent d’adopter les meilleures pratiques en matière de transparence et de lutte contre les comportements abusifs des entreprises15. Ces évolutions traduisent l’émergence de standards juridiques susceptibles de s’imposer à l’échelle globale tant le sujet de la fraude fiscale est devenu sensible : l’étiquette de « paradis fiscal » devient très difficile à porter, y compris par certains petits États longtemps associés à cette expression16.
es évolutions traduisent l’émergence de standards juridiques susceptibles de s’imposer à l’échelle globale tant le sujet de la fraude fiscale est devenu sensible : l’étiquette de « paradis fiscal » devient très difficile à porter, y compris par certains petits États longtemps associés à cette expression.
MARTIN COLLET
Vers de nouveaux principes de taxation des profits des multinationales ?
« Pilier 1 » et « Pilier 2 » : les nouvelles initiatives de l’OCDE pour modifier l’allocation des droits de taxer les profits des multinationales
S’agissant des défis posés spécifiquement par la numérisation de l’économie, les constats dressés par le Rapport Collin-Colin et largement repris par le Rapport sur l’Action 1 de BEPS n’ont jamais été démentis. Pourtant, les États se sont montrés incapables, jusqu’à présent, de s’entendre sur les conséquences à en tirer.
À l’échelle globale, l’OCDE a déployé d’importants efforts pour tenter d’effacer le relatif échec de l’Action 1 qui, faute de consensus – du fait notamment des réticences de l’Administration Obama aux propositions susceptibles d’affecter certaines grandes entreprises américaines –, n’avait débouché sur rien de tangible. Contre toute attente, l’élection de Donald Trump a modifié la donne. L’essentiel des préoccupations causées par les pratiques des grandes entreprises du numérique coïncidait en effet avec celles prises en compte, plus globalement, par la réforme fiscale initiée par les Républicains en 2017 et visant notamment à favoriser la relocalisation des bénéfices des entreprises américaines sur le sol des États-Unis tout en instaurant un mécanisme de taxation minimale de leurs profits réalisés à l’étranger17.
Adoubées par les États-Unis, de nouvelles négociations « BEPS 2.0 » ont ainsi débuté en janvier 2019 dans un « cadre inclusif » réunissant 140 pays, puis un plan de travail a été adopté par le sommet du G20 de Fukuoka des 8 et 9 juin 2019. Ces discussions ont conduit à deux séries de propositions entérinées par les membres du cadre inclusif en janvier 202018.
D’abord, un « pilier 1 » a pour objet de mieux prendre en compte le lieu de vente de divers biens et services (au-delà même du cas des entreprises du numérique) dans la localisation des bénéfices générés par ces ventes. Concrètement, l’idée consiste à proposer une clé de répartition des profits qui tienne compte non plus seulement de l’État de siège de l’entreprise mais aussi des États de consommation, afin d’allouer à ces derniers une fraction du bénéfice réalisé sur leur sol par les entreprises n’y étant pas implantées. Ensuite, un « pilier 2 » entend introduire un taux effectif minimal d’imposition pour les multinationales, en permettant aux États de taxer leurs groupes internationaux pour les bénéfices réalisés à l’étranger et peu ou pas imposés grâce au jeu des conventions bilatérales. Il s’agit alors de dissuader les délocalisations de bénéfice à finalité purement fiscale et de limiter ainsi la concurrence fiscale entre États.
Toutefois, du fait notamment de la volte-face des États-Unis qui, fin 2020, ont pris leurs distances avec les négociations19, les propositions de l’OCDE restent pour l’heure dans les cartons. À dire vrai, rien n’indique que d’autres États ayant activement participé aux discussions ne pourraient pas déchanter lors de l’examen plus détaillé des conséquences pratiques que pourrait impliquer la mise en œuvre concrète des deux piliers. Rien ne permet d’affirmer, notamment, que la France serait gagnante en cas d’application du « pilier 1 » : pour quelques milliards d’impôts potentiellement prélevés sur les bénéfices de Google et de Facebook, combien devraient être abandonnés sur les profits réalisés à l’étranger par LVMH ou Sanofi ?
Pour quelques milliards d’impôts potentiellement prélevés sur les bénéfices de Google et de Facebook, combien devraient être abandonnés sur les profits réalisés à l’étranger par LVMH ou Sanofi ?
MARTIN COLLET
Dans l’attente d’une réponse globale, les propositions de la Commission européenne
Malgré les divergences entre États membres, la Commission européenne propose une réponse au « sentiment d’injustice » que ferait naître la faible taxation, sur le sol européen, des géants du numérique
De son côté, la Commission européenne a présenté en mars 201820 plusieurs propositions qui, dans l’attente d’une hypothétique solution globale dégagée par l’OCDE, pourraient limiter les risques d’érosion des bases fiscales et, à tout le moins, répondre au « sentiment d’injustice »21 né, selon la Commission, des modalités actuelles de taxation des entreprises du numérique. La Commission assume ainsi le caractère autant politique que juridique de sa démarche : il s’agit bien pour elle de prouver la capacité de l’Europe à agir sur un sujet de portée globale sans attendre l’assentiment des États-Unis. Ces propositions lui permettent également, fort subtilement, de suggérer qu’il existerait bel et bien une opinion publique européenne homogène (partageant en l’occurrence un sentiment d’injustice) dont les aspirations pourraient être efficacement portées par les institutions européennes.
D’après la Commission, une première proposition consisterait à établir de nouvelles règles d’imposition des sociétés ayant une « présence numérique significative » sur le territoire d’un État : celui-ci gagnerait le droit d’imposer une partie des bénéfices liés à cette présence « virtuelle », en l’absence même d’implantation physique. Il s’agit là d’une proposition aussi audacieuse que difficile à mettre en œuvre : elle implique de réviser chacune des conventions fiscales bilatérales signées par chaque État membre car toutes, actuellement, déterminent le lieu d’imposition des bénéfices des entreprises sur le fondement de la notion universellement admise d’« établissement stable » qui, elle-même, repose sur des critères de présence essentiellement physique. Une seconde proposition tiendrait à un système commun de taxe sur le chiffre d’affaires dégagé par les entreprises grâce à certains services numériques.
Cette dernière proposition a recueilli un accueil plus que mitigé. Seuls dix États sur vingt-sept l’ont jugé pertinente22 et plusieurs ont manifesté leur franche hostilité. Ainsi en est-il d’abord de l’Irlande. Alors même qu’une telle taxe n’occasionnerait qu’une perte très limitée de recette pour ce pays, son gouvernement a fait valoir qu’il estimait essentiel de maintenir ces discussions au niveau de l’OCDE afin d’aboutir à des solutions à une échelle mondiale23. Tout en partageant ce sentiment, la Suède est opposée au principe même d’une taxe sur le chiffre d’affaires, en estimant « qu’elle entraverait l’innovation, les investissements et la croissance dans l’Union et nuirait à sa compétitivité par rapport aux autres régions »24. Le Danemark et le Luxembourg partagent pour l’essentiel ces points de vue25.
Face au blocage de la proposition de la Commission et dans l’attente d’une éventuelle solution globale, plusieurs États européens ont introduit – ou au moins annoncé leur intention de la faire – un dispositif de taxation visant spécifiquement certains services numériques.
MARTIN COLLET
Les initiatives nationales de taxe sur les services numériques
À défaut d’une réponse globale, plusieurs États privilégient la mise en place de taxes purement nationales sur certains services numériques
Face au blocage de la proposition de la Commission et dans l’attente d’une éventuelle solution globale, plusieurs États européens ont introduit – ou au moins annoncé leur intention de la faire – un dispositif de taxation visant spécifiquement certains services numériques. Dans l’esprit de leurs promoteurs, ces dispositifs ont notamment pour intérêt de maintenir la pression sur les organisations internationales et, plus encore, sur leurs membres les plus frileux : la perspective d’une multiplication de ces taxes peut en effet les conduire à se laisser convaincre qu’une réponse globale serait finalement un moindre mal.
Ainsi, en France, une loi de 201926 a instauré une taxe de 3 % frappant les revenus des services de type « marketplace » (Amazon, Blablacar, Airbnb, etc.) et ceux tirés du placement de messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l’utilisateur. Seules sont concernées les entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires au niveau mondial et 25 millions d’euros au titre des services fournis en France.
Plusieurs projets comparables ont été introduits, ou sont en voie de l’être, par plusieurs pays européens : l’Autriche, la République tchèque, la Hongrie, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni27. De même, au-delà des frontières européennes, plusieurs grands pays – le Brésil, l’Inde, l’Indonésie et la Turquie – ont déjà mis en œuvre (ou envisage de le faire) une « taxe sur les services numérique » (digital services tax) comparable à la « taxe GAFA » française, comme l’a récemment relevé le Département du commerce des US28.
Des réponses juridiquement pertinentes ?
Taxer le chiffre d’affaires plutôt que les bénéfices a-t-il un sens ?
La taxe française (tout comme les dispositifs étrangers équivalents) encourt plusieurs critiques. En premier lieu, elle passe doublement à côté de son objectif : d’abord en frappant un chiffre d’affaires sans tenir compte des bénéfices (et en particulier des bénéfices supposément délocalisés par certaines des entreprises assujetties), ensuite car cette taxe à la consommation est aisément répercutable sur les clients. Ainsi, au bout du compte, plutôt que de réduire les bénéfices des entreprises étrangères (Google et autres), la charge économique de la taxe pèse essentiellement voire exclusivement sur leurs clients français.
En second lieu, ces taxes mises en œuvre de manière unilatérale font peser des risques de représailles particulièrement lourds en comparaison de leur rendement budgétaire assez modeste (de l’ordre de 350 millions par an29). Les autorités américaines ont ainsi annoncé en 2019 que la taxe française constituait, selon elles, une pratique discriminatoire de la part d’un partenaire commercial qui justifie des contre-mesures, en application de la section 301 du Trade Act de 197430. Une liste de 63 produits français qui représentaient en 2018 des importations d’un montant d’environ 2,4 milliards d’euros a ainsi été établie, afin que puissent leur être appliqués des droits de douane d’un montant pouvant aller jusqu’à 100 %31. Le département du commerce (US Trade Representative) a certes décidé en janvier 2021 de suspendre l’application de ces droits… mais au regard de l’enquête en cours visant d’autres initiatives de « taxe sur les services numérique » (digital services tax) lancés par plusieurs pays (l’Autriche, le Brésil, la République Tchèque, l’Union européenne, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et la Grande-Bretagne)32. L’affaire est donc loin d’être close.
Sans se satisfaire tout à fait du système actuel, de nombreux États s’inquiètent surtout des propositions encore peu claires de l’OCDE et des risques d’insécurité juridique qu’elles feraient peser en exigeant de reprendre de fond en comble les principes sur lesquels repose la fiscalité internationale depuis un siècle.
Martin Collet
Toutefois, les partisans de ces taxes domestiques peuvent légitimement faire valoir que, sans leur menace, les négociations conduites depuis 2019 par l’OCDE n’auraient sans doute jamais démarré. Quant aux défauts structurels de ces taxes, ils s’expliquent avant tout par le fait que toute autre forme d’impôt, et notamment un impôt assis sur les bénéfices d’entreprises étrangères, se heurterait immanquablement aux dispositions des conventions bilatérales signées par les États concernés. Autrement dit, en attendant que ces dernières soient modifiées – afin, le cas échéant, d’intégrer les propositions de l’OCDE – les États les plus impatients d’agir pour répondre à leurs opinions publiques n’ont guère le choix des armes.
Plus encore, la pression mise par certains gouvernements pour faire avancer les négociations internationales a sans doute produit d’importantes conséquences sur les pratiques même de beaucoup d’entreprises, inquiètes pour leur image. La décision de Google de signer en 2019 une transaction avec l’administration fiscale française en même temps qu’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP)33 illustre sans doute ce souci : l’entreprise américaine a préféré abandonner un milliard d’euros à l’État français pour mettre un terme définitif à ses différends avec l’administration fiscale plutôt que d’attendre leur solution juridictionnelle, et ce alors même que les juridictions de premier et de second degré lui avaient donné raison34.
En revanche, du côté du droit, les évolutions restent encore hypothétiques. Sans se satisfaire tout à fait du système actuel, de nombreux États s’inquiètent surtout des propositions encore peu claires de l’OCDE et des risques d’insécurité juridique qu’elles feraient peser en exigeant de reprendre de fond en comble les principes sur lesquels repose la fiscalité internationale depuis un siècle. Au bout du compte, la seule certitude qui se dessine au début de l’année 2021 est qu’en matière de fiscalité du numérique comme en d’autres matières, c’est bien le rapport de force international et, tout particulièrement, la volonté des États-Unis de pousser dans un sens plutôt que dans un autre qui conduira – ou non – le droit à évoluer pour, un jour peut-être, gouverner la mondialisation.
Sources
- Comme le relevait, en 2013, le Rapport « Collin-Colin » l’économie numérique renvoie à la fois à des entreprises immédiatement associées à cette notion (entreprises des secteurs de la publicité, de l’information ou du divertissement dont l’activité repose essentiellement sur l’usage de technologies numériques, sociétés d’édition logicielle, société de services et d’ingénierie informatique, agences Web, opérateurs de télécommunications) mais aussi, en réalité, à des entreprises de toute taille et de tous secteurs qui, de plus en plus, ont recours aux technologies numériques et, notamment, exploitent toujours plus intensément les données issues de l’activité de leurs utilisateurs. C’est ainsi que, aujourd’hui, les économistes préfèrent parler de « numérisation de l’économie » que d’économie numérique, tant ce phénomène embrasse la plupart des activités de production de biens comme de services, y compris les plus traditionnelles (P. Collin, N. Colin, Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, Rapport au Ministre de l’économie et des finances, au Ministre du redressement productif, au Ministre délégué chargé du budget et à la Ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique, 2013, p. 5 et s.).
- V. notamment : A. Garapon, « Une Cour peut réguler la mondialisation », Le Grand Continent – Revue européenne du droit, 13 novembre 2019.
- R. Hiault, « Taxe Gafa : le G20 ne peut que constater l’échec politique », Les Échos.
- Pour une présentation de ce schéma, v. : T. Bergin, « How Strabucks avoids UK taxes« , Reuters, 15 octobre 2012.
- V. : P. Collin, N. Colin, rapport préc., 2013, p. 21.
- Ibid, p. 52 et s.
- V. : E. Vincent, « Liechtenstein, la vallée des milliards cachés », Le Monde, 19 févr. 2008.
- Les dispositions de la loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) imposent aux banques du monde entier de communiquer aux autorités fiscales américaines l’ensemble des comptes détenus par des citoyens américains. Pour plus de précisions, v. : <https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca>.
- En 2020, l’OCDE se félicite tant de l’augmentation spectaculaire du nombre d’échanges de renseignements depuis le lancement de son « Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales » en 2009, que de la réduction significative (de près de 25 % entre 2008 et 2019) du volume des dépôts bancaires dans les centres financiers internationaux (Singapour, Hong-Kong, etc.) par des non‑résidents (v. : <https://www.oecd.org/fr/fiscalite/la-communaute-internationale-a-obtenu-un-succes-sans-precedent-dans-la-lutte-contre-la-fraude-fiscale-internationale.htm>).
- Au détour d’une micro-formule perdue au milieu des 14 pages de la déclaration finale de la réunion du G20 de Los Cabos (Mexique) en juin 2012 : « We reiterate the need to prevent base erosion and profit shifting and we will follow with attention the ongoing work of the OECD in this area » (v. : <https://www.oecd.org/g20/summits/los-cabos/2012-0619-loscabos.pdf>).
- OCDE, Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique, Action 1 – Rapport final 2015.
- Les données statistiques apparaissent toutefois aussi lacunaires que contradictoires. La Commission européenne estimait en 2018 que, en moyenne, les entreprises du numérique seraient imposées à un taux effectif moyen de 9,5 % contre 23,2 % pour les modèles d’affaire traditionnels (v. l’étude d’impact des services de la Commission européenne sur les deux propositions de directives : SWD (2018) 81 final/2). De son côté, le département du commerce des US relève dans son rapport d’enquête sur la « taxe GAFA » adoptée par la France que plusieurs études considèrent à l’inverse que les taux d’imposition de ces différentes catégories d’entreprises restent globalement équivalents (Office of the United States Trade Representative, Report on France’s Digital Services Tax prepared in the investigation under Section 301 of the Trade Act of 1974, 2 décembre 2019, p. 5.).
- Pour un état des lieux : <https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/actions-beps.htm>.
- V. not. les directives ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) du 12 juillet 2016 (Dir. 2016/1164) et « DAC 6 » du 25 mai 2018 (Dir. 2018/822).
- V. : X. Paluszkiewicz, F. Dumas, L’espace fiscal européen, Rapport d’information déposé par la Commission des affaires européennes, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juillet 2020, p. 34.
- Plus que la perspective d’une mise au ban de la communauté internationale, la crainte de faire fuir les investissements étrangers – les entreprises devenant elles-mêmes très inquiètes de leur image – explique vraisemblablement ce phénomène.
- Pour une présentation de la réforme fiscale américaine de 2017, v. par ex. : S. Humbert, Les frontières des impôts de production, CPO, Rapport particulier n°2, 2020, p. 55 et s.
- V. : Statement by the OECD/G20 inclusive framework on BEPS on the two-pillar approach to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy, as approved by the OECD/G20 inclusive framework on BEPS on 29/30 January 2020.
- Les US ont alors manifesté leur « forte réticence » au projet (CPO, Adapter la fiscalité des entreprises à une économie mondiale numérisée, 2020, p. 129).
- V. : documents COM(2018) 147 final et COM(2018) 148 final.
- Proposition de directive du Conseil concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques, COM (2018) 148 final, p. 3.
- V. : X. Paluszkiewicz, F. Dumas, Rapp. Préc., p. 50.
- Rapp. préc., p. 51
- Idem.
- Idem.
- L. n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.
- Les caractéristiques des différentes taxes sont présentées par : X. Paluszkiewicz, F. Dumas, Rapp. Préc., p. 53.
- V. : Office of the US Trade Representative, Docket Number USTR-2019-009, 7 janv. 2021.
- Selon le projet de loi de finances pour 2021, cette taxe devrait rapporter 358 millions d’euros en 2021, après en avoir rapporté 405 en 2020 (PLF 2021, voies et moyens, t. 1, p. 33).
- V. la présentation des dernières actions conduites sur ce fondement – contre la Chine (droits de propriété intellectuelle), l’Union européenne (subventions à Airbus) et la France (taxe sur les services numériques) – sur le site Internet du ministre du Commerce des États-Unis : <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2018/june/section-301-investigation-fact-sheet>.
- Office of the US Trade Representative, Notice of Determination and Request for Comments Concerning Action Pursuant to Section 301 : France’s Digital Services Tax, Federal register/vol. 84, n° 235, 6 déc. 2019, p. 66957.
- Office of the US Trade Representative, Docket Number USTR-2019-009, 7 janv. 2021.
- La CJIP est disponible sur : <https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/190903_CJIP.pdf>.
- V. en dernier lieu : CAA Paris, 25 avril 2019, min. c/ Google Ireland Ltd, Dr. fisc. 2019, n° 25, comm. 305, concl. A. Mielnik-Meddah, note F. Deboissy et G. Wicker.