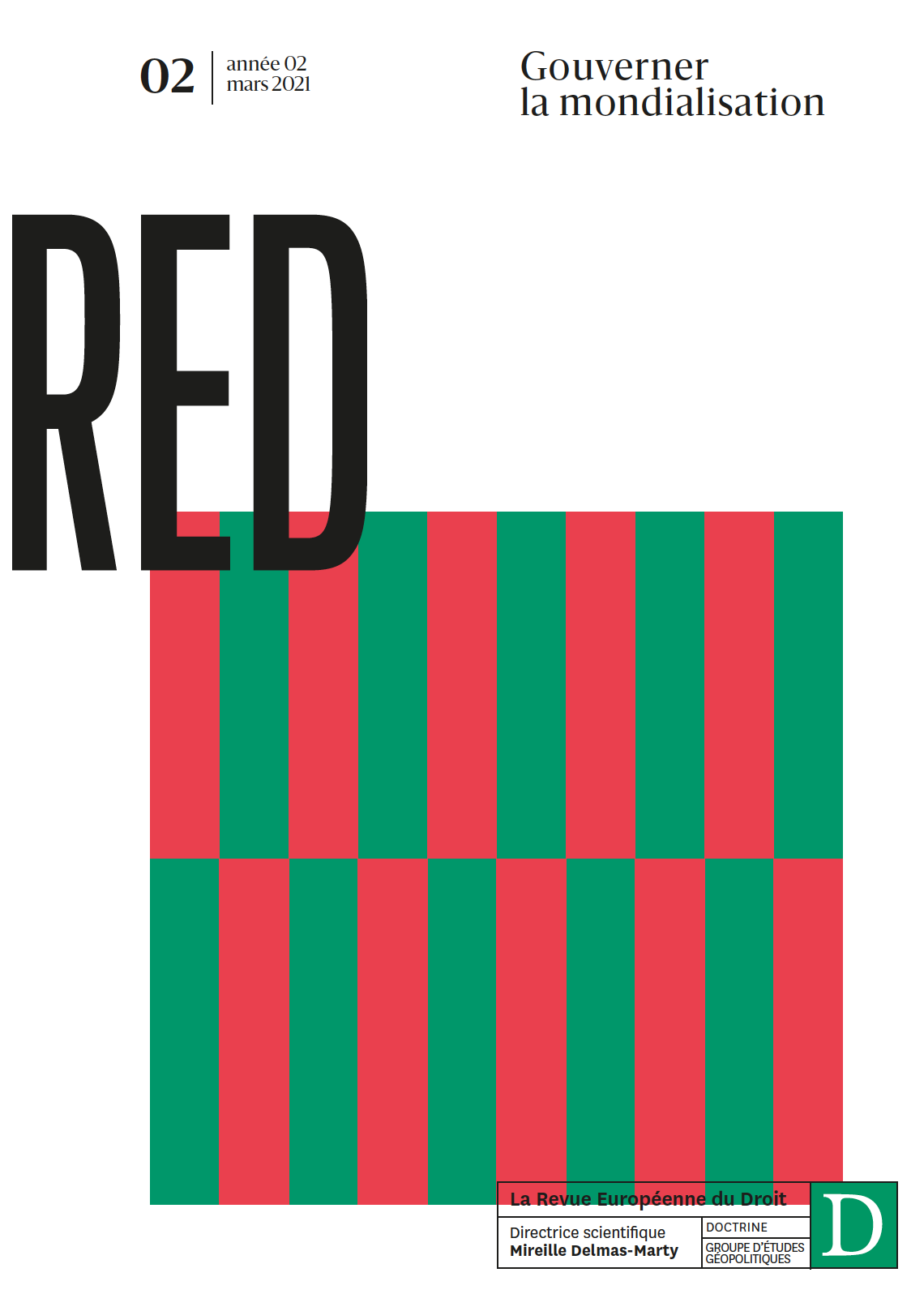Cet article est disponible en version anglaise sur le site du Groupe d’études géopolitiques.
Aborder le thème de la soft law, c’est a priori se lancer dans un vaste débat sur la question des formes de la normativité en droit. Ce ne sera pas ici le cas. Il existe de multiples études techniques et complètes sur cette question, et il semble inutile de les dupliquer1. Il s’agira plutôt de constater les implications de l’utilisation et des méthodes de la soft law dans le cadre de la gouvernance mondiale, y compris insidieuses ou masquées.
Nous rappellerons simplement que les modulations de la norme sont infinies en droit, d’autant que les sources formelles, qui attestent simplement d’un procédé permettant de cibler certaines normes, sont désormais concurrencées par de multiples modes de production de la norme qui en reflètent le processus réel de formation, particulièrement en droit international. Le débat n’est pas récent. Le droit est plus grand que la source formelle, rappelait il y a déjà longtemps le Doyen Carbonnier 2 , et Hans Kelsen ne s’exprimait guère autrement : « Commander n’est pas cependant l’unique fonction d’une norme ; habiliter, permettre, abroger sont aussi des fonctions de la norme3 ». Il en résulte qu’entre les normes impératives, supplétives, permissives, prescriptives ou prohibitives, les combinaisons sont nombreuses, d’autant que les instruments porteurs de ces normes peuvent également être souples ou durs. Ceci se traduit en droit international par des pratiques, principes directeurs, lignes directrices, quand il ne s’agit pas de standards dont on sait qu’il est bien difficile de les ranger dans une catégorie précise.
Ajoutons que la soft law ne peut plus guère être considérée comme une forme intermédiaire ou provisoire car elle se présente souvent comme un substitut et non un complément à la hard law, particulièrement dans le domaine des activités financières qui sera ici privilégié comme illustrant l’emprise de plus en plus grande de la soft law dans la gouvernance mondiale4. Ce qui doit être fondamentalement présent, c’est un processus de formalisation d’une norme qui deviendra juridique parce que des acteurs ont alors la conviction que cette règle leur sera utile et qu’ils lui donneront donc une forme juridique. Mais cette formalisation est loin de correspondre à un processus univoque et figé, et balaye la logique binaire entre l’interdit et l’autorisé trop souvent présentée comme la finalité indépassable de la règle de droit.
Ce qui doit être fondamentalement présent, c’est un processus de formalisation d’une norme qui deviendra juridique parce que des acteurs ont alors la conviction que cette règle leur sera utile et qu’ils lui donneront donc une forme juridique. Mais cette formalisation est loin de correspondre à un processus univoque et figé, et balaye la logique binaire entre l’interdit et l’autorisé, trop souvent présentée comme la finalité indépassable de la règle de droit.
jean-marc sorel
Si la mondialisation se rapporte à l’universalisation des échanges, donc à son droit substantiel, la globalisation elle se rapporte à l’universalisation des concepts juridiques avec la création d’îlots horizontaux et spécialisés dans certains domaines. Dans cet univers renouvelé, la soft law joue un rôle central, ce qui n’est pas nouveau puisque le droit international y prédispose par l’absence de système normatif centralisé. Ce rôle s’est accentué avec la croissance du domaine financier qui démontre l’imbrication des acteurs publics et privés, nationaux, régionaux ou internationaux.
Pour démontrer l’emprise croissante de la soft law dans la gouvernance mondiale, il est nécessaire de remonter les enchaînements qui posent des contraintes de plus en plus fortes sur la latitude des décisions des gouvernants, et qui aboutissent à une emprise de plus en plus importante de cette forme de normativité.
1. La diversité de facteurs conduisant à l’emprise de la soft law
Obligation versus contrainte. Une confusion entretenue entre obligation et contrainte laisse planer des incertitudes sur la soft law. Le droit souple peut ne pas être obligatoire mais peut être plus contraignant qu’une obligation juridique. Si la force obligatoire est toujours contraignante, la force contraignante n’est pas toujours obligatoire, et si les obligations portent toujours des contraintes, les contraintes ne découlent pas toujours d’obligations juridiques. Rejeter la soft law dans le non-droit revient souvent à ignorer cette réalité, alors que de nombreuses contraintes s’avèrent plus dissuasives que des obligations. Ajoutons que le lien juridique créé par une obligation n’a pas la même signification selon les systèmes juridiques5.
En réalité, c’est la liaison bien connue entre obligation et sanction qui est visée. Sans obligation, pas de sanction en cas de non-respect, donc pas de juge, donc pas de droit. C’est oublier que le droit sanctionné n’est pas tout le droit, et que ce dernier n’est pas prima facie caractérisé par la sanction mais par le sentiment qu’ont les sujets de sa nécessité. En matière économique, les États ont clairement conscience qu’ils ont intérêt à respecter la règle et que la sanction de l’excommunication économique serait bien plus lourde qu’une simple sanction juridique. Au surplus, les acteurs (et pas seulement les États), ont conscience que la soft law peut imposer le respect d’une norme si elle naît d’un besoin collectif et est conforme à l’esprit dans lequel ils souhaitent intervenir. Il y a dès lors une liaison entre l’intérêt d’une norme et le consensus pour y parvenir, et ceci sans que la sanction juridique soit nécessaire. La mise en conformité résulte donc du fait que les acteurs sociaux, au sens large, perçoivent celle-ci comme un avantage, et qu’ils anticipent les profits qu’ils pourront tirer de l’effectivité des normes.
L’absence de maîtrise des faits. Si la technicité du droit est censée apaiser les passions6, elle peut également devenir source de confusion ou d’incompréhension, y compris pour des juristes. La soft law illustre cette forme de décrochage entre une technique toujours plus sophistiquée et la difficulté pour le juriste d’en saisir les contours. Certes la part d’insaisissabilité de la soft law est consubstantielle à son existence, et si aucun domaine social n’échappe à sa traduction juridique, il n’en reste pas moins que l’impression est qu’on délègue à des faits complexes le soin de penser eux-mêmes le cadre juridique qu’ils méritent. Sauf à être omniscient (utopiste) ou doté d’une hyper spécialisation (ce qui, par ailleurs, n’est pas souhaitable), un juriste, tout en se devant de saisir la complexité d’un système, ne peut être à même de juger une telle technicité comprenant parfois des algorithmes difficilement compréhensibles. Il peut en revanche juger du bien-fondé de l’utilisation de ces techniques. Une nouvelle fois, le domaine financier en est un exemple particulièrement symptomatique. Il s’agit, en quelque sorte, d’un monde sauvage (parce que peu de normes primaires semblent lui dicter sa conduite), qui connaît par ailleurs des processus ultrasophistiqués, extrêmement techniques et peu compréhensibles pour le grand public. L’unicité du libéralisme économique (avec des nuances) oppose ainsi à la pression du droit pour en réguler les excès encore plus de résistances.
Mais cela ramène surtout au rapport du droit au fait. Si le droit encadre le fait, et si le fait doit se fondre au droit, l’adéquation ne peut fonctionner que s’il y a une maîtrise du fait. Or, c’est bien ce qui semble faire défaut aujourd’hui dans beaucoup de domaines, dont celui de la finance : en dehors de quelques spécialistes de l’ingénierie financière, la maîtrise du fait économiquement, socialement, politiquement, est imparfaite et le droit ne peut qu’imparfaitement l’encadrer. Rendre compte de normes d’une technicité telle qu’elle échappe à la compréhension du plus grand nombre devient une question holistique car aboutissant à une forme de désacralisation du droit propre à amoindrir l’exclusivité des compétences de ceux qui sont censés le maîtriser.
Les mutations dans la validité de la norme. Avec la soft law, la norme supplante la règle entendue comme générale et impersonnelle. Le respect ne vient plus d’une norme posée à l’avance et à laquelle on se conforme, mais de son effectivité et de son efficacité. Selon les variations dans la validité de la norme, entre la validité formelle (légalité), la validité axiologique (légitimité) ou la validité factuelle (effectivité)7, seule cette dernière semble s’imposer. Ce sont les catégories juridiques qui s’adaptent aux faits, et non l’inverse. La soft law est donc aussi une leçon de modestie face à une légalité et une légitimité toujours sujettes à la réfutation de l’évolution sociologique.
Cette évolution est le résultat d’un long processus non achevé consécutif à la dilution de la verticalité dans des réseaux horizontaux (la régulation économique par exemple), une perte partielle de la sacralisation du vertical (et de la croyance en des institutions immuables), la complexification des relations, ou l’immixtion de la personne privée au sein du dialogue juridique qui n’est plus seulement celui d’un ordre donné d’en haut qui doit ruisseler vers le bas.
Régulation et autorégulation. Cet ensemble de facteurs s’insère dans le primat de la régulation, ce droit en mouvement dont la finalité supplante l’instrument, et qui déroge aux caractéristiques d’un droit abstrait, général et immuable, pour pénétrer dans une sphère mouvante, plus concrète et particulière proche des « lois » économiques, d’où la préférence pour un droit plus souple qui privilégie par exemple les standards ou les principes, opposés à des règles qui symbolisent la stabilité. À défaut d’être rigide, ce droit se révèle efficace, si efficacité veut dire répondre à une fonction donnée. La fonction supplante l’instrument, même si la régulation contribue à créer un semblant de sécurité car elle est une façon de faire fonctionner le droit qui semble satisfaire les différents intervenants.
Le souci d’obtenir l’adhésion du destinataire de la règle, et l’attente légitime chez ces derniers, façonnent la soft law. Les instances qui émettent la soft law partent du principe que, si les destinataires sont associés au processus de production normative, ils ne s’opposeront pas au respect de ces règles, considérées alors comme étant légitimes. Et, plutôt que d’imposer frontalement des normes « dures » contournables, on préfère – même inconsciemment – laisser les acteurs se réguler, en espérant qu’ils privilégieront la sécurité juridique à une rentabilité sans filet, et créeront dans leur « ordre » particulier un système autorégulateur. La soft law constitue donc le vecteur privilégié d’une sphère qui aspire à l’autorégulation.
Dans ce cercle restreint, « on se sent obligé », ce qui revient à une forme d’opinio juris. On peut aussi à cet égard invoquer la dynamique autopoïétique transposée du paradigme biologique de l’organisme au droit afin de décrire les phénomènes juridiques qui manifestent une « fermeture normative » vis-à-vis de l’extérieur, dans le sens où ils déterminent eux-mêmes le légal ou l’illégal, le licite ou l’illicite, ceci en s’adaptant à une société de plus en plus complexe8. Cette hypothèse correspond au monde de la finance internationale qui engendre et spécifie sa propre organisation, et est continuellement soumis à des perturbations externes qu’il compense. Simple logique darwinienne de survie où les marchés répondent avant tout à la loi de l’évolution et de l’adaptation. Ceci est d’autant plus insidieux qu’une institution aura tendance à étudier l’ensemble des problèmes sous l’angle de sa fonctionnalité, et à les traiter de cette manière. Les dangers ne sont pas ignorés, mais ils sont susurrés plus qu’affirmés.
La soft law génère donc des normes qui s’adaptent à l’expansion de leurs destinataires et sont simplement freinées par des normes de régulation qui sont à la fois celles imposées par les anciennes structures (États, organisations) et celles acceptées par les acteurs.
La fonction d’organisation sociale. L’ordre juridique se caractérise par un ensemble de normes que l’on peut sanctionner pour faire respecter cet ordre. Or, avec la soft law, le contrôle est supérieur à la sanction. Dès lors, on en a vite déduit que cette normativité relative ne répondait pas à la fonction d’organisation sociale du système juridique international qu’on est en droit d’attendre de tout système juridique. En effet, ce droit souple comme système autonome de régulation des relations internationales s’extrairait d’un ordre juridique uniforme pour répondre aux préoccupations particulières d’un ensemble corporatiste restreint, le plus souvent économique, et c’est la force de l’économie qui fait du droit souple un droit parfois dur sans ordre juridique prédéterminé.
En poussant le raisonnement le plus loin possible, on peut même s’interroger sur la nécessité pour la soft law d’évoluer dans le cadre d’un ordre juridique ? Il existe une forme de « puissance de fait »9, et le droit souple utilise tous les canaux (politique, économique, social, etc.), ce qui conduit à constater qu’il est bien égal au droit souple d’être du droit, ou qu’il ignore lui-même en être si on ne le lui « révèle » pas.
L’ordre juridique se caractérise par un ensemble de normes que l’on peut sanctionner pour faire respecter cet ordre. Or, avec la soft law, le contrôle est supérieur à la sanction.
jean-marc sorel
Le droit possède un double rôle : à côté de sa fonction de « donner des ordres aux hommes », il a aussi une mission de régulation qui est celle de « donner un ordre aux choses »10. Dès lors, à partir du moment où l’encadrement arrive à imposer cet ordre social, à mettre de l’ordre dans le désordre, nous sommes potentiellement en présence d’un droit, même en l’absence d’un ordre juridique au sens strict.
Le droit saisi par la communication. La soft law est une expression anglo-saxonne mais qui se révèle surtout apatride. Qu’on la dénomme « droit souple » en français reste une traduction non complète, avec une fausse impression de douceur, de rondeur, bref de bienveillance11. Elle fait surtout partie d’un cercle d’expressions apatrides, de la même planète que : gouvernance, régulation, transparence ou accountability (dont la traduction par « rendre compte » reste tout aussi imparfaite), ou encore la compliance, forme d’assouplissement sémantique de la mise en conformité qui résonne surtout comme le résumé de tractations économiques propres à adoucir la potentialité de l’exécution d’une décision. Cet ensemble est la marque d’un néo-corporatisme débridé lié à la communication. On met des mots qui adoucissent la rigueur de la règle : la gouvernance élargit le gouvernement, l’accountability permet de restreindre la responsabilité à sa partie émergée, la transparence – miroir sans tain – permet à chacun de rendre compte sans forcément assumer. Selon une expression de Jean-Arnaud Mazères qui synthétise bien cet ensemble : « La loi du marché, faisant du droit une marchandise, aboutit au marché de la loi »12, ce qui est aussi une forme de dumping normatif.
2. Tentation hégémonique et recul de la démocratisation
Le cumul des remarques précédentes amène à un constat : le soft power de la soft law peut aboutir à une forme d’hégémonie dans la gouvernance mondiale, ce que certains pourraient qualifier de totalitarisme soft, via une domination technico-financière de la planète. Alors que la soft law semble s’imposer comme une manière de plus en plus courante et renouvelée d’envisager la normativité, il est permis d’en voir la face cachée, autrement dit cet agencement ne conduit-il pas vers une nouvelle forme d’hégémonie par le biais du droit ? Même s’il s’agit plus d’une intuition que d’un constat établi13, on ne peut s’empêcher de remarquer que si l’on trouve beaucoup de qualités à ce droit souple, on peut aussi le penser comme une forme de rouleau compresseur remplaçant l’ordre de contrainte traditionnel par un ordre contraignant. Face au phénomène de la soft law, on en jauge les fondements, les effets et les conséquences pour l’ordre juridique, sans forcément avoir la volonté d’aller au-delà de cette analyse juridique pour replacer ce phénomène dans un contexte plus large. Pourtant, une certaine irrationalité étant masquée par la scientificité, l’autorégulation étant la norme, les acteurs privés pouvant désormais se prononcer sur la défaillance des États (et leur imposer des remèdes), l’intérêt général étant remplacé par des intérêts privés catégoriels, les risques d’une forme d’hégémonie ne sont pas négligeables.
L’hégémonie peut être ici entendue au sens que lui donnait Antonio Gramsci. L’absence de réelle réaction face à la globalité de la logique poursuivie et intégrée à la société mène sur la piste de ce qu’il est convenu de qualifier d’hégémonie culturelle, concept qui décrit la domination culturelle d’un groupe et le rôle que les pratiques quotidiennes et les croyances collectives jouent dans l’établissement des systèmes de domination. Analyse ancienne certes et qui peut paraître désuète, mais qui pointait déjà quelques travers qui n’en sont pas moins actuels : sirènes du nationalisme, du consumérisme et de l’ascension sociale sur fond de compétition individualiste. Le monopole du droit souple quand le droit dur ne peut ou ne veut s’imposer peut aussi être un danger d’autant plus pernicieux que le commandement est diffus. Ce droit proposé sous une forme de faux volontariat est aussi imposé avec ses contraintes suggérées, le plus souvent économiques. Un slogan publicitaire résumait involontairement mais fort bien ce phénomène : Soft is the New Strong.
Le monopole du droit souple quand le droit dur ne peut ou ne veut s’imposer peut aussi être un danger d’autant plus pernicieux que le commandement est diffus. Ce droit proposé sous une forme de faux volontariat est aussi imposé avec ses contraintes suggérées, le plus souvent économiques. Un slogan publicitaire résumait involontairement mais fort bien ce phénomène : Soft is the New Strong.
jean-marc sorel
L’enchaînement est logique (et l’on pourrait dire « fatal ») : partant d’une expertise qui se veut à la fois technique et neutre, la norme est proposée au niveau national, régional ou international en symbiose avec le dogme économique dominant qui se répand et imprègne l’ensemble du système international d’une manière douce mais parfaitement contraignante. Le risque du remplacement de l’intérêt général par des intérêts privés catégoriels n’est pas une chimère et est renforcé par une forme de déni de démocratie réelle car les normes atteignent rarement les parlements nationaux ou les instances juridictionnelles des États. Ceci n’est pas récent et fut par exemple la marque de fabrique des « accords de confirmation » – qui ne sont pas des traités au sens juridique – conclus entre le FMI et les pays demandeurs depuis des décennies. On estime aussi que les mécanismes de suivi (parfois opaques parce que techniques, en dépit de la transparence affichée) des instances de standardisation tiennent lieu de substitut au débat public14.
L’architecture financière internationale constitue un ensemble particulièrement hétéroclite du point de vue des instances qui y participent. En effet, on y trouve des institutions multilatérales ouvertes à tous les États telles que le FMI, la Banque Mondiale, l’AICA, l’OICV. D’autres instances reposent sur une base plus restreinte. C’est le cas de la BRI qui comprend une soixantaine de banques centrales nationales membres ou de l’OCDE et du GAFI qui comprennent chacun une quarantaine d’États membres environ. Le cercle se rétrécit encore pour le Comité de Bâle, le CSF et le G20 qui comprennent respectivement 27, 24 et 19 États représentés (plus l’UE) et qui fonctionnent selon une logique de « club ». Le G20, instance qui entend piloter cette gouvernance financière internationale, dispose à cet égard de la base de composition la plus réduite du point de vue interétatique. Il existe donc un hiatus entre la composition plurilatérale des instances et la portée multilatérale, voire l’ambition universelle, de leurs standards sous forme de soft law. Or, une fois transposés dans les ordres juridiques internes, les standards financiers internationaux constituent des normes qui affectent dans leur très grande majorité le cadre réglementaire applicable à la prestation de services financiers. Le résultat en est une contrainte sociale pernicieuse car non avouée. Si l’on prend l’exemple des normes du Comité de Bâle en matière bancaire et prudentielle, l’adoption d’une norme débouche sur la nécessité d’adopter tout un ensemble qui s’impose dans sa cohérence. « Il s’agit donc de placer les destinataires des règles, à l’aide de différentes techniques, dans une situation telle qu’ils n’auront pas d’autres choix que de les respecter. En d’autres termes, les instances internationales ne cherchent pas à sanctionner une violation des normes, mais à contraindre à leur respect, avant même toute violation »15.
Si l’hégémonie dont il est ici question s’éloigne donc de celle envisagée par Mireille Delmas-Marty qui se réfère à celle d’un État16 (qui, par sa puissance, serait une forme « d’empire »), nous la rejoignons lorsqu’elle précise : « Apparemment moins contraignante, la soft law est parfois plus efficace, et finalement plus répressive, que la hard law. »17 Le système de la soft law peut effectivement devenir plus « répressif » dans le sens d’une contrainte imposée, et non d’une sanction désignée.
Si le droit en général devrait sans doute plus se soumettre au critère de la réfutabilité, notamment pour éviter l’enfermement scientifique qui conditionne la manière d’envisager cette matière, la soft law en offre une opportunité car c’est bien l’expérience qui prime sur la scientificité. À travers la soft law, le droit se redécouvre fragile et éphémère là où il pensait être immuable dans sa structuration fondamentale. Néanmoins, la fragilité concerne plus les manières d’envisager le droit que l’immixtion de la soft law dans ce paysage car il s’agit bien aussi de normes de puissance. Que la vocation à la rationalité – que l’on espérait attraper – se dilue dans les méandres de la norme est troublant, mais ne change pas les paramètres de la puissance car il s’agit plus d’un déplacement vers des acteurs jusque-là dans l’ombre. L’aspiration prométhéenne des États à maîtriser la réalité pâlit et l’expérimentation ne peut décidément que difficilement entrer dans des cases préconçues car la pratique se contente d’une simple adaptation à la réalité.
Le recul d’une forme de souverainisme absolu l’affaiblit sans doute, mais donne à l’État l’opportunité de se recentrer sur un équilibre lui permettant de revêtir le rôle de régulateur, face à ce foisonnement de soft law, qu’il a abandonné au profit d’entités non guidées par l’intérêt général.
JEAN-MARC SOREL
Faut-il pour autant désespérer de voir le droit se sortir du piège de la puissance ? Plusieurs signaux poussent vers un retour à un certain équilibre. Tout d’abord, dans le domaine financier ici pris comme exemple pertinent de diffusion de la soft law, la logique de sécurité tend à contrebalancer la logique de rentabilité et pousse les acteurs vers un cadre juridique. En clair, on est prêt à perdre « un peu » pour gagner en sécurité. D’autre part, si comme le remarque Mireille Delmas-Marty : « Notre conception de la souveraineté doit ainsi être renouvelée. Pour créer un état de droit sans véritable État mondial, l’universalisme est trop ambitieux et le souverainisme, par repli sur les communautés nationales, trop frileux »18, on est en droit de se demander si ce « souverainisme frileux » n’est pas finalement une aubaine, et si l’internationalisation qu’elle appelle de ses vœux n’est pas un simple retour aux sources.
Il faudrait en quelque sorte revenir à Jean Bodin, sans le détour par Hobbes ou Hegel. La souveraineté de l’État a été initialement envisagée comme une coexistence pour des États qui ont toujours été pluriels, contrairement à l’empire. Autrement dit le support de l’indépendance est tout autant le moyen de l’interdépendance.
L’absolutisme de la souveraineté a masqué pendant longtemps cette double facette. Le recul d’une forme de souverainisme absolu l’affaiblit sans doute, mais donne à l’État l’opportunité de se recentrer sur un équilibre lui permettant de revêtir le rôle de régulateur, face à ce foisonnement de soft law, qu’il a abandonné au profit d’entités non guidées par l’intérêt général. C’est ainsi que la souveraineté qui se voulait (ou qui s’était crue) « solitaire » pourrait (re)devenir « solidaire »19. Encore faut-il qu’il y ait une volonté politique globale en ce sens, et que le piège de l’économisme ne se referme pas définitivement sur les États.
Sources
- Parmi les plus récentes en France (et sans être exhaustif) : P. Deumier et J.-M. Sorel (dir.), Regards croisés sur la soft law en droit interne, européen et international, LGDJ, Paris, 2018, 492 p ; S. Cassella, V. Lasserre et B. Lecourt (dir.), Le droit souple démasqué, Articulation des normes privées, publiques et internationales, Pedone, Paris, 2018, 194 p. Nous emprunterons ci-après quelques remarques à nos propres réflexions antérieures.
- J. Carbonnier, Flexible droit – Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 10e éd., 2001, p. 21.
- H. Kelsen, Théorie générale des normes, Paris, PUF, Réédition 1996, p. 1.
- Voir notre étude : « Quelle normativité pour le droit des relations monétaires et financières internationale ? », RCADI, tome 404, Brill / Nijhoff, 2020, pp. 235-403.
- Voir notamment : P.- E. Will et M. Delmas-Marty (dir.), La chine et la démocratie, Fayard 2007.
- Voir : P. Servan-Schreiber, H. Pascal et V. Rotaru, « Le droit à l’échelle pertinente », Revue européenne du droit, septembre 2020.
- F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2002.
- N. Luhmann, « L’unité du système juridique », Archives de philosophie du droit, vol. 31, 1986, pp. 163-188. Sur les développements de cette dynamique au secteur bancaire, voir l’analyse très complète et pertinente d’Hélène Kouyaté : L’encadrement juridique international du secteur bancaire, entre recherche du réalisme et confrontation à la réalité, Thèse Paris 1, 2010, 473 p.
- P. Deumier :« La réception du droit souple par l’ordre juridique » in : Le droit souple, Association Capitant, Paris, Dalloz, Paris, 2009, p. 139.
- Barrès, cité par Claude Champaud : « Des droits nés avec nous. Discours sur la méthode réaliste et structuraliste de la connaissance du droit », in Mélanges en l’Honneur de Gérard Farjat, Philosophie du droit et droit économique, Éditions Frison-Roche, Paris, 1999, pp. 69-109, p. 74.
- Voir à cet égard la distinction opérée par Mireille Delmas Marty entre « mou, doux et flou » : « Gouverner la mondialisation par le droit », Revue européenne du droit, n° 1, sept. 2020, p.7.
- « L’un et le multiple dans la dialectique Marché – Nation », in : Stern. B. (dir.) : Marché et Nation, Regards croisés, Montchrestien, Paris, 1995, pp. 81-188.
- Encore que basée sur des études concordantes, dont certaines déjà anciennes. Voir notamment : A.A. Fatouros : « On the Hegemonic Role of International Functional Organizations », GYBIL, 1980, pp. 9 à 36 ; A.-C. Martineau, Le débat sur la fragmentation du droit international. Une analyse critique, Bruxelles, Bruylant, 2016, XIX - 584 p., spéc. pp. 337-387 ; Nico Krisch, « International Law in Times of Hegemony : Unequal Power and the Shaping of the International Legal Order » (2005) 16 E.J.I.L., p.369.
- Voir T. Bonneau : « La gouvernance technicienne des marchés financiers », in Le droit souple démasqué, Articulation des normes privées, publiques et internationales, op. cit., pp. 125 à 133, spéc pp.130 à 133, ainsi que notre étude : « Sur quelques aspects juridiques de la conditionnalité au F.M.I et leurs conséquences », E.J.I.L. 1996/1, pp. 42 à 66.
- H. Kouyaté, op. cit., p. 380.
- « Certes il serait possible de gouverner la mondialisation par le droit de façon simple. Il suffirait de mettre en place un système hégémonique, par extension du droit du pays le plus puissant au reste de la planète (…) Mais jusqu’à présent aucun empire n’a fonctionné à l’échelle planétaire. » ; in : « Gouverner la mondialisation par le droit », Revue européenne du droit, op. cit., p.7.
- Ibid., p. 7.
- Ibid., p. 6.
- Ibid., p. 11.