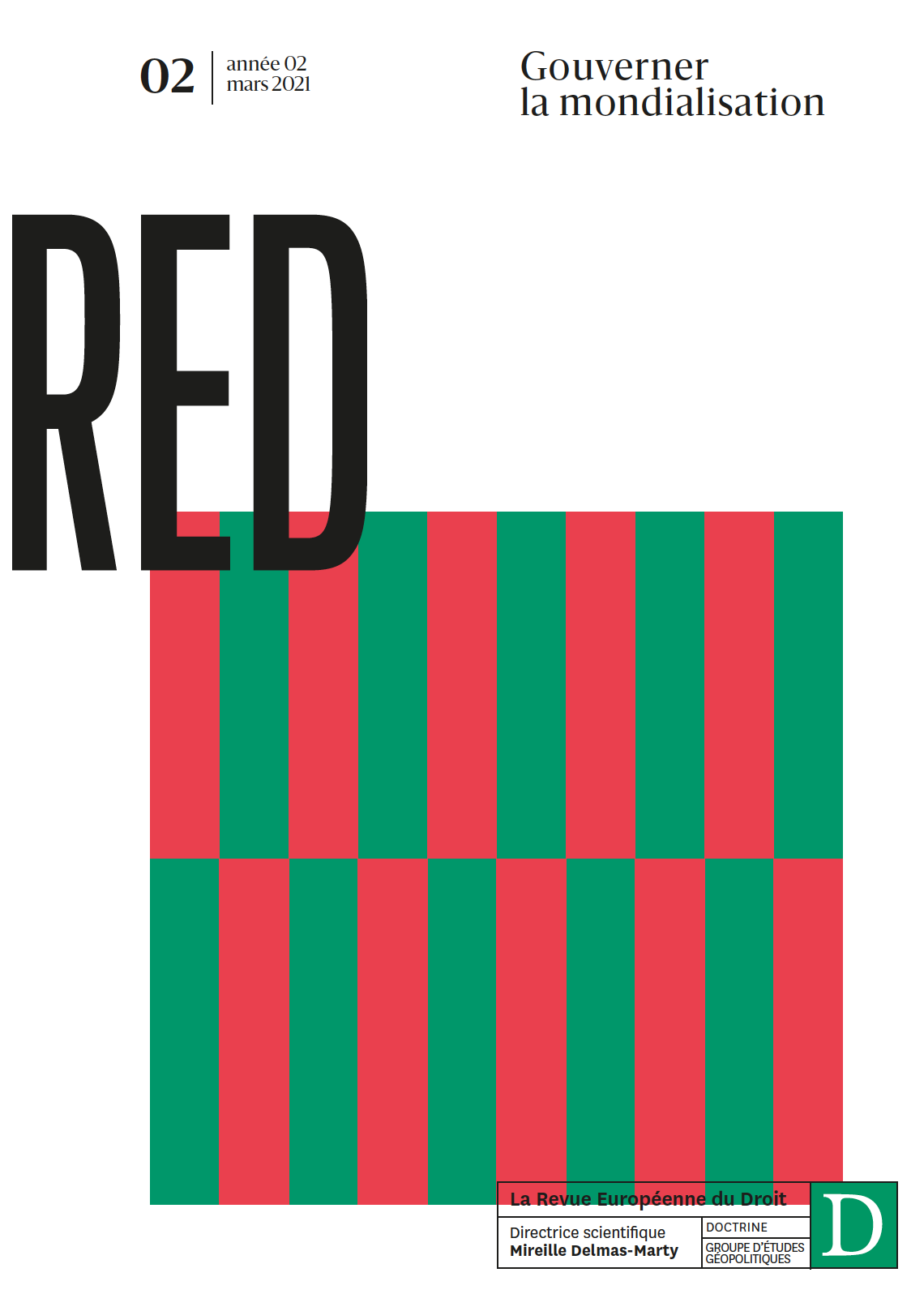Cet article est disponible en version anglaise sur le site du Groupe d’études géopolitiques.
Un cadre de pensée westphalien devenu obsolète
Le système westphalien, qui confie l’ordre international aux souverains et à eux seuls, est plongé dans une crise profonde, apparue aux yeux de tous depuis les années 1990. La dissymétrie entre cet affaiblissement durable et la montée des crises systémiques dans un monde désormais globalisé a précipité la gouvernance mondiale dans un chaos la rendant largement impuissante face aux enjeux immédiats comme de plus long terme de nos sociétés contemporaines. La dernière preuve vient de nous en être cruellement administrée par la Covid.
La raison de ce délitement est simple. L’ordre multilatéral actuel repose sur un principe, la souveraineté de l’État-nation1. Or cette notion n’est qu’une fiction2. Bien sûr, les grandes fictions peuvent être utiles, elles sont même très commodes. N’oublions pas que celle-ci a précisément été bâtie par des États rivaux déchirés par les guerres de religion, dans le but d’instaurer une paix relative entre eux mais aussi au sein de leur population. N’oublions pas non plus que quelques tempéraments destinés à encadrer les excès de la souveraineté ont vu le jour dans le droit international depuis un siècle et demi3. Toutefois, à l’ère de la mondialisation galopante, la souveraineté grince. L’État a de moins en moins prise et la fiction est incapable d’apporter une réponse satisfaisante à bien des problèmes. Cette impuissance ronge dangereusement leur légitimité, autre fiction westphalienne corollaire de la précédente. Je l’ai vécu professionnellement comme directeur de cabinet de Jacques Delors à Bruxelles, comme Commissaire européen, puis comme Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce.
Pour reprendre l’image, fonder un système international sur une fiction qui grince ne produit pas de concert harmonieux. Notre système multilatéral est bâti sur toutes sortes de formalismes. Les juristes continuent à prétendre que les États-nations sont tous égaux4. C’est bien sûr vrai d’un point de vue formel. Mais dans le monde réel, leurs relations sont réglées par l’asymétrie. Il en va de même pour la légitimité. Les États sont, par définition, tous légitimes. Le gouvernement est donc légitime à parler au nom de l’État. Il faudrait donc en déduire que des organisations constituées d’États-nations légitimes sont elles-mêmes légitimes par transitivité, du fait du monopole des États-nations. Cela est cohérent dans cet univers de concepts juridiques, mais ne correspond pas à la réalité des rapports politiques, économiques, sociaux, culturels5.
Il n’est pas question ici de prophétiser la mort de l’État-nation. A l’échelle d’un pays, l’État-nation a ce pouvoir d’incarner et d’agréger des tensions et des conflits entre agents ou groupes d’agents qui, bien qu’animés par des préférences différentes et parfois opposées, partagent ces préférences collectives qui permettent de fonder une appartenance commune. Néanmoins, dans la sphère des relations internationales et faute de ce sentiment communautaire, la seule relation entre États se révèle insuffisante pour agencer efficacement toutes les organisations humaines qui prospèrent et opèrent au niveau mondial.
Ces organisations sont très nombreuses. Il s’agit d’un nombre croissant d’organisations non gouvernementales (ONG) qui sont, de fait, sinon de droit, des agents internationaux. Il s’agit évidemment aussi d’entreprises multinationales6. Dès lors que l’on définit les organisations internationales aussi comme des groupes de personnes, au sens large, qui sont organisés pour agir à l’échelle mondiale, il ne fait aucun doute que le WWF, Greenpeace ou certaines grandes firmes sont des organisations multinationales dont l’influence n’est peut-être pas si différente de celle, par exemple, de l’Organisation des Nations unies.7 Elles ne constituent pas pour autant une classe homogène, car tous ne partagent pas les mêmes objectifs et évoluent dans des sphères quelquefois communes, mais souvent distinctes – ce qui n’empêchent pas qu’elles puissent dialoguer et s’entrechoquer. Un tel constat dépasse largement le cadre de ces deux catégories d’acteurs, les grandes ONG et les firmes multinationales traditionnellement décrites comme les principaux concurrents des États. Les grandes villes du monde, les communautés scientifiques, certaines grandes institutions académiques, pour ne citer qu’elles, semblent parfaitement s’insérer dans une telle définition8.
Une incapacité évidente à articuler des politiques efficaces
La seconde moitié du XXe siècle restera sans doute dans l’histoire comme l’ère du multilatéralisme. Il y a pourtant un paradoxe évident. Ceux qui ont connu le système de l’intérieur ont très tôt pu s’apercevoir de ses insuffisances. Les jeunes générations de hauts fonctionnaires, dont je faisais partie dans les années 1970, étaient, du fait de leur formation et du discours majoritaire qui régnait alors, les premiers susceptibles de s’émerveiller de la structure parfaite du point de vue de l’esthétique conceptuelle de la galaxie onusienne. Or, ceux-là même ont très tôt été confrontés à l’absence de fonctionnement du système international. J’ai eu le très grand privilège d’être sherpa, très jeune, dans le Groupe des sept (G7), qui constituait déjà une tentative de réponse, dont on peut désormais dire sans trop d’hésitations qu’elle a échoué, tout comme d’ailleurs le G20, qui est aussi dans l’impasse aujourd’hui.
Ces tentatives cherchaient à dépasser le système diplomatique en établissant des contacts au plus haut niveau et en se défaisant ainsi des intermédiaires classiques. Certains chefs d’État et de gouvernement avaient conscience de ces insuffisances et une réelle envie de se débarrasser pour un moment des cadres de discussion dans lesquels leurs jurisconsultes et leurs administrations opéraient et qui les corsetaient. Or, cette tentative de dépasser les attributs diplomatiques habituels était une menace existentielle pour le système westphalien qui a fini par reprendre le contrôle de ce canal direct de discussion « au coin du feu » qui dérangeait les habitudes.
La séquence que nous vivons actuellement jette une lumière crue sur l’impuissance du système. Même si l’ampleur de cette paralysie est particulièrement spectaculaire, elle n’est pas la première occurrence de l’incurie du multilatéralisme en matière sanitaire. Un épisode désormais vieux de près de trois décennies a marqué beaucoup d’entre nous, la lutte contre une autre grande pandémie, le sida.
La mise en œuvre de politiques de prévention dignes de ce nom et la mise au point d’un traitement ont piétiné aussi longtemps que la question est restée dans les arcanes classiques des institutions intergouvernementales, parmi lesquelles l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et des traités. Les choses ont commencé à bouger quand une association, Act-Up, s’est engagée dans des provocations parfois très désagréables, à l’encontre de grands laboratoires et de responsables politiques dont j’étais. Elles ont aussi évolué de manière spectaculaire parce que l’industrie pharmaceutique a réussi à mettre un terme à un conflit interne de plusieurs années sur la question des prix différenciés9, et parce que des philanthropes comme Bill Gates ou d’autres se sont dit qu’il était temps de donner un coup d’accélérateur décisif. La mise sur pied du Fonds mondial de lutte contre le sida et une meilleure maîtrise du virus doivent sans doute davantage à ces acteurs, véritables intrus qui ne se sont guère embarrassés de la supposée primauté de la souveraineté étatique, qu’au multilatéralisme. Comparons, pour en être convaincus, la composition du conseil d’administration du Fonds Mondial, et celle du Conseil de Sécurité de l’ONU.
Les contre-exemples d’organisations intergouvernementales réellement efficaces sont rares. Malheureusement pour les tenants du multilatéralisme classiques, les États y sont justement souvent en retrait. L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)10 illustre bien ce paradigme. L’OIE repose sur le commerce de la viande. Si une vache attrape la fièvre aphteuse dans une province argentine, cette dernière est placée sur la liste noire du commerce de viande, se retrouve du jour au lendemain sans plus aucun débouché possible, et les autorités argentines en tirent les conséquences. L’explication d’une telle réussite repose sur le fait que les épizooties à l’échelle internationale sont l’objet d’un monopole, celui de la confiance que s’accordent les vétérinaires à travers les frontières. Un vétérinaire respecte un autre vétérinaire, mais pas forcément un ministre de l’agriculture. L’organisation internationale des épizooties devient alors l’organisation internationale des vétérinaires qui agissent car ils se font confiance. L’Organisation mondiale des douanes, qui n’est pas parée du statut d’organisation internationale, appartient aussi à ce modèle. Évidemment, ce genre de solution n’est pas non plus disponible dans tous les domaines.
Du multilatéralisme vers le polylatéralisme
Face à cette impasse de ce que j’ai pu appeler trop méchamment, comme on me le rappelle souvent, le syndrome de la « diplocratie », le concept de polylatéralisme, parce qu’il augmente l’inter de « international » et le multi de « multilatéral » résume bien la méthode pour tirer la leçon de ces expériences et revigorer la coopération internationale en comblant les manques westphaliens.
Le polylatéralisme consiste à mettre autour de la table ces agents internationaux qui n’ont presque pas de place dans le cadre du multilatéralisme formaliste des États-nations et qui pourtant ne nous ont pas attendu pour exercer leur influence. La réponse aux principales priorités de notre monde, de la Covid-19 à la transition écologique ou même la gestion de l’économie mondiale, ne sont pas aujourd’hui à la portée d’une approche inter-gouvernementale classique. Il faut en prendre acte. Le polylatéralisme ouvre une autre perspective et repose sur d’autres modalités.
C’est désormais dans le cadre du polylatéralisme que nous devrions nous appliquer à mobiliser ces nouveaux acteurs dont l’énergie et les dynamiques leur sont propres mais qui peinent à trouver un cadre propice à leurs interactions. De ce point de vue, cette approche se distingue profondément de la théorie réaliste des relations internationales selon laquelle des institutions à l’échelle mondiale ne servirait plus à rien11. Je n’épouse pas la notion de réalisme. Ce qui colle mieux à la réalité n’est pas forcément ce qui est bon. On peut vouloir autre chose, on peut améliorer le monde. C’est même pour cela qu’il convient d’accepter qu’il y a une vertu dans la diversité des approches.
La première grande traduction de l’acceptation de ce modèle polylatéral devrait être d’ouvrir bien plus grand le jeu de ce nouveau format à l’hétérogénéité de la légitimité. Il y a des entités non-étatiques dont l’influence internationale dépasse de loin celle de beaucoup d’États-nations. Il y a des villes, des régions dans le monde qui sont des êtres quasi internationaux. Toutefois, ils ne sont pas revêtus des attributs de la souveraineté de l’État-nation, et sont à la recherche d’un équilibre qui conduit souvent à des situations sous-optimales, car chercher à se parer de ces attributs pourrait immédiatement les mettre en difficulté face aux États, jaloux de leur monopole sur la scène internationale.
Les villes de New York ou de Paris sont évidemment aujourd’hui des acteurs géopolitiques et géoéconomiques internationaux12. C’est au niveau de ce genre de structures, notamment à l’échelle urbaine, que le rapport entre la légitimité et la puissance est le plus fort. Les maires sont plus légitimes que d’autres représentants, parce qu’ils sont plus près du terrain. La légitimité est une fonction inversement proportionnelle à la distance. En même temps, les grandes villes sont puissantes parce qu’elles ont la compétence de la maîtrise des réseaux qui, dans le monde moderne, sont les infrastructures de la gouvernance. Au-delà des fictions, le secret du pouvoir et de la légitimité passe de plus en plus par une organisation correcte des réseaux de transport, d’énergie, d’information, d’enseignement et de fourniture de matières premières de plus en plus rares.
Cette maîtrise des réseaux explique parfaitement pourquoi les grandes métropoles se sont spontanément réunies autour des enjeux liés au réchauffement climatique et plus largement aux transformations environnementales. Le C40, c’est-à-dire la coalition pour le climat dite des « 40 grandes villes du monde » qui a joué un rôle important dans le succès de la conférence de Paris, d’ailleurs largement née de l’échec de celle de Copenhague et de son approche diplomatique, en est un exemple éclatant. C’est aussi sur ce principe que la Chine a conçu sa stratégie dite “belt and road”.
Il n’y a, pour l’instant, qu’une seule organisation polylatérale, l’Organisation internationale du travail (OIT). L’OIT est née du traité de Versailles grâce à Léon Bourgeois et d’autres solidaristes qui avaient compris que la paix était une affaire de prévention des conflits et que le fait de mettre les États, les patrons et les ouvriers autour de la même table était la réponse la plus à même de répondre aux causes de la Première Guerre mondiale et de desserrer les contradictions inhérentes au modèle capitaliste. Mais ce “trilatéralisme” n’a guère prospéré pour des raisons qu’il serait trop long d’exposer ici.
Retenons simplement que les formats du polylatéralisme ne suivront pas ce standard et se développeront de manière plus sui generis. Leur existence et leur structure auront sans doute comme aiguillon leur succès et leur échec. Il faudra accepter l’idée qu’il y a des énergies disponibles pour obtenir des résultats dans des formats parfois improbables. Le polylatéralisme correspond par essence à des coalitions dont le moteur est la recherche de résultats, et dont la pérennité n’a pas besoin d’être assurée une fois que le résultat est atteint. Ce sont des organisations plus en réseaux, plus horizontales, probablement plus éphémères d’ailleurs, et sans doute moins légitimes sur le plan théorique.
Le Forum de Paris sur la Paix, initiative non pas “pour” la paix mais “sur” la paix qui regroupe une multiplicité d’acteurs portant des initiatives à vocation globale, reflète bien dans ses processus, son action, ses projets, ses coalitions et ses différentes approches, ce que peut être cette méthode polylatérale. Ses premiers résultats, après trois éditions, sont encourageants[.
Repenser l’idée de légitimité par le prisme de l’efficacité
Lorsque l’on s’écarte ainsi de la fiction de l’égalité des États-nations et du paradigme de la souveraineté, se pose immédiatement la question, pour tous les bons esprits formés à la politique classique, de la légitimité. Quelle est la légitimité d’une coalition formée entre Bill Gates, Anne Hidalgo et le patron de Greenpeace ? Et si légitimité il y a, d’où provient-elle ? Ces questions, d’apparence très pertinentes, obligent néanmoins à réfléchir formellement dans un cadre théorique épuisé.
Je prêche l’instauration d’une théorie de la légitimité inscrite dans le réel. Si le but de toute organisation est d’améliorer les conditions de vie des individus et l’environnement, lato sensu, dans lequel ils évoluent, la légitimité doit puiser sa source dans les résultats plutôt que dans la forme de ce qui est censé les donner13. L’adhésion à cette vision devrait être facilitée par le constat unanime de l’échec d’une forme donnée à y parvenir.
Penser la question de la légitimité par le prisme de l’idéal démocratique au travers du modèle existant serait d’ailleurs une erreur. Ce dernier n’est pas plus à même de reproduire ce que Hedley Bull a appelé « l’analogie domestique »14 que le modèle polylatéral ne le pourra. Dans un cas comme dans l’autre, il manquera toujours d’institutions qui relient le public, par le biais d’élections, aux organisations internationales.
Pour reprendre l’exemple de l’OIE, le système fonctionne parce que des vétérinaires compétents prennent des décisions entre eux, en se faisant confiance. Bien sûr, l’éleveur qui doit tuer tous ses poulets ou ses canards dans sa ferme du sud-ouest de la France subit un drame. En même temps, cela fait partie de la règle du jeu, parce que l’on se trouve dans une infrastructure du capitalisme de marché qui est le commerce de la viande. Il n’y a pas de raison idéologique. Dans une société où l’on mange beaucoup de viande, probablement trop d’ailleurs, le producteur de viande a un problème si on ne lui achète plus ce qu’il produit. Il y a une sorte de barre de rappel dans les infrastructures de l’économie globalisée, dont le champ d’action devrait peut-être de temps en temps s’exercer aussi sur les humains et pas simplement sur les marchés.
Bien sûr, les notions de démocratie et de polylatéralisme ne sont pas étrangères l’une pour l’autre. Le polylatéralisme n’est possible que si les organisations nongouvernementales, notamment, trouvent des espaces de liberté pour se développer et pour critiquer, ce qui n’existe pas dans bon nombre d’États.
Le cas de la Chine est l’un des défis les plus aigus dans le cadre de l’émergence du modèle polylatéral. Alors qu’elle assume un rôle croissant partout dans le monde, la Chine est aujourd’hui rétive au polylatéralisme comme au poly tout court. Les entreprises y sont très largement sous la houlette de l’État et les ONG très sévèrement contrôlées.
La rivalité, structurante des relations internationales, entre les États-Unis et la Chine n’est donc sans doute pas le terrain sur lequel le polylatéralisme sera susceptible de produire des résultats spectaculaires. A moins que le système chinois ne se détende, on voit mal des ONG chinoises prendre des ONG américaines par le bras, ou des entreprises américaines se rapprocher d’entreprises chinoises et trouver des solutions ensemble sans passer par l’État, au motif que cela marcherait mieux.
Toutefois, si le polylatéralisme semble moins adapté aux systèmes non libéraux, la méthode polylatérale est opératoire là où les systèmes politiques sont faibles, on peut notamment penser à certaines parties de l’Afrique.Enfin, il n’est pas interdit de penser que le polylatéralisme pourrait également contribuer indirectement à orienter les choix des régimes qui y sont en principe hermétiques. Pour prendre l’exemple du Green Deal européen, l’implication de nombreuses ONG, du C40, ou encore des coalitions dans le business comme le B4IG15 a beaucoup compté dans la genèse de ce nouvel axe stratégique de l’Union européenne. Or, quand le président chinois annonce au monde entier sa neutralité carbone en 2060, le fait que l’Europe s’y soit engagée pour 2050 y est sans doute pour quelque chose. Le polylatéralisme et le multilatéralisme pourraient ainsi faire bon ménage à l’avenir. C’est le pari que nous avons fait avec le Forum de Paris sur la Paix.
Sources
- Le concept de souveraineté a été forgé au XVIe siècle notamment par Jean Bodin mais c’est sans doute Hegel qui perçoit en premier le lien entre souveraineté et État-nation.
- Les travaux de B. Anderson en particulier dans son très fameux ouvrage de 1983 intitulé Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism sont les premiers à décrire le processus de formation de l’idée de nation.
- Se référer aux travaux d’Alain Pellet et notamment à « Histoire du droit international : Irréductible souveraineté ? », in Guillaume, G., (dir. publ.), La vie internationale, Hermann, Paris, 2017, pp. 7-24.
- Charte des Nations Unies, article 2.1 : « L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres ».
- Même si cette approche ne permet sans doute pas une vue d’ensemble du sujet, de nombreux auteurs ont cherché à démontrer que les États avaient été les premiers acteurs de leur mise en retrait (v. par ex., L. Pauly, « Capital Mobility, State Autonomy, and political Legitimacy », Journal of international affairs, New York, Columbia University, 1995).
- Pour une recension complète des études dédiées à l’influence des firmes transnationales v. L. Badel, « Milieux économiques et relations internationales : bilan et perspectives de la recherche au début du XXIe siècle », Relations Internationales, 2014/1 n° 157, pages 3 à 23.
- Pour une description des méthodes des ONG afin de conduire les États, les sociétés multinationales et d’autres à respecter les valeurs et les normes qu’ils défendent, v. par ex. M.E. Keck et K. Sikkink. Activists Beyond Borders : Advocacy networks in international politics, Cornell University Press, 1998.
- Il est frappant de voir que ce phénomène est encore amplifié par la crise pandémique actuelle. Les co-publications entre chinois et américains dans les revues médicales ont doublé en 2020. Des laboratoires se sont connectés les uns aux autres et des intentions de partage de la propriété intellectuelle pour les vaccins se sont manifestées.
- Il semble désormais prouvé que la différenciation des prix est l’un des facteurs déterminants dans la lutte contre les épidémies mondiales (v. Z. Ud-Bin Babar, « Differential pricing of pharmaceuticals : A bibliometric review of the litterature », Journal of Pharmaceutical Health Services Research, juillet 2014).
- Fondée en 1924 sous le nom d’Office international des épizooties, elle compte 182 États et territoires membres.
- J. Mearsheimer, « The False Promise of International Institutions », International Security 19-3 (Winter 1994/95).
- Sur l’influence des villes dans le jeu de la gouvernance mondiale, v. S. Curtis (ed.), The Power of Cities in International Relations, Routledge, 31 mai 2016.
- L’enjeu de la légitimité est en réalité double. Évidemment l’efficacité jouera un rôle prépondérant, toutefois d’importants auteurs ont relevé que la légitimité avançait sur deux jambes, l’efficacité et la responsabilité (accountability). Cette deuxième trouve sa source dans une certaine transparence procédurale (voir R. O. Keohane and J. S. Nye, Between Centralization and Fragmentation : The Club Model of Multilateral Cooperation and Problems of Democratic Legitimacy, KSG Faculty Research Working Paper Series, February 2001).
- H. Bull, The Anarchical Society : A Study of Order in World Politics, New York : Columbia University Press, 1977.
- Business for Inclusive Growth (B4IG) est un partenariat entre l’OCDE et une coalition mondiale d’entreprises qui luttent contre les inégalités de revenus et d’opportunités.