1.
Imaginez une usine qui fabrique une certaine machine en prévision d’une très grande demande. Il s’agit d’un investissement massif, mais le profit attendu est lui-aussi massif. Imaginez vous ensuite que cette prévision se révèle complètement erronée : la demande s’est contractée et les machines ne se vendent pas. Imaginez alors toutes ces belles machines, désormais inutiles, abandonnées dans les entrepôts. Ou bradées. Désassemblées. Détruites.
Très bien. Maintenant, imaginez que vous êtes une de ces machines.
Certains pourront se reconnaître dans cette description. Car nous aussi, fils de la classe moyenne, avons été « construits » par le système éducatif afin de remplir certaines fonctions sociales, en prévision d’une certaine croissance économique et du développement du secteur tertiaire, pour découvrir au bout du compte non seulement que nous n’étions pas tous requis mais aussi que la majorité des compétences que nous avions acquises étaient superflues. Cela sera d’autant plus vrai dans les années qui vont suivre la grande crise sanitaire de 2020, cet incroyable accélérateur du processus de modernisation. Sauf pour une minorité qui réussira à conquérir les rares positions attractives sur un marché du travail de plus en plus polarisé, la vie professionnelle ne pourra offrir qu’une interminable suite de déceptions. Les valeurs de créativité, d’autonomie, de non-conformisme qui auraient dû nous rendre attractifs apparaissent déjà comme des fardeaux à la fois professionnels et psychologiques. Incapables de penser la crise du capitalisme, nos sociétés ont échoué à prévoir et à planifier les besoins collectifs qui devaient être satisfaits à moyen et à long terme. Mais si l’explosion d’une bulle financière porte à une massive destruction de capital, qu’arrive-t-il lorsqu’explose une bulle humaine ?
Sauf pour une minorité qui réussira à conquérir les rares positions attractives sur un marché du travail de plus en plus polarisé, la vie professionnelle ne pourra offrir qu’une interminable suite de déceptions.
RAFFAELE ALBERTO VENTURA
C’est le problème qu’ont les usines : le temps entre l’investissement, la production et la vente. Le temps que souvent nous n’avons pas pour nous retourner lorsque nous découvrons que nous avons fait un mauvais pari sur l’avenir. Comme jadis dans les écoles militaires on tirait des enseignements à partir des compte-rendus des grandes batailles, aujourd’hui dans les écoles de commerce les futurs cadres et employés étudient les success stories et les brand failures des entreprises côtées en Bourse. Ils apprennent ainsi que le marché est ondoyant et qu’il faut ondoyer avec lui, en innovant sans cesse. Certains cas d’étude sont récurrents, comme celui de Kodak qui sous-estima l’impact du numérique sur la photographie et continua à investir massivement dans la pellicule jusqu’en 2003, ou celui du Betamax, le système d’enregistrement vidéo lancé par Sony en 1975 et anéanti par le succès du format VHS, pourtant mis en vente par JVC une année plus tard. Et pourtant on dit que la qualité du Betamax était bien meilleure que celle de son concurrent : le destin est parfois injuste. La date de naissance de ce format malheureux en fait une bonne allégorie des péripéties existentielles des derniers membres de la Génération X et des premiers Millennials.

L’échec, comme l’apprennent les jeunes personnes ambitieuses, fait partie du jeu. Certaines entreprises feront faillite et d’autres fleuriront, mais lorsque tout va bien, le mécanisme est vertueux et s’équilibre. La faillite des entreprises moins performantes est même nécessaire pour que les ressources aillent au plus innovantes. L’économiste autrichien Joseph Schumpeter parlait pour cela de « destruction créatrice », un ouragan perpétuel qu’il faut savoir traverser avec audace. Mais que se passe-t-il lorsqu’une économie entière se trompe de direction, en misant ses meilleures ressources sur des mauvais secteurs ? Qu’arrive-t-il si l’échec n’est pas compensé par une réussite et s’avère systémique ? Nous aurons peut-être l’occasion de le découvrir dans les prochaines années s’il se confirme que le système capitaliste est en train de vivre, un peu comme Kodak, sa « civilization failure« . C’est l’histoire d’une société qui a tellement cru dans ses propres projections de croissance qu’elle en a tout investi sur un avenir qui risque de ne jamais arriver, un avenir merveilleux où tout le monde aurait atteint le confort et réalisé ses rêves de carrière. C’est aussi l’histoire d’un système éducatif qui a fabriqué une génération de machines inutiles, la génération Betamax.
Dans les pays occidentaux, l’extraordinaire croissance économique des Trente glorieuses a permis à des segments de plus en plus amples de la population d’accéder à la classe moyenne. Tandis que les activités à basse qualification étaient affectées à des travailleurs immigrés ou externalisées vers les pays en voie de développement, une partie des ressources financières nouvellement acquises par les familles européennes et américaines a été investie dans la reproduction voire dans l’ascension sociale, à travers l’accumulation de ce qu’on appelle le capital culturel : apprentissage de la langue et des codes sociaux, construction de réseaux, acquisition de titres valable sur le marché de l’emploi. C’est ainsi que nous avons été formés à faire des choses extraordinaires et éduqués à les consommer. L’usine du petit-bourgeois gentilhomme a battu son plein, jusqu’à ce qu’on se rende compte que la course à la capitalisation culturelle avait l’effet pervers de dévaloriser, en les banalisant, les avantages acquis. La société aurait-elle donc passé les trente dernières années à fabriquer des machines inutiles ? On croyait avoir inventé le mouvement perpétuel, et à force de tertiarisation d’avoir aboli le travail. Mais ce n’était qu’un rêve.
On dit que le Betamax était un meilleur format que son concurrent, mais cela n’a pas été suffisant. Où sont passés tous ces vieux magnétoscopes ? Certains sont vendus sur Internet comme des antiquités de collection, témoins d’une époque optimiste ; d’autres ont été démontés et recyclés pour devenir des appareils plus utiles : ils bippent, ils réchauffent, ils mixent. Concentrés sur ces activités banales, ils ne cessent de penser avec mélancolie aux années merveilleuses lorsque l’on croyait encore que le Betamax aurait conquis le monde.

2.
Et nous alors ? Pour rendre malheureux un homme, il suffit de l’habituer à un style de vie qu’il ne peut pas se permettre : c’est la théorie qu’énonce le duc Des Esseintes, protagoniste du roman À rebours de Joris-Karl Huysmans. Prototype du dandy littéraire, il s’agit surtout d’un antihéros décadent et sadique : la scène la plus célèbre du livre reste celle où il torture à mort une tortue en incrustant des pierres précieuses dans sa carapace. Mais c’est une autre scène – non moins cruelle – qui illustre sa théorie. Elle a pour victime un misérable galopin d’environ seize ans, orphelin de sa mère, du nom d’Auguste Langlois. Le duc veut l’habituer à fréquenter le bordel : « En l’amenant ici, au milieu d’un luxe qu’il ne soupçonnait même pas et qui se gravera forcément dans sa mémoire ; en lui offrant, tous les quinze jours, une telle aubaine, il prendra l’habitude de ces jouissances que ses moyens lui interdisent. » Ainsi Des Esseintes réalise son plan diabolique : « J’aurai contribué, dans la mesure de mes ressources, à créer un gredin, un ennemi de plus pour cette hideuse société qui nous rançonne. » Car le malheur alimente le ressentiment face à la société, incapable de garantir des besoins devenus nécessaires. Ce ressentiment fomentera éventuellement la révolte. En quelques pages et sous l’apparence d’une simple anecdote, Huysmans n’aurait-il pas décrit à la perfection les contradictions culturelles de la société capitaliste, qui nous éduque à consommer toujours plus que ce qu’on pourra se permettre ?
L’usine du petit-bourgeois gentilhomme a battu son plein, jusqu’à ce qu’on se rende compte que la course à la capitalisation culturelle avait l’effet pervers de dévaloriser, en les banalisant, les avantages acquis.
RAFFAELE ALBERTO VENTURA
Nous avons aussi été éduqués à des luxes que nous ne soupçonnions pas, en imaginant pouvoir nous « réaliser » dans nos passions. Nous avons lu les grands classiques de la littérature, admiré des œuvres d’art, rêvé le grand amour, appris que nous avions le droit de devenir tout ce que nous voulions. Rien de cela ne nous attendait vraiment à l’orée de la vie adulte. C’est ainsi que nous avons été entraînés dans ce bordel et que nous risquons, comme Auguste Langlois, de nous transformer en gredins. Puisque le chemin vers l’enfer est pavé de bonnes intentions, il n’aura pas fallu de dandy décadent pour graver dans notre mémoire ces modèles hors d’atteinte : on aura eu les programmes scolaires de l’Education Nationale, conçus pour nous éduquer tous comme des bourgeois, et le matraquage publicitaire de l’industrie culturelle. Pensez à toutes ces publicités de smartphones qui promettent de nous transformer en photographes, réalisateurs, DJ ou jeunes cadres dynamiques.
Car il fallait bien faire tourner la machine. Hegel avait dénoncé il y a bien longtemps la contradiction fondamentale du capitalisme : « Malgré son excès de richesse, la société civile n’est pas assez riche. » Le philosophe allemand, lecteur d’économie politique, indiquait que la productivité de l’industrie avait tendance à excéder les capacités d’absorption du marché. Un véritable problème, car par effet du progrès technologique la masse des marchandises à valoriser augmentait tellement vite que personne ne pouvait les acheter. Par bonheur, au XXe siècle, apparut comme un messie la classe moyenne, élue et destinée à consommer ce surplus. Selon la doctrine keynésienne, l’État se chargeait de prélever une part croissante de profit pour la réassigner à la consommation. Mais il aura fallu aussi une révolution culturelle, au niveau des mentalités, pour que ces ressources soient mises au service d’une consommation massive et ininterrompue : il fallait stimuler les besoins et garantir l’obsolescence des désirs, en créant une humanité éternellement insatisfaite. La promesse de mobilité sociale servit parfaitement à cette fonction. Une quantité croissante de ressources privées fut allouée à des investissements éducatifs pour l’accès aux meilleures positions sur le marché du travail.
Je rêve parfois d‘être un personnage littéraire. Par exemple une dame vénitienne tout droit sortie d’une pièce de théâtre du XVIIIe siècle, élégante dans sa robe achetée à crédit. Elle veut impressionner un mari potentiel, si possible riche et pas trop avare, ce qui lui permettra de commencer à rembourser le tailleur. Pour la bourgeoisie de l’époque, apparaître est un travail à plein temps : cela sert à se situer dans l’espace social afin de se garantir un accès à la richesse produite en dehors de la scène, derrière les rideaux, à travers le circuit commercial des marchands de la Sérénissime, éparpillés partout dans le monde. On s’endette donc dans l’espoir de régler ses dettes, comme le ferait une Nation insolvable qui espère relancer l’économie en creusant son déficit public. Mais dans les lieux de villégiature fréquentés par les vénitiens, les robes sont plus nombreuses que les maris potentiels ; c’est pour cela qu’il faut avoir la plus belle, la plus chère, le dernier cri. C’est la « consommation ostentatoire » dont écrira en 1899 l’économiste Thorstein Veblen dans sa Théorie de la classe de loisir, portrait cinglant de la bourgeoise américaine de l’époque.
Pourtant, notre situation est assez semblable. Car il faut bien que nous trouvions, nous aussi, une place dans la société. Une jolie robe ne suffira pas : on nous jugera sur notre aspect, certes, mais surtout sur nos titres, nos compétences, notre maîtrise des codes linguistiques, notre réseau de connaissances, notre capital culturel. Et puisque sur le marché du travail aussi les robes sont plus nombreuses que les maris potentiels – c’est-à-dire que nous sommes plus nombreux que les places disponibles – il nous faudra accumuler et montrer plus de capital culturel que les autres. Ces luxes ne sont pas superflus mais bien nécessaires à la survie dans un espace social où l’accès aux ressources se négocie en échangeant des signes et des signaux.

Ainsi notre nouvelle « classe de loisir » a investi de plus en plus de ressources dans cette compétition, avec pour résultat principal d’alimenter une escalade de dépenses improductives. Car cette pléthore de signes sociaux n’a de valeur que différentielle par rapport à la totalité de signes : les titres éducatifs, tout comme les marchandises de luxes, sont des biens « positionnels ». On ne peut pas les multiplier sans produire un effet d’inflation qui les dévalorise. Dès que s’enclenche une course aux armements symboliques, on se retrouve exactement dans la même situation que dans une course aux armements militaires, c’est-à-dire une sorte de dilemme du prisonnier. Et comme pendant la Guerre froide les observateurs craignaient une « destruction mutuelle assurée » (MAD), si bien décrite dans Le docteur Folamour de Stanley Kubrick, nous risquons aujourd’hui un déclassement mutuel assuré. Les conséquences en sont dramatiques : le coût de la reproduction sociale augmente en rendant de plus en plus inégalitaire l’accès au marché du travail ; les familles gaspillent de plus en plus de leur patrimoine ; l’écart de rémunération entre les professions se creuse. La classe moyenne a été prise au piège d’une crise de suraccumulation, c’est-à-dire qu’il y a globalement plus de capitaux que d’opportunités d’investissements. Le résultat, c’est une surproduction de titres, une surproduction de capital humain qualifié, mais surtout une surproduction d’aspirations. Une dysphorie de classe, aussi, car comme la dysphorie de genre est marquée par une non-correspondance entre le sexe biologique et l’identité perçue par l’individu, de plus en plus d’invidus se trouvent déchirés entre un statut presque bourgeois et leur revenu presque prolétaire.
3.
Voyons le bon côté des choses : grâce aux progrès de la technologie et à la division internationale du travail, c’est-à-dire grâce au capitalisme, les Auguste Langlois de ce monde meurent de moins en moins de faim. Paradoxalement, et c’est le mauvais côté de ce même capitalisme, ils meurent de plus en plus de désespoir, c’est-à-dire d’une misère relative et socialement construite. Le sociologue Emile Durkheim l’appelait anomie. Comme l’a démontré Des Esseintes sur le corps vivant de son protégé, nous n’avons pas seulement des exigences matérielles mais aussi des besoins induits qui réclament parfois plus d’attention que les besoins primaires.
Dans les années 1940 le psychologue américain Abraham Maslow avait prétendu identifier une hiérarchie des besoins qui allait du matériel au très abstrait. En bas de la pyramide il y avait les besoins physiologiques comme la respiration, la faim, la soif ou le sommeil. Ensuite les besoins de sécurité, puis les besoins d’appartenance et d’amour, et à un niveau plus élevé le besoin d’estime et tout au sommet le besoin d’accomplissement de soi. En réalité les philosophes et les sociologues ont donné plusieurs noms à ce qui se passe dans cette zone aérienne de la pyramide : les Anciens parlaient d’honneur, Rousseau parle d’amour-propre et depuis Hegel on évoque le prestige et la reconnaissance. La plupart ont insisté sur l’importance pour l’être humain de satisfaire ce genre de besoins abstraits : ce sont eux qui déchaînent les conflits les plus violents, les révoltes et les guerres. Quant à nos choix de vie – quelles études choisir ? où aller habiter ? où partir en vacances ? où acheter nos vêtements ? – nous les avons plus souvent pris en fonction de nos besoins d’estime et d’accomplissement que de notre faim, soif ou sommeil. Un doute m’assaille : n’y aurait-il pas une erreur dans la hiérarchie proposée par Maslow ?
Il est temps de renverser sa pyramide : finalement on pense souvent à satisfaire nos besoins symboliques avant ceux qui sont matériels. Cela ne vaut pas seulement pour les individus mais aussi pour les sociétés. Jean Baudrillard le suggérait dans un court article de 1969, « La genèse idéologique des besoins ». Selon le sociologue, il n’existe aucun « minimum vital anthropologique » : dans chaque société ce minimum est défini artificiellement à partir de la part de richesse qui reste après l’extraction du surplus, c’est-à-dire du luxe, du sacré voire aujourd’hui du profit. De ce fait « un surplus énorme peut coexister avec la pire misère ». Même les individus peuvent être portés à des comportements qui ne respectent aucunement la hiérarchie matérialiste des besoins : Baudrillard prenait l’exemple de quelqu’un qui préférerait perdre toutes ses économies en jouant au poker, au prix de faire mourir de faim sa famille. Or nous avons tous notre poker à nous : un rêve à réaliser ou un talent particulier à cultiver. C’est que justement les besoins sont construits idéologiquement, sur la base de valeurs historiquement données et d’habitudes sociales ; les considérer comme des réalités naturelles relève selon Baudrillard d’une « psychologie primaire », voire de la « pensée magique« .
Voilà pourquoi nous sommes tellement insatisfaits et voilà pourquoi nous continuons à rêver d’ailleurs : nous avons été programmés ainsi. C’est parce qu’on nous a appris que tout était possible que nous sommes condamnés à vivre dans l’échec.
raffaele Alberto Ventura
Voilà pourquoi nous sommes tellement insatisfaits et voilà pourquoi nous continuons à rêver d’ailleurs : nous avons été programmés ainsi. C’est parce qu’on nous a appris que tout était possible que nous sommes condamnés à vivre dans l’échec. C’est parce qu’on nous a vendu de vieux rêves que nous n’arrivons pas à nous réveiller. À qui la faute ? Certains – je pense à nos parents ou à nos professeurs – étaient sans doute sincères lorsqu’ils croyaient qu’en nous éduquant à la beauté ils nous auraient aidé à la conquérir. Ils pensaient sincèrement qu’il eût été classiste de nous priver de l’espoir d’accomplir nos ambitions sous prétexte que cela nous aurait accoutumé à un style de vie réservé à un petit cercle d’élus. D’autres ne pensaient qu’à nous vendre leur marchandises, c’est-à-dire leurs livres, leurs cours de fac, leurs appareils technologiques : car il fallait bien faire tourner la machine, en créant toujours de nouveaux besoins symboliques et en faisant de l’accomplissement de soi la grande monoculture du capitalisme post-industriel. Ce mariage entre idéologie et économie, bonnes et mauvaises intentions, s’est refermé sur nous comme un piège digne d’une invention cruelle du duc Des Esseintes.
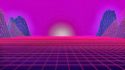
Nous sommes trop riches pour renoncer à nos aspirations et trop pauvres pour les réaliser. Le problème est pourtant récurrent, au rythme toujours plus rapide des cycles économiques. On parlait déjà au XIXe siècle de « chômage intellectuel » et d’encombrement des professions libérales. Comme le raconte un bel article d’Alain Chatriot, en 1934 un jeune docteur en droit du nom d’Alfred Rosier dénonçait l’existence d’une « masse d’intellectuels errants au gré des circonstances les plus diverses, prêts à abandonner toute spécialisation et ainsi le fruit de tant d’années d’efforts ». L’activisme de Rosier au sein de la Confédération des Travailleurs Intellectuels anima même un mouvement étudiant qui anticipait sous plus petite échelle celui de Mai 68. Quelques années plus tard André Liesse, professeur d’économie, revint sur cette crise en parlant d’une « inflation de parchemins » qui donnait vie à un véritable « prolétariat intellectuel ». Celui-ci souffrait de l’écart entre la valeur présumée de ses diplômes, censée lui donner des droits, et l’incapacité du marché du travail de l’absorber. Or il est difficile pour un système éducatif de planifier les besoins d’une économie à cinq ou dix ans — surtout si, comme après 1929, 2008 ou 2020, on sort d’une crise forcément imprévue. À l’époque, en tout cas, un rapport de la Société des Nations proposait une solution toute simple : trop d’individus instruits ? Aucun problème, nous développerons les institutions éducatives afin que ceux-ci soient absorbés au titre d’enseignants, et qu’ils forment d’autres instruits. À l’infini. Une véritable pyramide de Ponzi. Pourvu que la croissance économique soit toujours au rendez-vous et qu’aucune crise sanitaire ou écologique ne vienne interrompre sa lancée…
En 1942 Joseph Schumpeter, qui par ailleurs défendait le capitalisme comme le mode de production le plus efficient, osa se poser la question des questions : « Le capitalisme peut-il survivre ? » Sa conclusion était que le capitalisme cache en son sein une contradiction non pas strictement économique mais plutôt sociale et culturelle, car le système produit ses propres ennemis. Ce sont toujours eux : les chômeurs intellectuels, produits en masse au rythme de l’essor économique, ceux qui ont trop étudié et trop rêvé, ceux qui attendent qu’on leur donne ce qui leur est dû, une masse croissante d’insatisfaits qui peuple l’hémisphère Nord de la planète. La destruction créatrice n’est donc pas indolore. On savait qu’à chaque fin de cycle économique correspond une destruction concrète de capital, mais on oublie de raconter ce qui arrive au capital humain et comment s’opère sa destruction. L’ouragan de Schumpeter a un coût humain énorme puisqu’il abandonne à leur destin des individus que la société considère comme superflus. L’économiste arrive à la même conclusion que le duc Des Esseintes dans À rebours : leur insatisfaction va générer du ressentiment, ce ressentiment va produire la révolte. Amassées comme des vieux magnétoscopes dans une usine désaffectée, des millions de « machines inutiles » attendent en rêvant. Que se passera-t-il lorsqu’elles se réveilleront ?


