Éprouver la guerre civile, une conversation avec Quentin Deluermoz et Jérémie Foa
Travail interdisciplinaire, le livre dirigé par Quentin Deluermoz et Jérémie Foa explore la guerre civile comme moment de réarticulation incertain des normes implicites qui soutiennent une société. Des guerres de religion aux conflits en Ukraine et en Colombie, l'ouvrage examine ce qui persiste, change ou s'effondre dans l'incertitude.
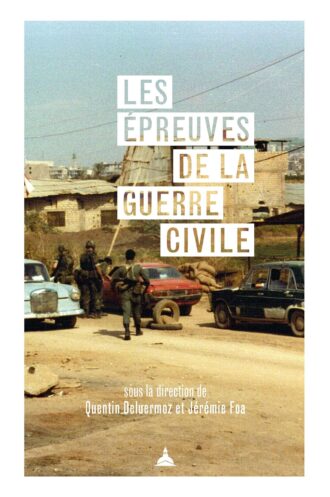
Vous êtes spécialistes d’époques séparées par près de trois siècles. Comment vous est venue l’idée de réunir des modernistes et des contemporanéistes ? Quitte à ouvrir largement la focale chronologique, pourquoi ne pas inclure des spécialistes d’histoire médiévale (à l’exception de Patrick Boucheron, qui signe l’avant-propos) voire d’histoire ancienne ?
Jérémie Foa
Nous avions l’idée de rester dans des terrains que nous connaissions tous les deux – le XVIe et le XIXe siècle, jusqu’au XXe siècle. Une figure qui nous paraissait très importante pour penser la guerre civile telle que nous l’entendions, c’est l’État, qui n’existe pas au sens moderne du terme à l’époque médiévale et à l’Antiquité. Nous ne voulions pas tomber dans une description tellement large qu’elle en deviendrait molle et peu rigoureuse. Circonscrire l’étude à des époques où l’institution centrale sous sa forme étatique est puissante nous permettait de rendre les situations comparables.
Quentin Deluermoz
Nous avions déjà travaillé ensemble sur la Commune de Paris (1871) : Jérémie Foa m’avait accompagné dans une enquête sur les usurpations de fonctions publiques. Son regard de seiziémiste percevait des choses que je ne voyais pas dans les archives. Par exemple, il était très sensible aux questions de dénominations – ex-préfecture de Police, ex-archevêque… À l’inverse, l’abondance (relative) des sources au XIXe siècle, autorisait des recherches qui étaient impossibles pour les guerres de Religion du XVIe siècle, sur les trajectoires sociales des acteurs ordinaires par exemple, suscitant alors d’autres questions. De là est venue l’idée de poursuivre cette rencontre féconde des attentions.
Mais ce qui nous réunit est aussi une démarche d’histoire nourrie de sciences sociales, qui permet notamment de se déplacer sur différents terrains et de les croiser. Dans le livre, nous approchons « au ras du sol » l’expérience de guerres civiles qui présentent de réelles similitudes tout en étant situées dans des époques différentes. Encore fallait-il circonscrire l’objet, d’où ce bornage chronologique moderne et contemporain dont Jérémie a donné la raison. Cette barrière n’est d’ailleurs pas si originale. Comme nous le disait récemment le médiéviste Jean-Claude Schmitt, s’il reste une frontière en histoire qu’on franchit rarement, même dans les approches transversales, c’est bien celle du XVIe siècle. L’avant-propos du médiéviste Patrick Boucheron a dans ce cadre précisément vocation à présenter la pertinence du questionnaire pour les périodes antérieures (de l’antiquité au moyen-âge) – et ce faisant de suggérer des pistes pour d’autres enquêtes à venir, tout en laissant l’étude collective se centrer sur l’après XVIe siècle.
En Europe, le paradigme de la guerre civile semble donc connaître une transformation au XVIe siècle. Est-ce attribuable aux guerres d’Italie, aux guerres de Religion, faut-il faire un lien entre les deux ?
Jérémie Foa
Bien sûr, il faut faire un lien entre les deux. Les guerres d’Italie marquent un moment de brutalisation des sociétés européennes, comme l’a bien montré Jean-Louis Fournel. Les Français qui vont se battre en Italie incorporent des pratiques de violence en Italie qui vont se retrouver ensuite dans les guerres de Religion. Ce lien est aussi important dans la construction d’une pensée de l’État. Les pensées de Machiavel ou de Guichardin servent dans le cadre des guerres de Religion pour penser le lien de la raison d’État avec d’autres impératifs comme la morale ou la religion.
Des événements appartenant à la période ultra contemporaine — de la guerre civile libanaise au génocide des Tutsis au Rwanda — ont-ils transformé la manière dont les historiens travaillent sur la guerre civile ?
Quentin Deluermoz
Précisons tout d’abord que jamais, dans ce travail, nous ne rencontrons de situation de guerre civile chimiquement pure, tout simplement parce que les définitions varient. C’est pourquoi nous avons adopté une approche relationnelle et pragmatique qui se concentre sur des dynamiques de guerre civile : celles-ci vont du conflit armé déclaré comme tel aux « formes paroxystiques de remise en cause du taken for granted, instaurant le soupçon au coeur du familier », pour reprendre la formule de Laurent Gayer à propos d’une étude sur un quartier de Karachi, au Pakistan. Cette grille de lecture permet de considérer des situations de destruction quasi-totale des ordres sociaux antérieurs, comme dans la Yougoslavie des années 1990, et d’autres où ces derniers, affectés, transformés, sont moins radicalement mis à mal, comme pendant la « guerre après la guerre » dans l’Espagne des années 1939-1950.
À l’évidence, la guerre civile libanaise (1975-1990) et le génocide des tutsis rwandais ont rendu visible la présence et l’importance de telles situations, et ont contribué à en donner cette définition ouverte. Par leur actualité, leur ampleur et leur intensité, ils ont amené les sciences sociales à reconsidérer les situations de guerre civile, de déchirures socio-politiques et plus largement de considérer la question de la violence et de l’incertitude. La seconde, par exemple, a transformé le regard des chercheuses et chercheurs en leur faisant considérer un massacre des voisins qui, comme l’a montré Hélène Dumas1, ne répondait à aucune des formes ou règles tacites que l’on estimait pertinentes jusque-là. Ce qui a poussé anthropologues, sociologues et historiens à remettre en question un certain nombre de considérations, y compris, en retour, pour l’étude de conflits appartenant à des époques anciennes.
Jérémie Foa
Celui qui montre bien ce millefeuille des époques, c’est Patrice Chéreau dans La Reine Margot, qui, tandis qu’il filme la Saint-Barthélémy, a sous les yeux les images de l’épuration ethnique en ex-Yougoslavie et celles du génocide des Tutsis du Rwanda. Les travaux d’Hélène Dumas sur le Rwanda m’ont personnellement permis d’appliquer une réflexion sur le massacre des voisins à la Saint-Barthélémy. Au sujet du Liban que vous évoquez, les images de la guerre civile libanaise ont été omniprésentes pendant les années de formation de la génération de chercheurs à laquelle nous appartenons. C’était l’actualité quotidienne des années 1980, tout en restant une forme de « souffrance à distance » comme le dit Luc Boltanski2, vécue par l’intermédiaire de la télévision.
Le fil conducteur des contributions que réunit ce livre semble être la façon dont la guerre civile est un moment où, dans une société, tout ce qui était ordinaire devient suspect. Une nouvelle grammaire sémiotique se met en place : il s’agit de sur-signifier son appartenance à un camp, ou au contraire de la masquer, par des gestes qu’on ne commettait pas auparavant. Pouvez-vous revenir sur cette intuition première et sur la façon dont elle s’illustre dans différents cas ?
Quentin Deluermoz
Cette attention à l’explicitation vient d’abord des réflexions que Jérémie Foa menait sur la guerre civile au XVIe siècle, avant de s’affiner au fur et à mesure de notre dialogue. L’idée principale, c’est bien que la guerre civile est un moment où tout ce qui était « normal » (qui n’apparaît tel qu’après coup) ne l’est plus, ne fonctionne plus – des accents aux façons de s’habiller en passant par les marques d’appartenance religieuse. L’objectif derrière cette hypothèse est double : d’une part, mieux comprendre ce qui se joue dans une guerre civile ; de l’autre, révéler l’ordre social tacite dans lequel nous baignons et vivons sans jamais y faire pleinement attention.
L’idée principale, c’est bien que la guerre civile est un moment où tout ce qui était « normal » ne l’est plus.
Quentin Deluermoz
La réussite de ce projet tient au fait que toutes les contributrices et tous les contributeurs ont accepté d’appliquer cette grille d’analyse à leur terrain et de la tester. Les moments de guerre civile y apparaissent bien comme des révélateurs, des moments d’explicitation des usages et des pratiques sociales : une identité religieuse jusqu’ici reléguée à la sphère privée devient d’un coup un marqueur essentiel. Et l’un des déplacements importants apparus au fil des échanges est que ce sont aussi des moments où de nouvelles règles tacites se mettent en place (par exemple de nouvelles habitudes de vie, ou le recours à de nouvelles catégories de repérage social, comme « Blanc », « Rouge » dans l’Ukraine des années 1918-1920). Il y a explicitation et reconstruction de l’implicite – mais elles se caractérisent cette fois par leur instabilité. C’est toute la différence avec ce que les sociologues appellent, pour les temps dits « normaux », « le sens commun » et le « repos sur l’institution ». Tout l’enjeu des périodes de guerre civile va être, pour les victimes ou les populations, soit d’échapper à la mort, soit de stabiliser des règles communes dont on sait qu’elles n’appartiennent pas à tous et qu’elles restent constamment mouvantes.
Jérémie Foa
Un des points originaires de cette réflexion, c’est la sociologie pragmatique et notamment les travaux de Luc Boltanski. Son concept d’incertitude nous a permis d’approcher la guerre civile non de manière essentialiste, en partant d’une définition, mais plutôt sous un angle processuel : nous nous sommes demandés non pas ce qu’est la guerre civile mais davantage ce que fait la guerre civile en la considérant comme un moment qui provoque de l’incertitude dans le tissu social, et donc via les tactiques par lesquelles on tente de réduire cette incertitude. L’article de Sophie Wahnich développe ainsi une lecture de la Révolution française comme un moment de crise de confiance. Autour de ces concepts d’incertitude, de confiance, nous proposons une grille d’analyse pour se demander ce que la guerre civile fait s’effondrer dans ce qui nous paraît évident en temps de paix. Nous avons pris la guerre civile comme un laboratoire de l’évidence, comme un révélateur de ce qui, dans un temps « normal », se déroule sans faire l’objet d’un doute ou d’une méfiance. L’hypothèse fondatrice de ce livre est que la guerre civile est un moment où tous ces implicites qui nous permettent de vivre ensemble, au moins depuis le XVIe siècle, sont fragilisés, mis à nu, questionnés, explicités. Dans le fond, c’est aux processus de hausse de la réflexivité dans la crise (explicitation) comme aux phénomènes de « régressions vers les habitus » (Michel Dobry) que nous nous sommes intéressés. Nous avons ainsi proposé à nos contributeurs de travailler sur quatre doutes fondamentaux : sur les gens, sur les mots, sur l’espace et sur les choses.
En temps normal, il y a une sorte de tautologie de l’existence : un vêtement c’est un vêtement, un tonneau c’est un tonneau. Quand l’incertitude apparaît, un tonneau peut toujours cacher un traître ou une bombe, un vêtement peut toujours voiler une identité qui se dissimule. Toute une série de faits et de phénomènes qu’on n’interrogeait même pas en temps normal se font un objet de doute. Le sociologue américain Harold Garfinkel a tenté de reproduire, en laboratoire, ce type de crise en demandant à ses étudiants de parler à leurs parents comme s’ils étaient étrangers, de rendre problématique leur implicite familial, extraordinaire leur quotidien. Questionner l’évidence en situation normale, c’est s’exposer à passer pour un fou, à être taxé d’anormalité. En temps de paix, demander à quelqu’un de dévoiler son identité, exiger de fouiller son sac, de vérifier ce qu’il porte sous ses vêtements, ce n’est pas normal. Comme le montre Luc Boltanski, en situation de guerre civile, cet ultra-scepticisme ou cette prolifération des enquêtes3, qui pourraient passer pour de la paranoïa en situation ordinaire ne relève plus de la folie mais de la prudence. Ce sont aussi les frontières du normal et du pathologique qui sont déplacées par la guerre civile.
La situation que vous décrivez est celle où la guerre civile est déjà là. Mais comment entre-t-on en guerre civile ?
Quentin Deluermoz
Votre question est très importante car la recherche des origines est un classique en histoire. Or, elle pose problème. Elle suppose une définition stable (et essentialisée) de ce dans quoi on « entre », et son choix oriente l’interprétation des faits. Par exemple pour la Commune de Paris que je connais mieux, vous ne suggérerez pas la même interprétation si vous débutez avec la guerre franco-prussienne de 1870 (la Commune est alors le fruit de la contingence), ou les mouvements des « réunions publiques » de la fin des années 1860 (elle est cette fois le produit d’un mouvement politique et populaire). Pour éviter ce problème, sans renoncer à l’explication, chercheurs et chercheuses en histoire et sciences sociales mobilisent une approche dite processuelle, qui est celle que l’on reprend dans le livre. Pour analyser l’émergence de ces situations nouvelles, on distingue des « conditions de possibilités » qui n’aboutissent pas forcément à un changement brutal, des éléments déclencheurs et enfin la dynamique propre de la crise, avec son efficacité de transformation à elle. En gros, on explique le quand et le pourquoi par le comment. Cela permet aussi de penser la manière dont le passé persiste ou est transformé dans le présent de la crise, ou ici de la guerre civile, mais aussi de se montrer sensible à ces moments où ce qui allait de soi se déchire, où se créent peu à peu les clivages ami/ennemi. Enfin, elle invite on l’a dit à appréhender les logiques spécifiques de ce nouvel univers de sens et de pratiques, très particulier, auquel ce processus aboutit.
Jérémie Foa
La question de l’origine ne nous a pas travaillé problématiquement. Je le vois aussi avec le massacre de la Saint-Barthélémy, où la question de l’origine a mobilisé des énergies démesurées au regard des résultats qu’elle a produits. Pour prolonger ce que dit Quentin, en neutralisant cette question de la cause, de l’étincelle – qui reste bien sûr une question légitime–, nous avons préféré nous placer au moment où les acteurs soit le disent, soit le sentent et tentent de qualifier les moments qu’ils traversent. Bien sûr, tous les acteurs ne considèrent pas qu’ils sont en guerre civile – c’est le cas de la Révolution française par exemple. Quand certains observateurs parlent de guerre civile, d’autres préférent qualifier les événements de troubles, d’émeute, de rébellion, de « guerre des gangs », etc. En refusant de partir d’une définition imposée d’en haut, nous avons préféré nous situer au ras du sol, en nous plaçant à cet instant même où les acteurs considèrent qu’ils sont dans une situation d’incertitude radicale par rapport à l’ensemble de ce qu’ils pouvaient vivre et faire au quotidien.
Tenter de saisir historiquement la guerre civile permet-il de mieux définir la guerre « classique » ? La démarcation entre les deux phénomènes est-elle très poreuse ?
Je pense en réalité que, sur le terrain, existe un long continuum entre ces deux états de « guerre ». À l’état chimiquement pur, ce sont deux phénomènes qui s’opposent radicalement. Théoriquement, une guerre au sens classique – on parlait de « guerre juste » au Moyen-Âge – oppose deux États ou deux pays qui ne se reconnaissaient pas antérieurement comme membres d’une même communauté. De même, la guerre classique se déroule dans un temps supposément encadré, dans un lieu circonscrit, le long d’un front où des personnes désignées pour le combat se battent, tandis qu’à l’arrière une vie sociale perdure, protégeant dans un abri plus ou moins sûr les civils, les femmes et les enfants. Dans la guerre civile, ces distinctions entre le front et l’arrière, entre l’ami et l’ennemi, le civil et le combattant, les temporalités du combat, la dimension reconnaissable de l’ennemi, tout cela est bouleversé. Ainsi au cours des guerres de Religion, on peut se battre dans une rue, dans une chambre, tuer quelqu’un le dimanche ou la nuit, s’en prendre à des femmes ou à des enfants, à des villes désarmées, etc. Ce sont tous ces partages que la guerre civile déplace. Mais plus on s’approche du terrain par des études de cas, plus cette opposition théorique s’estompe.
Quentin Deluermoz
Les précisions de Jérémie sont importantes pour saisir les phénomènes observés et dégager leurs enjeux. Elles permettent aussi de rappeler que rarement les guerres civiles fonctionnent isolément, même définies de manière plus stricte (par exemple, en suivant Jean-Clément Martin dans sa contribution, comme une dynamique qui divise une communauté qui antérieurement se considérait comme unie, et qui est provoquée par la concurrence de groupes luttant pour le contrôle du pouvoir et exercer la violence estimée légitime). Elles se combinent souvent avec des guerres internationales, parfois avec des processus de nettoyage ethnique ou une volonté de destruction d’une partie de la population, parfois au contraire avec une dynamique révolutionnaire porteuse d’un projet de justice sociale et d’égalité populaire. Une partie d’un pays peut connaître un état de paix, une autre une situation de guerre civile ou de sécession, comme au Mexique de la fin du XXe siècle. Chacun des cas explorés dans l’ouvrage rappelle cette intrication des situations, expliquant d’ailleurs les conflits entre camps sur la désignation de la situation : « guerre civile », « guerre », « lutte contre le crime », « action terroriste », « événements », « révolution », etc.
Les formes de la guerre « classique » ont changé ces dernières décennies : elles sont moins conventionnelles, moins linéaires, plus irrégulières.
Quentin Deluermoz
L’enquête doit rester attentive à ces réalités plurielles et à ces luttes de significations. Autrement dit, travailler sur les guerres civiles, c’est à la fois permettre de pouvoir encore la distinguer de la guerre conventionnelle, et ainsi même de définir cette dernière ; mais c’est aussi s’autoriser à se saisir des mutations qui ne répondent pas aux catégories classiques de la guerre et de la paix forgées au XIXe et XXe siècle. Cela vaut pour le passé comme pour le présent. Comme vous le savez, les formes de la guerre « classique » ont changé ces dernières décennies : elles sont moins conventionnelles, moins linéaires, plus irrégulières. Et les périmètres s’affaissant, les distinctions s’effritent. L’approche retenue dans l’ouvrage et la diversité des cas abordés peut aider à mieux se saisir, pour reprendre le langage des sociologues Dominique Linhardt et Cédric Moreau de Bellaing4, de la manière dont se nouent la guerre et la paix, le droit et la violence, l’intérieur et l’extérieur.
Si la question de l’entrée en guerre civile peut être neutralisée, il n’en va sans doute pas de même pour la sortie de la guerre civile. Comment se produit le retour, même partiel, à la normalité ?
Jérémie Foa
Cette question nous a plus mobilisés, parce qu’elle engage la question de l’institution, pensée par Boltanski comme un réducteur d’incertitude. Comment recrée-t-on de la certitude ? Les contributeurs de l’ouvrage se sont intéressés aux différents processus d’institutionnalisation qui cherchent à faire sortir de l’instabilité et contribuent ce faisant à asseoir à la pacification. L’institution, un État fort par exemple, c’est ce qui rétablit la puissance tautologique du langage, des objets, des normes, des monnaies. Un exemple d’institutionnalisation, c’est le dictionnaire : l’établissement d’un sens circonscrit aux mots (« un sou est un sou », un « chou est un chou »), par opposition à la prolifération sémantique des mots que Thucydide observait déjà pendant la guerre du Péloponnèse. Ce sont aussi les papiers d’identité (qui disent que les personnes sont ce qu’elles disent) ou un sceau étatique, autant de procédés de certification qui évoluent technologiquement dans l’histoire. Plutôt que de s’intéresser aux grandes décisions de paix par en haut, nous avons là encore privilégié une observation au ras du sol des processus d’institutionnalisation qui amènent un retour progressif de la paix.
Quentin Deluermoz
Depuis plusieurs années, l’étude des sorties de guerre s’est fortement développée en histoire (je songe en particulier aux travaux de Bruno Cabanes) ; des travaux sur les sorties de guerre civile seraient tout à fait importants, dans la mesure où se pose alors la question, en effet, de l’institution, de l’adéquation des mots aux choses, de la restitution de la confiance dans les routines ou de l’acceptation des tensions dans un cadre pacifique. Soit un changement, à nouveau, d’ordre anthropologique. L’angle adopté dans l’ouvrage peut dessiner des pistes pour saisir ce travail difficile de suture sur le plan politique, juridique mais aussi social, culturel et intime. Élisabeth Claverie montre par exemple l’importance du tribunal pénal international dans la sortie de la situation de guerre civile qu’a connue la Yougoslavie dans les années 1990 (et toute la difficulté qu’il y a, alors, à appliquer les catégories juridiques sur le trouble absolu qui était alors présent). Mais les chapitres rappellent aussi que la question de la distinction entre l’avant et l’après, entre l’ordinaire et l’extraordinaire, reste souvent tissée de continuités. Ainsi, même lorsqu’existent des marqueurs nets pour signifier politiquement et symboliquement la fin de la guerre civile, le traumatisme, individuel ou collectif, indique la persistance des souffrances dans le monde d’après. À propos de la séparation entre l’Inde et le Pakistan en 1947, l’anthropologue Veena Das5 a montré ainsi dans un livre célèbre la puissance des souffrances psychiques et intimes qui affectent, longtemps après les faits, parfois même sur plusieurs générations, les relations personnelles, les corps comme les mots. De nombreux chapitres de l’ouvrage rendent compte de ces continuités. D’autres, encore, posent la question de la fin de la guerre civile, dans des cas où elle dure plusieurs dizaines d’années, comme au Liban, ou encore lorsque cette « sortie » n’est jamais réellement actée ou effective, comme dans l’Uraba Colombien. La déliquescence durable est aussi une issue possible des sorties de guerre civile.
Même si les vertus d’un certain usage de l’anachronisme sont rappelées par Patrick Boucheron, qui cite Nicole Loraux dans sa préface, l’exercice est toujours périlleux pour la discipline historique, plus encore lorsqu’il s’agit d’appliquer le savoir historique à l’analyse du présent. Toutefois, la manifestation du 8 janvier 2023 au Brésil, comme peut-être celle du 6 janvier 2021 à Washington, ravivent le spectre de la guerre civile dans le présent politique de certains pays. Quelle grille de lecture les contributions des Épreuves de la guerre civile peuvent-elles nous apporter sur ces événements contemporains ?
Jérémie Foa
Comme vous le dites justement, l’histoire ne donne pas de leçon – et quand elle en donnerait, on demeurerait toujours libre de les suivre ou non. Elle ne donne pas de leçons mais elle éclaire des choix, c’est pourquoi je pense que la grille de lecture que notre ouvrage propose sur les guerres civiles du passé peut avoir une certaine pertinence dans le présent. Je pense ainsi que cette approche processuelle de la guerre civile par ce qu’elle fait et moins par ce qu’elle est peut aider à tracer des comparaisons, à guetter des échos entre le passé et le présent.
L’histoire ne donne pas de leçon, mais elle éclaire des choix.
Jérémie Foa
Quentin Deluermoz
La diversité des scènes abordées dans le livre rappelle déjà qu’en réalité, à l’échelle de la planète, de telles situations de discordes et de déchirements sont récurrentes. Ceci posé, il est vrai que le contexte dans lequel nous vivons depuis une trentaine d’années, marqué par l’accroissement des inégalités, la crise environnementale, la montée des nationalismes, la méfiance dans les institutions représentatives ou encore le succès des discours complotistes sur les réseaux sociaux explique en partie que dans les deux pays dont vous parlez, le Brésil et les États-Unis (mais il y en a d’autres), les populations finissent par se partager en des camps qui semblent irréconciliables, camps qui mettent à mal les principes de la démocratie libérale jusqu’ici acceptés (comme le fait de reconnaître sa défaite aux élections). Pour l’instant, ces derniers tiennent bien cependant. En ce sens, Les épreuves de la guerre civile permettent de sortir ces situation « extra-ordinaires » de l’exceptionnel et d’en rappeler au contraire, hélas, la régularité. Elles offrent un moyen de se familiariser avec des univers où plus rien « ne va de soi », d’être attentifs aux mutations contemporaines mais aussi au nécessaire décentrement des regards. Comme le rappelle Yassin al haj Saleh, écrivain syrien, dans un récent numéro de la revue Sensibilités à laquelle j’appartiens, du point de vue de la Syrie et du Moyen Orient, le fonctionnement normal du monde est un état réservé aux sociétés dites occidentales, qui ressemble dans ses régions à une sorte de fiction lointaine.
Y a-t-il des conflits ou des questions que vous auriez voulu traiter dans cet ouvrage qui en sont absents ?
Beaucoup, bien sûr. L’espace subsaharien, ancien ou passé, est trop absent de notre panorama. Pour le XIXe siècle que je connais mieux, les guerres civiles espagnoles du début du siècle, ou surtout la guerre de Sécession américaine (1860-1865), auraient à l’évidence mérité un traitement. Pour le reste, bien des aspects sont traités que nous n’avons pas abordé ici, comme le rôle de la conflictualité et de leurs effets sur les positionnements politiques abordés par Malika Rahal pour l’Algérie de la fin des années 1980. Néanmoins, il me semble que la question du droit ou des imaginaires, sans être toujours absents (comme le montre le chapitre sur Karachi ou sur le renforcement de l’État après les guerres civiles du XVIe siècle) auraient mérité plus de développement. Tout comme, pour la période contemporaine, le rôle des acteurs internationaux (ONG, médias, État ou communauté d’États). Il faut rappeler cependant que l’ouvrage a bien vocation à poser des jalons et à ouvrir des questionnements. Comme nous le rappelons en introduction, le travail de comparaison, s’il est désormais rendu possible par la démarche, reste par exemple à mettre plus concrètement en œuvre.
Jérémie Foa
Il y en a évidemment. Je pense en particulier, en plus de ce qui vient d’être évoqué, à la Fronde au XVIIe siècle, à l’Irlande au XXe siècle. La série de ces études de cas reste ouverte et pourrait être étendue. Surtout ces problématiques, telles que nous les avons construites à partir de nos approches respectives des guerres de Religion et de la Commune, gagneraient aussi, je crois, à être contestées et affinées par une extension des cas étudiés.
La « guerre civile » (qu’elle soit crainte, fantasmée ou préparée) est un point topique de l’imaginaire des droites radicales. Comment l’expliquer ? Cela pourrait-il dériver du sentiment d’avoir été « vaincu » par l’histoire, une situation que seule la confrontation violente pourrait renverser ?
Vous avez raison, le spectre de la guerre civile hante la pensée d’extrême droite. On le vérifie tous les jours sur les chaînes d’information en continu en France ou aux États-Unis. Pour remonter aux origines de l’extrême droite contemporaine, on peut remarquer qu’Edouard Drumond ou Charles Maurras étaient hantés par la Saint-Barthélémy et par l’idée de l’ennemi invisible au sein de la société. Cette obsession est présente chez Éric Zemmour, qui lui aussi trace un parallèle entre Protestantisme et Islam, deux « partis invisibles » qui menaceraient la France de l’intérieur, en prétendant tirer leçon des décisions prises par Catherine de Médicis (la Saint-Barthélémy, en 1572), Richelieu (la guerre, le siège de la Rochelle) puis Louis XIV (la révocation de l’Édit de Nantes, en 1685) pour lutter contre les Réformés. Le paradigme de la guerre civile larvée, de l’ennemi intérieur, est au cœur de la pensée d’extrême droite.
Le spectre de la guerre civile hante la pensée d’extrême droite.
Jérémie Foa
Quentin Deluermoz
Il faut rappeler cependant que la dénonciation de la guerre civile n’est pas propre à la droite. C’est un motif que l’on retrouve depuis l’antiquité. Comme l’a montré l’historien Jean-Claude Caron, dans la France du XIXe siècle, la guerre civile est la figure du mal absolu que les différents camps se renvoient, car elle signifie la négation de la concorde. Ainsi est-elle utilisée par les autorités en place pour fédérer les populations derrière elle, ou par les insurgés pour dénoncer un pouvoir fauteur de massacre et soucieux de préserver ses positions ; elle est mobilisée à gauche, comme à droite, selon des intentions évidemment différentes. La version aujourd’hui la plus visible, en France, aux États-Unis et ailleurs (il s’agit bien là d’un phénomène transnational) est en effet celle des droites radicales. Ce discours dénonce tantôt une guerre civile des dealers et criminels contre les honnêtes gens, tantôt une lutte de civilisation, voire une véritable guerre des races. Ces descriptions fantasmées sont sous-tendues par une perspective assez claire : elles visent en réponse à un retour à l’ordre, à un durcissement autoritaire du pouvoir (trop « mou »), à la fin d’une intolérance jugée coupable et à une imposition ferme, voire plus, de normes sociales, raciales, culturelles jugées essentielles. En ce sens, il s’agit bien d’un discours classique d’extrême droite. Le livre rappelle aussi comment cette notion de « guerre civile » peut-être instrumentalisée, sur les terrains étudiés, au sein des luttes politiques.
Sources
- Hélène Dumas, Le génocide au village : le massacre des Tutsi au Rwanda, Paris, Éditions du Seuil, 2014
- Luc Boltanski, La souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique, Paris, Métailié, 1993.
- Énigmes et complots : Une enquête à propos d’enquêtes, Paris, Gallimard, 2012
- Dominique Linhardt, Cédric Moreau de Bellaing, « Ni guerre, ni paix. Dislocations de l’ordre politique et décantonnements de la guerre », dans Politix, n°104, 2013/4, p. 7-23.
- Veena Das & al., Remaking a World Violence, Social Suffering, and Recovery, Berkeley, University of California Press, 2001.

