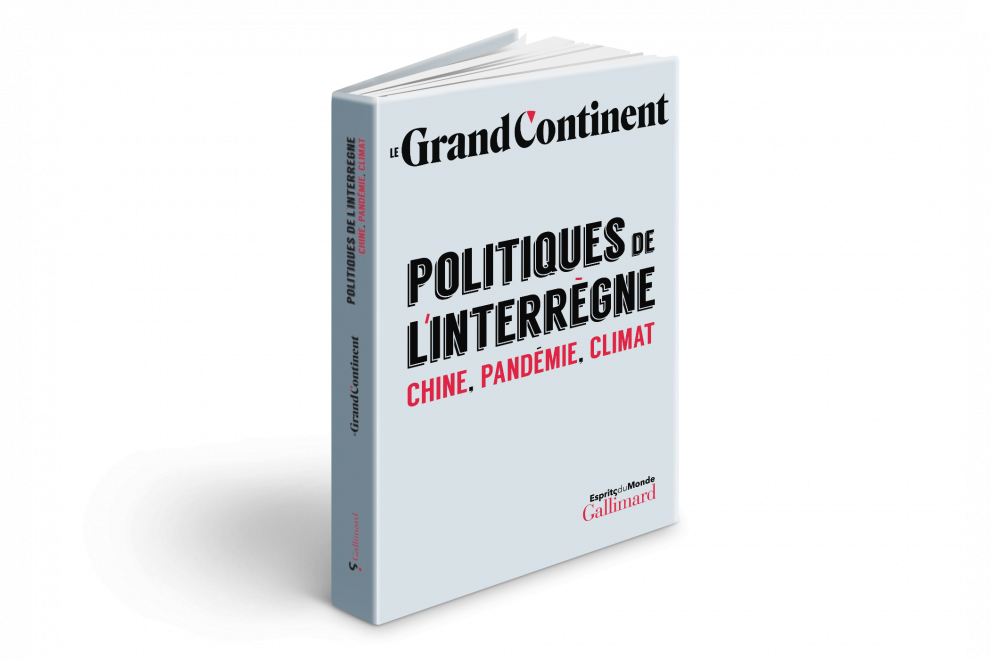Abonnez-vous à nos Lettres Restez informés des actualités du Grand Continent
Il y a guerre et guerre. Il y a la guerre physique, armée et mortelle qui a refait irruption en Europe depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et se signale par la détresse et l’horreur, à Marioupol et au-delà. Et il y a la guerre métaphorique, à l’instar de celle déclenchée contre le virus à laquelle le président de la République avait souhaité faire référence en déclenchant l’état d’urgence sanitaire face au Covid-19. Cette guerre-là était une des expressions de l’état d’urgence qui depuis plusieurs années sature notre vie politique, sociale et démocratique. À côté des états d’urgence supposés (en 2016 et en 2018, face à divers mouvements sociaux, les présidents Hollande et Macron ont déclaré « l’état d’urgence économique et sociale ») et des états d’urgence revendiqués (depuis 2020, le secrétaire général de l’ONU appelle les États à déclarer l’« état d’urgence climatique »), il y a eu, en effet, les états d’urgence avérés. La France a vécu 47 des 76 mois écoulés depuis le 13 novembre 2015 sous état d’urgence, anti-terroriste, d’abord, sanitaire, ensuite. De sorte qu’à côté ou derrière ce dramatique retour de la guerre en Europe, il ne faut pas oublier cette forme de l’état d’urgence qui s’est ancrée durablement dans notre vie politique et juridique. Car on peut raisonnablement faire l’hypothèse sommaire qu’on ne gouverne pas impunément par l’état d’urgence – et donc considérer qu’il est important d’interroger ce que nous coûte cette permanence inédite du gouvernement par l’état d’urgence.
L’installation des « pouvoirs d’urgence » au rang des paradigmes de gouvernement n’est certes pas unique à la France ; elle s’observe à l’échelle du monde, au moins depuis ce point de bascule qu’auront constitué les attentats perpétrés sur le sol états-unien le 11 septembre 2001. Le vice-président états-unien Dick Cheney l’avait à l’époque d’ailleurs reconnu en termes clairs : « La politique de sécurité intérieure n’est pas une réponse temporaire à une crise donnée. Nombre des initiatives que nous avons dû prendre deviendront permanentes dans la vie américaine […]. J’y vois une nouvelle normalité »1. Vingt ans plus tard, la réponse américaine à ces attaques est volontiers lue comme ayant inauguré, bien au-delà des États-Unis, une nouvelle ère de l’état d’urgence mondial permanent2. Et si la question terroriste a joué ici un rôle premier, la crise pandémique liée au Covid-19 a puissamment renforcé cette tendance à la gestion de crise par le recours aux pouvoirs exceptionnels : du Japon au Maroc, du Portugal ou de la Serbie à la Malaisie, des régimes d’urgence ont été activés dans plus de cent pays3. Dans la forme, ces régimes d’exception peuvent bien sûr différer. Il s’agit tantôt de dispositifs prévus par la Constitution (près de 9 constitutions sur 10 prévoient un dispositif spécifique en cas de crise : « état de danger » en Hongrie, « état d’alarme » en Espagne, « état d’urgence » au Ghana…), tantôt de régimes législatifs, qui peuvent préexister à la crise ou être façonnés ad hoc – à l’instar du célèbre Patriot Act américain voté au lendemain des attaques du 11 septembre 2001 mais aussi des nombreuses lois « Covid-19 » votées en 2020 à l’échelle du monde. Indépendamment du dispositif juridique qui les fonde, on voit donc depuis deux décennies au moins se multiplier des réponses gouvernementales aux situations de crise d’un format nouveau, fondées sur des règles spécialement édictées pour faire face à des situations exceptionnelles ; John Ferejohn et Pasquale Pasquino voient dans la multiplication de ces « pouvoirs d’urgence » (emergency powers) un nouveau modèle de gestion de crise4.
On peut raisonnablement faire l’hypothèse sommaire qu’on ne gouverne pas impunément par l’état d’urgence – et donc considérer qu’il est important d’interroger ce que nous coûte cette permanence inédite du gouvernement par l’état d’urgence.
Stéphanie Hennette-Vauchez
La France, de ce point de vue, est bien dotée. La constitution prévoit plusieurs régimes d’exception. C’est le cas de l’état de siège (art. 36) qui emporte le transfert du pouvoir civil à l’autorité militaire, mais aussi du régime de pleins pouvoirs accordés au chef de l’État en cas de menace grave et immédiate sur l’indépendance de la Nation et l’intégrité du territoire et d’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels (art. 16). À cela s’ajoute le régime législatif de l’état d’urgence organisé par la loi du 3 avril 1955. Votée pour doter le gouvernement des moyens de répondre à ce qu’on cherchait alors à cantonner sous l’appellation d’« évènements d’Algérie » (d’où la mise à l’écart du dispositif à connotation militaire de l’état de siège5), la loi de 1955 a d’ailleurs longtemps conservé pour titre « loi relative à l’état d’urgence en Algérie »6. Elle fut appliquée à trois reprises en lien avec cette guerre d’indépendance (1955, 1958, 1961). Par la suite, elle fut remise en vigueur face au conflit opposant indépendantistes et loyalistes en Nouvelle-Calédonie (1984-1985), puis face aux émeutes urbaines qui embrasèrent la France à la fin de 2005 après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré dans une course-poursuite avec la police. Mais, à l’exception de l’état d’urgence de 1961 (qui est exceptionnel à tous égards7), ce régime n’est généralement demeuré en vigueur que de quelques semaines à quelques mois. Il s’agit là d’un élément important pour comprendre la radicale nouveauté qui caractérise les deux expériences récentes de l’état d’urgence : leur longue durée. Il ne s’en est fallu que d’une quinzaine de jours que l’état d’urgence anti-terroriste ait célébré, en novembre 2017, son 2ème anniversaire. L’état d’urgence sanitaire quant à lui souffle ses 2 bougies le 23 mars 2022. Et par-delà le seul prisme chiffré ou quantitatif, ce que prouvent l’expérience et l’analyse, c’est qu’un régime d’exception qui s’ancre dans la durée, c’est un régime d’exception qui non seulement sort de son lit et diffuse sa logique dans l’ensemble de l’ordre juridique et politique (d’où la dégradation notable du régime des libertés) mais encore, déséquilibre le fonctionnement institutionnel régulier (un enjeu qui revêt en France une particulière intensité, du fait que le cadre politique et institutionnel y est structurellement marqué par un fort déséquilibre des pouvoirs en faveur de l’exécutif, qui n’est dès lors qu’aggravé : verticalité du pouvoir présidentiel, minoration du Parlement, paralysie des contre-pouvoirs).
Quelle importance faut-il prêter à cette banalisation de ces « pouvoirs d’urgence » ? Que signifie, au juste, leur installation au rang des paradigmes de gouvernement ? Où en sommes-nous, en termes de libertés et de démocratie, après ces expériences inédites : ont-elles changé la donne, ou suffit-il d’attendre sagement que la parenthèse se referme pour que tout redevienne « comme avant » ? Le retour au statu quo ante est-il seulement possible ? Quelles leçons tirer de cette permanence inédite du gouvernement par l’urgence ? Pour répondre à ces questions, il faut bien sûr faire le recensement et l’analyse des reculs et régressions observables en matière de droits et liberté comme en matière des modalités de l’exercice du pouvoir politique -et des modalités de contrôle et de responsabilité afférentes. Mais au-delà de l’état d’urgence comme régime, il faut aussi prêter attention à l’importance de l’état d’urgence comme discours -car c’est à ce niveau que se situe l’un des dangers de l’état d’urgence permanent : la corruption sémantique du vocabulaire même du politique.
Au-delà de l’état d’urgence comme régime, il faut aussi prêter attention à l’importance de l’état d’urgence comme discours – c’est à ce niveau que se situe l’un des dangers de l’état d’urgence permanent : la corruption sémantique du vocabulaire même du politique.
Stéphanie Hennette-Vauchez
La question du format et des modalités de la réponse du pouvoir politique aux situations de crises graves est ancienne ; on en trouve trace dès l’Antiquité avec, notamment, le modèle de la dictature romaine antique qui prévoyait la possibilité, en situation de crise, de désigner temporairement un dictateur disposant de tous les pouvoirs afin de rétablir l’ordre et éradiquer le danger8… Au plan théorique, ces dispositifs ont essentiellement été saisis au prisme de l’état d’exception9, qui est un modèle de gouvernement articulé à l’idée de suspension et/ou de dérogation à la norme10 : face aux circonstances exceptionnelles, l’État organise la suspension temporelle de l’ordre normal des choses, pour confier le pouvoir à un dictateur temporaire chargé de faire face à la crise. Cette conception de l’état d’exception a toutefois été déstabilisée sinon mise à mal par la montée en puissance du paradigme de l’État de droit. Conceptualisé à partir de la fin du XIXème siècle, il s’est imposé, notamment depuis la seconde moitié du XXème siècle, comme le cadre juridique de la démocratie politique. L’État de droit, c’est l’État soumis au droit, l’action publique contrainte par le respect de la séparation des pouvoirs et l’exigence de la garantie des droits individuels. Il charrie avec lui l’idée que les sphères où domine l’arbitraire décisionnel ont vocation à être réduites, cantonnées, voire supprimées. Il est donc construit en opposition à l’idée d’exception, et affiche précisément l’ambition de la domestiquer. Il l’a d’ailleurs parfois annulée, emportant par exemple la suppression de juridictions d’exception ou de l’immunité juridictionnelle dont jouissaient traditionnellement certaines séries d’actes juridiques. Si l’on comprend que la progression inéluctable de ce modèle a pu avoir pour effet de délégitimer les règles, institutions ou régimes d’exception, il ne les a pas pour autant fait disparaître. En réalité, il a donné naissance à une réalité juridique et discursive nouvelle : à l’exception comme suspension du droit s’est substituée l’état d’urgence compatible (voire nécessaire) à l’État de droit. L’État de droit n’aurait ainsi pas éradiqué l’exception ; mais il l’aurait domestiquée.
L’état d’urgence est un jour sans fin.
Comment sortir de l’interrègne ?
Nous publions notre premier volume papier chez Gallimard.
En librairie depuis le 24 mars.
Ce glissement discursif se donne pleinement à voir dans les expériences françaises récentes de l’état d’urgence : loin de se présenter comme extérieures ou dérogatoires par rapport aux exigences de l’État de droit, elles revendiquent le fait de s’y nicher en plein cœur. Depuis 2015, gouvernants et juges n’ont pas manqué une occasion de justifier le recours répété à l’état d’urgence précisément par le fait que, contrairement aux états d’exception brutaux, autoritaires et incontrôlés de jadis, il correspondrait à la forme moderne, démocratique, soft en quelque sorte, du gouvernement en situation de crise. Manuel Valls a joué un rôle de premier plan dans l’affirmation de l’idée selon laquelle l’état d’urgence « s’inscrit pleinement dans l’État de droit » ; il en est une « modalité d’application »11. Son successeur Bernard Cazeneuve entonnera le même chant, soutenant même que « l’état d’urgence, ce n’est pas un état d’exception. Il est constitutif de l’État de droit »12. Comme en écho, le président de la section du contentieux du Conseil d’État Bernard Stirn souligne quant à lui que « l’état d’urgence est un ami sur lequel les libertés peuvent avoir besoin de compter »13. Mais une telle opération discursive est problématique : alors même que l’état d’exception est présenté comme s’étant conformé à l’État de droit, l’analyse rapprochée de ses traductions et applications concrètes14 révèle que c’est bien souvent le mouvement inverse qui est l’œuvre. Tout autant, voire bien plus qu’il n’a domestiqué l’état d’exception, l’État de droit s’y adapte, sans parvenir à le cantonner ou le contrôler, surtout lorsqu’il s’ancre dans la durée.
Tout autant, voire bien plus qu’il n’a domestiqué l’état d’exception, l’État de droit s’y adapte, sans parvenir à le cantonner ou le contrôler, surtout lorsqu’il s’ancre dans la durée.
Stéphanie Hennette-Vauchez
C’est ce que confirme notamment l’étude de la manière dont les juges exercent leur contrôle sur les modalités d’application de l’état d’urgence – un contrôle qui n’est ni très poussé ni très exigeant. Au nom de circonstances exceptionnelles, les juges laissent souvent à l’autorité publique une marge de manœuvre. En pandémie, même la presse généraliste se sera ainsi fait l’écho de cette mansuétude du juge : un dossier du Monde indiquait ainsi en mars 2021 que « depuis le premier confinement, sur les 840 requêtes déposées devant le Conseil d’État, 511 ont été écartées d’office sans débat contradictoire, 329 ont été instruites, huit ont été jugées dans un sens défavorable au gouvernement »15. La haute juridiction reconnaît d’ailleurs elle-même que, sous état d’urgence, « la balance des droits et libertés ne s’exerce pas de la même façon qu’en période normale ». Selon elle, « la déclaration d’état d’urgence constitue une présomption de péril imminent qui engendre un nouvel étalonnage de la balance (…) ; le principe de proportionnalité est utilisé de la même manière qu’en période normale mais les objectifs poursuivis par l’état d’urgence (protection de l’ordre public ou protection de la santé) pèsent plus lourd dans la balance qu’en temps normal »16. Les standards du contrôle juridictionnels sont donc altérés -et en l’occurrence, abaissés. Concrètement, cela se traduit par le fait qu’à la faveur de l’état d’urgence, certaines catégories centrales de l’État de droit sont redéfinies. L’assignation à résidence, qui fut l’une des mesures-phare de l’état d’urgence antiterroriste entre 2015 et 2017, en fournit un exemple éclairant. L’assignation est une décision administrative du préfet, sans enquête ou condamnation judiciaire, qui peut faire interdiction à la personne visée de sortir de chez elle entre 20 heures et 8 heures ; elle s’accompagne généralement d’une obligation de pointage au commissariat deux ou trois fois dans la journée. En tant que tel, le régime de l’assignation à résidence a été contesté devant le Conseil constitutionnel pendant l’état d’urgence antiterroriste : une telle mesure qui prive la personne de sa liberté de mouvement 12 heures quotidiennes sans condamnation ne s’apparente-elle pas à une mesure privative de liberté ? Si tel était le cas, un contrôle du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle selon la Constitution française serait requis. Mais le Conseil constitutionnel a jugé qu’une mesure n’était privative de liberté qu’au-delà de 12 heures par jour ; en-deçà, il s’agit d’une mesure restrictive de liberté, pour laquelle il est acceptable que seule l’autorité administrative soit compétente17. Voilà un positionnement bien opportun du critère retenu pour positionner la frontière entre mesures restrictives et mesures privatives de liberté, qui illustre la manière dont l’état d’urgence a pour effet de façonner des catégories permanentes du droit, donc de l’État de droit.
[Depuis le tout début de l’invasion de la Russie de l’Ukraine, avec nos cartes, nos analyses et nos perspectives nous avons aidé presque 2 millions de personnes à comprendre les transformations géopolitiques de cette séquence. Si vous trouvez notre travail utile et vous pensez qu’il mérite d’être soutenu, vous pouvez vous abonner ici.]
En d’autres termes, l’état d’urgence n’est pas une simple parenthèse qui permettrait, une fois refermée, le retour au statu quo ante. Les déplacements de curseur qu’il permet sont durables et peuvent être lus, comme le propose Bernard Harcourt, au prisme de la notion foucaldienne d’illégalismes18. Foucault désignait ainsi la façon dont la société bourgeoise en était venue à définir comme illégales des pratiques des classes populaires, comme le carnaval, les bals, etc. Inversant la formule, Harcourt évoque les « légalismes » par lesquels le pouvoir rend légales des pratiques qui ne l’étaient pas jusqu’ici. La surveillance de l’espace public par les drones en fournit un bon exemple. Les drones ont été utilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour vérifier le respect par la population du confinement. Saisi par la Quadrature du Net, une association de défense des libertés, le Conseil d’État censurait cette pratique dépourvue de base légale19. Pourtant dans certaines villes, comme Paris, la surveillance de l’espace public par les drones a continué à être pratiquée par les forces de police, notamment dans le cadre des manifestations sur la voie publique. De nouveau, le Conseil d’État censurait les décisions du préfet de police20. Mais la volonté politique refuse de reculer devant l’analyse en termes de droits et libertés. Nulle part ne se donne-t-elle à voir avec plus de force que dans le courrier adressé par le ministre de l’Intérieur à la CNIL après qu’il a été informé que celle-ci envisageait à son tour de sanctionner l’usage de drones en dehors de tout cadre légal. On y lit que « l’utilisation de drones constitue désormais une nécessité opérationnelle indéniable », de sorte qu’« il est indispensable qu’une éventuelle sanction ne soit pas assortie d’une injonction de cesser l’usage de drones selon les modalités actuelles tant qu’un cadre légal adapté ne sera pas mis en œuvre »21. Sur ces entrefaites, le Parlement adoptait en mai 2021 la loi pour une Sécurité globale22 dont l’objet était, entre autres, de légaliser la surveillance de l’espace public par drones. Cette disposition était toutefois censurée par le Conseil constitutionnel, qui l’estimait insuffisamment protectrice des libertés, et notamment du droit au respect de la vie privée23. Refusant à nouveau de se plier à cette analyse, le gouvernement présentait fin 2021 un projet de loi pour la responsabilité pénale et la sécurité intérieure24 dont certaines dispositions entreprennent une nouvelle fois de légaliser la surveillance par drone de l’espace public dans le cadre d’opérations de police administrative. Et une nouvelle fois, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnelles les dispositions permettant aux polices municipales de surveiller l’espace public ; et il a, par ailleurs, enserré l’ensemble des dispositions concernées dans de strictes réserves d’interprétation25. Reste que cette saga révèle les multiples déplacements de curseur à l’œuvre sur cette question, à la fois sur le fond et la forme. Au fond, en dépit des coups de butoir posés par les juges, la surveillance de l’espace public par drones a bien fini par être autorisée, sous certaines conditions, par la loi ; notamment, elle peut désormais être autorisée par le préfet26. Sur la forme, cet épisode donne à voir la détermination du pouvoir politique qui, de fait, considère les censures juridictionnelles, même répétées, comme des obstacles surmontables. Loin de marquer le coup d’arrêt à un projet législatif, la censure juridictionnelle se borne ici à opérer comme exigence d’un meilleur encadrement des pouvoirs dévolus, ici, à l’autorité administrative : tant qu’elle conditionne l’usage des pouvoirs qu’elle lui attribue à quelques conditions (l’autorisation préfectorale) et contrôles (juridictionnels), tout se passe comme si la question de fond (pourquoi et comment autoriser la surveillance de l’espace public par drones ?) était reléguée au second plan. Spectaculaire illustration en actes de ce jeu des légalismes – opérations par lesquelles le droit commun, méconnu par celui qui est chargé de l’appliquer, est sommé de s’adapter à la logique même des justifications de sa méconnaissance.
Puisque le droit est avant tout un discours, il importe de prendre son langage au sérieux et d’engager un travail critique de déconstruction et de contestation de cette idée selon laquelle l’état d’urgence serait « constitutif » de l’État de droit et « ami » des libertés : il n’est ni l’un, ni l’autre.
Stéphanie Hennette-Vauchez
Puisque le droit est avant tout un discours, il importe de prendre son langage au sérieux et d’engager un travail critique de déconstruction et de contestation de cette idée selon laquelle l’état d’urgence serait « constitutif » de l’État de droit et « ami » des libertés : il n’est ni l’un, ni l’autre. Alors même qu’il prétend soumettre la décision politique à la règle de droit, il fait en réalité prévaloir la première sur la seconde ; loin de garantir les libertés, il précipite leur effritement. À l’approche d’échéances démocratiques de premier plan, il est regrettable que la compétition politique fasse l’économie du bilan de ces années de gouvernement par l’état d’urgence. Or les crises de demain se profilent déjà. La volonté de savoir comment il est envisagé d’y faire face n’est que légitime, tout comme la crainte que, faute d’anticipation ou d’imagination, ces crises futures mènent inéluctablement au réflexe, somme toute paresseux, de nouveaux états d’urgence. Il faut tirer les leçons du passé récent pour que chaque crise ne réenclenche pas, demain et après-demain, le coûteux cycle qui associe la concentration du pouvoir exécutif à la paralysie des contre-pouvoirs et à une restriction généralisée des libertés. C’est à cette condition que nous pourrons espérer sortir du jour sans fin de l’état d’urgence.
Sources
- Cité par Ian Zuckerman, « One Law for War and Peace ? Judicial Review and Emergency Powers between the Norm and the Exception », Constellations. An International Journal of Critical Democratic Theory, 2006, n°4, p. 522 (nous soulignons et traduisons).
- Kim Scheppele, « The migration of anti-constitutional ideas : the post-9/11 globalization of public law and the international state of emergency » in Sajit Choudry (dir.), The Migration of Constitutional Ideas, Cambridge University Press, 2006, p.354.
- https://www.icnl.org/coronavirus-response#regional
- John Ferejohn et Pasquale Pasquino, « The Law of Exception : A Typology of Emergency powers », International Journal of Constitutional Law, 2004, vol. 2, p. 210, p. 216.
- Olivier Beaud, Cécile Guérin-Bargues, L’état d’urgence. Une étude historique, constitutionnelle et critique, 2è ed., Montchrestien, 2018.
- C’est un toilettage légistique datant de 2011 qui l’intitule « loi relative à l’état d’urgence ».
- En effet, non seulement il demeure longuement en vigueur, mais encore il se double non seulement de loi du 16 mars 1956 sur les pouvoirs spéciaux en Algérie mais aussi de l’unique et longue mise en œuvre des pleins pouvoirs présidentiels de l’article 16 -une situation de « confusion des pouvoirs d’exception » : Frédéric Rolin, « L’état d’urgence », in Bertrand Mathieu (dir.), Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Dalloz, 2008, p. 611, p. 613.
- Thibaud Lanfranchi, « Dictature et état d’exception sous la dictature romaine », in S. Hennette Vauchez, La démocratie en état d’urgence. Quand l’exception devient permanente, Seuil, 2022.
- François Saint-Bonnet, L’État d’exception, PUF, 2001, Coll. Léviathan.
- Bernard Manin, « Le paradigme de l’exception », La Vie des idées, 15 décembre 2015.
- Véronique Champeil Desplats, « Aspects théoriques : ce que l’état d’urgence fait à l’Etat de droit », in S. Hennette Vauchez dir., Ce qui reste(ra) toujours de l’urgence, Institut Varenne, 2018.
- Bernard Cazeneuve, Le Monde, 20 juillet 2016 (souligné par nous).
- Bernard Stirn, « Lutte contre le terrorisme, état d’urgence et État de droit », Discours de rentrée, IEP Aix en Provence, 21 sept. 2016.
- Stéphanie Hennette Vauchez dir., Ce qui reste(ra) toujours de l’urgence, Institut Universitaire Varenne, 2018 ; Stéphanie Hennette Vauchez, La démocratie en état d’urgence. Quand l’exception devient permanente, Seuil, 2022.
- Le Monde Magazine, 12 mars 2021, « La folle année du Conseil d’État ».
- Conseil d’Etat, L’état d’urgence : la démocratie sous contraintes, 2021
- Conseil Constitutionnel, 22 déc. 2015, Décision n° 2015-527.
- Bernard Harcourt, The Counter-Revolution. How Our Government Went to War Against Its Own Citizens, Basic Books, 2018.
- CE, 18 mai 2020, n°440442.
- CE, 22 décembre 2020, n°446155.
- Courrier de M. Gérald Darmanin, publié in Mediapart, 8 mai 2021.
- Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
- CC, 20 mai 2021, n°2021-871DC.
- Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
- CC, 20 janvier 2022, n° 2021-834 DC.
- Notamment aux fins suivantes : assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques de commission de certaines infractions, veiller à la protection des bâtiments et des installations publics et leurs abords immédiats particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation, prévenir les actes de terrorisme et assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public. V. La Quadrature du Net : https://www.laquadrature.net/2022/01/21/les-drones-policiers-autorises-par-le-conseil-constitutionnel/