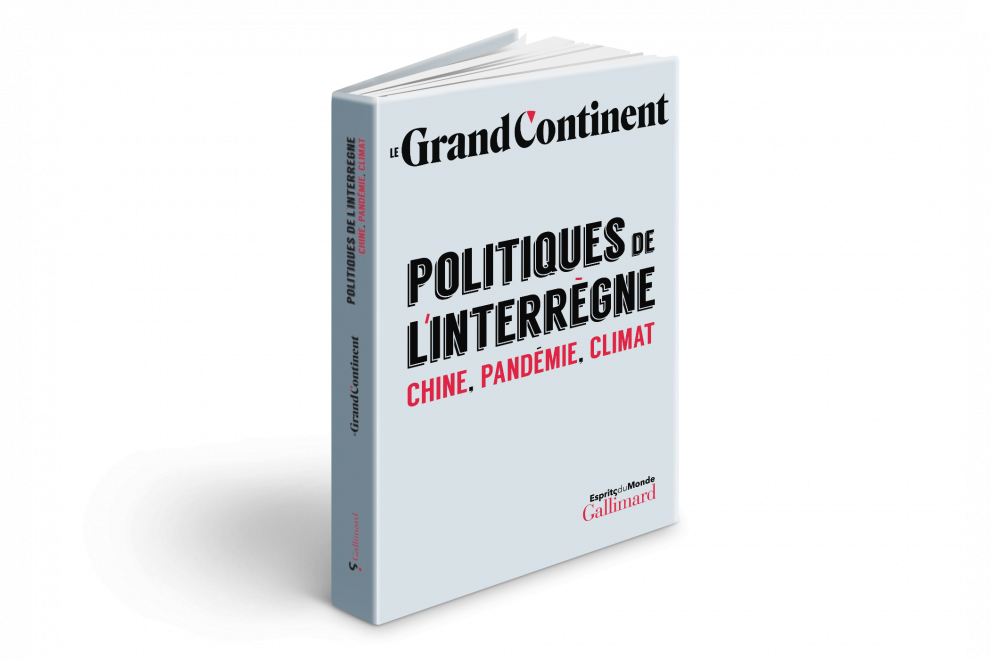Abonnez-vous à nos Lettres Restez informés des actualités du Grand Continent
Changements de paradigme
Il y a quelques mois, j’ai tenté dans ces colonnes de décrire le nouveau visage du pouvoir politique dans un monde marqué par les effets de la pandémie de Covid-19. À la lumière du nouveau désordre mondial qui se réalise dans une forme militaire, celle du conflit entre la Russie et l’Ukraine, cette analyse mérite un aggiornamento. Il ne s’agit pas d’une guerre comme celles que nous avons connues ces trente dernières années : ce n’est pas une guerre civile ; ce n’est pas une guerre menée par des terroristes ; elle n’est pas menée par ou vers des États défaillants et précaires. C’est une guerre au cœur de l’Europe entre deux pays souverains. Mieux, il s’agit d’une invasion russe motivée par des objectifs impérialistes, de puissance et de sécurité. Le lieu de cette guerre, au seuil des frontières de l’Union européenne, et le moment choisi, après une longue pandémie et des changements économiques, sociaux et technologiques inattendus et brutaux, rendent le spectre de son impact particulièrement large et insaisissable, d’autant que nous ne connaissons pas aujourd’hui son issue sur le terrain.
Le paradigme économique a changé inexorablement au cours des deux dernières années, consumant définitivement un dispositif mis en place dans les années 1990 et qui a entamé son processus de détérioration dès la crise économique de 2008. Dans l’Occident tout entier, les politiques expansionnistes des gouvernements et des banques centrales sont revenues sur le devant de la scène. Une tendance qui a commencé avec la réponse américaine de Barack Obama à la crise de 2008 et qui n’est arrivée en Europe qu’avec le moment Whatever It Takes de Mario Draghi, alors président de la Banque centrale européenne. La pandémie a accéléré ce processus de changement, en Europe avec le plan de relance et la suspension du pacte de stabilité, et aux États-Unis avec un plan de relance budgétaire massif impulsé par l’administration Biden.
[Depuis l’invasion de la Russie de l’Ukraine, avec nos cartes, nos analyses et nos traductions commentées nous avons aidé plus de 1,5 millions de personnes à comprendre les transformations géopolitiques de cette séquence. Si vous trouvez notre travail utile et vous pensez qu’il mérite d’être soutenu, vous pouvez vous abonner ici.]
Le monde est entré lentement et subrepticement dans une nouvelle guerre froide.
Lorenzo Castellani
Ce changement de paradigme tire parti de la nécessité de répondre à la pandémie et à ses fermetures, mais s’inscrit également dans une dynamique où le contexte de la politique internationale a muté. Le monde est entré lentement et subrepticement dans une nouvelle guerre froide. Les politiques protectionnistes américaines inaugurées par Obama se sont poursuivies avec plus de vigueur pendant la présidence troublée de Donald Trump. Elles sont dues, notamment, à la nécessité de faire face au développement de la puissance économique et technologique de la Chine, d’une part, et d’apporter une réponse aux pressions intérieures découlant de la désindustrialisation, d’autre part. Les tentatives de reshoring, c’est-à-dire de retour de la production sur le sol américain, sont en cours depuis maintenant cinq ans, créant une continuité claire entre les administrations républicaine et démocrate. Cela s’accompagne d’un contrôle accru des investissements étrangers sur le sol américain et de politiques visant à protéger l’arsenal technologique et numérique de la première puissance occidentale.

Nouvelle guerre froide
Cette posture anti-chinoise des États-Unis a également eu des répercussions dans la sphère européenne. Qu’on pense au contrôle des investissements avec la golden rule et au contrôle de la fourniture de technologies et de systèmes de défense. C’est pourquoi, dans tout l’Occident, l’État a été plus interventionniste dans trois domaines : monétaire et économique, pour relancer la croissance ; sécuritaire, pour contrôler la montée de l’influence chinoise ; et social, pour adoucir l’opinion publique, épuisée par la stagnation socio-économique et séduite ces dernières années par les sirènes populistes, anti-establishment et nationalistes. En Europe, cela a conduit à un renforcement des institutions de l’Union, qui en sont ressorties plus centralisées en termes économiques et de politique publique. C’est un fait : Bruxelles planifie et contrôle plus qu’avant. Le paquet Next Generation EU est né d’une nécessité économique et sociale face au choc de la pandémie, mais il a également représenté l’occasion d’un saut asymétrique, non pas politico-constitutionnel mais économico-fonctionnel, dans un processus d’intégration qui était au point mort ces dernières années. Un paradoxe est apparu dans cette dynamique : l’establishment européen s’est approprié des solutions qui, il y a quelques années encore, étaient l’apanage de partis et d’intellectuels contestataires hors du courant dominant ou à des courants qui demeuraient minoritaires au sein de grandes formations gouvernementales centristes. Un changement de cap qui a permis aux partis modérés, souvent renouvelés dans leur leadership et leur forme – qu’on pense par exemple à Macron ou aux Verts allemands – de maintenir l’ordre politique et de faire plier les pulsions anti-européennes. Aujourd’hui, les pays européens sont donc plus interdépendants, mais dans un cadre économique et culturel différent. Même si les deux pôles opposés ont du mal à l’admettre, une intégration entre européisme et souverainisme a bel et bien eu lieu, notamment dans les pays de la zone euro. Un compromis nécessaire entre le haut et le bas pour la survie de l’Union et de la classe dirigeante européenne. Aujourd’hui, personne ne peut sérieusement envisager de se déconnecter du système ou de devenir totalement indépendant des autres pays européens. Dans le même temps, des éléments de souveraineté sont nécessaires pour faire face aux incertitudes économiques et aux insécurités mondiales. Cela a également des implications sur d’autres fronts mondiaux, comme la lutte contre le changement climatique. Il est en effet clair aujourd’hui que la transition écologique ne se fera pas au rythme imaginé par les gouvernements occidentaux, mais qu’une plus grande gradualité sera nécessaire dans la conception et la mise en œuvre des politiques vertes. Si les énergies propres continuent d’être financées, les formes de planification et de réglementation trop agressives semblent destinées à être mises de côté. Les risques d’approvisionnement, la crise énergétique, l’inflation, le chômage potentiel dans certaines industries en raison des politiques vertes, et maintenant la guerre, obligent l’idéologie écologiste à une reddition des comptes en prise avec ces nouvelles permanences. Dans le même temps, il est également vrai que les sources d’énergie alternatives sont fonctionnelles sur un autre plan : l’émancipation des pays européens vis-à-vis des fournisseurs extérieurs de gaz et de pétrole, préparatoire à un bond en avant de l’autonomie énergétique européenne. Des années de recherche et d’investissement seront nécessaires, mais le développement de nouvelles technologies vertes restera une priorité d’un point de vue stratégique plutôt qu’éthique. La dépendance excessive à l’égard de la Russie et le contexte instable au Moyen-Orient ne peuvent être réduits qu’en misant sur une transition verte progressive et une restauration de l’énergie nucléaire.
L’establishment européen s’est approprié des solutions qui, il y a quelques années encore, étaient l’apanage de partis et d’intellectuels contestataires.
Lorenzo Castellani
Sur le plan national, les États ont été contraints d’adopter une réglementation méticuleuse et profonde pour faire face à la pandémie. Les restrictions, les obligations et les nouveaux pouvoirs et institutions ont été légitimés en s’appuyant sur la peur de la maladie. L’opinion publique et le pouvoir politique institutionnalisé semblent donc déjà prêts à résister à un choc sécuritaire lié à la détérioration des relations internationales. La pandémie a montré quels mécanismes de délégitimation politique peuvent être déclenchés face à l’urgence, comme le discrédit des anti-vaccins et une convergence au centre pour la gestion de l’urgence avec l’émoussement des ailes extrêmes. Si l’on considère les pays européens, un événement d’un impact tel que celui de la pandémie ne semble pas avoir beaucoup affaibli les gouvernements en place ou les coalitions sous-jacentes. Dans certains cas, au contraire, les gouvernants ont été renforcés. Y compris en Italie, où une nouvelle majorité autour de Draghi s’est formée avec une relative facilité et tranquillité, dans un gouvernement a fonctionné avec un large soutien au sein des forces politiques et de la population. En général, au fond, l’urgence a, du moins jusqu’à présent, généré la stabilité et cristallisé l’équilibre. La guerre en Ukraine a le potentiel de renforcer cette tendance, à moins que ses escalades ne soient de nature à déclencher un conflit mondial à moyen terme. Une autre urgence, bien plus dangereuse que la pandémie, poussera les gouvernements à une centralisation accrue et à une coopération internationale renforcée avec une intégration plus poussée des institutions communes.
Le monde se transforme vertigineusement.
Comment naviguer dans l’interrègne ?
Nous publions notre premier volume papier chez Gallimard.
En librairie le 24 mars.
Dans le cas de l’Europe, par exemple, il est clair que Next Generation EU ne peut être que le point de départ de nouvelles politiques expansionnistes et qu’un retour à la discipline budgétaire est essentiellement irréalisable. Un compromis acceptable devra être trouvé entre les partisans de l’austérité, encore influents au sein de l’establishment allemand et dans les pays « frugaux » du Nord, et ceux qui voudraient voir plus de dépenses publiques dans un contexte où la dette publique est déjà en constante augmentation. Il est probable que le point de bascule sera trouvé dans une exclusion des investissements dans la transition écologique, la défense et les infrastructures stratégiques de la discipline budgétaire traditionnelle. En bref, une politique économique qui s’inscrira dans un nouveau contexte mondial où les pouvoirs en présence sont en constante évolution. Le conflit ukrainien jette en fait les bases d’une nouvelle militarisation de l’Europe face au retour de la guerre sur le continent après des décennies de paix. La puissance militaire avait été reléguée au fond de l’inconscient européen, remplacée par la puissance politique, administrative et économique ; soudainement, elle fait à nouveau partie de l’architecture de puissance du continent. Les implications sociopolitiques d’une telle bascule seront importantes : la peur de la pandémie est remplacée par la peur de la guerre. La demande de l’opinion publique en matière de sécurité et de contrôle est susceptible de croître, s’accompagnant par conséquent de la demande de reconstruction d’un « État protecteur ». Beaucoup dépendra de la forme que prendra cette remilitarisation, c’est-à-dire si elle se fera entièrement à l’ombre de l’OTAN ou si, au contraire, elle prendra une forme européenne autonome avec un degré de coordination et d’intégration entre les armées qui, aujourd’hui, reste à planifier. En tout état de cause, nous sommes à un tournant et la gestion de cette transition militaire sera cruciale pour le destin de l’Europe. Une remilitarisation nationale, suivie de la poursuite d’intérêts souverains, peut entraîner des pressions perturbatrices sur l’ordre européen. A contrario, un renforcement du partenariat euro-atlantique, avec une plus grande autonomie militaire européenne grâce à des formes de coordination supranationale, pourrait mieux intégrer et relier la sécurité et la défense du continent et du bloc occidental. L’aboutissement du processus d’institutionnalisation des organisations politiques a toujours été la création de l’armée et de sa bureaucratie. C’est la seule manière de continuer de se doter des armes pour continuer la politique par d’autres moyens. Parce qu’elle a jusqu’à présent tué la politique, l’Europe n’a pas réussi à les créer. Sans politique, point de menace de guerre ; et sans la capacité de menacer de guerre, point d’Europe comme sujet des relations internationales. Face à la peur de l’ennemi, belliqueux aux frontières de l’Union, une nouvelle fenêtre d’opportunité semble s’ouvrir pour le démarrage d’un processus constitutionnel européen qui dépasse le mythe fonctionnaliste et économiste qui prévaut aujourd’hui et projette l’Union vers un avenir plus intensément politique, bien que dans ses formes institutionnelles particulières. Dans le système de pouvoir mondial, l’avenir du continent dépend de la reconstitution politique du pouvoir militaire.
Sans politique, point de menace de guerre ; et sans la capacité de menacer de guerre, point d’Europe comme sujet des relations internationales.
Lorenzo Castellani
Face à la crise ukrainienne, la discipline politique au sein des États va s’intensifier : les partis politiques ou les dirigeants ayant des sympathies pro-russes, pro-chinoises ou sceptiques vis-à-vis de l’OTAN auront plus de mal à entrer au gouvernement, quel que soit leur camp. Les élites politiques modérées, pro-européennes et atlantistes – aidées par les élites économiques, financières et administratives – auront tendance à être plus unies, attirées par une force centripète. Les espaces de pluralisme se réduiront presque inévitablement comme peau de chagrin, du moins tant qu’il y aura un ennemi menaçant aux marches des pays européens. Les États semblent déjà équipés pour passer en mode semi-guerrier. L’histoire nous montre en quoi la guerre réclame davantage d’experts sectoriels, de spécialistes, de scientifiques, de gestionnaires au sein du gouvernement, une possibilité qui s’est déjà consolidée au cours des dernières décennies et encore plus avec l’urgence sanitaire. Des dépenses militaires accrues, une vigilance accrue des services de renseignement, des formes plus strictes de contrôle économique, un rôle de plus en plus décisif des banques centrales… autant de dimensions qui impliqueront de nouvelles doses de technocratie. Les frontières entre public et privé deviendront plus floues, avec un renforcement du capitalisme politique qui s’est déjà manifesté ces dernières années au sein des grandes puissances.
Au niveau mondial, le rétrécissement des chaînes d’approvisionnement et les difficultés d’approvisionnement en matières premières dues à l’augmentation de la demande et aux tensions géopolitiques vont obliger les économies nationales à réduire leur champ d’action. Elle n’est plus tout à fait mondiale, mais régionale. Il y aura des secteurs qui, surtout en Europe, seront destinés à souffrir, à se rétrécir ou à se transformer. L’approvisionnement en énergie sera progressivement diversifié, mais cela nécessitera un soutien de l’État. Le monde se réduira de plus en plus à des blocs, à des agrégations régionales supranationales, tandis que certains États autoritaires – comme la Russie et la Chine – devront évoluer vers des formes semi-autarciques. Cela ne signifie pas une opposition politique et économique automatique en blocs entre les démocraties libérales et les régimes autoritaires – puisqu’entre les deux, il existe de nombreuses formes hybrides et des positions géopolitiques spécifiques – mais il est possible que l’ordre mondial soit structuré selon des critères plus impérialistes, donnant lieu à des contestations amères dans les zones en crise et ayant des institutions faibles.

Ennemi actif, ennemi passif
La cessation définitive des relations de l’Occident avec la Russie, et son tournant définitif vers une politique de puissance impérialiste agressive envers l’Europe, place cette nation dans le camp de l’ennemi actif. Cela signifie que le modèle politique poutiniste, fondé sur un autoritarisme centralisé perçu comme conservateur par l’Occident, ne pourra plus guère servir d’inspiration manifeste aux partis et mouvements culturels européens. La fascination pour un modèle qui s’est ouvertement transformé en ennemi est destinée à s’estomper et à barrer la route aux tentatives de légitimation du système russe au sein des systèmes politiques européens. Les leviers d’influence de Poutine seront paralysés. Il ne reste donc qu’un seul modèle alternatif puissant à la démocratie libérale occidentale : l’autoritarisme capitaliste chinois. La relation avec la Chine deviendra un sujet de débat de plus en plus vif car aujourd’hui le régime de Xi à Pékin – contrairement à la Russie de Poutine – fait figure d’ennemi passif. Certaines franges de l’establishment intellectuel et politique continueront à regarder avec intérêt le seul modèle alternatif à la démocratie libérale, qui veut se présenter aux yeux de l’Occident comme un bastion de la méritocratie, du progrès technologique et de la réussite économique tout en dissimulant sa structure totalitaire. Au moins tant qu’il n’y aura pas de tension militaire explicite avec l’Occident, les bâtisseurs de ponts avec Pékin et les admirateurs de son modèle organisationnel-décisionnel continueront d’être présents dans nos pays dans le but de souligner la modération et la rationalité du régime chinois pour accroître son soft power. En bref, il ne manquera pas de pièces du système occidental qui se consacreront à faire de l’intelligence, comme c’est le cas depuis des années, avec un ennemi qui est, pour l’instant, froid.
La relation avec la Chine deviendra un sujet de débat de plus en plus vif car aujourd’hui le régime de Xi à Pékin – contrairement à la Russie de Poutine – fait figure d’ennemi passif.
Lorenzo Castellani
Enfin, les signaux faibles d’un changement culturel sont là. Un certain réalisme devrait à nouveau l’emporter sur le libéralisme internationaliste. La guerre met à mal la possibilité de réguler le monde par le droit et l’économie. Le droit est une invention de l’homme pour contenir les forts et protéger les faibles, mais l’histoire ne cesse de le subvertir. Dans le même temps, la politique ne peut être réduite à la mécanique économique, sinon l’illusion de voir un monde plat et rationnel en surface et de sous-estimer le magma impétueux de ses abysses. Le désordre et la tragédie prospèrent lorsque la politique internationale fondée sur l’art de la diplomatie, qui établit comment les espaces géopolitiques de la planète sont organisés entre des acteurs institutionnalisés, échoue. Il est temps de mettre fin au temps des traités qui, comme le montre l’accord de Minsk, ont peu ou pas d’impact. Il sera bientôt temps de revenir au système de pensée néo-westphalien et à la praxis qui en découle, envisagés par Henry Kissinger et oubliés au cours des deux dernières décennies de politique internationale, où l’on a préféré détruire la solidité institutionnelle de certaines réalités en faveur d’un idéal disruptif incapable de produire la construction d’un État et donc la possibilité d’un ordre. Seule la politique, à travers la diplomatie, peut être le prélude, ou plutôt la condition sine qua non, à la signature d’accords militaires, économiques et spatiaux durables entre des entités institutionnelles solides. C’est d’autant plus vrai dans un système de plus en plus caractérisé par des impulsions néo-impériales dans lequel il convient de marquer des frontières et des repères entre les plaques tectoniques géopolitiques afin de préserver la paix.
La saison de l’optimisme, qui a structuré culturellement les années 1990, qui voyait dans des mécanismes automatiques non politiques et apolitiques une garantie de la production de progrès, d’ordre et de sécurité, semble donc s’achever définitivement. Des termes et des concepts comme la défense, les frontières, la dissuasion, la sécurité, l’intérêt national et les alliances militaires reprendront place dans nos cauchemars. C’est un monde nouveau : plus solide et plus dur à l’intérieur, plus agressif et plus belliqueux à l’extérieur. Du moins jusqu’à ce que la prochaine crise vienne en altérer davantage l’essence.