Les 1 crises à répétition que connaît l’Europe depuis le début de notre siècle mettent à l’épreuve la clé de voûte sur laquelle se bouclent nos systèmes politiques issus de la modernité : le principe de souveraineté. Cela vaut doublement pour les États membres de l’Union européenne (UE) qui voient se surajouter aux effets de la mondialisation les effets de l’intégration européenne. L’incertitude de la localisation explicite du principe de souveraineté caractérise l’Europe plus que n’importe quel autre continent. La figure du souverain, essentielle à l’autonomie fondationnelle de nos communautés politiques nationales, semble échapper au champ de vision des citoyens, voire se dissoudre dans un magma réglementaire et procédural. Qui est souverain en Europe ? Et, si souverain il y a, l’est-il pleinement ?
La question de la souveraineté obsède les peuples et leurs dirigeants. Tous les « Brexit » menés à leur terme, avortés ou en gestation, procèdent du désir d’une ressaisie, d’une réassurance du principe de souveraineté alors que celle-ci semble dériver sur un océan extra-national jusqu’à disparaître sous la ligne de l’horizon. Le « take back control » n’est que le cri de l’impérieux rappel de la souveraineté nationale par les peuples. Mais cette obsession qui vire à l’angoisse des « majorités menacées », pour reprendre l’expression d’Ivan Krastev, oblitère une autre dimension, plus fondamentale encore et seule porteuse d’une conciliation entre les nations et l’Europe : la possibilité de la démocratie européenne.
La figure du souverain, essentielle à l’autonomie fondationnelle de nos communautés politiques nationales, semble échapper au champ de vision des citoyens, voire se dissoudre dans un magma réglementaire et procédural. Qui est souverain en Europe ? Et, si souverain il y a, l’est-il pleinement ?
Nicolas Leron
Au travers de ce court essai, nous nous efforcerons de mettre au jour les différentes facettes de ce phénomène de dissipation du principe de souveraineté, d’en relever les lignes de faille qu’il dessine au sein du système juridico-politique européen, d’enregistrer la pulsation fébrile d’une ontologie qui n’accepte aucune réplication à l’échelle, aucune démultiplication. L’éclat de la souveraineté aveugle ses adorateurs comme ses contempteurs, ceux qui clament son rapatriement comme ceux qui agitent les faux-semblants de la souveraineté européenne. La quête du souverain défait inéluctablement les aventureux et les ambitieux, le politique comme le théoricien. Car sa géométrie est implacable, elle ramène toute échappée à son absoluité, à ce que veut dire avoir le dernier mot. Posséder de son regard l’entièreté des choses – et n’avoir personne dans son dos.
Nous distinguerons ensuite dans le trouble des eaux mêlées européennes le courant qui remonte à la source du demos du courant qui descend vers les rives du kratos. Si la question du demos européen, de l’identité de l’unité politique première, résonne avec le principe de souveraineté et sa géométrie exclusive, la question du kratos, de l’agir collectif, ouvre sur la démocratie européenne et ses possibles inclusifs.
Oscillation, intermittence et dissipation de la souveraineté
Le principe de souveraineté réside dans l’État ; en France, depuis la Révolution, il se rattache à la nation ; il s’énonce par le geste du Constituant et se rappelle par la bouche du juge constitutionnel ; il appartient et s’exerce en dernière instance par le peuple. L’intégration européenne ne saurait changer ce donné fondamental. Pour autant, l’articulation complexe des ordres juridico-politiques de l’Union et des États membres instille un soupçon qui devient poison, au point d’altérer la vue des peuples. Ceux-ci se laissent gagner par une angoisse muette qui insensiblement se fait bruyante, puis vindicative. Ils se découvrent contraints par des liens d’interdépendances de moins en moins supportables ; ils interrogent l’effectivité de la souveraineté nationale ; ils cherchent un dégagement.
L’articulation complexe des ordres juridico-politiques de l’Union et des États membres instille un soupçon qui devient poison, au point d’altérer la vue des peuples. Ceux-ci se laissent gagner par une angoisse muette qui insensiblement se fait bruyante, puis vindicative.
NICOLAS LERON
À mesure que l’intégration européenne se poursuit sur le terrain du droit, l’ancrage national de la souveraineté semble faiblir. Pour notre plus grand étonnement, la souveraineté oscille sous nos yeux, prise d’un mouvement de balancement entre les sommets des ordres juridiques national et européen. En effet, sans se référer explicitement à la souveraineté, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) développe depuis soixante ans une grammaire de « l’effet utile » du droit européen qui aboutit à des considérations similaires et concurrentes au principe de souveraineté étatique. Les juristes européens l’appellent l’argument existentiel : le droit de l’UE tire son autorité sur les ordres juridiques nationaux de lui-même, de sa nature propre, et non par la médiation d’une délégation de ces derniers, autrement il ne saurait être effectif, « utile », et donc existant. Au cœur de la construction d’un ordre juridique de l’UE autonome et sui generis se dressent deux principes cardinaux absents des traités mais « découverts » par l’action prétorienne de la CJUE : les principes d’effet direct et de primauté absolue du droit de l’UE qui à la fois fondent et découlent, selon la CJUE et suivant un raisonnement circulaire autoréférentiel, de la nature propre du droit de l’UE.
Selon la CJUE, pour répondre aux objectifs que se sont fixés les rédacteurs des traités européens, à commencer par l’établissement d’un marché intérieur, le droit de l’Union se doit d’être un droit commun à tous les États membres, c’est-à-dire un droit unitaire. Du respect des règles européennes par tous les États membres dépend « l’effet utile » du droit de l’UE, le bon fonctionnement du marché intérieur, et partant l’existence même de l’Union. De ce fait, pour les juristes en droit de l’UE, « la primauté ne peut-être qu’absolue ou ne pas être » 2, c’est-à-dire y compris en ce qui concerne les rapports entre normes européennes et normes constitutionnelles nationales, toujours en raison de l’effectivité de l’ordre juridique de l’UE. « La primauté ne souffre pas la relativité, sauf à se nier elle-même. […] La moindre nuance à la primauté oblige à considérer que l’on est en présence “d’autre chose” que la primauté. » 3 Il ne peut s’agir que « d’une primauté inconditionnelle de tout le droit communautaire sur tout le droit national. » 4 Nous retrouvons ici la même sémantique que celle de la souveraineté nationale qui ne saurait être qu’une, indivisible et absolue – ou ne pas être.
Pour les juristes en droit de l’Union européenne, « la primauté ne peut-être qu’absolue ou ne pas être »
NICOLAS LERON
Les prétentions antinomiques de la CJUE et des cours constitutionnelles des États membres amènent à conclure que la souveraineté semble une question non tranchée, en suspens, voire un principe schizophrène doué d’ubiquité. Les cours constitutionnelles défendent la suprématie ultime de la Constitution nationale face au droit de l’UE, tandis que la CJUE affirme sans ambiguïté qu’à ses yeux le droit de l’UE prime sur les droits nationaux, y compris les normes constitutionnelles, consacrant la protection des droits fondamentaux ou le principe de démocratie. Derrière la lutte pour la définition de la norme au sommet du système juridique européen se joue la lutte pour celui qui aura le dernier mot, c’est-à-dire de qui, de la CJUE ou des cours constitutionnelles, sera l’instance juridictionnelle suprême. La CJUE, institution née des traités européens et en charge de les interpréter, s’auto-érige en juge des rapports entre l’UE et les États membres, c’est-à-dire entre les traités, dont elle est issue, et les constitutions nationales. Les cours constitutionnelles, elles-mêmes institutions nées des constitutions nationales et en charge de leur respect, s’auto-attribuent la responsabilité et la compétence de juger en dernière instance les rapports entre l’ordre juridique de l’UE et leur ordre juridique national.
De cette compétition sans conciliation possible, car la logique même de la hiérarchie des normes juridiques empêche toute dualité au sommet de l’édifice juridico-constitutionnel, naît l’incertitude quant à la localisation de la souveraineté en Europe. Si les ordres juridiques nationaux semblent retenir en dernière instance la souveraineté, s’agit-il d’une souveraineté résiduelle, dont l’activation n’est possible qu’à un coût quasi-prohibitif (crise constitutionnelle ouverte ou sortie de l’UE) ? Jusqu’ici et malgré ses coups de semonces répétés, la puissante Cour de Karlsruhe s’est interdit de franchir la ligne rouge – « un chien qui aboie mais qui ne mord pas » pourraient conclure les juges de la CJUE – tout en s’en rapprochant toujours davantage, jusqu’à se tenir à l’extrême bord, pour montrer sa pleine détermination à la franchir – et par où adviennent les accidents. Quant au « Brexit », tout en réassurant le principe de souveraineté étatique, il semble une confirmation du dilemme de l’État membre de l’UE : poursuivre le projet d’intégration européenne, au risque de sa souveraineté, ou bien rompre avec lui, au risque de son isolement.
De cette compétition sans conciliation possible, car la logique même de la hiérarchie des normes juridiques empêche toute dualité au sommet de l’édifice juridico-constitutionnel, naît l’incertitude quant à la localisation de la souveraineté juridique en Europe.
NICOLAS LERON
Plus récemment, au cours de la dernière décennie, l’oscillation de la souveraineté s’est doublée d’un phénomène d’intermittence, plus étrange et problématique encore. Une première occurrence du phénomène s’est manifestée à nos yeux au travers d’une courte phrase – « whatever it takes ». Ces quelques mots énoncés par la bouche du président d’une institution non élue, aux attributions définies et déléguées par les États membres dans le cadre des traités européens, condensent la matière noire de la souveraineté. L’espace d’un instant, la souveraineté semble avoir transmigré des États à la Banque centrale européenne (BCE). Remarquons qu’une telle captation de souveraineté ne peut que susciter la réaction d’une cour constitutionnelle conséquente, à l’instar de la Cour de Karlsruhe qui édifie patiemment depuis quarante ans un ensemble jurisprudentiel de garde-fous et d’écluses aux fins de maitriser autant que possible le double phénomène d’extension du champ d’applicabilité du droit européen et d’aspiration de la souveraineté nationale par les organes supranationaux de l’UE 5. Que les commentateurs ne se trompent point ici : le scandale serait celui de l’absence de résistance de la part des gardiens des constitutions nationales, et non l’inverse – ce qui n’interdit pas une analyse critique sur le plan du droit des décisions des cours nationales 6.
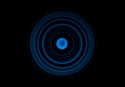
Soulignons ici qu’il se joue quelque chose au sein de la zone euro de radicalement différent d’avec le reste de l’UE. La zone euro n’est pas la continuité fonctionnelle de l’UE et de son marché intérieur ; elle constitue une configuration incommensurable avec celle des États membres de l’UE hors zone euro. En transférant leurs compétences monétaires, les États membres de la zone euro se sont auto-dépossédés d’un attribut essentiel de la souveraineté. Il ne s’agit pas du pouvoir de battre la monnaie en tant que tel – la Monnaie de Paris, sur demande de la Banque de France, continue d’ailleurs de produire les pièces d’euro – mais d’être l’instance monétaire de dernier ressort, c’est-à-dire l’instance qui en dernier recours prêtera, en la créant, la monnaie dont la société a vitalement besoin. La rupture du lien organique entre monnaie et souverain politique (État) constitue un nouvel effacement du souverain 7. La monnaie qui circule dans la zone euro est une monnaie étrangère, sans ancrage dans la communauté politique dont pourtant elle irrigue l’économie et maille la société. En cas de choc macro-économique, l’étrangeté de l’euro se fait jour. La folie de cette déliaison entre la monnaie et le souverain étatique semble alors inconcevable. Mais elle est bien réelle, avec ses conséquences pratiques : la possibilité pour un État membre de la zone euro de faire faillite.
La monnaie qui circule dans la zone euro est une monnaie étrangère, sans ancrage dans la communauté politique dont pourtant elle irrigue l’économie et maille la société. En cas de choc macro-économique, l’étrangeté de l’euro se fait jour.
NICOLAS LERON
Mais le souverain, que ce soit dans sa forme juridique, monétaire ou politique, ne disparaît pas pour autant ; il perdure dans l’ombre. Son apparente dissipation n’est qu’éclipse. Lorsque le système politique européen entre en crise, que sa mécanique fonctionnaliste se grippe, c’est-à-dire lorsque la dimension fondamentale du politique refait surface, le souverain oublié resurgit du fonds des eaux. Il en va ainsi de la crise des dettes souveraines au sein de la zone euro. Au moment où le risque de dislocation du système monétaire européen devenait intenable, est réapparu le souverain monétaire en la figure de la BCE. Celle-ci a, de sa propre autorité, renoué le lien organique entre monnaie et souverain au sein de la zone euro. Elle s’est auto-instituée prêteur en dernier ressort. Pour ce faire, la BCE s’est affranchie de la lettre du mandat que lui confèrent les traités européens ; elle s’est auto-attribué la compétence de redéfinir ses propres compétences. Elle a décidé d’elle-même et pour elle-même de l’état d’exception. En sauvant la zone euro, elle s’est sauvée elle-même.
Pour autant, la souveraineté qui s’était momentanément échappée des États leur retourne lorsque l’état d’urgence n’est plus monétaire mais sécuritaire ou sanitaire. L’État peut alors à nouveau faire jaillir la matière noire de la souveraineté – « le pacte de sécurité prime sur le pacte de stabilité ». Le « whatever it takes » supranational se reformule en un « quoi qu’il en coûte » national. Menacée dans son intégrité physique, la communauté politique nationale reprend ses droits souverains, décide de l’état d’exception et s’affranchit le temps nécessaire de ses engagements européens. La Commission européenne ne peut que suivre, suspendre les règles du pacte de stabilité et mettre l’ensemble de ses leviers budgétaires et logistiques au service des États.
La souveraineté ne quitte jamais vraiment l’État. Malgré ses oscillations, ses intermittences, ses transmigrations, ses effets de dissipations, la souveraineté demeure indéfectiblement reliée aux États qui peuvent à tout moment en actualiser le principe et l’exercer dans tout son éclat.
NICOLAS LERON
La souveraineté ne quitte jamais vraiment l’État. Malgré ses oscillations, ses intermittences, ses transmigrations, ses effets de dissipations, la souveraineté demeure indéfectiblement reliée aux États qui peuvent à tout moment en actualiser le principe et l’exercer dans tout son éclat. Ce rappel irréductible de la souveraineté peut survenir de différents endroits du corps du souverain : de son peuple qui, lassé d’humiliations, met fin à son appartenance européenne ; de sa cour constitutionnelle qui, ulcérée de tant d’écarts avec la lettre et l’esprit des traités, frappe l’UE et ses organes du sceau d’inconstitutionnalité ; de son gouvernement qui, alerté par l’urgence de la situation, s’émancipe de toute contrainte décisionnelle supranationale.
L’impossible souverain européen
Le thème de la souveraineté européenne, mobilisé par Emmanuel Macron et repris des libéraux-centristes européens jusqu’à la Commission européenne 8, fait figure de dernière tentative pour résoudre le problème européen de la souveraineté, c’est-à-dire d’une souveraineté européenne se surajoutant aux souverainetés nationales sans les absorber. Une telle visée contraire à la logique du dernier ressort ne peut qu’être fatalement aporétique. « L’Europe comme rassemblement de notre souveraineté par et avec une souveraineté plus grande encore » 9 relève du non-sens. « On a tenté de réaliser des choses impossibles, de concilier une souveraineté partielle dans l’Union avec une souveraineté complète dans les États ; de renverser un axiome de mathématique en ôtant une partie et en laissant subsister le tout », observait déjà en son temps James Madison. Jacques Delors lui-même semble le reconnaître quand il distingue souveraineté nationale et puissance européenne commune. Sa formule aussi fameuse qu’énigmatique de la « Fédération d’États-nations » ne renvoie pas à la notion de souveraineté européenne. Plus subtilement, Jacques Delors cherche à tâtons « l’invention d’un nouvel espace politique où l’État-nation ne disparaît aucunement, mais accepte la délégation d’un part des composantes de la souveraineté lorsqu’il juge que c’est la condition de la puissance (…) » 10.
Le thème de la souveraineté européenne, mobilisé par Emmanuel Macron et repris des libéraux-centristes européens jusqu’à la Commission européenne, fait figure de dernière tentative pour résoudre le problème européen de la souveraineté, c’est-à-dire d’une souveraineté européenne se surajoutant aux souverainetés nationales sans les absorber.
NICOLAS LERON
La souveraineté européenne énoncée par Emmanuel Macron n’est qu’une autonomie stratégique plurisectorielle : la sécurité et la défense, le contrôle de nos frontières, la politique étrangère, l’agriculture, le numérique et l’économie industrielle, corrélée à la monnaie. Elle inclut et élargit ainsi la notion de puissance de marché de l’Union. Les « six clés de la souveraineté européenne » 11 ne sont que le nom grandiloquent d’une Europe puissance assise sur six politiques publiques stratégiques. Mais toute sémantique ne saurait être neutre, sans coût pour celui qui l’emploie – a fortiori quand il s’agit de la sémantique de la souveraineté. Sur un plan politique, le discours de la souveraineté européenne fait courir le risque de laisser accroire que la souveraineté étatique ne serait plus que formelle, voire fictive, et ne saurait trouver de salut que dans sa dilution au sein d’une souveraineté supranationale. C’est là toute l’inconséquence du discours du rétablissement de la souveraineté par le niveau européen. Car en effet, si « L’Europe seule peut […] assurer une souveraineté réelle » 12 – mais pour autant non encore advenue –, qu’en est-il alors des souverainetés nationales ? Finalement, les tenants de la souveraineté européenne, comme les souverainistes populistes, partagent le même diagnostic : la souveraineté nationale n’est plus. La faute à l’Europe, disent les uns, qui vampirise la souveraineté nationale ; la faute à l’Europe, disent en quelque sorte les autres, car non encore pleinement souveraine.

Plus fondamentalement, la souveraineté européenne faite d’un agrégat de souverainetés étatiques cache dans son ombre le retour de la notion molle de la gouvernance européenne, dont nous connaissons le terrible effet dépolitisant. Elle s’articule sur le principe de la coordination horizontale – mue par la logique des nombres 13 – d’unités politiques souveraines qui, elles, enracinent leur légitimation dans le principe de discrétion et d’auto-législation. Or la coordination s’oppose nécessairement à la discrétion. En ce sens, la souveraineté européenne se découvre comme une anti-souveraineté. Elle se dévoile comme l’ultime avatar de l’intégration fonctionnaliste de régulation supranationale des politiques publiques nationales. Derrière l’effet de verticalité recherché par le recours à la sémantique de la souveraineté se dévoile une logique interétatique horizontale : le regroupement (et non le transfert) des souverainetés nationales autour de grands objectifs d’autonomie stratégique continentale face au reste du monde 14. L’Europe politique se fait ici au travers de l’ambition de puissance européenne, qui ferait l’unité de l’extérieur par le scellement d’une alliance entre États, et non par l’établissement d’une démocratie européenne, qui ferait l’unité de l’intérieur par la constitution d’une communauté́ politique et l’avènement d’une citoyenneté européenne authentique. La souveraineté européenne est une Europe du directoire des chefs d’État et de gouvernement impulsant par-dessus la tête des citoyens les grands projets européens jugés nécessaires – un fédéralisme exécutif renforcé.
Finalement, les tenants de la souveraineté européenne, comme les souverainistes populistes, partagent le même diagnostic : la souveraineté nationale n’est plus. La faute à l’Europe, disent les uns, qui vampirise la souveraineté nationale ; la faute à l’Europe, disent en quelque sorte les autres, car non encore pleinement souveraine.
NICOLAS LERON
Reste le Conseil européen. D’aucuns ont pu y voir la figure d’un souverain collectif. En dernière instance politique, lorsque la maison européenne brûle, c’est au Conseil européen qu’il revient de prendre les décisions salutaires et, au besoin, de redéfinir par touches le pacte constitutif européen qui lie les États membres entre eux. Le Mécanisme européen de stabilité (MES) et l’Union bancaire sont nés ainsi de la volonté politique du Conseil européen confronté à la menace d’une destruction de la zone euro. Le Conseil européen incarnerait alors une souveraineté collective, la somme des souverainetés nationales représentées par les chefs d’États et de gouvernements. La souveraineté étatique individuelle de chaque État membre demeurerait dans sa capacité à opposer son veto à toute décision contraire à ses intérêts vitaux. Mais la souveraineté serait aussi collective dans son exercice 15. Les grands enjeux tels que la sécurité et la défense, la lutte contre le changement climatique, la crise des réfugiés ou encore les intérêts commerciaux européens seraient pris à bras le corps par le Conseil européen, comme instance collective de dernier ressort. L’UE retrouverait par ce biais, d’une part, un souverain politique et, d’autre part, une légitimité politique du fait que chaque composante du Conseil européen serait le fruit légitime du processus démocratique national.
Il ne saurait pour autant en aller ainsi. En raison de sa nature même, le Conseil européen est dans l’incapacité de jouer le rôle d’un souverain collectif à même de définir et incarner l’intérêt général européen. Il n’est, en effet, capable que de compromis « au bord de l’abîme », de courtes vues, partiels et précaires. Le Conseil européen traduit dans une enceinte institutionnalisée un jeu de puissances étatiques somme toute classique, voire aggravé par la très forte interdépendance mutuelle des membres le composant. Les Conseils européens « de la dernière chance » se caractérisent par le retour des rapports de puissance internationaux au sein de l’UE, avec la prépondérance du gouvernement allemand jouant de l’avantage positionnel stratégique de l’Allemagne qui se situe doublement au centre de l’UE – au centre économique et au centre géopolitique intra-européen 16. La logique de puissance entre unités fortement interdépendantes tend à structurer la logique décisionnelle du Conseil européen en jeu d’alliances autour de centres de gravité à géométrie variable, mais souvent récurrents et dont le premier d’entre eux s’agrège autour de l’Allemagne. Les « petits » États membres se voient obligés par la logique même du Conseil européen de se mettre au service d’un grand protecteur, directement (comme satellite d’un grand État) ou indirectement (via une coalition d’intérêts comme la nouvelle ligue hanséatique). Point de véritable intérêt collectif ici, mais l’entrechoquement des intérêts particuliers des États membres. En cas de crise, la tension monte, les esprits s’échauffent et les passions négatives longtemps contenues s’expriment à nouveau, de part et d’autre, au moyen de l’invective et de la haine. Le contentieux autour des coronabonds n’est que le dernier épisode d’un même scénario qui se répète en s’amplifiant depuis une décennie.
Le Conseil européen traduit dans une enceinte institutionnalisée un jeu de puissances étatiques somme toute classique, voire aggravé par la très forte interdépendance mutuelle des membres le composant.
NICOLAS LERON
L’Union européenne n’est pas une démocratie
Les jeux d’ombre et de lumière de la souveraineté excitent le regard et le détournent de la part inavouable de l’intégration européenne – l’Union européenne n’est pas une démocratie. La question démocratique européenne n’est pas celle d’un déficit qu’il s’agirait de combler au travers d’un processus de démocratisation, mais celle d’une absence qui appelle un acte de fondation – l’ouverture d’une dimension politique proprement européenne. La crise de l’Europe est au commencement une crise du regard, le fait d’un certain regard économiciste et fonctionnaliste.
Nous pensons à ce regard qui appréhende la crise européenne au travers de notions économiques filtrant la réalité européenne : l’incomplétude du marché intérieur, la sous-optimalité de la zone monétaire euro, le caractère pro-cyclique de l’Union économique et monétaire (UEM) en cas de choc asymétrique, les déséquilibres macroéconomiques intra-européens non soutenables, ceux relatifs aux niveaux et aux écarts d’endettement, à la balance des paiements, à la compétitivité, aux taux d’inflation et de change réels. Le maître mot, celui de tous les rapports et de toutes les notes d’analyses sur l’avenir de la zone euro, est stabilité – qui s’opère par la convergence des facteurs économiques jusqu’aux souverainetés nationales. L’objectif ultime, la raison de toutes les réformes structurelles, ne visera pas la légitimité politique d’une nouvelle communauté, la nature démocratique de l’ensemble, l’avènement d’un « nous » européen – mais la stabilité macroéconomique d’une zone monétaire sous-optimale mise à mal par ses asymétries internes et soumises aux chocs externes (géoéconomiques, géopolitiques, migratoires ou sanitaires).
Le regard économiciste résonne avec la matrice fonctionnaliste de l’intégration européenne : résorber la sous-optimalité de la zone euro (union monétaire) commence par l’approfondissement de l’intégration des marchés de capitaux nationaux (union des marchés de capitaux) et l’unification de la surveillance et de la gestion des faillites des grands établissement bancaires dits « systémiques » (union bancaire), puis nécessite de transférer au niveau supranational la coordination des politiques économiques nationales (union économique), ce qui implique en toute logique de mettre en place une politique fiscale et budgétaire européenne (union fiscale et budgétaire), qui elle-même ne peut se légitimer – c’est à ce moment tardif que le politique se rappelle à l’esprit de l’économiste – sans l’achèvement d’une Europe fédérale (union politique). Le discours économiciste comme celui de la souveraineté européenne positionnent la question démocratique en fin de raisonnement, comme l’étape conclusive – voire optionnelle – d’un processus focalisé avant toute chose sur le problème de la stabilité interne (sous-optimalité de la zone euro) et externe (autonomie stratégique européenne).
Le discours économiciste comme celui de la souveraineté européenne positionnent la question démocratique en fin de raisonnement, comme l’étape conclusive – voire optionnelle – d’un processus focalisé avant toute chose sur le problème de la stabilité interne et externe.
NICOLAS LERON
Plus encore, les ingénieurs institutionnels évacuent la question démocratique au moyen de la référence rapide à la « responsabilité démocratique » qu’ils résument à un effort de transparence des processus décisionnels et d’un droit de regard du Parlement européen. Parmi d’autres, citons l’exemple édifiant du Document de réflexion sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire de mai 2017 publié par la Commission européenne 17. Document de quarante pages sur l’avenir de la zone euro, la question démocratique n’y est traitée qu’en quelques paragraphes noyés dans le ventre mou du texte, au 5e point de la 4e sous-partie, sous l’intitulé « Comment renforcer la responsabilité démocratique ? » Le substantif « démocratie » est absent du document, seul l’adjectif « démocratique » y figure, accolé à « responsabilité » (sans aucune mention faite à la « légitimité démocratique » 18. Cette diminution de la démocratie s’observe également dans le discours de la Sorbonne d’Emmanuel Macron où le troisième terme de son triptyque « souveraineté-unité-démocratie » n’apparaît qu’au deuxième tiers du discours, après les développements sur la souveraineté européenne et les questions d’architecture de l’UEM 19. À Strasbourg, Parlement européen oblige, le Président français fait certes « remonter » l’item de la démocratie dans l’ordre de son discours, mais il évoque la défense du modèle de démocratie libérale en Europe, et non l’établissement d’une démocratie européenne 20. Il opère ainsi une confusion conceptuelle fondamentale en parlant de souveraineté européenne et de démocratie en Europe, alors qu’il faudrait parler de démocratie européenne (celle de l’UE, de la zone euro ou d’un noyau dur) et de souveraineté en Europe (celle des États membres).
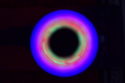
Une telle relégation ne laisse pas de surprendre de la part d’esprits sincèrement attachés à la cause européenne. Elle pourrait toutefois s’expliquer par l’appréhension confuse mais profonde d’une vérité difficilement dicible : le fait que l’UE n’est pas une démocratie, qu’il n’y a pas de démocratie européenne. Innommable, celle-ci n’est donc point nommée.
Les ingénieurs institutionnels évacuent la question démocratique au moyen de la référence rapide à la « responsabilité démocratique » qu’ils résument à un effort de transparence des processus décisionnels et d’un droit de regard du Parlement européen.
NICOLAS LERON
La démocratie moderne commence et se concentre dans le vote du budget politique par une majorité parlementaire élue et capable de traduire en politiques publiques structurantes les préférences socio-économiques et sociétales des citoyens. Le vote du budget correspond, d’une part, au vote des recettes fiscales, c’est-à-dire à la richesse commune que le collectif décide de se donner à lui-même (avec l’enjeu de l’ampleur et de la répartition du prélèvement sur les richesses privées) et, d’autre part, au vote des dépenses, c’est-à-dire aux biens publics que le collectif décide de produire pour lui-même (avec l’enjeu de la nature et de la distribution de ces biens publics). Le pouvoir budgétaire, c’est-à-dire la capacité budgétaire, en volume et en orientation, à la disposition du collectif (et non seulement la compétence institutionnelle de voter le budget), est au cœur des attributs du Parlement. Si la démocratie est un demos, elle est aussi un kratos, une capacité collective d’agir sur la réalité commune – une puissance publique.
À l’aune de cette définition substantielle et non seulement formelle de la démocratie, nous observons que l’UE repose sur un système sophistiqué d’équilibre des pouvoirs et assure une transparence institutionnelle, qu’elle respecte l’État de droit et garantit un haut niveau de protection des droits fondamentaux, qu’elle développe un puissant droit du marché intérieur et déploie des politiques sectorielles et territoriales qui comptent pour celles et ceux qui en bénéficient. Mais elle n’a point de budget politique. L’extrême faiblesse en volume de son budget, qui oscille autour de 1 % du PIB, en fait un budget technique que l’on peut rapprocher des 0,7 % de RNB que préconise l’ONU aux États en matière d’aide au développement. En France, le budget de l’Agence française de développement (AFD) devrait atteindre 0,55 % du RNB en 2022 21. Autrement dit, si le Parlement européen a bien une compétence budgétaire (le vote du budget de l’UE), il lui fait défaut toute véritable capacité budgétaire. Or qu’est-ce un Parlement sans pouvoir budgétaire ? C’est une assemblée, mais point un Parlement. Et qu’est-ce qu’un système institutionnel moderne sans parlement ? Ce n’est pas une démocratie. L’UE n’est pas une démocratie ; elle se dévoile dans sa matérialité comme une super-agence de régulation productrice de normes et doublée d’une agence de développement sectoriel (politique agricole, financement de la recherche…) et territorial (fonds de cohésion).
Qu’est-ce un Parlement sans pouvoir budgétaire ? C’est une assemblée, mais point un Parlement. Et qu’est-ce qu’un système institutionnel sans parlement ? Ce n’est pas une démocratie.
NICOLAS LERON
La crise de l’Europe se révèle en premier lieu comme une crise de puissance publique – et non de la sous-optimalité d’une zone monétaire –, de sa capacité, tant au niveau de l’UE qu’au niveau des États membres, de délivrer à ses citoyens des réponses à leurs préoccupations, de mettre en œuvre des politiques publiques qui changent le cours de la vie, c’est-à-dire qui confère au vote, à l’électeur, au citoyen, sa réalité démocratique. L’Union et sa Constitution économique (et budgétaire pour la zone euro) affaiblissent les puissances publiques nationales, c’est-à-dire corrodent le pouvoir budgétaire des parlements nationaux, et donc démonétisent le bulletin de vote des citoyens nationaux, sans pour autant recouvrer à l’échelon européen le différentiel de puissance publique perdu à l’échelon national. Le système politique européen dans son ensemble (UE et États membres) nourrit en son sein un procès de baisse tendancielle du niveau de puissance publique 22.
L’ouverture d’un compte européen
La relégation de la démocratie couvre un refoulement plus obscur encore : l’oubli du politique européen. Outre les mécanos du supra-politique enferrés dans le paradigme de la règle et de la coordination, l’oubli du politique européen frappe également les penseurs de l’infra-politique, à l’instar de Pascal Lamy qui conclut que « le temps est venu de cesser de nous concentrer exclusivement, comme nous l’avons fait pendant des années – moi y compris –, sur ce qui est de l’ordre de l’économique et du supra-politique en Europe, pour aller chercher dans ce qui est infra-politique les éléments d’un nouveau récit commun. » 23 Ce remarquable enjambement du politique européen est symptomatique d’un impensé fondamental – d’un scandale primordial – de la construction européenne : l’Europe à proprement parler n’existe pas. L’Europe est sur toutes les bouches, des institutions puissantes s’autorisent en son nom, mais l’Europe comme substance politique n’existe pas ou si peu – dans l’épaisseur du trait de la règle.
La relégation de la démocratie couvre un refoulement plus obscur encore : l’oubli du politique européen.
NICOLAS LERON
L’architecture de l’UE et plus encore celle de la zone euro n’admettent qu’une seule voie structurelle à la disposition des Européens pour répondre aux défis pressants du siècle : celle de la coordination sous contrainte des politiques économiques et budgétaires nationales. En la double absence d’un véritable budget politique commun et de la possibilité de transferts budgétaires interétatiques (et de l’interdiction pour un État membre de la zone euro de faire défaut), l’Union économique, jambe malingre de l’UEM, ne saurait se tenir droite que dans l’exercice hautement sophistiqué d’une gouvernance macroéconomique où chaque État membre inscrit sa trajectoire budgétaire dans un policy mix interétatique finement paramétré. C’est ici que l’illusion économiciste joue le plus fortement : elle réunit dans un même effort dantesque un nombre faramineux d’administrateurs et d’experts tendus vers la découverte de l’équation macroéconomique parfaite, celle qui définira le point d’équilibre macro-structurel de la zone euro. Outre la vanité d’une telle entreprise, cette acmé de la gouvernance par les nombres consacre une configuration de la zone euro centrée sur le primat d’un principe de coordination d’unités politiques nationales souveraines. Or le principe de coordination contrevient au principe démocratique d’auto-législation. Se coordonner, c’est fatalement se soumettre pour partie à la contrainte collective et renoncer d’autant à sa liberté d’action, à son libre arbitre. Mais plus encore, le principe de coordination bloque sous son plafond de verre l’ouverture d’une dimension politique proprement européenne, incommensurable à la dimension interétatique.
Dépourvue de dimension européenne authentique, la dialectique européenne ne peut que se nouer autour du couple « solidarité contre responsabilité ». Les États débiteurs du Sud appellent à l’impérieuse solidarité des États créditeurs du Nord, ces derniers leur répondant par l’exigence préalable de responsabilité des premiers – le pas-de-solidarité-sans-responsabilité et le pas-de-responsabilité-sans-solidarité se neutralisant mutuellement. L’Europe n’est alors que le faux-nom d’un jeu interétatique intra-européen. Aussi étrange que cela puisse paraître, l’Europe authentiquement européenne est l’Arlésienne de l’intégration européenne. Le philosophe néerlandais Luuk Van Middelaar identifie trois sphères européennes : la sphère externe des États membres comme États souverains aux considérations géostratégiques, la sphère intermédiaire du cercle des États membres comme parties prenantes du jeu politique de l’UE, et la sphère interne des institutions européennes régies par le droit 24. Ces trois sphères sont bien présentes dans l’UE et la zone euro et elles animent la politique européenne : le retour de la politique de puissance en Europe entre États aux intérêts fondamentaux divergents, la politique de la négociation à la table du Conseil européen et la politique des institutions européennes qui poursuivent leur propre agenda. Pour autant le politique européen n’advient jamais.
L’Europe n’est que le faux-nom d’un jeu interétatique intra-européen. Aussi étrange que cela puisse paraître, l’Europe authentiquement européenne est l’Arlésienne de l’intégration européenne.
NICOLAS LERON
La querelle des coronabonds constitue à cet égard la dernière tentative en date de sauver l’Europe tout en restant dans le cadre de la coopération interétatique. Car à y regarder de près, il n’y a rien de proprement européen dans la mutualisation de l’endettement qui en bout de chaîne repose sur le système budgétaire et fiscal de chaque État membre. Le verrou du « keine Transferunion » réduit toute action collective européenne à une somme d’actions nationales. C’est précisément ce verrou qu’il faut lever. Précisons bien les choses : il n’est pas question ici d’un transfert budgétaire entre États membres, ce qui reviendrait à retomber dans le piège de « la solidarité contre la responsabilité ». Il s’agit d’établir un transfert de richesses entre les citoyens européens bénéficiaires de biens publics européens (incorporant une valeur ajoutée européenne) et les profits privés générés par l’existence même du marché intérieur – qui constitue déjà à ce titre une union de transfert (mue par une dynamique centripète d’agrégation des richesses vers un centre, en l’occurrence le bloc germanique du fait de la grande modération salariale de l’Allemagne post-réunification, d’une spécialisation industrielle en résonnance avec la phase de développement économique de la Chine et d’un taux de change de l’euro favorable) 25. Nous retrouvons-là les fondements de la démocratie moderne : la figure du citoyen européen, et donc l’Europe politique, ne peut prendre corps qu’à la condition d’une capacité de fiscaliser le marché intérieur, et donc de générer des recettes et des dépenses publiques qui échappent pour partie à toute comptabilité interétatique. En un mot, l’intégration européenne doit « briser le quatrième mur » pour enfin s’adresser directement au public européen.
La figure du citoyen européen, et donc l’Europe politique, ne peut prendre corps qu’à la condition d’une capacité de fiscaliser le marché intérieur, et donc de générer des recettes et des dépenses publiques qui échappent pour partie à toute compatibilité interétatique. En un mot, l’intégration européenne doit « briser le quatrième mur » pour enfin s’adresser directement au public européen.
NICOLAS LERON
Si la démocratie nationale limite toute coopération interétatique d’ampleur (double résistance politique et constitutionnelle du principe démocratique national), une démocratie européenne authentique ouvrirait un nouvel espace d’action collective. Car à la différence de la souveraineté, la démocratie n’est pas exclusive : une démocratie européenne ne cannibalise pas les démocraties nationales. Encore faut-il lui donner sa propre substance politique, son propre kratos. Celui-ci se trouve, comme pour toute démocratie, dans le prélèvement de l’impôt qui abonde un budget politique aux mains d’un Parlement élu. Ainsi, dans cette période où s’entrouvre la fenêtre de l’Histoire qui seule suspend la tragédie des horizons, le combat à mener n’est pas celui des coronabonds, mais celui de la fiscalité européenne. Aucune démocratie européenne ne peut naître d’un budget technique abondé pour l’essentiel par des contributions étatiques, ni d’une mutualisation de l’endettement où chacun comptera ses billes et se regardera en chiens de faïence. Le saut budgétaire européen, que nous identifions comme le véritable saut politique, est double : en volume 26 et en nature des ressources. Loin d’être un sujet technique parmi d’autre, la fiscalité européenne touche au politique européen 27. Celle-ci peut prendre la forme de différents impôts et taxes : impôt sur les sociétés, taxe carbone, taxe sur les transactions financières etc. Il revient aux États membres de choisir l’instrument fiscal européen le plus à même de faire consensus. En ces temps de changement climatique et de réévaluation du capitalisme financier, la taxe carbone et la taxe sur les transactions financières semblent tenir la corde – d’autant qu’elles pourraient être en Allemagne le terme de l’accord de coalition possiblement à venir entre la CDU et les Grünen.

L’important, au-delà du choix de l’instrument fiscal, est de franchir le plafond de verre du politique européen. Car la levée d’un budget politique européen ouvrirait un espace d’incommensurabilité : l’ouverture d’un compte européen irréductible aux comptabilités interétatiques, une part européenne assignable aux seuls citoyens européens, c’est-à-dire inassignable à la somme des citoyens nationaux. L’enfer du couple solidarité-responsabilité ferait alors place au faire-société. Nos amis Américains sont nés du mot d’ordre « no taxation without representation », à nous Européens de naître du combat victorieux sous la bannière du « no representation without taxation ». Le saut politique se situe ici, et non dans la recherche confuse d’une inconsistante souveraineté européenne : fiscalisons le marché intérieur et décidons de ce que nous, Européens, voulons en faire.
Nos amis Américains sont nés du mot d’ordre « no taxation without representation », à nous Européens de naître du combat victorieux sous la bannière du « no representation without taxation ».
NICOLAS LERON
Dans la geste européenne, il revient de coutume à la France de proposer et à l’Allemagne de se laisser convaincre. Mais l’entêtement du gouvernement français à fourbir des propositions qui tombent systématiquement à côté (souveraineté européenne, armée européenne, budget zone euro et maintenant coronabonds) pourrait avoir la conséquence heureuse, bien que non intentionnelle, de forcer l’Allemagne à se défaire de son attentisme hérité de l’Histoire pour enfin oser parler à l’Europe avec ses propres mots et lui proposer une voie à la hauteur du siècle : celle de la démocratie européenne. Car l’Allemagne est bien la grande démocratie du continent, le peuple qui en honore le principe avec le plus de compréhension et de continuité depuis l’après-guerre. Derrière la querelle vaine des coronabonds peut ainsi émerger la question de la fiscalité européenne et du budget politique européen, fondements d’une démocratie européenne. Alors que l’Allemagne prendra la présidence du Conseil de l’UE le 1er juillet 2020, Angela Merkel s’apprête à poser sa pierre à l’édifice de l’histoire de la construction européenne. Elle en a la possibilité et, sans doute, la lucidité, elle qui semble avoir attendu avec son art consommé de la patience ce moment qui s’annonce finalement au crépuscule de sa quatrième et dernière mandature. Espérons que la proposition franco-allemande du 18 mai 2020 soit le signe avant-coureur de l’assomption européenne de la Chancelière – et non l’ultime ruse de la politique du statu quo. Espérons également que, le cas échéant, la France et son gouvernement auront l’humilité de la suivre.
Sources
- Le présent article reprend le titre de la deuxième partie de notre essai La Double démocratie (Seuil, 2017), écrit avec Michel Aglietta, pour en développer et actualiser les thèses au regard de la question de la démocratie européenne.
- Dominique Carreau, « Droit communautaire et droits nationaux : concurrence ou primauté ? », Revue trimestrielle de droit européen, 1978, p. 319‑418, spéc. p. 385.
- Denis Alland, « Consécration d’un paradoxe : primauté du droit interne sur le droit international (Réflexions sur le vif à propos de l’arrêt du Conseil d’État, Sarran, Levacher et autres du 30 octobre 1998) », Revue française de droit administratif, 1998, p. 1094-1104, spéc. p. 1094-1095.
- Denys Simon, Le système juridique communautaire, Paris, PUF, 3e éd., 2001, p. 410.
- La décision de la Cour constitutionnelle allemande du 5 mai 2020 relative au programme d’achat de titres publics de la BCE s’inscrit dans une longue chaîne jurisprudentielle qui remonte aux années 1970 depuis les décisions « Milchpulver » du 9 juin 1971 et « Solange I » du 29 mai 1974 à partir de la question du respect des droits fondamentaux par le droit communautaire. Qu’on nous permette au sujet de la réaction des cours nationales face aux prétentions du droit européen de renvoyer le lecteur à notre thèse La gouvernance constitutionnelle des juges, IEP de Paris, 2014, disponible en ligne <https://spire.sciencespo.fr/>.
- Pour une analyse juridique critique de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 5 mai 2020, voir le commentaire de Francesco Martucci publié sur le site du Club des juristes, 11 mai 2020.
- Sur la théorie institutionnaliste de la monnaie, voir : Michel Aglietta, La monnaie. Entre dettes et souveraineté, Odile Jacob, 2016.
- Cf. Jean-Claude Juncker, « L’heure de la souveraineté européenne », Discours sur l’état de l’Union, 12 septembre 2018.
- Emmanuel Macron, Discours devant le Parlement européen, Strasbourg, 17 avril 2018.
- Jacques Delors, « Préface », in Jacques Lenoble et Nicole Dewandre (dir.), L’Europe au soir du siècle. Identité et démocratie, éd. Esprit, 1992.
- Emmanuel Macron, « Initiative pour l’Europe », La Sorbonne, Paris, 26 septembre 2017.
- Ibid.
- Cf. Alain Supiot, La gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France, 2012-2014, Paris, Fayard, 2015.
- Pour une critique de la notion de souveraineté européenne dont l’argumentaire est brièvement repris ici, voir notre article : Nicolas Leron, « Les faux-semblants de la souveraineté européenne », Esprit, mai 2019.
- ela semble correspondre grosso modo au schéma dual proposé par Jean-Marc Ferry d’une souveraineté négative (États membres) et d’une souveraineté positive (UE). Cf. « Qu’est-ce qu’un État européen ? Une conversation avec Jean-Marc Ferry », Le Grand Continent, 2 novembre 2018.
- Cf. Shahin Vallée et Edouard Gaudot, « Sortir de l’impasse européenne : pour une nouvelle théorie du changement », Le Vent Se Lève, 7 mai 2020.
- Commission européenne, Document de réflexion sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, COM(2017) 291, 31 mai 2017, disponible en ligne : <https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_fr.pdf>.
- L’absence du substantif « démocratie » se retrouve également dans le rapport des cinq présidents de 2015. Cf. Jean-Claude Juncker e.a., Le rapport des cinq présidents. Compléter l’Union économique et monétaire européenne, 22 juin 2015, disponible en ligne : <https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_fr.pdf>. La démocratie disparaît tout autant du discours de Jean-Claude Juncker sur l’état de l’Union de 2018 axé sur « l’heure de la souveraineté européenne », lui qui articulait son discours sur l’état de l’Union de 2017 autour de la ligne de force « une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique » – le progrès démocratique se résumant à ses yeux aux aspects institutionnels comme les listes transnationales, l’animation de conventions citoyennes, le système des Spitzenkandidaten et la fusion des présidences de la Commission et du Conseil européen.
- Emmanuel Macron, « Initiative pour l’Europe », op. cit.
- Emmanuel Macron, Discours devant le Parlement européen, op. cit.
- Rappelons que le RNB (revenu national brut) est la somme du PIB (produit intérieur brut) et du solde des flux de revenus primaires avec le reste du monde. Pour un pays développé ayant des relations équilibrées avec l’extérieur, la différence entre les deux agrégats est faible.
- Pour un argumentaire développé de ce point, voir notre article « La gauche à l’épreuve de l’Europe. La voie de la double démocratie européenne », Le Débat, mars-avril 2020.
- Pascal Lamy, « Jalons pour une anthropologie européenne », Le Grand Continent, 8 janvier 2020.
- Luuk Van Middelaar, Le passage à l’Europe. Histoire d’un commencement, Paris, Gallimard, 2012.
- Sur la structure du marché du travail en Europe, voir : Xavier Ragot, Civiliser le capitalisme, Paris, Fayard, 2019. Il est à noter que si le centre de gravité actuel de l’Europe se trouve en Allemagne, l’évolution de l’économie mondiale (guerre économique américaine et nouvelle phase économique de la Chine qui entre désormais en concurrence avec l’industrie allemande) peut amener celui-ci à se déplacer. Pour autant, cette non fixité du centre de gravité de l’UE ne saurait en rien constituer un mécanisme d’équilibre macroéconomique, et ne confère aucune assise de légitimation politique.
- Avec Michel Aglietta, nous avons suggéré un seuil de 3,5 % du PIB européen, soit approximativement un budget annuel de 500 Md€. Cf. Michel Aglietta et Nicolas Leron, La Double démocratie, Seuil, 2017.
- Le groupe pluridisciplinaire réuni par Thomas Piketty autour du Manifeste pour la démocratisation de l’Europe (T-DEM) prend justement pour point de départ la question démocratique. Il propose la création d’une Assemblée européenne (composée à 80 % de députés nationaux et 20 % de députés européen) dont le principal attribut serait l’adoption d’un budget européen conséquent (4 % du PIB) abondé par la création de quatre impôts européens (sur le bénéfice des sociétés, sur les hauts patrimoines, sur les hauts revenus, sur les émissions carbone). Le projet de T-DEM refuse toutefois la perspective d’une union de transferts. Les recettes versées par chaque pays ont vocation à être équivalentes (avec un écart maximal de 0,1 % du PIB) aux dépenses dont il bénéficiera. Si la proposition du T-DEM (que j’ai cosignée) est le fruit d’une réflexion ambitieuse et féconde, elle trouve une limite fondamentale dans le maintien du principe d’interdiction d’une union de transferts et la logique afférente d’une comptabilité budgétaire interétatique. La proposition se rabat ultimement sur une ingénierie institutionnelle et fiscale de coordination interétatique de politiques de réduction des inégalités internes doublée d’un pare-feu collectif contre les stratégies non-coopératives de dumping fiscal. En cela, le T-DEM ne répond pas à la question première de la production d’une substance politique proprement européenne.


