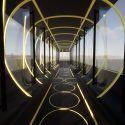Nous ne nous réveillerons pas, après le confinement, dans un nouveau monde ; ce sera le même, en un peu pire.
Michel Houellebecq
La catastrophe et la régénération
À la date du 21 août 2021, dix-huit mois après l’explosion des contagions, Google Scholar rapporte 8580 articles contenant la formule « post-Covid » et 2780 autres mentionnant « post-pandémique » 1. Une véritable pandémie académique en d’autres termes : il semble que personne, quelle que soit sa spécialisation, à l’exception peut-être des quelques stricts spécialistes de galaxies particulières, de l’éthologie des poissons ou de la littérature nordique, n’ait pu s’empêcher de donner son avis sur le monde nouveau qui verra le jour lorsque nous serons défaits du Covid-19. Je ne prétends certainement pas avoir parcouru, et encore moins lu, ne serait-ce qu’un centième de ces onze-mille articles ou plus – si j’avais le temps, je ne serais pas contre en savoir davantage sur l’Epinephelus marginatus ou Snorri Sturlson. Avec une superficialité et une hâte ô combien déplorable du point de vue de la déontologie académique, j’ai cependant étudié certains textes produits ces derniers mois dans le domaine des sciences sociales, au sens strict du terme, parmi ceux qui se concentrent davantage sur le scénario général que sur les questions de détail. Au vrai, ils ne m’ont pas laissé une grande impression même si, bien sûr, il s’agit d’une impression hâtive et superficielle, et que je ne peux que présenter comme telle 2.
La pandémie est pleine de contradictions, le monde qui l’a accueillie l’est encore plus, et il est donc impossible de prophétiser la manière dont ces antinomies interagiront entre elles et dans quelle direction cela nous mènera.
Giovanni Orsina
Mon impression est donc que ce débat, s’il était traduit en musique, ressemblerait à une symphonie en quatre mouvements. Le premier, sombre et solennel, marqué par les percussions avec une clarté apodictique qui ne laisse aucune place aux malentendus ou aux nuances, annonce que la pandémie représente sans aucun doute une rupture historique de première importance. Le second est bien plus hésitant, le rythme est brisé et syncopé, les archets divergent et dissonent des vents : une rupture de premier ordre, certes, mais qui sait ce qui adviendra. La pandémie est pleine de contradictions, le monde qui l’a accueillie l’est encore plus ; il est donc impossible de prophétiser la manière dont ces antinomies interagiront entre elles et dans quelle direction cela nous mènera. Le troisième mouvement est franchement dramatique : même dans l’incertitude, nous courons le risque très concret d’un alignement satanique tel que le monde pandémique sera infiniment pire que le monde pré-pandémique. En somme, une catastrophe se profile. La quatrième et dernière partie est en deux volets, le premier exhortatif, le second timidement triomphant : si les humains comprennent les dangers auxquels ils sont confrontés et se comportent de manière adéquate, le risque diabolique sera évité, et un monde plus solide, tolérant et pacifique verra le jour.
« La pandémie a aussi montré clairement que les politiques actuelles consistent autant à contrôler les récits politiques qu’à être efficaces » écrivent Miguel Poiares Maduro et Paul W. Kahn dans l’introduction à Democracy in Times of Pandemic. « Face aux récits de peur qui peuvent être la réponse naturelle aux crises de la pandémie, nous pouvons commencer à voir notre chemin vers un nouveau récit d’optimisme […] Ce sont peut-être les outils grâce auxquels nous pourrons gagner la bataille de l’opinion publique qui a lieu à l’échelle nationale et internationale. À partir de là, nous pouvons imaginer un nouveau départ dans lequel la démocratie est de nouveau liée à la raison, au pluralisme, à un ethos civique, et au constitutionnalisme d’inspiration libérale » 3. En vérité, il n’y avait pas besoin de la pandémie pour nous rendre compte de la manière dont la politique vise à contrôler les récits. Mais ce qui a pu être rendu encore plus évident grâce au Covid-19, c’est à quel point, non pas la politique, mais les sciences sociales se sont livrées au contrôle des récits, à la production de raisonnements dont le but n’est pas d’interpréter le monde mais de le transformer, pas d’éclairer l’homo sapiens mais de le mobiliser. Des prophéties qui n’ont de valeur que dans la mesure où elles visent, en somme, l’accomplissement de soi.
S’il en était ainsi, ce ne serait, selon moi, pas la meilleure nouvelle et certainement pas parce que je m’oppose aux objectifs : « raison, pluralisme, ethos civique, et constitutionnalisme libéral », mais précisément parce que je retiens que pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de disposer de lectures de la réalité les plus « propres » possibles, des lectures qui ne sont pas contrôlées dès le départ par le désir de contrôler le récit, pas même dans le but noble de les mettre au service de ces objectifs. À force de substituer Weber à Marx, à force de persévérer sur la voie de cette trahison des clercs qui, avec l’arrivée du Covid-19, me semble s’être constituée de manière plus évidente, nous risquons de parcourir le dernier kilomètre et de tomber têtes baissées dans une des pages les plus dystopiques de Czesław Miłosz : « Processus dialectique : prévoir que la maison brûlera, puisse verser de l’essence autour du poêle. La maison prend feu, mes prévisions sont justes. Processus dialectiques : prédire que la création artistique non conforme aux canons du réalisme socialiste serait sans valeur, puis mettre l’artiste dans une position où elle n’en a vraiment pas. Les prévisions étaient exactes. » 4. Autre que « la raison, le pluralisme, l’éthique civique et le constitutionnalisme libéral ».
Il est possible que la pandémie représente une rupture majeure, mais pas le tournant historique majeur qu’on prédit souvent.
Giovanni orsina
Dans les paragraphes qui suivent, j’essaierai donc de déconstruire la symphonie post-Covid, en commençant par le premier mouvement : la catastrophe. Il est possible que la pandémie représente une rupture majeure, mais pas le tournant historique majeur qu’on prédit souvent 5. Dans le discours public, elle a été fréquemment comparée à une guerre : pour ceux nés après 1945, a-t-on dit, elle représenterait l’équivalent de ce que les deux Guerres mondiales ont été pour leurs parents et grands-parents. Cependant, il n’en faut pas beaucoup pour voir que la comparaison ne tient pas la route. À la fin du mois de septembre 2021, le Covid avait fait environ 4,8 millions de morts dans le monde 6. Avoir des chiffres précis sur les pertes causées par la Seconde Guerre mondiale n’est pas aisé, mais pour la première nous pouvons raisonnablement estimer plus de vingt millions de morts en incluant les victimes de la grippe espagnole 7, et pour la seconde, les estimations les plus prudentes parlent de plus de trente-cinq millions de victimes, tandis que les moins prudentes vont jusqu’à quatre-vingts millions 8, le tout sur une population mondiale représentant un quart de celle d’aujourd’hui.
Naturellement, les chiffres ne sont qu’une partie de l’histoire. Si nous continuons à penser en termes de victimes, nous devons considérer que la mort d’une personne de plus de 80 ans accablée par la maladie n’est pas comparable en termes d’impact psychologique et social à celle d’un jeune de 20 ans en pleine santé. Ne sont pas non plus comparables les impacts psychologiques et sociaux d’un phénomène qui peut tuer tout le monde – hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, civils, militaires –, comme ce fut le cas de la Seconde Guerre mondiale, avec un autre qui, pour une très grande majorité de la population, ne présentait pratiquement aucun danger. En Italie, dans la tranche d’âge des 0-59 ans, qui représente 70 % de la population dans l’un des pays les plus vieux du monde, six mille trois cents personnes étaient décédées du Covid au 22 septembre 2021 9. Personnellement – l’accent mis sur la perspective subjective caractérisant de nombreux écrits sur la pandémie et le monde post-pandémique, j’en profite –, en tant que personne de plus de cinquante ans n’ayant jamais souffert de maladies graves, depuis que la pandémie a commencé, je n’ai jamais craint pour ma vie. Le 19 juillet 1943, les bombes américaines tombaient à deux kilomètres de là où j’habite actuellement : si j’y avais habité à cette époque, mon sentiment n’aurait pas été celui de la sécurité.
Mais même les morts ne sont qu’une partie de l’histoire. Les Guerres mondiales, catastrophes générées de « l’intérieur » de l’humanité, même en laissant de côté leurs immenses conséquences psychologiques et sociales, ont été de puissants générateurs d’idéologie politique et ont profondément modifié la distribution du pouvoir à l’échelle globale. La Grande Guerre a amplifié de manière démesurée à la fois le sentiment national et la conviction que les nations étaient impliquées dans un affrontement darwinien pour la survie, le sentiment de classe et la conviction que les classes étaient impliquées elles aussi dans un tel affrontement, et la foi dans l’action politique radicale, qu’elle soit nationaliste ou classiste, comme moyen de changer le monde – une foi que, dans les dernières décennies du XIXème, la culture européenne semblait avoir finalement réussi à supprimer, au prix d’un effort surhumain. Le second conflit mondial a éliminé l’option nationaliste radicale de la liste des possibilités politiques et a achevé la transition du pouvoir mondial du Vieux Continent vers deux puissances extra-européennes. Il ne semble pas que le Covid-19 sous-tende de tels changements.
Le rythme de l’histoire est souvent plus important que la direction dans laquelle on se déplace.
Giovanni Orsina
Mais si cela est vrai, alors pourquoi tant de gens croient-ils que la pandémie représente une avancée historique majeure ? La première réponse, et la plus simple, est que c’est peut-être moi qui n’ai pas du tout compris. Ce n’est pas impossible : « Celui qui se souvient qu’il a été trompé tant de fois dans son propre jugement », prévient Michel de Montaigne, « n’est-il pas un fou s’il ne s’en méfie pas maintenant ? » 10. Par ailleurs, certaines ou toutes les hypothèses suivantes pourraient être vraies. Nous sommes, tout d’abord, immergés dans une sphère communicative sur-stimulée qui tend non seulement à dramatiser tout phénomène ou événement, mais aussi à intensifier la dramatisation. Depuis des mois, on ne parle que du Covid : il est évident que le virus est apparu comme un proche parent des quatre cavaliers de l’Apocalypse. D’autre part, nous étions tous confinés, et cela ne s’était jamais produit auparavant. Il est alors trop facile d’extrapoler du court terme au long terme, c’est-à-dire d’imaginer qu’un événement aussi extraordinaire est inévitablement destiné à avoir des conséquences tout aussi macroscopiques. Le fait intéressant, cependant, est que selon cette hypothèse, le véritable impact culturel n’aurait pas tant été un événement naturel comme la pandémie, mais un événement artificiel, c’est-à-dire politique et inutile (on se souvient de l’exemple suédois), comme le confinement. Troisièmement, pour les faiseurs d’opinions – intellectuels, universitaires, chercheurs, journalistes et gens cultivés – le Covid-19 a représenté une opportunité commerciale non négligeable en matière éditoriale et de communication. Il n’est pas facile de vendre un livre sur la pandémie si la quatrième de couverture dit qu’en définitive la pandémie n’est pas si importante. Si l’objectif n’est pas d’éclairer les homines sapientes mais de les mobiliser, alors la dramatisation devient indispensable. Les humains se convertissent lorsque la fin du monde est proche, certainement pas lorsqu’ils n’ont qu’un pneu crevé.
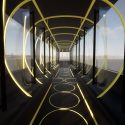
La pandémie bénie ne serait donc qu’une ondulation de l’histoire ? Mon article peut-il se clore ainsi ? Non, bien sûr que non : entre les ondulations et les tsunamis, il y a de nombreuses vagues intermédiaires, et celle générée par Covid-19 n’est pas des moindres. Selon toute vraisemblance – sur ce point, je suis d’accord avec divers autres prophètes du monde post-pandémique 11 – la vague n’est pas tant destinée à générer de la nouveauté, mais bien davantage à accélérer les tendances déjà en cours. Ce qui n’est pas rien : le rythme de l’histoire est souvent plus important que la direction dans laquelle on se déplace. Quelles étaient donc les tendances dans le monde d’hier ?
Le monde d’hier
Ma thèse, plutôt banale, est la suivante : la saison pré-pandémique a été marquée par un conflit politique âpre sur la manière de maîtriser un monde que l’affaiblissement des frontières à tous les niveaux a rendu de moins en moins gouvernable. C’est donc à l’aune de ce conflit que nous devons mesurer les effets du Covid-19.
Les tiroirs d’Aristote et les miettes grecques
Les processus de liquéfaction des frontières dans la modernité tardive ont fait couler beaucoup d’encre. Cela me permet de rester fidèle à la stratégie de parcimonie académique que j’ai choisie pour cet article et de ne citer que l’essentiel. Contre les interprétations du vingtième siècle comme « siècle court » délimité de 1914 à 1989, en vogue à la fin des années 1990 12, le maître des historiens politiques Charles Maier a proposé un « vingtième siècle long » allant de 1870 aux années 1970. Selon lui, l’essentiel de ce centenaire a consisté précisément à structurer les territoires : en marquant et en faisant respecter les frontières politiques des États, certes, mais aussi en construisant des routes, des chemins de fer, des lignes télégraphiques et téléphoniques. En bref, le centenaire aurait consisté en une répartition de la surface de la planète suivant un plan plus ou moins rationnel (ou du moins légitimé comme tel), et évidemment dans le but d’exercer un pouvoir sur elle. Ce processus aurait connu une accélération historiquement déterminante dans les dernières décennies du XIXème siècle pour entrer ensuite en crise, environ un siècle plus tard 13.
Cette tension permanente et insoluble entre la nécessité de créer un ordre d’une part et l’insupportable exercice du pouvoir qui seul peut imposer cet ordre d’autre part était bien présente pour un enfant excentrique de la crise de la raison.
Giovanni orsina
L’ébranlement des frontières, comme je l’ai mentionné précédemment, est visible à plusieurs niveaux : ce ne sont pas seulement les lignes qui structuraient notre monde physique qui se sont estompées, ce sont également les lignes métaphoriques qui, sous la conduite de la raison moderniste, organisaient notre univers mental. La crise de la raison moderne n’est certainement pas l’histoire des cinquante dernières années, mais celle des cent cinquante dernières années 14. Mais le chemin par lequel cette crise est passée de philosophique à historique – elle est descendue de l’hyperuranion des penseurs et des avant-gardes culturelles jusqu’au commun des mortels, accélérant les processus entropiques qui caractérisent notre coexistence – a été accidenté et tout sauf linéaire. Il est par exemple intéressant de noter que dans la chronologie que je viens de citer, la fin du XIXème siècle représente un moment dans lequel, d’une part, commencent à s’estomper les frontières métaphoriques, tandis que, d’autre part, celles physiques se font plus définitives et contraignantes. Il est peu probable qu’il s’agisse d’une coïncidence aléatoire. Il est également intéressant – puisque nous réfléchissons aux conséquences historiques des catastrophes – que les deux conflits mondiaux aient eu, de ce point de vue, des effets diamétralement opposés. La Grande Guerre a, pour ainsi dire, extrait la crise des élégantes et oiseuses escarmouches dialectiques que, dans le calme du Davos d’avant-guerre, Lodovico Settembrini et Leo Naphta tissaient autour du jeune Hans Castorp, « l’élève de la vie » 15, et l’a littéralement fait entrer dans l’histoire. Au contraire, le carnage de 1939-1945 a reconstruit un ordre politique et intellectuel de telle sorte que, pour quelques décennies au moins, les deux mondes ont ignoré ce que, par exemple, Adorno et Horkheimer théorisaient entre-temps pour le tiers-monde 16. Ce qui caractérise l’ère de la fracture que nous vivons depuis les années 1970 17, et qui la rapproche à certains égards de l’entre-deux-guerres, pourrait donc être précisément la superposition des crises des deux types de frontières, frontières physiques et frontières mentales.
Nous ne connaissons que trop bien les effets négatifs, parfois catastrophiques, du travail historique de la subdivision de la surface terrestre. Au contraire, il n’est pas impossible de soutenir que la crise des frontières territoriales ait été déterminée ou du moins renforcée et accélérée par la prise de conscience croissante de ces effets négatifs et de leur caractère inacceptable. Nous savons également que le travail de discipline du tiers-monde n’est en rien innocent. Nous pourrions saluer le processus de dissolution des frontières comme une évolution ô combien positive, une contribution puissante à la liberté humaine. Cependant, il est également vrai que, comme l’a écrit Victor Davis Hanson, « Dans l’Histoire, les murs fonctionnent » 18. En bref, il est encore à prouver que le monde des idées et le monde sensible peuvent être gouvernés, en bien comme en mal, s’ils ne sont pas subdivisés et structurés d’une manière ou d’une autre. Ou, alternativement, qu’ils peuvent fonctionner de manière ordonnée et progressive en l’absence de toute forme de gouvernement.
Cette tension permanente et insoluble entre la nécessité de créer un ordre d’une part et l’insupportable exercice du pouvoir qui seul peut imposer cet ordre d’autre part était bien présente pour l’un des rejetons excentriques de la crise de la raison. « Opprimante sensation d’extranéité à la lecture d’Aristote », écrivait Elias Canetti en 1943. « Sa pensée est d’abord et avant tout la répartition. Il a un sens très développé des hiérarchies, de la place qui revient à chaque chose, des désignations de la parenté, et il introduit une sorte de système de classes dans tout ce qu’il traite… Il y a aujourd’hui des hommes qui sont incapables d’aborder un objet sans lui appliquer ses subdivisions ; et plus d’un croit que dans les boîtes et les tiroirs d’Aristote les choses paraissent plus claires, alors qu’en réalité elles n’y sont que plus mortes » 19. Cependant, la même année, il est également obligé d’écrire avec colère, en se référant à lui-même : « Tu vis donc comme un mendiant sur les miettes grecques ? Que dit ta fierté à ce sujet ? Si tu retrouves chez eux ce que tu as toi-même pensé, n’oublie jamais que cela, d’une manière ou d’une autre, a fait son chemin jusqu’à toi. C’est d’eux qu’il vient à toi. Ton esprit est à leur merci. Tu es un roseau dans le vent. Tu peux évoquer longuement les tempêtes des barbares : mais tu dois penser dans le vent clair, vivifiant, sain des Grecs » 20.
Mais fermons la parenthèse sur Canetti et ses frustrations helléniques et récapitulons brièvement la chronologie. Nous sommes partis de la seconde moitié du XIXème siècle en y voyant la saison où l’imposition des frontières physiques s’accélérait, tandis que celle des frontières mentales commençait à faiblir. Nous avons été témoins de la manière dont les deux processus sont entrés simultanément en crise entre les deux guerres, puis nous avons vu comment la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale les a portés pendant quelques décennies – appelées en France, et ce n’est pas un hasard, trente glorieuses – à diverger, pour enfin les faire converger à la fin des années 1970 : faire tomber les murs au-dessus du ciel, et en dessous. Ces processus bilatéraux de dissolution ont atteint leur point culminant au cours des « longues » années 1990 : la période de presque vingt ans qui s’ouvre le 9 novembre 1989 avec la démolition du Mur – pas métaphorique celui-là – de Berlin, a entamé une très lourde manœuvre d’atterrissage le 11 septembre 2001, et s’est finalement terminée en 2007 avec le début de la Grande Récession.
Le racloir et les sauterelles
L’historien anglais Tony Judt pensait qu’il s’agissait d’années dévorées par les sauterelles. « Dans les décennies à venir », écrivait-il en 2008, « nous regarderons, je pense, la demi-génération qui a séparé la chute du communisme en 1989-1991 de la catastrophique occupation américaine de l’Irak comme les années mangées par les sauterelles : une décennie et demie d’opportunités gâchées et d’incompétence politique des deux côtés de l’Atlantique. Avec trop de confiance et trop peu de réflexion, nous avons laissé le vingtième siècle derrière nous et nous nous sommes aventurés dans son successeur, emmitouflés dans des demi-vérités intéressées : le triomphe de l’Occident, la fin de l’Histoire, le moment unipolaire américain, la marche inéluctable de la mondialisation et du marché libre » 21. Nous ne pouvons pas savoir comment et à quel point les historiens futurs confirmeront le jugement sévère de Judt. Entre 1989 et 2007, par exemple, le pourcentage de la population mondiale qui vit avec moins de 1,9 dollar par jour est passé de 36,9 (sur 5,2 milliards d’humains) à 19,1 (sur 6,7 milliards) 22 : 36,9 moins 19,1 est égal à 17,8 % de 6,7 milliards d’être humains. C’est presque un milliard et deux cent millions de personnes. On devrait peut-être aussi leur demander ce qu’ils pensent des sauterelles.
L’hypothèse implicite est que le progrès prendra soin de lui tout seul, que les nœuds se dénoueront d’eux-mêmes.
Giovanni Orsina
D’autre part, les enquêtes timides, et totalement insuffisantes, que j’ai pu mener à propos de la culture des années 1990 – en matière de mondialisation, de société civile, de politique, de démocratie, d’identité – m’ont donné une image presque semblable à celle dessinée par Judt. En substance : la dissolution des frontières, à tous les niveaux, est présentée comme un phénomène largement positif et libérateur, et de toute façon inéluctable et irréversible. Les conséquences négatives de ce processus, actuelles et potentielles, sont reconnues, mais très rarement abordées en détail. L’hypothèse implicite est que le progrès se produira tout seul, que les nœuds se dénoueront d’eux-mêmes. De toute façon, la solution ne sera jamais d’essayer de ralentir le rythme du changement, mais toujours d’accélérer autant que possible, car c’est à la fin de l’arc-en-ciel que les lutins ont enterré le chaudron d’or. Si ce n’est un raisonnement de sauterelle – et de sauterelle bien intentionnée qui plus est – c’en est très proche. Dans les paragraphes qui suivent, je l’appellerai « néo-panglossisme ».
Non pas qu’il n’y ait pas de sceptiques bien-sûr. Il y en a toujours quelques-uns, heureusement. Le nom de Samuel Huntington est le premier qui vient à l’esprit, mais pour ne prendre qu’un seul exemple, du côté libéral, Ralf Dahrendorf est aussi très cité 23. Cependant, l’orientation générale est celle que j’ai décrite précédemment. Il suffit de penser au reste du destin du livre symbole des longues années 1990 – La fin de l’Histoire de Francis Fukuyama, évidemment –, dont la dernière partie, pas vraiment rassurante, fut rapidement expurgée de la mémoire collective en même temps que la seconde moitié du titre du volume (et le dernier homme), qui faisait référence à cette partie 24. Le néo-panglossisme, entre autres, était politiquement transversal, déclinant à gauche comme à droite. À droite, il a donné l’intégration mondiale des marchés et l’autonomie de l’économie par rapport au politique. À gauche, la fin des identités traditionnelles et territoriales, un embryon de droit mondial et le rêve d’un gouvernement planétaire. Plus généralement encore, cette orientation tendait donc à être antipolitique, puisqu’elle dissolvait les prémisses de la politique – identité, pouvoir, inimitiés – et niait que l’histoire ait besoin d’un gouvernement. Par conséquent, elle a rendu la droite et la gauche inutiles et les a empêchées de se distinguer l’une de l’autre. De fait, dans les années 1990, les forces politiques de droite et de gauche ont fini par converger au centre et par se ressembler de plus en plus 25.
Dans l’ensemble, l’impression est que nous sommes confrontés au même phénomène que j’ai mentionné dans le premier paragraphe : l’optimisme veut être une prophétie auto-réalisatrice, un outil de mobilisation des homines fabri. Et c’est ainsi : la société ouverte est dans une large mesure une prophétie auto-réalisatrice, un mécanisme qui fonctionne tant que ceux qui en font partie sont convaincus qu’il peut fonctionner. À condition toutefois de ne pas franchir une certaine limite, celle au-delà de laquelle, pour mobiliser les homines fabri, on les réduit à être des homines insipientes. Je crains que, dans les longues années 90, cette limite n’ait été franchie un peu trop souvent. Ce que qu’Eugenio Montale a diagnostiqué plus de vingt ans auparavant, avec la prescience du poète, s’est produit :
Credi che il pessimismo
sia davvero esistito ? Se mi guardo
d’attorno non ne è traccia.
Dentro di noi, poi, non una voce
che si lagni. Se piango è un controcanto
per arricchire il grande
paese di cuccagna ch’è il domani.
Abbiamo ben grattato col raschino
ogni eruzione di pensiero. Ora
tutti i colori esaltano la nostra tavolozza,
escluso il nero. 26
Ces homines fabri bénis, d’autre part, vont être mobilisés avec un certain flair, si nous voulons garantir que le monde reste ordonné et progressif même si ses frontières disparaissent. Comme les instruments qui les disciplinent de l’extérieur sont de plus en plus rares, la discipline devra alors être portée de l’intérieur. Le néo-panglossisme des longues années 1990, tel que nous l’avons décrit précédemment, visait à atteindre cet objectif en trois mouvements, le premier et le troisième descriptifs, le second prescriptif. L’effort descriptif initial lisait l’histoire comme une nécessité : il n’y a pas de retour en arrière, le changement est inévitable. La prescription qui en a dérivé consistait en ce que l’unique réponse raisonnable et admissible au changement était de s’y adapter voire de l’accélérer autant que possible afin d’en minimiser les conséquences négatives. La description finale était que si les humains suivaient docilement cette seule stratégie raisonnable et acceptable, tout irait bien.
L’effort descriptif initial lisait l’histoire comme une nécessité : il n’y a pas de retour en arrière, le changement est inévitable.
Giovanni orsina
C’était un appareil plutôt fragile, de fait. La composante descriptive était déguisée en science, mais elle n’était que partiellement scientifique, conditionnée qu’elle était par des arrière-pensées politiques et une généreuse dose de wishful thinking. Le prescriptif ne pouvait que souffrir de la faiblesse de ses fondements descriptifs. Elle n’aurait pas non plus pu trouver d’autres fondements, étant donné que le postulat de départ était que les frontières avaient disparu, et que c’était une bonne chose. Elle n’a donc pas tant réussi à fonder des principes éthiques solides et robustes qu’à générer une sorte de moralisme diffus : des règles de comportement et de pensée fondées sur la force des institutions sociales et culturelles qui les ont promues plutôt que sur leurs vertus intrinsèques. En outre, le poids de la superstructure prescriptive a encore affaibli la structure descriptive : d’une part, il l’a rendue encore moins scientifique, d’autre part – au contraire – il a ajouté une généreuse dose de scientisme au moralisme.
En conclusion, le néo-panglossisme a fini par faire reposer toute la charge, à crédit, sur l’accomplissement de la prophétie finale : tout ira bien. En espérant qu’elle soit correcte, les humains s’adapteraient au climat moraliste – et s’ils s’adaptaient, la prophétie se réaliserait. Alors tout reprendrait du sens, toutes les tensions seraient résolues et la machine aurait finalement atteint son accomplissement : la science s’avérerait être la vraie science, car elle aurait bien prévu ; la morale s’avérerait être la morale juste, car elle aurait bien guidé. Oui. Mais que se serait-il passé à l’inverse si les choses avaient mal tourné et si les humains avaient commencé à douter du climat moral et de l’opportunité de s’y adapter ? Et si, par conséquent, la situation s’était encore aggravée que les doutes avaient augmenté ? En bref : si le cercle vertueux d’une prophétie qui se vérifie elle-même s’était transformé en cercle vicieux d’une prophétie qui se falsifie elle-même ?
Néo-panglossiens et souverainistes
Au tournant du siècle, en effet, les choses ont commencé à aller plutôt mal 27. La guerre contre le terrorisme de George W. Bush peut aussi être lue comme une tentative de mettre sous contrôle des processus historiques dont la gouvernabilité n’était plus garantie par des automatismes progressifs lubrifiés par l’optimisme. Ce n’est pas un hasard si Bush a souvent été comparé à Woodrow Wilson 28 : non seulement ils ont tous deux imaginé pouvoir universaliser les valeurs fondatrices des États-Unis, mais ils ont également tous deux tenté de reconstruire un ordre après la fin d’une longue saison de progressisme optimiste. Même si – je le répète – il ne semble pas que la Grande Guerre et la guerre contre le terrorisme soient comparables en termes d’impact historique. Surfant sur la vague émotionnelle générée par le 11 septembre et s’appuyant sur la réapparition d’un ennemi, Bush a essentiellement proposé de rétablir au moins une frontière claire entre le bien (les valeurs occidentales) et le mal (les anti-valeurs de l’islam radical), et c’est sur cette frontière qu’il a déployé la superpuissance américaine. La portée universaliste et globale du projet néoconservateur, le fait qu’il n’ait pas du tout représenté un retour pur et simple au conservatisme classique et son insistance sur la valeur inéluctable de la contingence, montrent à quel point la transformation culturelle qui a culminé dans les longues années 1990 était profonde. D’une certaine manière, il donne raison aux théoriciens de la mondialisation, convaincus que la disparition des frontières géographiques était inéluctable et irréversible. Ou, du moins, il témoigne de leur efficacité à convaincre tout le monde qu’elle l’était.
Le cercle vertueux s’est visiblement transformé en cercle vicieux, les remises en question politiques et le wishful thinking qui guidaient les sciences sociales se sont faits plus évidents
giovanni orsina
Non seulement le plan de Bush a échoué, mais avec le début de la Grande Récession, les longues et optimistes années 1990 arrivèrent véritablement à leur fin. Le cercle vertueux s’est visiblement transformé en cercle vicieux, les remises en question politiques et le wishful thinking qui guidaient les sciences sociales se sont faits plus évidents, le moralisme diffus n’a pas réussi à se solidifier en éthique. Et, naturellement, les protestations se sont multipliées. Bien sûr, elles avaient des racines économiques et sociales : manifestaient surtout ceux qui commençaient à voir, au quotidien, que tout n’allait pas bien. Ou qui, même s’ils parvenaient à résister, craignaient que leur état et celui de leurs enfants n’empire 29. Mais ce n’est pas seulement une question de porte-monnaie. Il existe également une irritation profonde et instinctive à l’égard des apprentis sorciers : ceux qui ont célébré la dissolution des frontières, voire l’ont accélérée, en croyant présomptueusement et à tort qu’ils pouvaient garder la situation sous contrôle. Il y a aussi une impatience croissante face aux exigences disciplinaires d’un moralisme généralisé. Celui-ci – le moralisme – réagit souvent en accusant les contestataires d’irrationalité. D’agir « avec les tripes ». Comme nous l’avons vu, cependant, ses fondements rationnels ne sont pas très solides, et ils ont été encore affaiblis lorsque sa prophétie optimiste ne s’est pas réalisée. En outre, lorsque les tripes rejoignent le porte-monnaie, l’accusation d’irrationalité devient encore plus faible.
Faute de mieux, la contestation a été baptisée « populisme », et la deuxième décennie du XXIe siècle a donc été la décennie populiste. Les partis mainstream, comme nous l’avons déjà noté, étaient trop profondément immergés dans le néo-panglossisme pour pouvoir affronter la rage croissante. Cette rage a alimenté soit des partis excentriques préexistants, suffisamment souples pour s’adapter rapidement aux nouvelles circonstances, soit des forces politiques entièrement nouvelles. Comme toute bonne rébellion plébéienne, même le soulèvement populiste ne pouvait qu’être plus désordonné que jamais. Les révoltés – si nous voulons rester sur Montale, les ennoblissant ainsi bien au-delà de leurs mérites – ne pouvaient dire que cela : ce qu’ils n’étaient pas, ce qu’ils ne voulaient pas. Et quand de la pars destruens ils sont passés à la pars construens, ce qui en est sorti était une mixture indigeste. Certaines des forces soi-disant populistes se sont situées à gauche et ont principalement attaqué les processus d’intégration des marchés mondiaux et la subordination conséquente de la politique à l’économie. D’autres, se situant à droite, ont attaqué le cosmopolitisme culturel, les formes supranationales de gouvernance et la perte de souveraineté des États. Le Mouvement 5 étoiles est unique en ce qu’il a réussi à transcender presque totalement le clivage droite-gauche en imaginant – dans son incarnation la plus aboutie intellectuellement, celle de Gianroberto Casaleggio – une pars construens non pas de fond mais de méthode : la démocratie directe par voie télématique 30.
Avec le temps, de plusieurs manières, la révolte populiste s’est concentrée davantage à droite, autour du soi-disant souverainisme : inversion du processus de mondialisation et regain de pouvoir de la part des États-nations. Une issue plutôt naturelle, il me semble : l’utopie de Casaleggio, jusqu’à preuve du contraire, est destinée à rester telle quelle ; le populisme de gauche, s’il veut ramener l’économie sous le contrôle de la politique, doit de toute façon passer d’abord par le renforcement des États ; et les États-nations, même très affaiblis, restent des sujets politiques d’importance majeure, dont les racines historiques et culturelles ne se sont pas encore complètement taries. D’ailleurs, l’État est encore le dernier lieu au sein duquel s’est développée la démocratie jusqu’à aujourd’hui : un fait trop souvent négligé, et qui constitue probablement la plus grave lacune du néo-panglossisme 31.
Tout en représentant la forme la plus solide de populisme, de plusieurs manières, le souverainisme est cependant rendu structurellement fragile par une série de tares internes. Relancer l’identité nationale après un demi-siècle de dépérissement des frontières politiques et un siècle et demi de dépérissement de celles intellectuelles est une opération tout sauf aisée. Inverser la mondialisation serait, aussi, tout sauf indolore. On parle vite de démondialisation, mais : pour quelles raisons ? Et jusqu’à quel point ? La politique entre autres, si ce n’est la démocratie, s’est largement déplacée vers le niveau supranational. Les souverainistes du monde entier ont du mal à se coordonner, à cause d’une contradiction plus qu’évidente – comme on le voit si bien dans l’Union Européenne. En outre, le Vieux Continent est peuplé d’États-nations de petites et moyennes dimensions qui ne sont guère en mesure de s’affirmer à l’échelle mondiale.
La flèche causale est inversée : nés parce que tout n’allait pas bien du tout, les populistes deviennent coupables du fait que tout ne va pas bien du tout.
giovanni orsina
Mais l’élément le plus fragile du souverainisme réside avec beaucoup de probabilités dans son développement culturel. Pour résumer : comme le démontre bien le débat sur le monde post-pandémie dont nous sommes inspirés, la culture est restée très majoritairement néo-panglossienne ou crypto-néo-panglossienne même après la fin des longues années 1990. Cela me semble également être un résultat tout à fait naturel : contrainte par la logique de la prophétie auto-réalisatrice, cette culture peut espérer que, si elle insiste sur sa prophétie en dépit de tous les démentis, si elle parvient à persuader les humains du caractère contingent et temporaire des difficultés, le cercle vertueux se remettra tôt ou tard à tourner. Le néo-panglossisme, en outre, n’a pas de plan B. L’avènement du populisme lui a enfin fourni un bouc émissaire parfait. En effet, celui qui nie une prophétie auto-réalisatrice est nécessairement coresponsable de sa non-réalisation. La flèche causale est inversée : nés parce que tout n’allait pas bien du tout, les populistes deviennent coupables du fait que tout ne va pas bien du tout. Le néo-panglossisme a enfin trouvé une frontière et un ennemi : tous sont légitimés et accueillis, toutes les identités, opinions, choix sont autorisés – à l’exception du populisme. Tous les péchés sont pardonnés, sauf le pessimisme.

La nécessité de défendre la démocratie libérale est invoquée pour justifier l’érection de ce mur par les négateurs des murs, cette déclaration d’intolérance prononcée par les omnitolérants. Mais c’est un appel spécieux. Aussi déséquilibrés et désagréables qu’ils puissent être, les populistes ne sont pas incompatibles avec les valeurs fondatrices des démocraties libérales. En effet, nous pourrions découvrir, d’ici quelque temps, qu’une des différences entre la crise actuelle et celle des années 1930 est précisément l’absence substantielle de forces politiques radicalement anti-démocratiques et anti-libérales en Occident. Les populistes sont beaucoup trop démocratiques : ils ne font rien d’autre qu’en appeler à la volonté du peuple. Et certes, bien sûr, la volonté du peuple n’est pas une condition suffisante pour générer une démocratie. Mais à force de répéter ce mantra anti-populiste, nous oublions trop souvent de rappeler que, si elle n’est pas suffisante, elle est certainement nécessaire.
Quant au libéralisme, il me semble que la question soit un peu plus compliquée. Si l’urgence d’aujourd’hui est de maîtriser un monde de plus en plus ingouvernable, alors c’est le Zeitgeist dans son ensemble qui est manifestement illibéral. Les populations de confessions souverainistes réagissent à ce climat historique en proposant d’actionner le vieux levier de l’État-nation. Ce n’est pas en soi un levier libéral ; il peut certainement être compatible avec la survie d’une démocratie libérale si l’on n’en abuse pas ; mais si l’on en abuse, on glissera facilement vers un régime autoritaire. Les souverains poussent donc dans une direction illibérale, sur une route où il y a un risque autoritaire.
Et au bout de leur route se trouve non pas un risque autoritaire, mais un risque totalitaire.
giovanni orsina
Même les néo-panglossiens réagissent au Zeitgeist illibéral, même le néo-panglossisme, comme nous l’avons vu, veut re-discipliner les humains. L’instrument de discipline est le moralisme diffus soutenu par les interprétations semi-scientifiques du développement historique et de l’optimisme progressiste. En revanche, la séparation entre la morale et la politique – ou du moins la minimisation de l’intersection entre les deux – représente une des acquisitions fondamentales du libéralisme. Même les néo-panglossiens, en somme, tout en promouvant l’émancipation individuelle universelle, poussent en fait dans une direction illibérale. Et au bout de leur route se trouve non pas un risque autoritaire, mais un risque totalitaire.
Cela a pris du temps, mais nous y sommes finalement arrivés : voici les termes du conflit politique actuel sur la manière de maîtriser de nouveau le monde. Dans les longues années 1990, les partis de droite et de gauche ont accepté le consensus néo-panglossien. Avec la crise de ce consensus, se sont développées des forces politiques nouvelles ou renouvelées, d’abord diversement situées sur l’axe gauche-droite, mais avec le temps de plus en plus clairement à droite. La dialectique politique a donc repris de la vigueur, mais dans une profondément différente de celle du passé. Et surtout, sous une forme dangereusement dysfonctionnelle. Il est dangereux que la culture soit toute d’un côté. Il est dangereux que les deux positions politiques soient ancrées dans des environnements géographiques et sociaux de plus en plus éloignés l’un de l’autre et de plus en plus imperméables aux raisons de l’autre. La colère des populistes, leur propension au rejet a priori, au complot et à la protestation, leur fuite de la raison, leur incapacité à proposer des alternatives réalistes sont autant de dangers. Ce qui est dangereux, c’est le refus du néo-panglossisme de sortir de sa bulle sociale et intellectuelle, son moralisme, son empressement à délégitimer toute personne dissidente. Le niveau croissant de polarisation est dangereux. Tout cela, enfin, est d’autant plus dangereux que le conflit se déroule, pour reprendre une expression que le grand historien néerlandais Johan Huizinga employait dans les années 30, dans un gigantesque « nuage de sophismes » 32. Inévitablement, pourrait-on dire, car le nuage est le résultat du manque d’ordre, et le conflit politique porte sur la manière de rétablir cet ordre.
Et à la fin, vient le Covid
Vous vous souvenez peut-être de la « symphonie post-Covid » que j’ai présentée dans le paragraphe d’introduction, en critiquant son premier mouvement. Et bien : le moment est venu d’aborder ses trois derniers mouvements. Tout ce que j’ai dit plus haut était propédeutique à l’achèvement de ce travail de déconstruction.
Le second mouvement (« La pandémie est pleine de contradictions, le monde qui l’accueille est plus contradictoire encore, et il est donc impossible de prophétiser la manière dont ces antinomies interagiront entre elles et dans quelle direction cela nous mènera ») est en lui-même dissonant. Il n’y a pas beaucoup à déconstruire, il y a plutôt à mettre de l’ordre en suivant le schéma dichotomique que nous avons vu dans les paragraphes précédents. À la lumière de ce schéma, la dissonance consiste précisément dans le fait que la pandémie pousse en même temps dans les deux directions opposées du néo-panglossisme et du souverainisme. La question est rendue encore plus complexe par le fait que non seulement l’événement pandémique dans son ensemble, mais souvent aussi ses composants individuels présentent un profil à double face 33.
L’Épiphanie du Covid-19 a certainement ramené la science au centre du débat public, et avec elle la valeur des experts et de leur expertise – un point pour le néo-panglossisme. Mais en même temps, sous la lumière crue des projecteurs, les spectateurs ont pu constater une fois de plus combien la connaissance scientifique est incertaine et provisoire, et par conséquent combien elle s’avère fragile lorsqu’on lui demande de remplir une fonction sociale « objectivante ». N’ont pas aidé bien sûr, du moins en Italie, l’ubiquité narcissique et la loquacité des épidémiologistes et des virologistes, qui se promènent plus nonchalants que jamais parmi les cristaux de la philosophie, du droit et de l’économie avec les mêmes pattes d’éléphant improbables avec lesquelles les philosophes, les juristes et les économistes se déplacent parmi les porcelaines fragiles de la virologie et de l’épidémiologie. Le débat scientifique sur le coronavirus n’a en rien dissipé le nuage de sophismes, en somme, mais a au contraire contribué à le rendre encore plus épais (un point pour le souverainisme). C’est la technologie qui a apporté le plus de clarté (comme toujours) : en prouvant leur efficacité, les vaccins ont au moins permis d’éclaircir un peu le nuage – ce qui donne un demi-point de plus au néo-panglossisme, qui passe ainsi à un et demi.
Mais en soi, la pandémie a montré jusqu’à quel point l’intégration globale de l’humanité pourrait être une source de dangers
giovanni orsina
La collaboration scientifique et technologique a révélé comment, si elle est intégrée au niveau mondial, l’humanité peut contrôler l’environnement de manière beaucoup plus efficace (le néo-panglossisme passe à deux points et demi). Mais en soi, la pandémie a montré jusqu’à quel point l’intégration globale de l’humanité pourrait être une source de dangers (un point en plus aux souverainistes : deux au total). L’affaire des vaccins a fait voir comment, si la science est globale, la technologie est néanmoins restée locale, peut être distribuée de manière sélective et mise au service d’intérêts économiques et politiques spécifiques (un autre point pour le souverainisme). Enfin, l’État-nation – avec ses frontières, ces racines culturelles et communautaires, sa force (y compris militaire), ses lois, ses richesses – a démontré être encore un instrument indispensable pour l’accaparement des ressources et la défense des menaces venues de l’extérieur (encore un point : le souverainisme s’arrête à quatre). En Europe, mais pas ailleurs, la prévalence de la logique communautaire dans l’acquisition des vaccins et le lancement du plan de relance contrebalance ce dernier élément, portant le néo-panglossisme à au moins trois points.
Le quatrième point pour le néo-panglossisme – qui au moins sur le Vieux Continent, revient au score en égalisant – consiste en ce que la pandémie a renforcé le moralisme dans une large mesure. Et un moralisme, de surcroît, entièrement fondé sur la science et légitimé par elle. En d’autres termes, à partir des indications de la recherche médicale, objectivées en rabotant ses nombreuses incertitudes et contradictions naturelles, une forte pression sociale a été générée pour bien se comporter : porter un masque, respecter la distanciation sociale, se confiner, se faire vacciner. La différence principale avec le néo-panglossisme « classique » que j’ai essayé de décrire précédemment réside dans le fait que le moralisme, dans ce cas, était plus souvent préparatoire qu’alternatif à l’introduction de normes formelles contraignantes. En somme, ce n’est pas la science et le moralisme au lieu du droit mais la science et le moralisme plus le droit. Ce n’est pas très rassurant pour ceux qui ne sont pas d’accord avec les solutions souverainistes et refusent en même temps d’être enfermés dans la logique néo-panglossienne. D’autant plus que, avant même que le Covid-19 n’ait déraillé, on pouvait déjà entrevoir le moralisme scientifique se préparer à sa prochaine bataille : le changement climatique.
Le triptyque science-moralisme-loi ne pouvait que se révéler indigeste aux partis de l’opinion publique qui ont animé l’insurrection populaire de la dernière décennie, et qui la représente politiquement. Il est surprenant que les authentiques « réticents au Covid » aient été très peu nombreux, et que l’immense majorité de la population, non sans grommeler, ait accepté de se soumettre à la discipline morale et légale. Cela montre que le virus a été perçu comme une menace tellement sérieuse que sa lutte a été en partie dépolitisée. Et cela malgré les tentatives incessantes et imprudentes de la politiser, d’un côté comme de l’autre.
Le temps additionnel du post-Covid ne devrait pas rompre l’équilibre que les souverainistes et les néo-panglossiens ont atteint dans le temps réglementaire. Les paramètres principaux dans ce cas me semblent être au nombre de deux : la numérisation et la dette publique. Avec la pandémie, c’est évident, l’impact du numérique a augmenté démesurément dans tous les domaines de la vie : divertissement, travail, relations sociales, consommation. Même dans ce cas, on parle de l’accélération ultérieure d’une tendance préexistante, et même si toutes les nouveautés portées par le virus ne resteront pas, il ne faut pas croire que la fin de la pandémie nous ramènera à 2019. Maintenant, c’est en soi le processus de dé-territorialisation intrinsèque à celui numérique qui alimente la thèse néo-panglossienne de fond, qui sortira donc confirmée et renforcée de la pandémie : la déconstruction des frontières est irréversible, et ses conséquences négatives ne pourront être affrontées en freinant, et encore moins en reculant – mais au contraire en accélérant encore le rythme de l’histoire. Cependant, pendant que nous attendons avec confiance que le meilleur des mondes possibles se gère tout seul, plus la numérisation presse l’œuvre de dé-territorialisation, plus ces conséquences négatives, qu’elles soient sociales ou culturelles, s’aggraveront. Confirmant et renforçant la thèse du populisme souverainiste.
Pendant que nous attendons avec confiance que le meilleur des mondes possibles se gère tout seul, plus la numérisation presse l’œuvre de dé-territorialisation, plus ces conséquences négatives, qu’elles soient sociales ou culturelles, s’aggraveront. Confirmant et renforçant la thèse du populisme souverainiste.
giovanni orsina
Les États se sont principalement occupés d’atténuer les effets économiques dévastateurs des confinements. Démontrant ainsi qu’ils avaient encore un rôle clef à jouer. En s’occupant de cette tâche, les États ont cependant augmenté dans des mesures considérables leur taux d’endettement, et il est bien possible (dans le cas de l’Italie, cela est même certain) que l’endettement soit destiné dans les années à venir à entraver la liberté d’action, surtout dans le cas des pays les plus fragiles et marginaux. En somme, dans ce cas aussi le mouvement est double, et pointe dans deux directions opposées. Sur le Vieux Continent, le double mouvement sera évidemment conditionné d’une manière déterminante par le comportement de l’Union européenne. La question est complexe et il ne me paraît pas être nécessaire de l’affronter ici. Je me limite à souligner qu’il existe une certaine tendance historique des pays européens à toujours faire le minimum d’efforts nécessaires face aux crises, pour que l’Union survive. À y regarder de plus près, même le plan de relance, souvent présenté comme une grande avancée, atteint à peine le sommet de l’impact économique de la pandémie. Voici : j’ai l’impression que dans les prochaines années, le problème de la dette sera destiné à mettre à l’épreuve cette stratégie du « minimum syndical ».
On se souvient que les troisième et quatrième mouvements de la symphonie post-Covid comprenaient trois passages : la préfiguration de la catastrophe imminente ; la proposition de conversion universelle ; et enfin, subordonnée à la conversion, le salut. Trois passages qui distinguent encore une fois le néo-panglossisme actuel de celui « classique » des années 1990 et le rendent beaucoup plus sombre, le transformant en une sorte de – pour ainsi dire – catastrophisme sotériologique. Nous avons déjà parlé de la catastrophe en abondance : la pandémie représente sans aucun doute un événement historique d’importance majeure, mais elle n’est pas nécessairement destinée à entrer dans l’histoire comme une rupture radicale. Si elle est soulignée, c’est aussi pour rendre l’appel à la conversion d’autant plus urgent et convaincant. Mais à quoi devrions-nous nous convertir en fin de compte ? Aux valeurs du néo-panglossisme, cela va sans dire : soit la pandémie, en rééduquant les humains, pourra relancer le cercle vertueux de la prophétie auto-réalisatrice, soit nous plongerons tous dans les affres de l’incivilité.
Du point de vue que j’ai donné dans ce texte, cependant, la question est assez intéressante. Selon moi, le risque principal est que la pandémie radicalise et polarise ultérieurement le conflit politique entre néo-panglossiens et souverainistes, rendant impossible le vivre-ensemble. Que l’accélération de la transformation numérique érode les frontières géographiques et gonfle également le nuage de sophismes, accroisse les tensions économiques générées par l’évolution des marchés et des technologies de production et de distribution. Que les problèmes générés par la gestion des dettes souveraines rendent les opinions publiques nationales encore plus intolérantes aux contraintes imposées par la finance mondiale. Que l’ambiguïté de la pandémie cristallise l’incommunicabilité et l’hostilité culturelle entre néo-panglossiens des grands centres urbains et les hostiles à ceux-ci, parfois souverainistes, des milles périphéries du monde.

Si tel est le risque, alors quiconque souligne l’impact de la pandémie en fait une lecture unilatérale et prétend en déduire la nécessité de poursuivre des solutions unilatérales, non seulement ne fera pas partie de la solution mais, au contraire, fera partie du problème. Le néo-panglossisme est né comme une idéologie d’harmonie et de paix, et il y a vingt ans, à l’exception de franges marginales, il l’était. Nous ne pourrons jamais savoir les effets qu’aurait eu le Covid-19 s’il était arrivé avant le 11 septembre, ou entre le 11 septembre et la Grande Récession. Nous savons pourtant que le Covid-19 se déroule aujourd’hui, et actuellement le néo-panglossisme, rejeté par une partie de l’opinion publique, qui a désespérément besoin d’un bouc émissaire pour se maintenir en vie, est une idéologie qui divise.
Nous ne pourrons jamais savoir les effets qu’aurait eu le Covid-19 s’il était arrivé avant le 11 septembre, ou entre le 11 septembre et la Grande Récession.
giovanni orsina
On peut voir à quel point il est divisé, pour ne prendre qu’un exemple, dans l’homélie que Yuval Noah Harari a publiée dans le Financial Times à l’aube de la pandémie, en mars 2020, et qui représente une pure distillation du néo-panglossisme 34. « L’humanité doit faire un choix », prévient l’historien à la fin de son article. « Allons-nous emprunter la voie de la désunion, ou adopterons-nous le chemin de la solidarité mondiale ? Si nous choisissons la désunion, cela ne fera pas que prolonger la crise, mais entraînera probablement des catastrophes encore plus graves à l’avenir. Si nous choisissons la solidarité mondiale, ce sera une victoire non seulement contre le coronavirus, mais contre toute future pandémie et crises futures qui pourraient assaillir l’humanité au cours du XXIe siècle. » En apparence, un vibrant appel à l’unité. En réalité, il s’agit d’un puissant exercice de délégitimation : Harari identifie en fait comme adversaire principal de la solidarité globale un monsieur aux cheveux jaunes, qui sept mois après la parution de son article, a obtenu 74 216 154 voix aux élections présidentielles américaines.
On peut supposer que le Financial Times ne vend pas beaucoup de tirages parmi ces plus de 74 millions de personnes. En soi, il s’agit là d’un problème pour le néo-panglossisme : pour qu’elle se réalise, la prophétie doit avoir un grand écho et pas seulement pour quelques milliers de lecteurs. Le problème est d’autant plus grand qu’il est certainement mieux que ces 74 millions de personnes ne lisent pas le Financial Times, ils s’irriteraient et se rétracteraient davantage. En d’autres termes, ils considéreraient des articles comme celui de Harari comme des sermons moralisateurs pétulants, prononcés le petit doigt en l’air, visant à protéger et à perpétuer un ordre dans lequel ils se sentent pénalisés et non reconnus.
Du point de vue de ce que j’ai présenté dans cet article et pour conclure, le catastrophisme sotériologique, cette concoction hystérique indigeste de prévisions apocalyptiques, de prêches moralisateurs et d’optimisme obtus que les médias nous ont si souvent servie au cours des dix-huit derniers mois, n’est en aucun cas la solution pour sortir de la pandémie vers un monde plus intégré, pacifique et coopératif. Au contraire, il risque d’accélérer et de radicaliser le processus de polarisation politique et sociale qui a débuté au cours de la dernière décennie, avec des conséquences potentiellement très dangereuses. La prise de conscience que cette polarisation doit être affrontée sur le terrain de l’économie semble avoir enfin pris forme, du moins en paroles. En revanche, la conscience que cette polarisation doit également être combattue dans le domaine culturel semble encore totalement absente. Et puisque, comme on l’a dit, le souverainisme ne fréquente pas vraiment ce terrain, c’est surtout sur le néo-panglossisme que retombe la charge de se repenser, de se réajuster à la saison historique, d’essayer au moins de rétablir un canal de communication avec l’insurrection populaire. Pour la culture aussi tient toujours, en définitive, la considération selon laquelle « de l’autre côté de la désertion des masses » il ne peut y avoir que « la désertion des minorités dirigeantes » 35.
Sources
- Ce texte est la traduction inédite d’une contribution de Giovanni Orsina dans l’ouvrage à paraître : Alfonso Dell’Erario, Sebastiano Maffettone (a cura di), Next Normal. Rilanciare l’Italia nel mondo post-pandemico, Luiss University Press, Roma, 2022.
- Gianfranco Pasquino, semble lui aussi avoir eu une impression semblable à la mienne : « Alors que je continue à voir circuler des hypothèses allant du banal au farfelu, je réalise en même temps que cette pandémie a mis à l’épreuve la capacité des sciences sociales. » (G. Pasquino, Dopo. Quel che verrà come verrà, « Paradoxa », XV, 2, aprile-giugno 2021, pp. 11-24, p. 12).
- M.P. Maduro, P.W. Kahn, Introduction : A New Beginning, in Iid. (a cura di), Democracy in Times of Pandemic. Different Futures Imagined, Cambridge University Press, Cambridge 2020, pp. 1-18, p. 18.
- C. Miłosz, La mente prigioniera, Adelphi, Milano 1981, pp. 36.
- Cfr. la voix quelque peu isolée de S. Moyn, The Irrelevance of the Pandemic, in M.P. Maduro, P.W. Kahn (a cura di), op. cit., pp. 104-114.
- https://www.worldometers.info/coronavirus/. Consulté le 29/09/2021.
- https://www.britannica.com/event/World-War-I/Killed-wounded-and-missing. Consulté le 29/09/2021.
- https://www.britannica.com/event/World-War-II/Human-and-material-cost. Consulté le 29/09/2021.
- https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/#box_8b. Consulté le 29/09/2021.
- M. de Montaigne, Saggi, Giunti/Bompiani, Firenze/Milano 2017, p. 1205
- Cfr. par exemple I. Krastev, Is It Tomorrow Yet ? Paradoxes of the Pandemic, Penguin books, Londra 2020 ; F. Zakaria, Ten Lessons for a Post-Pandemic World, W.W. Norton, New York 2020.
- Cfr. par exemple I. Krastev, Is It Tomorrow Yet ? Paradoxes of the Pandemic, Penguin books, Londra 2020 ; F. Zakaria, Ten Lessons for a Post-Pandemic World, W.W. Norton, New York 2020.
- Cfr. C.S. Maier, Consigning the Twentieth Century to History : Alternative Narratives for the Modern Era, « The American Historical Review », 105, 3, giugno 2000, pp. 807-831 ; id., Leviathan 2.0. Inventing Modern Statehood, Belknap, Cambridge MA e Londra, 2012 ; id., Once Within Borders. Territories of Power, Wealth, and Belonging Since 1500, Belknap, Cambridge MA e Londra, 2016.
- J.W. Burrow, The Crisis of Reason. European Thought, 1848-1914, Yale University Press, New Haven e Londra 2000.
- Thomas Mann, La montagna incantata, Corbaccio, Milano 1992, p. 380.
- Je fais évidemment référence à Th. Adorno, M. Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, 1947.
- Cfr. D.T. Rodgers, Age of Fracture, Belknap Press, Cambridge MA 2011 ; M. Gauchet, L’avènement de la démocratie, vol. IV, Le nouveau monde, Gallimard, Parigi 2017.
- V.D. Hanson, The Case for Trump, Basic Books, New York 2019, p. 15.
- E. Canetti, La provincia dell’uomo, Adelphi, Milano 1978, pp. 51-52.
- Ibid, p. 58.
- T. Judt, Reappraisals. Reflections on the Forgotten Twentieth Century, Penguin Press, New York 2008, pp. 1-2.
- https://data.worldbank.org/topic/11?end=2018&start=1989. Visitato il 29/09/2021.
- S.P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon&Schuster, New York 1996 ; di R. Dahrendorf cfr. par exemple After 1989. Morals, Revolution and Civil Society, St. Martin’s Press, New York 1997. Pour une reconstruction anthologique du débat sur la mondialisation qui donne une large place aux sceptiques et aux néo-panglossiens, voir D. Held, A. McGraw (a cura di), The Global Transformations Reader. An Introduction to the Globalization Debate, Polity Press, Cambridge 2003.
- F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, Free Press, New York 1992.
- Cfr. O. Knutsen, Expert Judgements of the Left-Right Location of Political Parties. A Comparative Longitudinal Study, in « West European Politics », 1998/2, pp. 63-94 ; G. Orsina, Destra e sinistra, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Decima appendice, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2020, vol. I, pp. 397-401. Per l’antipolitica, Id., La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’antipolitica, Marsilio, Venezia 2018.
- Eugenio Montale, Il raschino (1968), in Id., Satura, Mondadori, Milano 2009, pp. 95-96. Pensez-vous que le pessimisme ait vraiment existé ? Si je regarde autour de moi, il n’y a aucune trace. En nous, pas une voix qui se plaint. Si je pleure, c’est un contre-chant pour enrichir le grand le pays de cocagne qu’est demain. Nous avons bien gratté avec le racloir chaque éruption de pensée. Maintenant toutes les couleurs exaltent notre palette, sauf le noir.
- Pour un aperçu de la transition d’un « Age of Optimism » à un « Age of Anxiety » voir G. Rachman, Zero-Sum World : Politics, Power and Prosperity After the Crash, Atlantic Books, Londra 2010.
- Cfr. par exemple la définition bien connue de la politique de Bush, définit comme du « Wilsonianism in boots » de Pierre Hassner : The United States : The Empire of Force or the Force of Empire ?, « Chaillot Papers », 54, settembre 2002 (https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/chai54e.pdf ; consulté le 9/10/2021).
- Cfr. M. Lind, The New Class War. Saving Democracy from the Managerial Elite, Portfolio/Penguin, New York 2020.
- Cfr. J. Iacoboni, L’esperimento. Inchiesta sul Movimento 5 stelle, Laterza, Roma-Bari 2018 ; Id., L’esecuzione. 5 stelle da movimento a governo, Laterza, Roma-Bari 2019.
- « Il est parfois avancé que le concept de société civile mondiale sape et contourne la démocratie puisque la société civile mondiale s’auto-sélectionne », affirme par exemple Mary Kaldor en 2003. La chercheuse reconnaît que « la démocratie représentative traditionnelle est minée par le processus de mondialisation », mais réduit immédiatement l’argument, abandonnant essentiellement la noble et vénérée tradition démocratique à son sort : « Il n’est cependant pas possible de redonner vie à la démocratie représentative traditionnelle par l’unilatéralisme ou un renversement de la mondialisation, ni de reconstituer ce type de démocratie au niveau mondial. » Amen. M. Kaldor, Global Civil Society. An Answer to War, Polity Press, Cambridge 2003, p. 148.
- J. Huizinga, La crisi della civiltà, Einaudi, Torino 1937, p. 132.
- Cfr. I. Krastev, op. cit.
- Yuval Noah Harari, « The World After Coronavirus », Financial Times, 20/03/2020 (https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75. Consulté le 29/09/2021).
- J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, il Mulino, Bologna 1984, p. 67.