Notre société est confrontée à un défi inédit, celui d’opérer une transition écologique radicale dans un court laps de temps. Notre organisation économique et sociale actuelle est-elle assez outillée pour opérer les bons arbitrages et aligner les différents acteurs en présence ? Une approche fertile consiste à caractériser les biens communs impliqués dans la transition écologique, à identifier les conflits entre les objectifs légitimes, et à instaurer de nouveaux modes de gouvernance pour les affronter. Dans ce processus, les entreprises de service public comme EDF ont un rôle pivot à jouer. Cet article tente de l’illustrer dans le cas de la préservation du climat et de la gestion durable et équitable de l’énergie.
Gouverner pour les biens communs : apprendre à identifier les conflits d’objectifs
La prise de conscience de l’urgence climatique et écologique est grandissante dans les différentes composantes de notre société. Elle se heurte néanmoins à des inerties structurelles et à la force de nos habitudes individuelles et collectives. Une difficulté particulière réside dans la multiplication des conflits entre différents objectifs légitimes, tous liés aux enjeux climatiques et énergétiques. L’approche par les biens communs permet de les caractériser et de s’efforcer d’instaurer une gouvernance à même de les affronter pour plus d’efficacité et de justice.
La préservation de la planète et l’énergie, deux biens communs intimement liés
La prise de conscience porte non seulement sur le caractère prioritaire et systémique de l’enjeu de préservation de la planète et des écosystèmes, mais aussi sur le caractère commun du bien « notre planète » : c’est bien notre maison qui brûle, et c’est bien nous, habitants de cette maison, qui regardons ailleurs ou qui, sidérés par l’incendie, cherchons provisoirement à l’éteindre sans traiter les causes à la racine, sans nous organiser collectivement pour l’éviter ou — parce qu’il est peut-être trop tard pour l’empêcher — pour le minimiser et nous adapter à de nouveaux modes de vie.
L’interrogation en termes de biens communs éclaire les enjeux actuels : elle permet de revenir au sens étymologique de l’activité économique, qui consiste à gérer la maison commune (Oikonomia). John Stuart Mill soulignait dans ses Principes d’économie politique (1848) à quel point l’économie doit être reconnue comme une branche de la philosophie sociale, et non pas une discipline déconnectée de l’interrogation éthique et politique sur son sens. A quoi servent les activités économiques, si elles ne contribuent pas à la qualité de vie et à laisser une planète vivable aux générations qui viennent ? Une telle perspective s’articule avec le souci du bien commun promu depuis l’Antiquité sous l’angle de la recherche de la vie bonne. Les travaux contemporains sur les biens communs et sur les communs ont conduit à souligner la nécessité de redéfinir les ressources inappropriables1et celles qui conditionnent la vie et le bien vivre sur terre, et dont l’accès doit être rendu possible pour tous : l’énergie en général et l’électricité en particulier font partie de ces biens communs essentiels. Dans le langage des économistes, ils sont à la fois rivaux (leur usage par une personne empêche ou compromet l’usage par une autre) et non exclusifs (pour des raisons éthiques, techniques ou politiques on ne peut pas exclure quelqu’un de l’accès à ces biens). L’approche dite des communs insiste sur les règles et la gouvernance de ces biens communs, dans une perspective démocratique au service de la justice sociale et écologique2.
L’énergie qu’elle est un bien commun spécifique, architectonique, puisqu’elle est indispensable au développement physiologique des êtres humains et de chaque être vivant pris individuellement, mais aussi au développement des sociétés prises dans leur ensemble.
Jean-Bernard Lévy, Cécile Renouard et Charles Weymuller
On pourrait dire de l’énergie qu’elle est un bien commun spécifique, architectonique, puisqu’elle est indispensable au développement physiologique des êtres humains et de chaque être vivant pris individuellement, mais aussi au développement des sociétés prises dans leur ensemble (un blackout d’énergie met toute une société à l’arrêt, voire en danger de mort si l’on pense aux interdépendances et à la façon dont les activités les plus quotidiennes comme le ramassage et le traitement des déchets, ou l’approvisionnement des villes en dépendent structurellement). Certaines sources d’énergie semblent inépuisables, telles que le vent et le soleil. À ce titre, l’énergie ne serait pas rivale, car consommer une unité d’énergie n’empêcherait pas les autres de consommer leur énergie. Néanmoins, ce caractère inépuisable de l’énergie n’est qu’apparent : l’exploitation de l’énergie naturelle repose toujours sur l’utilisation de matériaux, qui sont, eux, des ressources naturelles présentes en quantité limitée. En particulier, l’exploitation de l’énergie dite renouvelable (éolienne, solaire et biomasse) mobilise d’importantes quantités de métaux dont les stocks sont limités. L’énergie « transformée » est donc un bien rival, indirectement via la consommation de matériaux qu’elle implique. C’est un bien commun, qui interagit avec le bien commun « notre planète » par les ressources naturelles qu’il consomme et par les ressources dérivées qu’il émet. Dans le même sens, à un niveau plus général, en vertu des lois thermodynamiques, toute transformation d’énergie augmente l’entropie du système, avec une part d’irréversibilité plus ou moins marquée, plus ou moins visible. On ne peut donc pas compter sur un accès illimité à l’énergie. Il faut donc traiter le stock d’énergie accessible à notre société comme un bien commun. Ainsi, parmi les Objectifs du développement durable (ODD) adoptés par la communauté internationale en 2015, l’ODD 7 souligne la nature de « bien commun » de l’énergie et vise à : « Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable ». On perçoit aussi que l’énergie est un bien commun qui agit comme un vecteur entre la planète (sphère géophysique) et la société des Hommes (sphère sociale). Ce bien commun est systémique car, outre les interdépendances propres à un système énergétique, il est utilisé en amont des chaînes de valeur de nos activités économiques et sociales.
Comme l’a souligné dès 1940 Richard Buckminster Fuller, la révolution industrielle s’est accompagnée du développement de notre capacité à utiliser des « esclaves énergétiques », grâce à des sources d’énergie qui se sont cumulées pour décupler nos capacités de production. Les historiens, notamment Jean-Baptiste Fressoz, montrent les courses folles de nos sociétés et le caractère illusoire, jusqu’à aujourd’hui, du remplacement d’une source d’énergie par une autre qui serait plus pérenne. La crise énergétique que l’on traverse nous le rappelle douloureusement : face aux difficultés d’approvisionnement en gaz, la consommation mondiale de charbon a été relancée… Nous devons intégrer le fait que les modes de vie et d’organisation de nos sociétés depuis les révolutions industrielles du XIXe siècle reposent, plus ou moins consciemment, sur l’hypothèse que nous disposons d’un accès à des ressources naturelles abondantes et une énergie tout aussi abondante. C’est cette hypothèse qui a sous-tendu le développement de nos sociétés modernes, fondées sur une consommation débridée collectivement. Les flux de consommation dans le textile ou dans l’électronique sont de simples exemples, mais édifiants et symptomatiques.3 La crise énergétique actuelle remet en cause cette hypothèse, trop insouciante. Nos sociétés n’ont plus d’autre choix que d’évoluer. Le grand défi actuel est de reconnaître le caractère rival et limité de nos ressources et de veiller à leur juste répartition et leur juste usage. Cet impératif concerne à la fois le climat — ce qui se traduit par l’objectif de la neutralité carbone mondiale en 2050 — et le maintien de la biodiversité — qui conditionne également le maintien de la vie humaine sur terre.4 Outre le respect du plafond des ressources naturelles5, il faut aussi assurer un plancher de satiation des besoins essentiels des Hommes et de la société. Agir pour ces communs, c’est construire un modèle de société qui évolue entre les planchers et les plafonds, dans l’espace qualifié de « d’économie du donut » par Kate Raworth6. Force est de reconnaître que les trajectoires actuelles de nos sociétés sont très loin du compte et dessinent un monde invivable à terme pour une partie de l’humanité et du vivant7. Si la réalité de la finitude s’impose à nous, il nous appartient de reconnaître que le coût de l’inaction actuelle est de plus en plus élevé, pour les générations futures comme pour les plus vulnérables de nos sociétés.
Une difficulté nouvelle vient du conflit entre les biens communs
Les objectifs de préservation ou de développement de ces biens communs interagissent entre eux, ce qui complexifie la problématique. Nous savions déjà qu’il était difficile de bien régir un bien commun — qu’on pense au débat sur le rôle que doit jouer le droit de propriété. En insistant sur la tragédie des communs, dans un article fameux de 19688, Hardin propose ou bien de tout privatiser ou bien de tout administrer par un État central ; à quoi les travaux empiriques menés par la prix Nobel d’économie Elinor Oström ont montré comment des communautés, à travers les âges, ont su s’organiser ensemble pour assurer une gestion pérenne des ressources communes. Cependant, nous faisons désormais l’expérience de la difficulté de régir plusieurs biens communs qui interagissent, ce qui crée des injonctions et des objectifs contradictoires. Cela donne également lieu à ce que l’on peut appeler, à la suite de la philosophe Martha Nussbaum, des « dilemmes tragiques »9. Beaucoup des arbitrages nécessaires aujourd’hui mettent en tension les divers besoins actuels nés de nos modes de vie, et illustrent le caractère incompatible de ces besoins individuels avec les contraintes actuelles et futures. La dimension « tragique » est relative à la perte inévitable, au regard du rêve impossible d’une qualité de vie dépendante d’une croissance infinie des matières et de l’énergie. Après l’invasion de l’Ukraine, alors que les systèmes énergétiques européens sous soumis à la double pression de la demande et du découplage des hydrocarbures russes, un outil comme l’Observatoire de la guerre écologique mis en place par le Groupe d’études géopolitiques est une tentative utile pour cartographier et prendre la mesure des conflits d’objectifs.
En particulier, dans notre gestion du climat et de l’énergie, nous sommes confrontés à un dilemme entre d’une part, la volonté d’assurer un accès continu et pour tous à l’énergie et d’autre part, le caractère insoutenable à moyen terme de nos modes de production et consommation actuels.
Nous sommes confrontés à un dilemme entre d’une part, la volonté d’assurer un accès continu et pour tous à l’énergie et d’autre part, le caractère insoutenable à moyen terme de nos modes de production et consommation actuels.
Jean-Bernard Lévy, Cécile Renouard et Charles Weymuller
Et au sein même des préoccupations de long terme relatives au climat et à l’énergie, nous sommes face à des conflits d’objectifs très concrets, entre différents impératifs :
La préservation de l’atmosphère et l’usage de la terre : la production et la distribution d’énergie charrie des conflits non résolus liés à la terre, comme l’illustre le contentieux de devoir de vigilance au Mexique où une communauté autochtone conteste le droit de tiers sur la propriété d’une terre sur laquelle EDF, dûment autorisée par l’État du Mexique, prévoit d’installer des éoliennes terrestres. Cela montre la limite d’un système qui repose exclusivement sur le droit de propriété pour gérer les communs.
La préservation de l’atmosphère et l’usage de l’eau : la production d’énergie, y compris décarbonée, utilise de l’eau à différentes étapes. Les conflits existent et vont se multiplier entre les usages à destination industrielle, agricole et individuelle. Les épisodes de sécheresse de l’été 2022 en Europe l’illustrent bien : les cours d’eau en Europe sont à leur plus bas niveau depuis 500 ans.
La préservation de l’atmosphère et la production de déchets : comme la plupart des activités humaines et industrielles, la production d’énergie transforme la matière et produit des déchets, à savoir de la matière sous un état inexploitable voire, dans certains cas, dommageable pour la santé humaine et l’environnement. C’est vrai aussi de la production d’énergie décarbonée. Dans le cas des éoliennes et des panneaux solaires, les équipements sont encore difficilement recyclables. Dans le cas de la technologie nucléaire, la réaction produisant l’énergie produit simultanément des isotopes, qui ne sont pas intégralement recyclés et dont le rayonnement ionisant de certains est dangereux pour la santé humaine et l’environnement si ces déchets ne sont pas soigneusement confinés le temps de l’extinction progressive de leur radioactivité. Ces déchets-là nécessitent donc une gestion dans la durée.
En l’état des technologies disponibles, aucune solution énergétique à l’heure actuelle, ne permet d’assurer la croissance infinie de nos sociétés thermo-industrielles telles qu’elles ont fonctionné jusqu’à aujourd’hui. La plupart des biens que nous utilisons aujourd’hui et qui ont contribué à nos sociétés d’abondance, dépendent encore des énergies fossiles et de prélèvements de matières premières. Cela est vrai pour tous les moyens de production des énergies, y compris celles dites renouvelables, comme les panneaux solaires et les éoliennes, dont la fabrication consomme des volumes non négligeables de métaux dont les gisements sont limités.
En vue d’établir une stratégie énergétique, pour ce qui concerne la production (la demande étant tout autant prioritaire, et l’impératif de sobriété est abordé dans la section suivante), il est nécessaire de comparer sur des bases objectives les solutions disponibles, et de pondérer les différents objectifs poursuivis. Pour ce faire, la meilleure approche est d’estimer l’impact environnemental des différents moyens de production et de consommation d’énergie sur l’intégralité de leur cycle de vie : de la phase d’avant-projet jusqu’à la déconstruction de l’installation et à la réhabilitation des terres mobilisées, en passant par la construction de l’installation, de ses composants et de son exploitation-maintenance ainsi que le traitement des déchets. Une telle analyse en cycle de vie (ACV) a été développée avec les indicateurs Changement climatique et Épuisement des ressources minérales, qui sont référencés dans l’ILCD (International Reference Life Cycle Data System) handbook de la Commission européenne.
Ces études permettent en particulier de porter une appréciation objective de la technologie nucléaire dans la production d’énergie. Du point de vue de l’objectif de la préservation du climat, la technologie nucléaire est, parmi les différentes technologies de production d’énergie, celle qui aboutit à l’empreinte carbone la plus basse. En particulier, les mix électriques comportant une part de nucléaire ont une empreinte carbone plus basse que les mix reposant à 100 % sur l’éolien, le solaire et l’hydraulique. Cela s’explique d’une part par les différences d’émissions de CO2 lors de la fabrication des équipements de production d’énergie, et d’autre part, par le caractère plus pilotable de l’énergie nucléaire, qui évite de devoir surdimensionner la puissance installée par rapport à la quantité d’énergie qui est attendue en production. Du point de vue de l’objectif de préservation des ressources minérales, la technologie nucléaire est là aussi nettement plus économe en matières prélevées que les technologies d’énergie renouvelable.
En revanche, du point de vue de la production de déchets, la technologie nucléaire produit des déchets qui sont plus sensibles, car une fraction d’entre eux émettent des rayonnements ionisants sur une longue durée avant l’extinction progressive de leur radioactivité. Dès lors, toute utilisation de la technologie nucléaire dans la production d’énergie nécessite obligatoirement une gestion rigoureuse et fiable des déchets produits. La gestion actuelle des déchets nucléaires est bien de cette nature, en bénéficiant notamment de la faible quantité des déchets dangereux (d’autant plus faible que les efforts de recyclage sont accrus) et de leur très bonne traçabilité (contrairement à la plupart des déchets toxiques émis par l’activité humaine). Il faut maintenir ce niveau de sûreté exemplaire, conforme aux plus hautes exigences internationales10. Néanmoins, cette gestion a un coût, notamment financier, qu’il faut assumer de payer si l’on souhaite bénéficier de la technologie nucléaire dans la production d’énergie11. De même, la production d’énergie nucléaire repose sur des processus physiques qui doivent absolument être maîtrisés au risque sinon de conduire à des accidents dont les conséquences sur la santé humaine et l’environnement peuvent être, lorsque le risque n’est pas maîtrisé et dans des cas extrêmes, d’une très grande gravité. Pour continuer de maîtriser en toute situation (y compris dans les situations les plus tendues, de guerre ou d’effondrement politique) les processus physiques qui sont en jeu et de cantonner le risque d’accident grave à une probabilité la plus faible possible, des flux d’investissements récurrents sont nécessaires, dans les structures, dans les compétences et dans les organismes de contrôle, ce qui engendre notamment des coûts. Toutefois, ce coût est indispensable pour garantir la sûreté nucléaire et les mix de production électrique qui combinent l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables demeurent ceux dont le coût complet (i.e. le coût pour le système électrique dans son ensemble) est le moins cher, par rapport notamment aux mix électriques qui reposent exclusivement sur les énergies renouvelables12.
Finalement, le choix du recours ou non à l’énergie nucléaire nécessite de se fonder sur une analyse précise des différentes dimensions évoquées ci-dessus. Cette analyse doit être collective. Elle doit faire l’objet de débats avec la participation des citoyens, sur la base d’une information éclairée sur les conséquences des différentes options, et une lucidité collective sur nos responsabilités, quelles que soient nos préférences ou options personnelles. En particulier, ces débats doivent instruire la capacité de l’énergie nucléaire à fournir une solution dans le dilemme entre finitude des ressources et fourniture de l’énergie nécessaire à la subsistance et au développement durable de nos sociétés. Ces débats doivent reconnaître les coûts et les exigences qu’implique le recours à l’énergie nucléaire : coûts financiers pour garantir le niveau de sûreté nucléaire nécessaire (coûts qui néanmoins, comme indiqué ci-dessus, ne modifient pas le fait que les mix électriques qui reposent à la fois sur le nucléaire et les renouvelables sont les moins coûteux pour produire de l’électricité), coûts sur les ressources naturelles mobilisées (même si elles sont plus faibles que pour les autres moyens de production d’énergie), exigences institutionnelles de contrôle et de transparence dans la gestion des déchets. Enfin, ces débats doivent porter sur l’organisation de la filière nucléaire au niveau mondial, pour que nos sociétés puissent compter sur une gouvernance robuste, à même de garantir la sûreté nucléaire et une gestion raisonnée de la technologie nucléaire à des fins énergétiques. Dans ces débats, nous devons certes reconnaître que nous sommes tributaires de choix et d’évènements passés, mais en assumant aussi que les enjeux et la complexité sont tels que des options nouvelles peuvent être envisagées sur les plans de l’innovation technologique, des usages et de l’organisation institutionnelle. Face aux immenses incertitudes relatives aux évolutions sociales et géopolitiques mondiales, et face aux risques que toute solution comporte, une éthique de responsabilité, assumée collectivement, dans nos choix énergétiques, est plus que jamais nécessaire.

Outre ces conflits d’objectifs propres au climat et à l’énergie, il faut aussi prendre en compte des conflits dans la manière dont les différents individus abordent le sujet, que ce soit des conflits de préférences (les individus ont des préférences hétérogènes, plus ou moins altruistes), des conflits de génération, et même des incohérences temporelles (un même individu peut être schizophrène dans son approche des biens communs).
La problématique n’est donc pas unidimensionnelle. Il y a d’une part une concurrence des risques attachés aux objectifs poursuivis, et d’autre part une multitude d’interactions entre les acteurs (échanges, frictions, comportements rationnels et irrationnels). On dépasse le cas théorique avec une seule externalité (comme le CO2) pour laquelle il suffirait de mettre un prix afin que les marchés internalisent le problème.
Pour prendre des décisions relatives à ces « dilemmes tragiques », une gouvernance renouvelée doit assumer d’agir pour les communs et expliciter les arbitrages, aux niveaux local et global
Face à l’urgence et à la complexité et dans la concurrence des périls, nous avons besoin à la fois d’une vision claire du modèle de société visé, et d’une nouvelle gouvernance pour provoquer l’action. Cette gouvernance doit assumer explicitement d’agir pour les communs et doit expliciter les arbitrages (trade-offs).
Tout d’abord, il s’agit de préciser le modèle de société que nous visons. Nous sommes visiblement à la fin d’un cycle économique, social et sociétal. Il est clair que le consensus de Washington n’est plus adapté pour affronter les défis actuels. Le tout-privé, tout-dérégulé, tout-décentralisé montre ses limites et son incapacité à embrasser efficacement les enjeux des communs. Par ailleurs la résurgence de régimes plus autoritaires et centralisés met en péril la viabilité du modèle démocratique. Les modèles de société adaptés aux enjeux demandent pourtant à être discutés en commun. Quelques lignes de force peuvent être dégagées, à partir des constats précédents.
Il est désormais assez clair que notre système institutionnel et légal s’est trop aveuglément reposé sur le droit de propriété : il n’est ni efficace ni juste de trancher les conflits d’usage par le truchement des droits de propriété.
Jean-Bernard Lévy, Cécile Renouard et Charles Weymuller
En premier lieu, il nous faut intégrer l’impératif de sobriété. Les trajectoires-cibles de neutralité carbone 2050 qui font référence13reposent non seulement sur la décarbonation des moyens de production d’énergie notamment d’électricité (via la mobilisation des renouvelables et du nucléaire) mais aussi – et avant tout – sur une baisse de la demande totale en énergie : la diminution de 45 % de la consommation énergétique en France d’ici 2050, une cible de réduction qui pourra être atteinte par une électrification accélérée des usages, une meilleure efficacité énergétique, et une réduction de la consommation finale en biens et services. C’est un effort collectif très important par rapport aux tendances actuelles. La nécessité de sobriété s’impose au regard des limites physiques sur les ressources naturelles (e.g. 4 fois plus de consommation de cuivre pour une voiture électrique qu’une voiture thermique). Rendre nos sociétés sobres en intrants énergétiques nécessite donc un double effort : d’une part un effort renouvelé d’efficacité énergétique (c’est-à-dire pour une unité de consommation finale donnée, baisser le volume d’énergie qui a été nécessaire pour produire cette unité-là), et d’autre part un effort inédit de réduction de la demande elle-même en consommation finale (adopter des usages moins consommateurs en biens et services finaux). Une telle sobriété s’organise : c’est l’enjeu de la planification à l’heure de l’écologie de guerre. Il faut une approche consolidée des enjeux systémiques, dans lesquels une contrainte physique unique s’impose à plusieurs usages, qui doivent donc prendre en compte leur coexistence. Par exemple des besoins en eau ou en minerais pour les différentes sources d’énergie bas carbone. Par ailleurs, une ‘révolution culturelle’ est nécessaire pour diminuer les consommations et se représenter autrement le bien vivre que sous l’angle du toujours plus. Cette révolution n’implique pas de renier le progrès et l’innovation, qui demeurent des atouts essentiels pour mener à bien la transition, y compris pour gagner en sobriété, en innovant dans l’efficacité énergétique et dans les usages. Il s’agit de redéfinir le progrès à l’aune de la qualité relationnelle que nous voulons promouvoir entre humains et avec les milieux vivants, à la fois pour survivre et pour bien vivre ensemble. L’accès de tous à l’électricité aujourd’hui et demain nécessite l’intégration de la sobriété comme principe directeur des politiques publiques et des stratégies d’entreprise14.
Ensuite, il faut mieux intégrer l’impératif de justice sociale. La transition juste est consubstantielle à la transition écologique, car la dimension inégalitaire du problème est majeure : le réchauffement climatique touche les populations de manière extrêmement hétérogène, selon les géographies, les emplois, les usages, les organisations sociales, les revenus et les patrimoines ; et réciproquement, l’impact des individus sur le climat est lui aussi extrêmement hétérogène15. Il est désormais assez clair que notre système institutionnel et légal s’est trop aveuglément reposé sur le droit de propriété : il n’est ni efficace ni juste (notamment dans une perspective multigénérationnelle) de trancher les conflits d’usage par le truchement des droits de propriété. À plus forte raison à l’heure où le partage d’usage doit se développer comme solution au défi de la sobriété. La crise des gilets jaunes illustre l’enjeu de ne pas faire peser sur les populations les plus démunies financièrement les efforts pour plus de sobriété, et de reconnaître que les personnes plus aisées en moyenne polluent plus et émettent plus de gaz à effet de serre. Des débats collectifs sont nécessaires, autant sur la gestion de la précarité énergétique, que sur les critères d’équité dans la répartition des coûts des transformations à opérer.
Ainsi, il est légitime de s’interroger sur la différenciation des coûts effectifs de l’énergie entre les ménages, selon les revenus voire selon les usages16. Le coût effectif de l’énergie du point de vue d’un ménage peut être défini comme le coût pour un ménage donné de sa consommation d’énergie, net des transferts qu’il reçoit au titre de la politique publique de l’énergie. Une différenciation entre les ménages des coûts effectifs de l’énergie peut être obtenue par différents moyens : ou bien en modulant directement le prix à la consommation d’énergie (une unité consommée d’énergie serait alors affectée de différents prix, selon le revenu du ménage qui la consomme voire selon l’usage qui est fait de cette unité d’énergie), ou bien en se reposant sur un prix uniforme de l’énergie (le même prix pour chaque unité consommée d’énergie, quels que soient le revenu du ménage et l’usage) couplé à des transferts publics (positifs ou négatifs) qui sont, eux, modulés selon les revenus des ménages voire selon les usages. En théorie, la première option a pour avantages de moduler « à la racine » le coût de l’énergie pour les ménages. Elle constitue un gain en lisibilité citoyenne, en simplicité d’affichage, et ne transite pas par les finances publiques, qui sont soumises actuellement à de fortes contraintes. Néanmoins, elle génère un risque de manipulations (consistant à travestir les usages ou à revendre l’énergie achetée à des prix différents), et plus globalement elle soulève des complexités techniques et juridiques difficilement surmontables17. En miroir, la seconde option permet d’éviter les risques de manipulation et les difficultés de mise en œuvre, et permet en outre de produire un prix uniforme pour l’énergie, ce qui est théoriquement plus efficace sur le plan agrégé pour mener une stratégie de décarbonation énergétique18. Elle peut néanmoins engendrer un besoin massif de subventions publiques, et elle n’est pas exempte de difficultés opérationnelles (dans cette option aussi, il faut proposer un ciblage des ménages selon les revenus voire selon les usages, et lutter contre les manipulations de ce ciblage). Les deux options sont finalement assez proches en termes d’effet utile, en ce qu’elles aboutissent toutes les deux à une progressivité effective dans le coût payé par les ménages pour leur énergie19. Le niveau souhaité de progressivité selon les revenus pour les coûts effectifs de l’énergie doit faire l’objet d’un débat démocratique, par exemple pour estimer un niveau de consommation d’énergie « de subsistance » qui devrait être rendue accessible et abordable pour tous. En outre, des pondérations de l’utilité sociale de différents usages de l’énergie pourrait être envisagées. Les cas polaires du chauffage d’un hôpital et du chauffage d’un jacuzzi permettant de souligner que la prise en compte, dans une certaine mesure, de l’usage qui est fait de l’énergie est souhaitable d’un point de vue normatif. Vu les problématiques de faisabilité techniques et juridiques soulevées, une mise en œuvre selon la deuxième option est probablement préférable, y compris si les pouvoirs publics souhaitent différencier les coûts effectifs de l’énergie selon les usages (c’est alors le montant du transfert ex post – ou alors la régulation20 – qui est modulé selon l’usage que le ménage fait de son énergie, ce qui permet de conserver un prix uniforme sur le bien énergétique sous-jacent21). Il est indéniable que ces problématiques soulèvent de nombreux défis techniques, mais l’hétérogénéité des impacts et les périls sociaux consubstantiels à la transition écologique rendent cette réflexion indispensable. De plus, la problématique mérite une attention prioritaire dans le contexte actuel. En effet, la facture énergétique agrégée est telle qu’elle devra plus que jamais être répartie selon des critères de justice et d’équité entre les acteurs économiques.
La facture énergétique agrégée est telle qu’elle devra plus que jamais être répartie selon des critères de justice et d’équité entre les acteurs économiques.
Jean-Bernard Lévy, Cécile Renouard et Charles Weymuller
Pour autant, la voie la plus efficace pour mener la transition nécessaire est probablement de ne pas renier intégralement l’économie sociale de marché, car le marché est un puissant mécanisme de décentralisation et donc de renvoi à des échelles locales, à condition qu’il soit suffisamment régulé pour internaliser des externalités et pour éviter les déséquilibres (instabilité financière ou concentration des richesses et accroissement des inégalités). En effet, il faut bien assurer le plancher des besoins essentiels des Hommes (dans l’économie du donut de Kate Raworth, cf supra). L’expérience historique nous démontre qu’une gestion intégralement en administration centralisée conduit à l’échec de la transition. C’est très exactement ce que l’approche des communs souligne.
Nos instruments économiques de régulation et d’échanges nécessitent des réformes profondes. Ainsi, la prix Nobel Elinor Oström préconise de sortir du « tout-privatisé » par les droits issus de la propriété en distribuant de manière étagée des « droits d’usage », ces droits pouvant être : l’accès, le prélèvement, la gestion, le droit d’exclure, le droit de céder ou de vendre22. Cette approche plus « diffractée » du droit de propriété fait écho à des débats actuels sur l’organisation du système électrique. On souhaite par exemple que les actifs de production soient plus considérés par leur apport à l’ensemble du système électrique. Le concept de valeur d’usage, utilisée dans la gestion des actifs de production électrique, fait aussi ressortir la dimension intertemporelle de la question de gérer un stock non illimité d’énergie. Des instruments économiques existent donc pour nous aider à mener la transition, et ils doivent interagir en cohérence avec la politique publique, qui doit certainement activer les 3 leviers du policy-mix (prix du CO2, subventions, normes) simultanément, en appréhendant finement les impacts multiples sur les agents. Ce policy-mix peut tout à fait se penser et s’insérer dans le cadre de l’économie sociale de marché.
Ensuite, pour organiser une nouvelle gouvernance, différentes volontés se font entendre, toutes légitimes, mais souvent contradictoires, et centrifuges entre le niveau global (macro) et le niveau local (micro).

En particulier, plus de planification (top-down) est nécessaire afin de mieux coordonner les acteurs autour d’un cap lisible et assumé, pas trop volatil, pour des investissements de long terme. Le discours de Belfort du Président de la République sur la stratégie énergétique de la France à l’horizon 2050 est de cette nature.
Néanmoins, cette exigence soulève une question supplémentaire : quelle est l’échelle pertinente pour élaborer une stratégie top-down ? La plus naturelle est l’échelle mondiale, à partir du moment où il s’agit d’un bien commun planétaire. C’est ainsi qu’une diplomatie climatique s’est mise en place, via les COP. Pour autant, le bilan de près de 40 ans de négociations climatiques internationales est mitigé, en raison non seulement de la difficulté d’aboutir à des consensus à plus de 160 pays, mais aussi d’une faible granularité consubstantielle à ces négociations. La maille internationale demeure pertinente, notamment pour coordonner les engagements publics pris par les États, les collectivités et les entreprises.
En parallèle des difficultés rencontrées par cette gouvernance internationale, on peut observer le souhait grandissant de souveraineté énergétique à l’échelle nationale ou régionale (notamment européenne). Cet objectif est à de nombreux égards légitime (pour des raisons géopolitiques et de résilience économique notamment). Toutefois, il n’est pas sans coût, car il implique par définition plus de redondances, avec potentiellement une dégradation des communs (plus de consommation d’énergie) et une aggravation des conflits d’usage. Il faut donc pondérer le gain d’un point de vue des communs, qui est dans ce cas la préservation de l’accès à l’énergie, facteur de paix et de prospérité sociale, et le renforcement de la résilience face aux risques de disruptions (avérés par les événements récents), avec le coût de cette souveraineté d’un point de vue des communs. À ce titre, dans le contexte actuel, il est utile de noter que les différentes technologies de production ont des impacts très hétérogènes sur la souveraineté énergétique européenne. Ainsi, le développement de l’hydrogène comme vecteur énergétique n’est pas sans risque en termes de souveraineté si cet hydrogène est importé (une stratégie d’importation massive d’hydrogène qui serait produit par de l’énergie renouvelable dans des pays africains ou moyen-orientaux rendrait l’Europe vulnérable à l’interruption de ces flux, outre le problème éthique de renvoyer à ces pays partenaires les coûts de la production d’hydrogène, notamment une forte consommation d’eau23dans des régions exposées aux stress hydriques et une emprise foncière substantielle avec les conflits associés d’usage de la terre). Si une souveraineté est nécessaire au sens de stratégie/planification aux niveaux national et européen — stratégie pour laquelle le rôle orchestrateur de l’État est indispensable par sa légitimité démocratique —, il s’agit d’une souveraineté ouverte et solidaire, qui anticipe les points de clivage sources des conflits de demain, et qui évite de trop dupliquer l’usage de ressources énergétiques déjà rares.
Il faut pondérer le gain d’un point de vue des communs, qui est dans ce cas la préservation de l’accès à l’énergie, facteur de paix et de prospérité sociale, et le renforcement de la résilience face aux risques de disruptions (avérés par les événements récents), avec le coût de cette souveraineté d’un point de vue des communs.
Jean-Bernard Lévy, Cécile Renouard et Charles Weymuller
En parallèle de ce besoin de plus de planification, on observe un besoin complémentaire de plus de participation des acteurs locaux (bottom-up). La littérature économique sur les communs plaide souvent pour plus d’auto-gestion au niveau local afin d’éviter à la fois le tout-État et le tout-marché. Cela peut fonctionner sur certains sujets, par exemple l’acceptabilité d’une éolienne, mais ce n’est pas suffisant quand il s’agit de répondre à des défis communs à l’échelle d’un pays ou de la planète (par exemple l’externalité CO2 sur l’atmosphère ou encore la disponibilité limitée au niveau mondial des ressources). Une approche exclusivement locale ou territoriale augmente les risques de captation des ressources par une communauté fermée.
Combiner ces différents niveaux de gouvernance, en laissant de l’initiative au niveau local (en évitant d’homogénéiser outre-mesure), mais sans non plus se contenter de l’autogestion locale ni des contrats privés promus par Ronald Coase (qui considère que la négociation bilatérale contractuelle peut toujours aboutir à une allocation optimale des droits et des ressources). Finalement, la gouvernance optimale doit activer les différentes échelles et inclure un soutien top-down à des initiatives et des concertations bottom-up. La gouvernance polycentrique préconisée par Elinor Oström — qui ne nie pas l’importance du recours à la puissance publique — permet une telle articulation24.
Dans tous les cas, il faut que les priorités soient explicitées pour que les citoyens puissent délibérer dessus. Les impacts sur chaque citoyen doivent aussi être rendus transparents, sans nier les difficultés. Partager les contraintes est la voie la plus robuste pour faire émerger des consensus d’action.
Les entreprises de service public ont un rôle pivot dans la transition, pour concilier stratégie globale et solutions locales
Il n’existe pas d’architecture institutionnelle miracle, indépendamment du rôle de tous les acteurs de nos sociétés. Quelles que soient les configurations, les entreprises ont un rôle majeur dans l’action en faveur des communs, car c’est une maille indispensable pour faire émerger les solutions. De fait, les entreprises de service public ont une responsabilité accrue pour fertiliser les objectifs globaux et les solutions et initiatives qui émergent de manière décentralisée.
Si elle veut être acceptable, l’entreprise doit mettre la notion de « communs » au cœur de son action
L’action en faveur des communs peut devenir la boussole des actions d’entreprises sans pour autant se traduire en une chape de règles et de normes oppressantes. L’entreprise peut apporter une perspective d’action : elle a l’énergie vitale et les marges d’actions pour faire émerger des projets et des solutions.
Cela nécessite néanmoins un travail de redéfinition des grands objectifs de l’entreprise et de ses modes opératoires, afin de créer du bien commun en respectant les limites planétaires.
Tout d’abord la clarification du rôle que l’entreprise entend jouer dans la société, au-delà de sa seule activité économique. Ce travail a été mené chez un certain nombre d’entreprises du secteur de l’énergie. Par exemple, en France où le cadre juridique a évolué en 2019 pour inciter les entreprises à se doter d’une raison d’être, EDF a adopté comme raison d’être l’objectif de « construire un avenir énergétique neutre en CO₂, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants ». Cette visée semble cohérente avec les exigences évoquées supra pour toute entreprise, de s’inscrire dans une « économie du donut » qui respecte les frontières planétaires sociales et environnementales. La raison d’être met donc les communs — et pas seulement le CO2 — au cœur de l’action de l’entreprise. La raison d’être a une portée stratégique, managériale, mais aussi juridique. Au-delà de la France, de nombreux énergéticiens ont adopté des démarches analogues, souvent via le concept de purpose (qui n’a pas tout à fait la même portée juridique que la raison d’être en France). Ainsi, Iberdrola a adopté comme purpose : « to continue building together each day a healthier, more accessible energy model, based on electricity », outre 3 valeurs : « sustainable energy, integrating force, driving force ». Les énergéticiens Enel en Italie et EDP au Portugal ont adopté des purpose similaires. De manière générale, les « raisons d’être » et « purpose » doivent être analysées soigneusement, notamment pour identifier les tensions possibles entre objectifs — au risque sinon de se réduire à une rhétorique creuse25 et à du « green washing » — et ces visées demandent à être articulées avec des pratiques transformatrices : en s’insérant dans un collectif large de parties prenantes (cf. Conseil des parties prenantes), en agissant selon des critères RSE exemplaires, ou encore en recrutant et en formant selon la boussole de l’action en faveur des communs.
Cela devrait contribuer peu à peu à faire évoluer la gouvernance de l’entreprise afin qu’elle permette d’aligner la stratégie avec les exigences écologiques et sociales. Or comme le souligne le Haut Conseil pour le Climat, nos trajectoires actuelles ne sont pas suffisantes. C’est ainsi que l’on devrait parler de RSE comme responsabilité systémique d’entreprise et de citoyenneté d’entreprise et non pas seulement de responsabilité sociale et environnementale26. Il s’agit bien de faire converger les logiques financières et extra-financières. Les études menées par des cabinets comme Ethics & Boards indique l’ampleur du chemin à parcourir : les compétences sociales et environnementales sont peu représentées dans les CA et les membres des CA eux-mêmes sont insuffisamment formés sur ces sujets. Il s’agit enfin de promouvoir une harmonisation urgente des règles du jeu qui nous permette collectivement de modifier nos trajectoires. A cet égard, outre l’instrument fiscal, la réforme des normes comptables (bien soulignée par le rapport Sénard-Notat), la réduction des inégalités de revenus et la standardisation des critères ESG sont nécessaires, afin d’éviter la poursuite de pratiques prédatrices et insoutenables liées à une conception de la nature comme un réservoir de ressources à exploiter sans fin.
Mais surtout, l’entreprise peut — et doit — aussi fournir des solutions de « communs » pour répondre aux défis de la pression sur les ressources
Pour les entreprises, au-delà d’une approche « défensive » d’intégration des communs dans leur activité, les entreprises peuvent être des lieux précieux d’émergence des solutions et de renouvellement des approches, au sein de filières et de territoires.
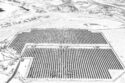
L’entreprise est un regroupement d’acteurs qui peut et doit être adapté aux défis posés par les communs27. Dans le cas des grands groupes, elle est à la fois macro (cap stratégique) et micro (ancré en territoires), ce qui est la source de multiples tensions (relatives notamment à la répartition des richesses créées) mais peut aussi être vecteur d’engagements solidaires sur des territoires. Ensuite, l’entreprise expérimente, tout en incitant à innover. Enfin, elle est structurée pour générer des solutions à des problèmes, en précédant ou en suivant les besoins sociétaux. De plus en plus de chefs d’entreprise, reconnaissant les contraintes physiques de la planète, réfléchissent à des stratégies de redirection de leurs activités. Comment créer et développer des activités qui s’inscrivent dans le respect des frontières planétaires ? Les défis sont énormes, dans tous les secteurs d’activité, de la mobilité à l’agriculture en passant par le bâtiment, le numérique et les loisirs…
L’implosion du consensus de Washington et l’urgence écologique aiguillonnent une interrogation radicale, pour traiter les problèmes à la racine, sur la place et le rôle de l’entreprise, en particulier de l’entreprise de service public dans le monde actuel, spécifiquement dans le cas de l’énergie.
Jean-Bernard Lévy, Cécile Renouard et Charles Weymuller
Ce potentiel de solutions se décline de façon transversale dans le cas de l’énergie. Pour que la transition énergétique soit socialement acceptable, il va falloir inventer des nouveaux modèles de vie, d’usage, mais aussi des nouveaux modèles économiques, fondés sur la sobriété et le partage. Les exercices de prospective montrent en effet qu’une composante de la stratégie doit reposer sur la sobriété, notamment énergétique, qui n’est autre qu’une intégration dans l’ordre des choix individuels et collectifs de la préoccupation « commune » de recourir à moins d’usages pour réduire nos impacts sur l’environnement. C’est pourquoi de nombreux énergéticiens comme EDF encouragent des usages plus sobres, qui invitent au changement de comportement de ses clients. Une sobriété commandée par une finalité de long terme. Les entreprises dont le modèle d’activité est fondé sur l’économie collaborative, proposant des solutions de partage, souvent alliées à des solutions technologiques, en sont de très bonnes illustrations. C Par exemple, l’entreprise Dreev accompagne l’émergence de flottes partagées de véhicules électriques pour les entreprises, et dont les cycles de chargement et déchargement sont optimisés. Cela permet à la fois un usage plus sobre de ces véhicules, ainsi qu’une utilisation de l’électricité plus efficace d’un point de vue climatique, car ces véhicules optimisent leurs cycles de charge pour pouvoir décharger de l’électricité vers le réseau pour soulager aux moments les plus tendus (et de fait éviter de mobiliser des moyens de production carbonés pour garantir l’équilibre offre-demande à ces moments). Avec cette solution, l’individu participer à l’équilibre du système global, dans le cadre d’un modèle économique viable. Autre exemple, dans les pays en développement : une entreprise comme SunCulture favorise le déploiement de solutions électriques autonomes et décarbonées pour améliorer les conditions de travail et de vie dans les territoires ruraux et isolés. Ces solutions consistent souvent en des instruments de travail ou des équipements ménages couplés directement sur un moyen de production d’énergie renouvelable, comme des pompes d’irrigation ou des prises électriques couplées à un panneau photovoltaïque. Ces moyens d’émancipation et de développement, respectueux des contraintes environnementales, sont développées par des entreprises innovantes, qui arrivent à leur faire correspondre des modèles d’activité. Ce sont des illustrations où des solutions technologiques, souvent relativement simples, sont passées à l’échelle, grâce à l’action des entreprises, souvent en coopération étroite avec les pouvoirs publics et les communautés locales.
La responsabilité supplémentaire des entreprises de service public
L’implosion du consensus de Washington (le tout-privé/tout-marché/tout-dérégulé) et l’urgence écologique aiguillonnent une interrogation radicale, pour traiter les problèmes à la racine, sur la place et le rôle de l’entreprise, en particulier de l’entreprise de service public dans le monde actuel, spécifiquement dans le cas de l’énergie.
L’énergie, service essentiel, est un service public : la fourniture d’énergie remplit en effet les principes de service public que sont la continuité, la mutabilité et l’égalité (les « lois de Rolland », du nom du juriste des années 1930). La caractéristique-clé ici est bien le service public que fournit EDF, et non son actionnariat (qui s’avère être par ailleurs public), ou encore le statut d’une majorité de ses salariés.
Pour une entreprise de service public de l’énergie, combiner le double objectif, celui d’innover pour les communs et celui de fournir un service public, est une opportunité : les deux sont alignés sur l’intérêt général et renforcent la raison d’être (e.g. y compris sur un plan très électrotechnique : la stabilité du réseau, la non-défaillance, la sécurité d’approvisionnement, sont à la fois des biens communs et des services publics). Dans le même temps, c’est aussi un défi à part entière : comment expérimenter, comment investir, comment prendre des risques au service des communs, quand il faut en même temps fournir à court terme, sans discontinuer et sans défaillance, un service public ? Ceci suppose un sérieux examen de conscience collectif – mené par de plus en plus de personnes et de collectifs, dont de plus en plus de jeunes diplômés – pour renoncer à des usages insoutenables.
Les responsabilités des entreprises de service public ne sont pas des charges ou des freins qui nous ralentiraient dans une course effrénée, mais un positionnement spécial, avec des droits et des devoirs supplémentaires, pour contribuer à prendre soin de notre monde commun.
Jean-Bernard Lévy, Cécile Renouard et Charles Weymuller
C’est une question existentielle pour EDF, en tant qu’entreprise de service public pour la transition énergétique, et de première importance pour notre pays. La mission pour EDF est de : i) continuer à délivrer à tout moment un service public, à savoir fournir de l’électricité abordable à tout citoyen qui le demande, et des biens communs associés (décarbonation des usages, capture du CO2 dans l’air et promotion des solutions fondées sur la nature pour séquestrer le CO2, stabilité du réseau, sécurité d’approvisionnement) ; ii) tout en investissant pour le long terme (horizons 2035 et 2050). Ces investissements sont de différentes natures. Il y a un besoin d’investissements de nouveaux moyens de production d’énergie renouvelable et d’énergie nucléaire. Comme évoqué supra, de l’avis des experts climatiques, ces deux moyens de productions sont les plus décarbonés et ceux qui prélèvent le moins le capital naturel de la planète, et ils sont par ailleurs complémentaires – le nucléaire apportant au réseau électrique la stabilité de production que les énergies renouvelables ne sont pas capables de fournir. Il y a aussi un besoin d’investissements de maintenance et de sécurisation, car la technologie nucléaire nécessite en particulier un degré de sureté très élevé, afin d’éviter tout nouvel accident nucléaire avec impact négatif généralisé sur la santé et l’environnement. Le risque d’un tel accident existe – risque non trivial dont il faut avoir conscience au moment des choix collectifs sur la stratégie énergétique -, mais ce risque peut être minimisé par des investissements continus dans la sécurisation des centrales nucléaires, dans la formation, dans les institutions de contrôle, pour parer à toutes les situations, y compris notamment de conflit armé. La technologie nucléaire vient donc avec des exigences et un coût pour le système électrique qui combine nucléaire et renouvelables, coût certes moindre que celui des autres mix électriques notamment ceux 100 % renouvelables (cf. supra), mais coût qu’il faut assumer si l’on veut bénéficier avec le plus de sûreté possible de la contribution du nucléaire, aux côtés des énergies renouvelables, à la réponse au plus urgent des défis, celui de la décarbonation de nos sociétés, sans laquelle nous marchons vers des situations écologiques et sociales catastrophiques à grande échelle. Rappelons que ce recours au nucléaire devrait être compris dans le cadre de la priorité absolue donnée à la sobriété énergétique dans nos sociétés. Pour y parvenir, outre l’éducation collective, l’évolution des mentalités et les contraintes nécessaires, il y a un besoin d’investissements d’innovation, aussi bien technologiques ciblés (dans de nouvelles méthodes de production d’énergie, dans l’optimisation du réseau électrique) que dans les usages, en vue d’aider les entreprises et les ménages à rendre leurs usages plus sobres. L’ampleur des investissements à mener, dans un cadre contraint par les limites sur les ressources physiques, humaines et financières mobilisables, révèle l’ampleur du défi qui est à relever, pour EDF et ses parties prenantes.
Dans la poursuite de cette mission d’entreprise de service public, nous endossons aussi des responsabilités accrues. Tout d’abord, celle de toujours adopter une organisation efficace, notamment pour fertiliser la stratégie globale avec les initiatives locales et la mise en œuvre concrète des projets. Ensuite, celle d’anticiper les transformations du monde et de contribuer à faire émerger une vision partagée du caractère impératif de la sobriété, de la justice sociale, de la gestion concertée de l’énergie, et des solutions industrielles à faire émerger. Cette vision doit être partagée aussi bien au niveau local, au plus près des territoires, qu’au niveau global, en lien étroit avec la conception des politiques publiques, nationales, européennes et internationales. Les responsabilités des entreprises de service public ne sont pas des charges ou des freins qui nous ralentiraient dans une course effrénée, mais un positionnement spécial, avec des droits et des devoirs supplémentaires, pour contribuer à prendre soin de notre monde commun.
Sources
- Pierre Dardot, Christian Laval, 2014 : Commun. Essai sur la révolution au XXe siècle. Paris, La Découverte.
- Benjamin Coriat (sous la direction de), 2015 : Le retour des communs, La crise de l’idéologie propriétaire. Les Liens qui Libèrent.
- Comme l’exprime sans concession Guillaume Poitrinal, ancien PDG d’Unibail et fondateur d’une entreprise de construction en bois, « les boomers sont devenus des gloutons qui dévalisent les hypermarchés, se suréquipent de vêtements à la mode, d’électroménager, d’automobiles et plus récemment d’écrans numériques. (…) À l’ère de la fast fashion, les français jettent 12 kgs de vêtements par an ». Poitrinal, 2022, Pour en finir avec l’apocalypse : Une écologie de l’action. Stock (p. 12).
- Bruno David, 2021 : À l’aube de la sixième extinction. Comment habiter la Terre. Grasset.
- Rockström, Steffen et al., 2009 : Planetary Boundaries : Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and Society.
- Kate Raworth, 2017 : Why it’s time for Doughnut Economics. IPPR Progressive Review.
- Lenton, Rockström, et al., 2019 : Climate tipping points — too risky to bet against. Nature.
- Garrett Hardin, 1968 : The Tragedy of Commons. Science
- Martha C. Nussbaum, 1989 : Tragic Dilemmas. Radcliffe Quarterly.
- L’AIEA a développé et fait infuser la Culture de Sûreté, notamment via le comité d’experts International Nuclear Safety Group (INSAG).
- Pour une approche globale de la problématique des déchets nucléaires, voir Jean-Paul Bouttes, 2022 : Les déchets nucléaires, une approche globale, Fondapol. Sur la concurrence des périls et les exigences que la technologie nucléaire implique, voire aussi Villalba, dans Jean-Paul Deléage et Michèle Descolonges, 2022 : Penser les effondrements, critiques d’un récit dominant. Le Bord de l’Eau Eds.
- Rapport Futurs Energétiques, RTE (2021).
- Ibid.
- Cette réorientation collective est ce que promeut le Campus de la Transition, dans des formations nourries par des expérimentations de modes de vie sobres, conviviaux et solidaires, et par la recherche — avec des enseignants-chercheurs et des praticiens — sur les moyens de favoriser une transition juste par une transformation des représentations collectives du bien-vivre et une évolution des règles du jeu économique à différentes échelles.
- Selon les estimations d’Oxfam, « au cours de ces 25 années, les 10 % les plus riches de la planète ont consommé 1/3 du budget carbone mondial encore disponible pour limiter le réchauffement à 1,5°C, alors que les 50 % les plus pauvres n’avaient consommé que 4 % du budget carbone ». Ces estimations se fondent sur des hypothèses et font prendre conscience des ordres de grandeur.
- La problématique de la différenciation des coûts pour les entreprises soulève d’autres enjeux, notamment d’équité entre les secteurs et de concurrence ; nous ne l’abordons pas ici, mais des considérations similaires s’y appliquent.
- En particulier, le Conseil constitutionnel a censuré en avril 2013 une proposition de loi du député François Brottes instaurant des tarifs différenciés de l’énergie, au titre d’une rupture d’égalité devant l’impôt. Plus largement, le débat parlementaire sur cette proposition de loi avait révélé l’extrême complexité de mise en œuvre d’une telle mesure : il faut alors envisager une myriade de barème selon les cas de figures de l’usage de l’électricité et chercher à parer tous les risques de manipulation (comme le fractionnement de consommation, ou la revente).
- Il y a alors un signal-prix « pur » d’un point de vue pigouvien, et donc une internalisation la plus efficace possible de l’externalité comme l’émission de CO2.
- Par exemple, le « tarif social de l’énergie » (le Tarif de Première Nécessité, en vigueur jusqu’en 2016) semble à première vue relever de la première option, or en réalité, il était une déclinaison assez sommaire de la deuxième option : le TPN consistait en un rabais forfaitaire de facture sur les premiers KWh selon des conditions de revenus et de composition du ménage. Ainsi, dès que la consommation d’un ménage éligible dépassait un certain seuil, il obtenait le rabais, qui n’était pas modulé selon sa consommation effective. Le remplacement du TPN par le chèque énergie (qui relève clairement de la deuxième option) n’a donc pas changé la nature économique de l’instrument.
- Certains usages peuvent simplement être interdits, ou régulés via les quantités consommées.
- Il est en effet plus difficilement envisageable à deux électrons, en tous points semblables d’un point de vue physique, deux prix différents.
- Elinor Ostrom et Charlotte Hess, 2007 : Understanding knowledge as a commons : from theory to practice, Cambridge. MIT Press.
- La production d’hydrogène par électrolyse consomme entre 10 et 20 litres par kilogramme d’hydrogène, et la consommation dépasse même 20 litres pour la production d’hydrogène par vaporeformage de gaz naturel.
- Cf. Cécile Renouard, Rémi Beau, Christophe Goupil et Christian Koenig (sous la dir.) Campus de la transition, 2020 : Manuel de la Grande transition, Les Liens qui Libèrent.
- Cécile Renouard, 2021 : Fondements éthiques de la responsabilité politique de l’entreprise dans l’anthropocène : de la raison d’être à la responsabilité systémique, Entreprises et Histoire.
- Cécile Renouard, Ibid.
- Bommier S., Renouard C., 2018 : L’entreprise comme commun, Au-delà de la RSE.


