Ce dimanche 25 septembre, les élections politiques auront lieu en Italie. Selon les sondages, il est très probable que la coalition de centre-droite l’emporte dans les urnes. Les trois principaux partis associés sont Forza Italia, menée par Silvio Berlusconi et qui, au Parlement européen, appartient au Parti Populaire (PPE) ; la Lega, dont Matteo Salvini est le secrétaire fédéral et qui à Strasbourg est inscrite au sein du groupe « populiste » Identité et Démocratie ; et Fratelli d’Italia, parti dirigé par Giorgia Meloni, qui a rejoint les Conservateurs et Réformistes. Toujours selon les sondages, Fratelli d’Italia pourrait peser davantage que ses deux alliés cumulés. Alors que Meloni insiste sur le profil idéologique conservateur de son propre parti et si les élections se déroulent effectivement comme nombre d’observateurs le prévoient, l’un des pays les plus peuplés de l’Union européenne, protagoniste de premier plan depuis le début du processus d’intégration continentale, se retrouverait avec un gouvernement à traction conservatrice.
Dans ce texte, trois réflexions s’entremêlent, chacune explorée dans une partie : quelle signification peut avoir le conservatisme à notre époque ? de quelle façon se sont transformées les forces politiques de droites dans les trente dernières années ? et de quelle manière le système politique italien et le rapport entre Italie et Europe ont-ils changé après 1989 ? Rassemblant les trois arguments, la quatrième et dernière partie s’interroge sur les conséquences possibles, pour l’Italie et l’Union européenne, de la naissance d’un gouvernement de droite dans la péninsule au lendemain des élections.
Il n’y a pas de conservatisme sans une sensibilité aiguë à la continuité temporelle : la conviction qu’on reçoit du passé une tradition qui peut être modifiée, mais qui a fait la preuve de sa valeur en résistant au temps et qui doit donc être maniée avec le plus grand respect et la plus grande prudence, et transmise aux générations futures.
Giovanni Orsina
Le conservatisme aujourd’hui : impossible et indispensable
Il est difficile, en 2022, de ne pas penser que l’effort pluriséculaire du conservatisme pour arrêter, ou du moins ralentir, l’avancée de la modernité ait fini par échouer, et de ne pas en conclure qu’aujourd’hui, le conservatisme se révèle tout simplement impossible. Je n’ai pas l’intention d’entrer ici dans le riche débat théorique sur la nature du conservatisme. Toutefois, il me paraît évident qu’une idéologie ne peut pas se dire conservatrice si elle n’arbore pas une attitude fortement sceptique sur la capacité de la raison humaine de comprendre et d’améliorer le monde, et donc sur la possibilité que, sur cette Terre, il soit possible d’atteindre la perfection. Si elle ne croit pas, par conséquent, que l’ordre politique et social doit être ancré à un « dogme minimal » : des principes admis a priori et soustraits, au moins en partie, à la critique de la raison, qu’ils soient religieux (Dieu), historiques (patrie) ou naturels (famille). Finalement, il n’y a pas de conservatisme sans une sensibilité aiguë à la continuité temporelle : la conviction qu’on reçoit du passé une tradition qui peut être altérée, mais qui a fait la preuve de sa valeur en résistant au temps et qui doit donc être maniée avec le plus grand respect et la plus grande prudence, et transmise aux générations futures.
En Occident, les cinquante dernières années d’histoire ont balayé les conditions qui rendaient possible — au prix tout de même d’un grand effort — cette manière de penser le monde. Dès les années soixante du XXe siècle, ce qui avait survécu des structures sociales traditionnelles a été délégitimé et démantelé. Les concepts sur lesquels reposait la « dureté » de la pensée conservatrice ont été soumis à une critique logique et historique impitoyable, à laquelle ils n’ont bien sûr pas survécu : on a découvert que les nations étaient des communautés imaginaires et que les traditions étaient des inventions, que les identités individuelles et collectives étaient multiples et artéfactuelles, qu’il n’y avait rien d’aussi artificiel que la nature. Que Dieu soit une filiation de l’imagination humaine n’est pas une conviction des cinquantes dernières années — Friedrich Nietzsche, comme on le sait tous, en a annoncé la mort en 1882 — mais dans la fin du vingtième siècle les procès de sécularisation ont subi une accélération impressionnante. Entre-temps, l’aspiration utopique qui caractérise la modernité n’a nullement diminué, elle s’est même renforcée à certains égards — seulement, elle a réagi à la crise du communisme en confiant son destin à l’économie, à la technologie et au droit plutôt qu’à la politique. Finalement, la continuité temporelle s’est dissoute : le passé n’a plus rien à dire au présent, et par conséquent le présent n’a plus rien à transmettre au futur. Tout cela a rendu le conservatisme insoutenable. D’où l’attitude presque moqueuse que les progressistes — qui ne se sont pas retrouvés par hasard hégémoniques dans le monde de la culture — réservent aux conservateurs, accusés en substance de vouloir retenir l’eau d’une cruche percée. Et d’où la sensation qu’ils sont définitivement dépassés par l’histoire, qu’ils rêvent d’un impensable et indésirable retour au Moyen-âge.
L’aspiration utopique qui caractérise la modernité n’a nullement diminué, elle s’est même renforcée à certains égards — seulement, elle a réagi à la crise du communisme en confiant son destin à l’économie, à la technologie et au droit plutôt qu’à la politique.
Giovanni Orsina
Le discours pourrait aussi s’arrêter là, si ce n’était qu’entre-temps, cette même modernité qui a rendu le conservatisme impossible s’est avérée, pour une partie non négligeable des citoyens des démocraties occidentales, plutôt difficile à habiter. Après 1989, pendant une longue décennie marquée par un certain optimisme panglossien, on a pu développer l’illusion qu’il était possible de construire un ordre politique et social parfaitement structuré en forme réflexive, c’est-à-dire replié et appuyé sur lui-même : capable de se passer de valeurs absolues, de concepts « durs » ou d’identités préfabriquées, traversé le moins possible par des rapports de pouvoir, axé sur une rationalité formelle et procédurale. Les deux premières décennies du vingtième siècle se sont chargées de démontrer qu’il s’agissait d’une illusion. Et cet ordre, qui était en réalité légitimé surtout par sa crédibilité de la promesse d’un futur fait de progrès, de paix, de stabilité et de bien-être, a été durement frappé par une série de graves démentis historiques — du 11 septembre 2001 au 24 février 2022, en passant par la Grande Récession et la pandémie.
Dans ce goulot d’étranglement, le conservatisme, impossible en principe, est devenu indispensable dans les faits : au moment où les habitants des démocraties avancées, alarmés par l’illisibilité de l’avenir et de moins en moins convaincus des « magnifiche sorti e progressive », ont commencé à exiger que le rythme effréné des changements historiques ralentisse un peu et que l’on rétablisse un minimum de points de référence, bien que précaires et provisoires. Trop souvent prisonniers de leurs schémas abstraits comme ils le sont de leurs beaux appartements au cœur des grandes métropoles, les intellectuels progressistes continuent à se demander, stupéfaits, comment les électeurs peuvent se montrer inconscients au point de voter pour ceux qui déblatèrent sur la famille naturelle qui, naturellement, n’est pas naturelle, ou sur une patrie artificielle. Alors qu’ils sont tout entiers occupés à se moquer de la paille de l’inconscience des autres, ils ne se rendent pas compte de la poutre qui traverse leur œil. Pourtant, il leur suffirait de relire Simone Weil avec un minimum d’attention : « L’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus incompris de l’âme humaine. » Un besoin que, par définition, une modernité tardive engagée dans la destruction systématique des racines ne pourra jamais satisfaire.
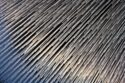
Popularistes et populistes
La crise de l’optimisme progressiste qui avait marqué les « longues » années 1990 a pris les partis situés à la droite du centre de court. Il s’agissait là de forces politiques qui auraient dû répondre à la requête, qui venait des niveaux inférieurs des démocraties développées, que les procès de transformation historique soient ramenés sous contrôle. Savoir pourquoi ces partis se sont retrouvés pris au dépourvu est une autre question cruciale qui nécessiterait une analyse beaucoup plus approfondie que celle que nous pouvons proposer ici. Très rapidement, celle-ci pourrait s’articuler autour des axes suivants. Le problème de l’inaptitude du conservatisme à la modernité croît de façon démesurée dans le dernier demi-siècle, mais prend naissance bien avant. Il est possible de soutenir que le succès des partis démocrates-chrétiens après la Seconde guerre mondiale ne dépendait pas tant de leur force intrinsèque que du besoin généralisé de stabilité et d’assurance ; du rôle majeur des églises, accru par la crise d’après guerre des institutions étatiques et nationales ; de l’absence, à la droite de l’échiquier politique, de courants crédibles — le conservatisme traditionnel ayant été blessé à mort par sa contiguïté avec le nazisme et le fascisme.
Finalement, la continuité temporelle s’est dissoute : le passé n’a plus rien à dire au présent, et par conséquent le présent n’a plus rien à transmettre au futur. Tout cela a rendu le conservatisme insoutenable.
Giovanni Orsina
À partir des années 1960, le processus de sécularisation, le dépérissement des structures sociales traditionnelles et la crise du communisme ont accru la pression sur les fragiles structures politiques et culturelles des partis de droite, en les obligeant à se repenser et à s’adapter à la nouvelle conjoncture historique. De manière pragmatique, elles se sont adaptées et repensées : elles ont accepté en bonne partie la modernité tardive, en s’appuyant au mieux sur les vestiges de la tradition pour donner, de temps en temps, un petit coup de frein, et surtout en s’efforçant de trouver nouveau principe ordonnateur interne à la modernité tardive elle-même. Et c’est dans le marché qu’ils ont trouvé ce principe, déjà épousé avec enthousiasme par la droite anglo-saxonne, suivie — dans une forme beaucoup moins directe et idéologique puisqu’englobé à l’intérieur du processus d’intégration européenne — par les droites continentales. Après s’être réconciliées avec la modernité tardive et avoir misé sur le marché, les forces politiques situées à droite du centre ont fini par partager — voire par contribuer à générer — le climat d’optimisme dépolitisé qui a caractérisé les « longues » années 1990. Par conséquent, elles n’étaient plus en mesure de remplir cette fonction de contrôle du changement historique et de défense des fragiles et résiduels points de référence qui nous semblent indispensables.
Car si une fonction est indispensable, il faudra bien que quelqu’un l’assume. Dans l’espace laissé partiellement vide par les partis populaires ou conservateurs « traditionnels », on a vu s’insinuer des forces politiques nouvelles ou renouvelées par des changements récents. Faute de meilleures définitions, on les a appelées « populistes ». Le populisme, dans l’interprétation que je propose ici, est donc le fruit politique de la rébellion diffuse contre la modernité tardive, la dissolution de tout point de référence, l’accélération forcenée de la temporalité historique. La modernité tardive ayant démoli tous les a priori et déconstruit toutes les narrations, le populisme ne peut pas proposer un projet politique cohérent qui s’appuie sur des fondations théoriques solides. Puisque la très grande majorité de la classe intellectuelle a accepté la modernité tardive, et qu’elle perd une grande partie de son temps dans l’illusion qu’arrivera à se corriger toute seule et à produire finalement les miracles qu’elle a promis, le populisme n’attire pas les intellectuels — il ne peut prendre la forme que d’un profil anti-intellectuel. Et du moment qu’il s’agit d’exprimer une rébellion et une protestation, de multiples formes politiques et idéologiques peuvent s’y adapter : de droite, de gauche, ni de droite ni de gauche, libertaire et étatiste, cosmopolite et nationaliste.
Le populisme, dans l’interprétation que je propose ici, est donc le fruit politique de la rébellion diffuse contre la modernité tardive, la dissolution de tout point de référence, l’accélération forcenée de la temporalité historique.
Giovanni Orsina
De là vient aussi une certaine volatilité du vote populiste, sa capacité de passer rapidement d’un parti à l’autre malgrés ces partis peuvent paraître très éloignés les uns des autres. Dans la clairvoyance déconcertante du poète, Eugenio Montale avait déjà décrit le phénomène avec une précision chirurgicale il y a soixante ans : « Quand la protestation devient une carrière profitable l’étincelle s’éteint, notre délégué, notre élu, l’homme auquel on avait confié le courage qui nous manquait est rapidement substitué par quelqu’un d’autre. Indéniable, en tout cas, le fait d’une protestation universelle qui n’affecte pas tel ou tel régime politique ou social, mais le caractère non naturel (innaturalità) de notre mode de vie ».
Et pourtant, parce qu’elle est dirigée contre les processus de liquéfaction des repères qui marquent la modernité tardive, il est difficile que, dans ses circonvolutions, la protestation ne rencontre pas tôt ou tard la nation. Il s’agit peut-être d’une communauté imaginaire et elle a peut-être été fortement affaiblie par la catastrophe de 1945, mais elle reste une présence historique séculaire, profondément ancrée dans la psyché collective et très difficile à remplacer. Elle reste également le principe de légitimation des entités étatiques au sein desquelles la plupart des processus politiques en général, et démocratiques en particulier, continuent de se dérouler. En bref, la nation n’a plus la « dureté » qu’elle avait dans la première moitié du XXe siècle, mais elle est toujours plus « dure » que tout autre point de référence possible. C’est ainsi qu’a pris forme un populisme de droite nationaliste — ou souverainisme.
Parce qu’elle est dirigée contre les processus de liquéfaction des repères qui marquent la modernité tardive, il est difficile que, dans ses circonvolutions, la protestation ne rencontre pas tôt ou tard la nation.
Giovanni Orsina
Le laboratoire italien
La réflexion conduite jusqu’ici a l’audace de vouloir être valable pour toutes les démocraties avancées, évidemment sous des formes qui peuvent être très différentes selon les spécificités de chaque cas national. Cela vaut certainement pour l’Italie : un pays fragile et, par conséquent, plus exposé que d’autres au conditionnement international, dans lequel certains des phénomènes que j’ai décrits dans les paragraphes précédents sont apparus plus tôt et de manière plus macroscopique qu’ailleurs. Un pays, en somme, qui, à certains égards, peut être considéré comme un laboratoire de la démocratie libérale de la modernité tardive.
Tout raisonnement à propos de l’Italie contemporaine doit partir des événements de la séquence 1989-1994 : chute du Mur de Berlin (1998), signature du traité de Maastricht (1992), crise du système politique italien (1992-1993) et entrée en politique — suivie de sa victoire électorale — de Silvio Berlusconi (1994). Encore une fois, il n’est pas possible de reparcourir ici de façon exhaustive trente ans d’histoire italienne. Tentons toutefois de le dire brièvement : la Guerre Froide épargnait d’une part à l’Italie la fatigue de s’interroger sur son identité nationale et sur sa projection à l’étranger, en la coinçant dans l’Occident (la « Bulgarie de l’OTAN ») et en lui garantissant une position aisée sur la scène internationale ; d’autre part, elle fournissait une structure au système politique, cantonnant les démocrates-chrétiens au gouvernement et le parti communiste à l’opposition. Avec 1989, tout cela a soudainement pris fin, et la péninsule a été confrontée à la fragilité de son identité et à la nécessité de repenser à la fois ses arrangements internes et son action extérieure.

La Urkatastrophe de l’Italie du vingt-et-unième siècle, son cataclysme originel, c’est que la métamorphose du système politique italien est advenue en passant par un séisme judiciaire en 1992-1993. Les partis historiques ont été balayés, à l’exception du petit parti post-fasciste et des plus importants partis post-communistes. La Démocratie-chrétienne s’effondre, en ouvrant un gouffre au centre et au centre-droite de l’espace public. Ainsi, en Italie la crise du popularisme advient très précocement. Cela dépend bien sûr beaucoup des circonstances nationales particulières, mais elle peut aussi être interprétée, de façon plus générale, comme une conséquence de l’incapacité de la Démocratie chrétienne de parvenir à un équilibre nouveau et fonctionnel entre l’identité et les intérêts nationaux d’un côté, et le nouveau contexte européen et international de l’autre.
La Urkatastrophe de l’Italie du vingt-et-unième siècle, son cataclysme originel, est que la métamorphose du système politique italien est advenue en passant par un séisme judiciaire en 1992-1993.
Giovanni Orsina
Le gouffre que l’effondrement démocrate chrétien a ouvert à la droite du système politique est, du moins partiellement, peuplé par la Lega, formée dans les années 1980, et par les post-fascistes du Movimento sociale italiano, fondé en 1946. Mais les solutions qu’ils proposent sont faciles et résiduelles : aussi bien l’autonomisme — sinon le sécessionnisme — de la Lega, qui même dans l’Italie septentrionale n’arrive pas à convaincre plus qu’une grosse minorité de l’opinion publique ; que le post-fascisme, qui ne peut pas se baser sur ses racines historiques et sur la faiblesse de la culture politique qu’il avait su produire, après 1945, au-delà de ces racines. À partir de 1994, donc, le protagoniste de la reconstruction de la droite sera Silvio Berlusconi.
Le berlusconisme cherche à reconstruire l’identité publique de l’Italie à travers la valorisation de son identité privée : le pays des mille villes, de la créativité, de l’inventivité et de l’esprit entrepreneurial, de l’art et de la beauté, de l’inconcevable variété des paysages, de l’œnologie et de la gastronomie. Il s’agit d’une émulsion de populisme et de libéralisme : populiste parce qu’elle met l’emphase sur l’unité « naturelle » du peuple italien ; libérale parce que cette unité est ouverte, diverse et accueillante ; populiste et libérale parce que, dans le même temps, elle confie aux élites politiques un rôle marginal. Il s’agit d’une opération géniale et impossible qui ne pouvait être imaginée que dans le climat optimiste et antipolitique des « longues » années 1990. Mais Berlusconi parvient à se maintenir de manière durable au pouvoir seulement en 2001, lorsque son projet est déjà périmé. Entre-temps, conformément à l’assombrissement du climat historique au tournant du millénaire, il a atténué son libéralisme et accentué son conservatisme. En 1999, son parti, Forza Italia, rejoint le Parti populaire européen : le popularisme commence donc à collaborer avec le populisme — même si l’on parle ici d’un populisme particulier : celui de Silvio Berlusconi.
À gauche, où les post-communistes occupent une position hégémonique et où les démocrates-chrétiens progressistes font figures de sparring partners, les choses ne vont pas mieux. Les deux traditions politico-culturelles du communisme du progressisme catholique réfutent non seulement in abstracto l’idée de nation par rapport à des références supranationales, mais, concrètement, formulent un jugement très négatif de l’histoire de l’Italie, qu’ils considèrent comme une erreur dès ses débuts et qui nécessite une réorientation urgente, de l’ordre de la palingénésie. Ainsi, après 1994, les points de référence de la guerre froide ayant disparu, la gauche italienne n’est pas en mesure de repenser la nation et n’a d’autre choix que d’adopter une position entièrement pro-européenne : l’Europe devient pour l’Italie le seul horizon identitaire possible et en même temps le seul instrument capable de la déraciner de son passé et de la projeter, entièrement renouvelée moralement avant de l’être politiquement, dans l’avenir. On fait coïncider l’intérêt national italien avec l’intégration toujours plus profonde du continent.
Cette ligne programmatique — que le centre-droite berlusconien réfute en théorie mais n’arrive pas à contrecarrer dans les faits, en partie aussi parce qu’elle est fortement présente au sein de l’État profond italien — a des conséquences concrètes : à la table de poker européenne, où on joue avec des cartes françaises, l’Italie se retrouve avec un jeu de cartes napolitaines, convaincue qu’on joue à briscola. Au-delà de la métaphore, les négociations, dans l’Europe de Maastricht, exigent que l’on se présente avec une identité forte, une idée claire de l’intérêt national et de la façon de le promouvoir d’une manière compatible avec le contexte continental, et, qu’ensuite, une fois l’accord collectif conclu, le système décisionnel national soit modifié en harmonie avec cet accord, de manière à s’adapter aux limites qu’il impose et à pouvoir en tirer le meilleur parti. Les deux blocs politico-culturels qui se disputent l’Italie après 1994, la droite hégémonisée par le populisme libéral de Berlusconi et la gauche pro-européenne, sont mal armés pour gérer ces deux moments. Le bloc de gauche est le plus inapte à gérer le premier, car, comme on l’a dit, son objectif dans les négociations continentales n’est pas la promotion de l’intérêt national mais le succès des négociations elles-mêmes. Le bloc de droite est inapte à gérer le second moment, car il rechigne à dompter les enthousiasmes instinctifs — au sens keynésien d’animal spirits — du peuple italien. La grave inefficacité de l’appareil décisionnel public et l’incapacité des deux blocs opposés à trouver un accord sur sa réforme complètent le tableau de la profonde inadéquation de l’Italie à l’Europe.
La grave inefficacité de l’appareil décisionnel public et l’incapacité des deux blocs opposés à trouver un accord sur sa réforme complètent le tableau de la profonde inadéquation de l’Italie à l’Europe.
Giovanni Orsina
Dans les années qui séparent la fin de la première et le début de la deuxième décennie du vingt-unième siècle, sous les coups de la Grande Récession et de la crise de la dette, cette inaptitude conduit à l’effondrement du système politique qui avait pris forme après 1994. C’est le moment où l’optimisme des « longues » années 1990 prend fin définitivement. Le monde protéiforme, tumultueux et ingouvernable de la modernité tardive commence à montrer sa face la moins plaisante, et les Italiens, à la recherche d’un peu de protection, ne savent plus où se tourner. La proposition berlusconienne de reconstruire une identité nationale œcuménique et libérale, pouvait faire sens dans le Zeitgeist de 1989 ; elle est désormais dépassée par l’histoire. L’Europe reste la seule option viable, à tel point qu’à la fin de l’année 2011, avec le gouvernement Monti, l’Italie se retrouve, de fait, mise sous tutelle. Il est assez probable qu’il n’y ait pas eu d’alternative à l’époque. Quoi qu’il en soit, les conséquences de cet événement, sans précédent dans aucun autre pays de l’Union européenne, se font sentir jusqu’à aujourd’hui. Les politiques d’austérité du gouvernement Monti, pro-cycliques dans une phase de récession, convainquent une partie importante de l’opinion publique, à tort ou à raison, que la coïncidence entre les intérêts italiens et européens n’est ni nécessaire ni automatique, et que ce n’est pas à l’Europe que les Italiens peuvent demander d’être protégés des tempêtes mondiales.
C’est ainsi que commence le cycle populiste italien, avec les caractéristiques décrites à la fin de la deuxième partie : l’extraordinaire succès du Mouvement 5 étoiles, ni de droite ni de gauche, aux élections de 2013 ; puis la métamorphose de la Ligue fédéraliste et nordiste en « salvinisme », populiste et nationaliste ; la montée du consensus leghiste-salvinien à partir de 2014, coïncidant avec la crise migratoire ; le succès combiné de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles aux élections de 2018 et la naissance du gouvernement dit « jaune-vert ». Les populismes se sont superposés, contournés et dévorés les uns les autres, jusqu’à ce que, plus récemment, un discours national-conservateur s’affirme en leur sein. Cela nous amène à l’époque actuelle et au probable succès électoral de Fratelli d’Italia.
[Si vous trouvez notre travail utile et souhaitez contribuer à ce que le Grand Continent reste une publication ouverte, vous pouvez vous abonner par ici.]
La droite italienne et l’Europe
Le moment est venu de retisser les fils que nous avons déroulés dans les parties précédentes et d’essayer de comprendre comment ils peuvent éclairer notre présent. Sur la politique italienne, sur la politique européenne, et sur l’impact que celle-là pourrait avoir sur celle-ci.
Le conservatisme national de Giorgia Meloni est une créature très fragile. Pour trois raisons. La première est celle, générale, dont nous avons parlé dans la première partie : la modernité tardive a déconstruit toutes les valeurs sur lesquelles la pensée conservatrice pouvait reposer, la rendant théoriquement impossible et dressant contre elle la grande majorité des élites intellectuelles. Nous avons déjà dit quelque chose de la deuxième raison : il n’y a pas de tradition nationale-conservatrice forte en Italie à laquelle Meloni puisse se référer. Ce n’est donc pas une coïncidence si, après la fin de la guerre froide, lorsque la péninsule a été confrontée au problème de repenser son identité, les réponses ont été l’Europe d’une part et d’autre part l’idée saugrenue, presque prépolitique, d’un peuple composé d’individus. Dans l’histoire politique italienne du XXe siècle, le fascisme et la démocratie chrétienne ont pesé lourdement sur la droite. Mais la tradition fasciste est complètement inutile, et l’effort de Meloni est bien de montrer que son parti s’en est complètement détaché. La tradition démocrate-chrétienne pourrait peut-être reprendre le dessus, mais elle ne serait pas d’un grand secours pour Fratelli d’Italia : c’est une tradition qui n’est que partiellement conservatrice et presque pas nationale ; et c’est une tradition qui, en Italie, a prospéré grâce à sa relation symbiotique avec une Église catholique à la présence forte et affirmée — alors qu’aujourd’hui, l’Église, même si elle a conservé sa pertinence, est beaucoup plus faible, distraite et politiquement divisée.
C’est donc un peu par désespoir que Meloni semble chercher refuge dans la tradition conservatrice anglo-saxonne. Laquelle est extraordinairement riche et profonde, assurément, mais conçue dans des histoires très différentes de celle de l’Italie. Tenter de l’importer dans la péninsule ne peut que créer des difficultés. La compatibilité entre la dimension nationale et la dimension occidentale ne va pas de soi, même dans le monde anglo-saxon, par exemple, mais elle est certainement beaucoup plus naturelle qu’en Italie : un pays qui appartient historiquement à l’Occident, mais dans une position excentrique, et qui n’a pas manqué de mettre cette excentricité au service de son identité nationale. Pour l’instant, également sous l’impulsion du conflit ukrainien, Meloni s’efforce de maintenir ensemble le patriotisme italien et l’atlantisme — mais la relation et le poids relatif de ces deux termes ne sont pas du tout clairs dans sa pensée.
C’est un peu par désespoir que Meloni semble chercher refuge dans la tradition conservatrice anglo-saxonne.
Giovanni Orsina
La troisième raison pour laquelle le conservatisme national de Meloni est fragile tient à l’histoire de son parti : une petite force politique qui, ces dernières années seulement, a gonflé dans les sondages au point de pouvoir briguer la direction du pays. Une force politique qui, en somme, a lancé quelques initiatives culturelles limitées et produit quelques réflexions mais nécessairement à petite échelle et avec des résultats modestes. Il n’y a pas de réflexion ambitieuse derrière Meloni sur ce que pourrait être un conservatisme approprié pour le XXIe siècle, ni sur la contribution que la tradition italienne pourrait apporter à ce projet. Il n’y a qu’une ébauche de raisonnement sur la relation entre la liberté économique et la protection des producteurs nationaux, ce qui, à mon avis, est la question cruciale à laquelle les conservateurs doivent répondre aujourd’hui. L’Italie de Meloni ne dispose pas d’un point de référence intellectuel, ni d’un livre de chevet. C’est la raison pour laquelle les racines post-fascistes de Fratelli d’Italia pèsent négativement : non pas parce que le parti aurait le désir, et encore moins la possibilité, de recréer un régime fasciste en Italie — une hypothèse pour le moins ridicule — mais parce qu’il ne peut pas s’appuyer sur sa tradition et n’en a pas d’autre avec laquelle la remplacer.

Malgré cette fragilité, selon les sondages, Fratelli d’Italia recueillera un quart des voix et la coalition de droite et de centre presque la moitié : le conservatisme impossible, comme mentionné dans le premier paragraphe, est indispensable, car c’est de ce côté que se tourne une partie importante de l’opinion publique. Ce sont des électeurs souvent irrités, ombrageux, volages, géographiquement, culturellement ou socialement périphériques, qui se sentent à tort ou à raison dévalorisés, et dont une partie est passée, entre 2013 et 2018, pour le populisme ni de gauche ni de droite du Mouvement 5 étoiles. La majorité d’entre eux sont sans doute de droite, mais on hésiterait à les définir idéologiquement comme des conservateurs, et encore moins comme des nationalistes : le national-conservatisme vient d’en haut, bien qu’avec les caractéristiques fragiles que j’ai illustrées plus haut, et rassemble — pour cette fois, qui sait pour la prochaine ? — un électorat magmatique en quête de compréhension et d’un peu de protection plutôt que de véritables batailles idéologiques. Néanmoins, le fait qu’une coalition se soit formée à droite, que cette coalition puisse rassembler près de la moitié des voix, gagner les élections et former un gouvernement, et que les trois principaux partis de l’alliance appartiennent à trois groupes différents au Parlement européen, reste un fait historique destiné à avoir, selon toute vraisemblance, des conséquences non négligeables.
Il n’y a pas de réflexion ambitieuse derrière Meloni sur ce que pourrait être un conservatisme approprié pour le XXIe siècle, ni sur la contribution que la tradition italienne pourrait apporter à ce projet.
Giovanni Orsina
L’Italie, on l’a dit plus haut, est un pays fragile, exposé plus que les autres au conditionnement international. Si nous ajoutons cette donnée structurelle à la faiblesse — inadéquation culturelle, concurrence interne, désaccords programmatiques, absence de classe dirigeante — des différents partis de droite et de leur coalition, et si nous inscrivons le tout dans un contexte historique tel que celui que nous connaissons actuellement, marqué par le plan de relance et le conflit ukrainien, nous obtenons comme résultat que la marge de manœuvre de tout futur gouvernement de droite sera très modeste. Certains prédisent déjà qu’il s’agira, à supposer qu’il réussisse à voir le jour, d’un gouvernement éphémère, destiné à avoir la durée de vie « d’un chat sur une autoroute », et que l’Italie reviendra bientôt à un gouvernement gestionnaire de tutelle, comme ceux de Mario Monti et de Mario Draghi, soutenu par le Parti démocrate, référent de l’État profond italien et gardien de la loyauté européenne. Il est possible que cela se produise, même si, bien sûr, ce n’est pas certain. Il s’agira certainement d’un gouvernement qui ne pourra pas aller à la recherche des tensions avec Washington, des grands investisseurs internationaux, Bruxelles, Berlin, Paris. En bref, la coalition de droite et de centre, avec une traction nationale-conservatrice, devra mettre en adéquation ses aspirations idéologiques avec la dure réalité.
Mais si un gouvernement italien de centre-droit se mettait en place dans la durée, un jeu européen plus général, bien que très compliqué, pourrait alors s’ouvrir. Jusqu’à présent, les forces politiques appartenant au groupe des conservateurs et des réformateurs, et plus encore celles qui adhèrent à Identité et Démocratie, ont été maintenues en marge du jeu politique continental, isolées par une sorte de « cordon sanitaire ». Légitimé d’une part par le doute non négligeable quant à la compatibilité d’une perspective explicitement et durement nationaliste avec les institutions européennes, et d’autre part par l’espoir que la rébellion populiste de droite s’avère éphémère et cyclique et soit rapidement résorbée. Or la position prise par exemple par la Pologne dans le conflit ukrainien, mais plus encore le glissement à droite de l’opinion publique européenne, affaiblissent déjà ce cordon sanitaire vis-à-vis sinon des nationaux-populistes, du moins des conservateurs. Un éventuel gouvernement de la droite et du centre en Italie, pays parmi les plus peuplés de l’Union et acteur de premier plan du processus d’intégration depuis ses débuts, un gouvernement centré sur une force politique conservatrice alliée à une force nationale-populiste et populaire, pourrait définitivement couper ce cordon et ouvrir de nouveaux espaces pour un dialogue à droite. Le laboratoire italien, en somme, pourrait anticiper un processus plus général de restructuration de la politique continentale.
Le laboratoire italien pourrait anticiper un processus plus général de restructuration de la politique continentale.
Giovanni Orsina
Ou peut-être pas. Peut-être le cordon sanitaire pourrait-il rester intact, attendant patiemment que le chat de la droite italienne, s’aventurant imprudemment sur l’autoroute, finisse sous les roues d’un SUV. Cette option, qui dans l’immédiat est certainement politiquement moins coûteuse que la précédente, comporte néanmoins au moins deux inconvénients. D’abord, l’échec d’un gouvernement de droite doté d’une solide légitimité électorale — ce serait le premier depuis 2011 — et son remplacement, une fois de plus, par un cabinet de garantie européenne porterait un nouveau coup sévère à l’édifice déjà périlleux de la démocratie italienne. Ensuite, dans une démocratie en danger, la rébellion de l’électorat pourrait prendre des chemins encore plus perturbateurs par rapport à l’équilibre continental. Surtout si cette rébellion devait s’avérer n’être ni éphémère ni conjoncturelle — comme nous l’avons soutenu depuis la première ligne de ce texte.


