Guerre sans frontières, une conversation avec Louis Gautier
Déployant des réflexions historico-politiques sur les conflits depuis 1945 et passant en revue des théories de la guerre jusqu'à l'époque la plus récente, Louis Gautier, Directeur de la Chaire « Grands enjeux stratégiques contemporains » à l'Université Paris-1, a répondu à nos questions sur le dernier volume des Mondes en guerre qu'il a dirigé chez Passés Composés.
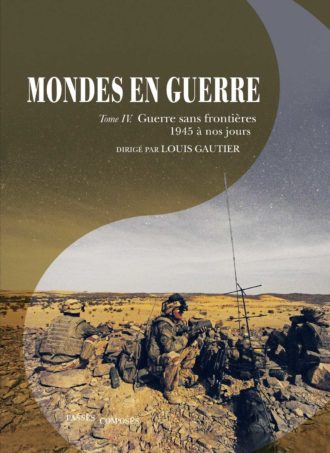
Vous avez fait le choix chronologique de ne pas limiter le volume à la Guerre froide et même à l’intérieur des grandes sous-parties, de ne pas séparer clairement la Guerre froide des trente années qui ont suivi. Pourriez-vous expliciter les raisons de ce choix chronologique ?
Guerre sans frontières, le volume 4 des Mondes en guerre, couvre une période qui va de 1945 à nos jours. C’est, au départ, un choix éditorial que nous avons poussé le plus possible, puisque même des conflits très récents comme celui du Haut-Karabagh sont évoqués dans cet ouvrage. Traiter de la guerre de 1945 à nos jours, en cherchant à dégager l’unité historique sous-jacente à la période, est évidemment une gageure. On considère communément qu’il y a la Guerre froide fermée sur elle-même, tant ses caractéristiques géopolitiques sont singulières et puis un « au-delà » encore mal défini. La Guerre froide est dotée d’une historicité claire mais la période qui suit reste encore béante sur le futur. Pour cette raison, les premières décennies post-guerre froide ont souvent été appréhendées, notamment en Occident, de façon réductrice, soit comme une « après-guerre » libératrice d’énergies auparavant bridées, où capitalisme et démocratie retrouvaient des marges de progrès, soit comme un retour en amont, offrant au monde débarrassé du communisme la possibilité de renouer avec ses anciennes valeurs et de vieilles communautés d’appartenance. La réalité est plus complexe. Comme l’indique la généalogie de certains conflits persistants depuis 1945, l’affrontement entre l’Est et l’Ouest, aux temps de la Guerre froide « n’absorbait » pas toute la guerre. Bien des aspects échappaient à cette grille de lecture bipolaire. Depuis la guerre du golfe de 1991, trois cycles de conflits, (liés à l’effondrement du monde soviétique, aux interventions occidentales au nom de la paix et à la lutte contre le terrorisme au Proche et Moyen-Orient) ont déjà écrit un nouveau chapitre de l’histoire de la guerre. Les conflits humanitaires des années 1990-2000, sans que l’on y prenne garde, ont en effet pavé la voie aux conflits d’aujourd’hui caractérisés par le réengagement des logiques de puissance. En tout cas, dans un laps de temps que l’on peut situer entre 2008 et 2014, plusieurs événements sont venus signaler que le temps de la Pax americana post-guerre froide, caractérisée par la supériorité inégalée des États-Unis vainqueur dans tous les domaines, économique, militaire, géopolitique et culturel, avait, elle-même pris fin. L’histoire avait bien commencé à s’écrire sans simplification ni illusion. Partir de 1945, c’est-à-dire de plus loin, permet de mieux l’interpréter.
Comme je l’indique dans mon introduction, la Guerre froide aurait pu prendre place dans le précédent volume des Mondes en guerre consacré au XXème siècle, ce siècle terminé précipitamment en 1991 avec la fin de l’Union soviétique. Il y aurait eu à ce choix une logique intrinsèque, celle des guerres en chaîne théorisées par Raymond Aron, à partir de l’idée que les mauvaises conditions de la paix — le Traité de Francfort (1871), le Traité de Versailles (1919) ou la conférence de Yalta (1944) — contenaient en germe toutes les causes des affrontements suivants. C’était adopter un point de vue beaucoup plus convenu et moins stimulant. Guerre sans frontières cherche autant à mettre en évidence des tendances historiques lourdes qu’à éclairer les conflits présents et ceux de demain à partir de la mise en évidence de transformations longues dans les affaires militaires. Celles-ci peuvent découler de révolutions technologiques engagées au temps de la Guerre froide mais aussi des leçons opérationnelles tirées des combats et de l’emploi de la force, notamment lors des guerres de décolonisation. Il existe bien, en outre, un avant et un après Hiroshima. L’invention de la bombe atomique et de la dissuasion ont durablement modifié les représentations et l’appréhension de la guerre jusqu’à aujourd’hui. Le péril nucléaire et les missiles intercontinentaux, comme la course à l’espace changent définitivement la donne à partir de 1945.
Le fait nucléaire donne à lui seul une unité à la période traitée. À cet égard, à la fin de la Guerre froide on ne bascule pas dans un monde post-nucléaire, bien au contraire. Le monde, débarrassé de l’équilibre de la terreur, entre dans un second âge nucléaire moins effrayant a priori mais pas moins redoutable. De nombreux autres facteurs interviennent ensuite pour façonner les guerres actuelles. La compétition technologique entre Américains et Soviétiques pour la supériorité militaire et spatiale, le développement de l’informatique à des fins militaires viennent en premier à l’esprit. Dès les années 1980 sont mises au point et, pour la première fois, employées des armes « intelligentes » qui constituent les standards des armées d’aujourd’hui. Les guerres de décolonisation sont asymétriques et irrégulières comme la plupart des conflits des trente dernières années. En ouvrant la focale, Guerre sans frontières entend aussi déjouer le piège dans lequel tombe la plupart des ouvrages spécialisés consacrés à la Guerre froide qui sont excessivement polarisés par le jeu ou le sort de certains acteurs : les grandes puissances, et en premier bien sûr les États-Unis et l’Union soviétique, les pays qui furent les otages — par exemple les Hongrois ou les Tchèques — ou les victimes de l’antagonisme entre l’Est et l’Ouest — Coréens, Vietnamiens, Afghans… L’inconvénient de cette lecture est d’être trop univoque. La logique de la compétition entre les blocs, qui est elle-même une construction idéologique, se trouve systématiquement mise en avant. Elle influence fortement l’interprétation des affrontements armés entre 1945 et 1991, au détriment d’autres dynamiques qui, saisies dans la perspective des conflits d’aujourd’hui, ressortent beaucoup plus nettement. Il en va ainsi des enjeux culturels ou religieux. La fin de la Guerre froide a souvent été décrite comme un « dégel » des anciennes passions nationales et des querelles identitaires, comme si la lutte entre communisme et capitalisme avait mis ces facteurs entre parenthèses. C’était plus un « impensé » idéologique de l’époque qu’une vérité historique.
Guerre sans frontières cherche autant à mettre en évidence des tendances historiques lourdes qu’à éclairer les conflits présents et ceux de demain à partir de la mise en évidence de transformations longues dans les affaires militaires. Celles-ci peuvent découler de révolutions technologiques engagées au temps de la Guerre froide mais aussi des leçons opérationnelles tirées des combats et de l’emploi de la force, notamment lors des guerres de décolonisation.
Louis Gautier
Étudier les conflits dans leur continuité historique depuis 1945 apporte donc de la profondeur de champ aux analyses. La réflexion s’en trouve enrichie et densifiée sans perte de précision pour autant (la période sous revue ne couvre que 75 ans). Ce parti pris pose cependant un sérieux problème d’approche scientifique et de méthodologie. Pour la Guerre froide, nous pouvons d’ores et déjà mobiliser tous les outils de la recherche historique, la littérature est abondante et a connu une forte actualisation après l’ouverture des archives qui a suivi la chute du mur de Berlin. Il y a certes encore d’importantes zones d’ombre mais de plus en plus de documents sont accessibles. En revanche après 1991, tout devient plus incertain, il faut croiser les sources ouvertes et tenter d’objectiver les commentaires et les témoignages. Aussi, Guerre sans frontières fait-il appel à des historiens mais également à des spécialistes de diverses disciplines (science politique, sociologie, économie, droit). On multiplie de la sorte les critères d’interprétation et le paramétrage de questions demeurées actuelles.
Quand vous évoquez la notion de guerres en chaîne du XXe siècle, vous semblez dire que cette logique a été brisée en 1991. Est-ce dû à l’absence d’accord de paix entre les deux superpuissances ? La chaîne de la guerre est-elle vraiment interrompue ?
Cette chaîne est d’abord rompue parce que les antagonismes structurels dont l’épicentre était l’Europe et l’enjeu la domination de l’Europe ont eux-mêmes disparus. Il en reste bien sûr quelque chose mais les sujets de dissension et les tensions militaires en Europe ne tiennent plus en haleine le reste du monde.
À la fin de la Guerre froide personne ne cherche à définir la paix autrement que par un constat. On a retenu les leçons des expériences toxiques du siècle dernier. Après l’éclatement du Pacte de Varsovie et l’explosion de l’Union soviétique en 1991, avec qui d’ailleurs faire la paix ? L’erreur des Américains et des Européens, tout à la satisfaction de leur victoire, a cependant été d’en rester là, de croire que le système international issu de la charte de San Francisco de 1945, pouvait durablement se remettre à fonctionner sans réformer l’ONU. Ressuscité en 1991, le conseil de sécurité, 30 ans plus tard, est de nouveau dans l’impasse. S’agissant de l’architecture européenne de sécurité, les Occidentaux se sont contentés de maintenir l’OTAN en l’élargissant. L’OTAN est sans aucun doute une condition nécessaire à la sécurité du Vieux Continent mais cette condition n’a jamais été suffisante en soi. Il était illusoire de croire que la survie et la transformation de l’OTAN rimeraient, plus longtemps qu’un couplet, avec la marginalisation stratégique et géopolitique de la Russie.
Les guerres du XXème siècle sont des guerres européennes mondialisées. L’Europe affaiblie par des combats fratricides, à la suite des deux conflits mondiaux, s’efface derrière la puissance des États-Unis et de l’Union soviétique. Néanmoins, l’enjeu principal de la Guerre froide reste encore l’Europe. Après 1991, au cœur de l’Europe ne se joue plus le sort du monde. Ce que l’on n’a pas compris tout de suite après la chute de l’Union soviétique, tant la puissance des États-Unis était alors inégalée, c’est que la relativisation du poids stratégique des Européens puis des Russes serait suivie de celle des Américains, donc des Occidentaux, à un horizon d’autant plus rapproché que la mondialisation des échanges dont ils étaient les promoteurs serait un succès et accélèrerait l’essor de l’Asie. Dès la fin de la Guerre froide, le vent de l’histoire ne souffle plus d’Est en Ouest, comme le pensait Hegel, mais de l’Ouest vers l’Est. Là encore, la mise en perspective des conflits de 1945 à nos jours permet de constater bien avant 1991 les efforts entrepris par certains pays, comme l’Iran, afin de conquérir un statut de puissance régionale voire, pour l’Inde et la Chine, un statut de puissance mondiale.
La théorie des guerres en chaîne est restée pertinente tant que la question de l’Europe pour le monde était centrale. Sur le vieux continent, la crispation des relations avec la Russie sur fond d’annexion de la Crimée, de déstabilisation de l’Ukraine et de provocations de toutes sortes en ranime le pâle fantôme. Cependant, à une époque caractérisée par le renforcement de nombreux autres pôles de puissance et la mondialisation des risques cette théorie n’est plus vraiment opérante.
La logique des guerres en chaîne a été rompue parce que les antagonismes structurels dont l’épicentre était l’Europe et l’enjeu la domination de l’Europe ont eux-mêmes disparus. Il en reste bien sûr quelque chose mais les sujets de dissension et les tensions militaires en Europe ne tiennent plus en haleine le reste du monde.
Louis Gautier
Et donc c’est là où l’on bascule, selon l’expression que vous utilisez, dans les conflits en grappe, à l’échelle de continents ?
Les guerres en chaîne trouvent leur origine dans des accords de paix imposés à la suite d’une victoire militaire ou sur un rapport de forces (l’avancée soviétique en Europe centrale au moment de Yalta). Les guerres en grappe se caractérisent, elles, par l’impossibilité de dégager par les armes une issue politique aux conflits. Ce n’est plus l’existence mais l’absence d’accord de paix qui se trouve mise en cause. L’impossibilité de construire la paix sur une victoire militaire se constate dans la plupart des conflits de décolonisation ou intra-étatiques, majoritaires sur la période. Leur conclusion est d’ailleurs entièrement suspendue à la viabilité d’un règlement politique qui est un préalable à la cessation des hostilités. En outre, les puissances tierces qui interviennent dans ce type de conflits pour conforter un régime, stabiliser une ligne de front, s’interposer entre des belligérants ou conditionner le retour à la normale, obéissent depuis 1945 à des logiques de retenue stratégique et/ou opérationnelle qui limitent la poursuite de certains objectifs militaires. Il est plus difficile de mettre fin à une guerre civile qu’à un conflit entre Etats réglé sur des intérêts de puissance, même quand ceux-ci sont mal objectivés. Les conflits intra-étatiques, faute d’achèvement dans un compromis politique accepté par tous, ont donc tendance à tourner en boucle ou à se répéter de façon presque névrotique tels ceux d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie et du Liban, de la République centrafricaine…, avec des effets de contamination régionale. Les conflits durent jusqu’à l’épuisement des causes qui les ont fait naître (l’éclatement de la Yougoslavie) ou la lassitude des combattants, à commencer par celles des intervenants extérieurs. Certaines régions, depuis 1945, sont exposées à la violence des combats, en Indochine, dans la Corne de l’Afrique, au Proche et au Moyen-Orient, dans les Balkans ou le Caucase, dans la région des Grands Lacs, ou dans la bande sahélo-saharienne…, des sociétés sont lacérées, les blessures mettent du temps à cicatriser. Les séquelles entretiennent le ressentiment et causent de nouvelles flambées quand les feux sont mal éteints.
La persistance caractérise le concept de guerre en grappe que j’avais tenté de dégager dans un précédent essai de 2006, Face à la guerre, de même que la contamination à plusieurs foyers (Vietnam, Cambodge, Laos/ Irak, Syrie, Liban/ Tchad, Libye, Mali, Niger…). Les interventions militaires extérieures, censées favoriser l’obtention rapide d’un compromis, font évoluer dans un premier temps les rapports de force sur le terrain puis les figent. La conséquence est, généralement, de faire dévier les dynamiques politico-militaires qui sous-tendaient la décision initiale de recourir à la force. Les solutions de sortie de crise se complexifient et deviennent si longues à mettre en œuvre qu’elles contribuent, elles-mêmes, par leur instrumentalisation, au pourrissement des conflits. Les russes, comme les américains, pour les mêmes raisons quittent l’Afghanistan sur un échec cuisant. Tenir Kaboul et chasser Al Qaïda des grottes de Tora Bora était une première manche militairement réussie mais politiquement sans effet sur la suite. On peut dire la même chose de la prise de Bagdad en 2003.
Le conflit à rebond des Balkans (Croatie, Bosnie, Kosovo) est un cas d’étude intéressant, à la fois parce qu’il s’adosse à un arrière-plan historique antérieur à la Guerre froide et parce qu’il s’achève, pour une fois, sur des perspectives tangibles de retour à une paix durable. Au cœur des populations slaves du sud, ce conflit fait en effet réapparaître, après un long refoulement, la permanence des lignes de fractures héritées des anciens Empires Ottomans et Austro-Hongrois. Le démantèlement de la Yougoslavie qu’il entraîne s’accompagne pour tous les belligérants de la promesse d’un avenir possible dans l’Union européenne, ce qui au début des années 2000 est encore une proposition attractive et crédible.
Vous posez donc un regard critique sur les interventions occidentales post-guerre froide.
Ne mettons pas tout dans le même sac. Certaines actions ont été indiscutablement utiles. Je viens d’évoquer les Balkans. Je ne vois pas comment il était possible de rester les bras croisés devant la création de l’EI en Irak et en Syrie. Les interventions humanitaires qu’il est de bon ton de critiquer ont permis de protéger des populations civiles par exemple au Timor, à Haïti, au Congo, au Libéria, et même, ne l’oublions pas, en 2011 les villes bombardées en Libye. Ces interventions ont été l’occasion de faire progresser le droit international, d’engager la poursuite de criminels de guerre, de protéger des camps de réfugiés. Le chapitre de Jean-Baptiste Jeangène-Vilmer dans Guerre sans frontièrse montre cela clairement. Il n’empêche que l’on peut porter un regard sévère sur certaines interventions – l’invasion de l’Irak en 2003 a été une catastrophe – et être lucide sur les erreurs d’appréciation commises dans plusieurs autres opérations extérieures, dont celles de la France. Difficile et exposée, l’opération Licorne de la France en Côte d’Ivoire (2002-2015) en soutien de l’ONUCI parvient à ses fins. Le dire ne signifie pas pour autant une abdication du sens critique dans l’examen des tenants et des aboutissants de cette intervention. L’ouvrage cherche à décrire et à analyser, à dégager des enseignements objectifs, pas à donner des leçons.
En prétendant s’ériger en gendarmes du monde après 1991, les Occidentaux ont péché à la fois par angélisme et par excès de confiance. Le retour de bâton ne s’est pas fait attendre. L’année 2008 peut servir de marqueur. Les américains et l’OTAN sont englués dans le conflit afghan, la sécurité de l’Irak vire au cauchemar, la crise des subprimes fragilise l’économie des États-Unis et de l’Union européenne, la Russie s’enhardit alors dans un coup de main militaire contre la Géorgie et la Chine affirme sa puissance en devenant le premier créancier des États-Unis. La liberté d’action des américains et des européens sur la scène mondiale n’est plus inconditionnée. Plusieurs puissances régionales, comme l’Iran, mettent en place des stratégies de déni d’accès. L’annexion de la Crimée et l’agression de la Russie contre l’Ukraine en 2014, puis en 2015 son intervention militaire en Syrie signalent une désinhibition de l’usage de la force qui n’est plus seulement l’apanage des États-Unis et de leurs alliés. En regardant agir sur le théâtre syro-irakien à partir de 2015 quatre des cinq membres permanents du conseil de sécurité (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) et quatre des principales puissances militaires de la région (Arabie Saoudite, Israël, Iran, Turquie), chacun avec son propre agenda, on se dit qu’une boîte de Pandore a été ouverte qu’il ne sera pas facile de refermer.
En prétendant s’ériger en gendarmes du monde après 1991, les Occidentaux ont péché à la fois par angélisme et par excès de confiance. Le retour de bâton ne s’est pas fait attendre. L’année 2008 peut servir de marqueur. Les américains et l’OTAN sont englués dans le conflit afghan, la sécurité de l’Irak vire au cauchemar, la crise des subprimes fragilise l’économie des États-Unis et de l’Union européenne, la Russie s’enhardit alors dans un coup de main militaire contre la Géorgie et la Chine affirme sa puissance en devenant le premier créancier des États-Unis.
LOUIS GAUTIER
À vous entendre, il y aurait une multiplication des opérations depuis 1991 mais une perte de l’efficacité de l’action militaire ?
Il faut s’entendre sur ce que vous mettez derrière le terme efficacité. Tout dépend de la nature des conflits et de l’effet final recherché. À notre époque, le contrôle des flux physiques ou des données numériques est devenu le principal des enjeux. Dans beaucoup de conflits, la maîtrise d’un territoire, la possession de gisements naturels ou l’exercice du pouvoir ne sont plus des objectifs directement visés tant la dépense d’énergie et de moyens est jugée disproportionnée. Pourquoi détruire ce que l’on peut conquérir autrement et pourquoi conquérir ce que l’on veut contrôler ? À quoi bon subjuguer un régime politique que l’on peut manipuler ? Al Qaïda se contente de parasiter le pouvoir taliban à Kaboul. En Géorgie ou en Ukraine, les chars russes font incursion en Ossétie et dans le Donbass mais n’ont pas besoin de pousser plus loin pour faire plier, en multipliant les pressions, les gouvernements de Tbilissi et de Kiev. La stratégie d’implantation de la Chine en Afrique n’a rien à voir avec les politiques expéditionnaire ou impérialiste d’antan même si elle s’adosse depuis 2017 à une puissante base militaire à Djibouti. Il est de toute façon plus aisé de contrôler des voies et des réseaux de communication ou des flux financiers que des populations. Les stratégies hybrides qui mêlent actions indirectes, manipulations de l’opinion et engagements militaires limités sont efficaces et moins risquées.
Dès lors que la conquête d’un territoire, l’appropriation de ressources, l’anéantissement des forces de l’adversaire, voire la notion d’ennemi à abattre, ne sont plus des finalités en soi, la victoire militaire devient une étape non conclusive de la plupart des conflits contemporains, en particulier lorsque l’intervention vise à renverser un régime, rétablir l’État de droit ou à stabiliser un pays en proie à des troubles. Ce constat vaut surtout après 1991 et de toutes les façons pas pour tous les conflits. Les guerres de Corée, du Vietnam, entre l’Iran et l’Irak, en Irak ou en Syrie tablent sur l’efficacité militaire et sont aussi particulièrement destructrices. Le chapitre consacré par Renaud Bellais aux politiques d’armement ou celui d’Olivier Schmitt sur les alliances et les coopérations de défense montrent que la performance et l’efficience de leur outil militaire sont des préoccupations cruciales et constantes pour toutes les puissances de premier rang.
Le livre mêle la question des guerres coloniales à celle de la Guerre froide. Mais le paradigme de la Guerre froide n’écrase-t-il pas l’importance des guerres coloniales ? Comment signaler l’importance et la spécificité des conflits coloniaux, notamment en Afrique ?
Le chapitre d’Elie Tenenbaum qui traite du terrorisme et des guerres irrégulières insiste sur cette question fondamentale, j’y reviens moi-même longuement. Pour les puissances coloniales, la décolonisation marque la fin d’un système de domination ; pas pour les sociétés qui ont eu à subir les conséquences de cette domination et les effets des conflits de décolonisation. On évoque les frontières artificielles héritées de la colonisation et des mandats coloniaux pour expliquer de nombreux différends qui dégénèrent en conflit. La responsabilité coloniale ne se résume cependant pas à de simples erreurs de tracé. Dans beaucoup de pays, les injustices et les brutalités de la colonisation nourrissent encore la violence qui s’exprime aujourd’hui. En outre, la décolonisation ne signifie pas la fin de la domination et des logiques impériales ni bien sûr de l’animosité qu’elles peuvent encore susciter. Laver l’affront d’un siècle d’humiliation coloniale est un motto de la diplomatie de Xi Jiping, habilement exploité à des fins politiques internes en Chine mais aussi à l’extérieur auprès de nombreux pays d’Asie ou d’Afrique, eux-mêmes colonisés.
Le 11 Septembre, aux causes trop nombreuses pour être évoquées ici, plonge ses racines dans toute une série de causes réelles et de motifs allégués à l’origine de frustrations et d’un ressentiment profond à l’égard de l’Occident, des anciennes puissances coloniales européennes et de l’Amérique qui les a remplacées en jouant le rôle de parrain régional pour de nombreux régimes du Proche et du Moyen-Orient.
En Afrique, l’engagement militaire de certains pays, en premier lieu la France mais aussi le Royaume-Uni et de façon moindre la Belgique ou le Portugal, voire l’Italie en Libye, reste marquée par des adhérences à leur passé colonial. La France, en application d’accords de coopération militaire signés dans les années 1960 puis renégociés dans les années 1990 et 2000, intervient militairement plus souvent qu’à son tour depuis 1945 dans ce que certains désignent encore comme « son pré carré ». Les motifs et les modalités de ses engagements militaires ont évolué, pas la propension française à l’interventionnisme. Au temps de la Guerre froide, la raison principale des opérations de la France en Afrique était le soutien aux régimes en place. Dans les décennies postérieures, les engagements militaires français sont menés au nom du maintien de la paix, de la stabilité et du rétablissement de l’État de droit, de la lutte contre la piraterie. Il ne faut pas ignorer l’implication militaire des États-Unis en Afrique, par alliés interposés au temps de la Guerre froide puis directement ensuite notamment dans la lutte contre le terrorisme. On constate, en outre, une intensification de la coopération et de la présence militaire d’autres pays sur ce continent au cours de la décennie 2010 : le retour de la Russie, en particulier active en Libye et en RCA, l’implantation de la Chine qui a notamment ouvert, en 2017, une base à Djibouti, des interventions de pays arabes comme l’Arabie saoudite et le Qatar au Machrek et de la Turquie en Libye.
La superposition d’enjeux territoriaux, de problématiques humanitaires et de fortes ingérences extérieures est une caractéristique des conflits africains contemporains.
On évoque les frontières artificielles héritées de la colonisation et des mandats coloniaux pour expliquer de nombreux différends qui dégénèrent en conflit. La responsabilité coloniale ne se résume cependant pas à de simples erreurs de tracé. Dans beaucoup de pays, les injustices et les brutalités de la colonisation nourrissent encore la violence qui s’exprime aujourd’hui.
Louis Gautier
Pouvez-vous revenir sur le Rwanda, dans quelle mesure cette catastrophe qui vient clore le XXème siècle, est-elle une conséquence des politiques coloniales européennes, comment comprendre la (non) intervention française pendant le génocide des Tutsis ?
Le Rwanda qui s’effondre dans la plus atroce des guerres civiles génocidaires en 1994 est issu d’un Royaume pluriséculaire constitué bien avant la colonisation. Les trois groupes humains qui le composent, les Twas, les Tutsis et les Hutus, parlent une même langue, le kinyarwanda, et avaient autrefois la conscience d’appartenir à une même société féodale. Ni l’érection du Rwanda en État-nation indépendant en 1962 ni la délimitation de ses frontières ne constitue en soi un problème. En revanche, la gestion coloniale de ce territoire par l’administration allemande puis belge a laissé un terrible héritage. En opposant Tutsis et Hutus sur de pseudo-bases racialistes, les puissances coloniales, pour régner, ont semé les germes de la haine et de la division. Les violences attisées durant la colonisation et à la veille de l’indépendance vont persister, entraînant des pogroms réguliers contre les Tutsis puis le génocide dont ils furent victimes en 1994. Le passif colonial est lourd.
À une époque qui, notamment en matière militaire, a tendance à égaliser les niveaux de responsabilité en plaçant sur le même plan l’auteur des actes commis, intentionnellement ou non, celui qui s’en est rendu complice et celui qui s’est abstenu d’intervenir, mieux vaut être précis. Les archives françaises viennent de parler. Le rapport de Vincent Duclert qui les a exploitées conforte mon opinion. Notre pays poursuivit, après la Guerre froide, une politique d’extension de son influence en Afrique et de renforcement de sa position dans la région des Grands Lacs. Cette ambition était alimentée par une rivalité, à vrai dire assez chimérique, avec les « Anglo-saxons » porteurs d’un dessein jugé concurrent. La France a donc entrepris de réformer et de développer sa politique de coopération militaire vis-à-vis de ses alliés africains traditionnels et en direction des ex colonies belges, dont le Rwanda du président Habyarimana. Comme chacun sait, l’assassinat de ce dernier, dont l’avion a été abattu en plein vol par un missile, a été l’événement provocateur ou le prétexte au déclenchement du génocide des Tutsi (7 avril 1994). La France, soutien du régime d’Habyarimana, s’est-elle pour autant rendue complice du génocide ? Rien dans les archives consultées par la commission Duclert ne vient le démontrer. La France s’est néanmoins longtemps investie aux côtés d’un régime qui encourageait des exactions et des massacres racistes. Elle est demeurée aveugle face à la propagande haineuse appelant au crime de masse par les éléments les plus radicaux de ce régime. L’opération Turquoise qui visa ensuite à empêcher la perpétuation des massacres a certes tardé à se mettre en place. Elle n’entre en action qu’en juin 1994 après de longs conciliabules engagés en avril à l’ONU sur la compatibilité/complémentarité d’une telle opération avec la mission de la force multinationale de l’ONU, la MINUAR. La MINUAR, commandée par un général canadien Roméo Dallaire, avait été déployée fin 1993 pour faire appliquer les accords d’Arusha. Elle était donc en phase opérationnelle au début du génocide qu’elle a été incapable d’empêcher vu son mandat limité et ses faibles moyens, encore amoindris par le départ du contingent belge. L’opération Turquoise, en porte-à-faux politique, a été particulièrement difficile et éprouvante pour les militaires français. Les responsabilités françaises sont « lourdes et accablantes » pour reprendre les termes des conclusions du rapport Duclert. La passivité de la communauté internationale est aussi critiquable que l’absence de réactivité de l’ONU. Un des intérêts de la mission Duclert est aussi d’avoir essayé de mettre en évidence les différences de positions au sein de l’appareil d’Etat, en période de cohabitation, entre le président François Mitterrand, le premier ministre Edouard Balladur et son ministre de la défense François Léotard. Il ressort aussi que Pierre Joxe, son prédécesseur, dès 1992, avait alerté l’Élysée sur l’autonomisation problématique d’une chaîne de commandement parallèle concernant notre coopération militaire au Rwanda et mis en garde contre des risques de dérives.
Au Rwanda, la France s’est longtemps investie aux côtés d’un régime qui encourageait des exactions et des massacres racistes. Elle est demeurée aveugle face à la propagande haineuse appelant au crime de masse par les éléments les plus radicaux de ce régime.
Louis Gautier
Le Rwanda, ce « génocide à la machette », comme la « Shoah par balle » ou le génocide arménien constitue une des pages les plus terribles du XXème siècle. La création de la Cour pénale en 1998, à la suite de la mise en place des tribunaux permanents sur le Rwanda et la Yougoslavie, a pour origine la volonté de ne plus laisser les crimes contre l’humanité impunis.
Votre introduction propose une analyse générale du phénomène guerrier, marquée par la lecture de Hobbes et de Clausewitz, deux références anciennes et toujours pertinentes. Justement, la permanence de la guerre dans l’histoire, n’en fait-il pas un phénomène anhistorique par excellence ? Comment arrive-t-on à étudier des guerres dans le temps alors qu’il y a des guerres tout le temps ? Ce qui m’amène en fait à une deuxième question, qui est liée mais qui est quelque chose qui m‘a beaucoup frappé dans le livre : de savoir si l’étude des armes n’est pas au fond la manière la plus pertinente de faire une étude sur le temps long du phénomène guerrier – vous parlez notamment à un moment de l’arc gallois.
Il m’a semblé qu’au terme d’une histoire de la guerre, commencée aux temps préhistoriques par le volume 1 des Mondes en guerre, une réflexion de nature philosophico-politique en surplomb pouvait apporter un éclairage complémentaire. Les approches anthropologiques, sociologiques ou économiques souvent mobilisées pour expliquer la guerre dans la littérature contemporaine en tentant de l’objectiver rencontrent, elles aussi, leurs limites. [Il faut d’ailleurs reconnaître, en passant, que contrairement aux grandes guerres du passé, les conflits armés depuis 1945 ont peu perturbé ou transformé l’ordre économique mondial, bien moins que les crises économiques affectant le monde capitaliste avant 1991 (chocs pétroliers) ou que celles affectant, plus globalement, l’ensemble des échanges mondiaux par la suite (crise bancaire et financière de 2008, pandémie de Covid-19).
Comment, cependant, éviter de tomber dans le piège des idéologies de la guerre ou des conceptions transcendantales de la guerre ou qui l’essentialisent de façon mortifère ? Les spécialistes contemporains de la guerre adoptent, pour cette raison, une attitude distanciée et critique par rapport aux théories philosophiques en vogue aux XIXe et XXe siècles (de Friedrich Hegel à Carl Schmitt). Ils affichent une certaine réserve à l’égard des études historiques trop « démonstratives » (comme celles de Victor Davis Hanson sur le « modèle occidental de la guerre »). Ils sont également méfiants vis-à-vis de la Grande stratégie soupçonnée de nourrir une ambition autoréalisatrice (critique qui vise par exemple aux États-Unis, hier, les écrits d’Alfred Mahan et aujourd’hui, ceux d’Edward Luttwak).
Tirer une explication globale, c’est prendre le risque d’une justification politique et morale à la guerre. Après la seconde guerre mondiale, c’est apparu comme le plus grand des dangers. Je vous renvoie, sur ce point à de nombreux penseurs et à Hannah Arendt en particulier. Il est d’ailleurs intéressant de noter, comme nous le faisons, Bénédicte Chéron et moi, dans Guerre sans frontière, combien les arts contemporains évitent de représenter la guerre par crainte de la magnifier, même involontairement, en sublimant ses abominations. On peut associer les guerres du passé à de grandes œuvres glorifiant des héros ou s’attardant à décrire toutes ses atrocités, comme le firent Callot ou Goya ou encore Picasso. Depuis 1945, et pas seulement parce que beaucoup de courants artistiques tournent le dos à la figuration, les représentations de la guerre se tiennent généralement au plus près de sa réalité, privilégiant les arts visuels (la photo, le cinéma, la vidéo). Pas de Guernica mais des images ou des séquences emblématiques qui cherchent à délivrer un message brut plus qu’une symbolisation.
Comment étudier la guerre quand il est impossible de lui donner un seul visage ? Il n’y a pas grand-chose de semblable entre une campagne du maréchal de Saxe, la longue guerre du Vietnam, la chasse aux Talibans dans les grottes de Tora Bora déjà évoquée ou encore les combats de ville en Irak et en Syrie. Et pourtant, le sens commun reconnaît qu’il existe entre tous ces événements disparates une parenté. J’emprunte à Wittgenstein sa notion de « concept à bords flous ». Il en va de la guerre comme du jeu (football, tennis, échec, poker…). Tout le monde comprend de quoi il s’agit sans pouvoir en donner une définition plus précise. La différence entre le jeu et la guerre, souvent comparés, c’est le lien historique. La finale de la coupe du monde de football entre l’Uruguay et l’Argentine en 1930 est sans incidence directe sur le résultat des matchs Allemagne contre Argentine de 1990, ou France-Brésil de 1998. Il y a en revanche des interconnexions entre les conflits, et pas simplement comme le faisait remarquer Adorno en raison du progrès technique, qui mène de la fronde, ou de l’arc gallois ou du carreau d’arbalète à la bombe atomique.
Il n’y a pas grand-chose de semblable entre une campagne du maréchal de Saxe, la longue guerre du Vietnam, la chasse aux Talibans dans les grottes de Tora Bora déjà évoquée ou encore les combats de ville en Irak et en Syrie. Et pourtant, le sens commun reconnaît qu’il existe entre tous ces événements disparates une parenté. J’emprunte à Wittgenstein sa notion de « concept à bords flous ». Il en va de la guerre comme du jeu (football, tennis, échec, poker…). Tout le monde comprend de quoi il s’agit sans pouvoir en donner une définition plus précise.
Louis Gautier
Je crois que la guerre ne se connaît que par l’étude des cas particuliers, eux-mêmes conditionnés par l’état des mœurs et des idées, mais concrètement aussi par celui des techniques. La guerre s’appréhende dans des cas particuliers mais il ne faut pas la faire disparaître dans ces cas particuliers. La guerre se comprend comme un processus historique et par son inscription dans l’histoire des sociétés. À ce double titre, elle doit s’analyser comme un événement et une information, un élément circonstancié (le conflit du Kosovo en 1999) ou un bloc d’historicité (la Guerre froide de 1945 à 1991). C’est la proposition de ce livre.
Est-ce l’irruption du nucléaire qui a transformé notre monde en un monde de « guerre sans frontières » ? Plus généralement, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par cette expression qui donne son titre à l’ouvrage ?
C’est une première raison déjà évoquée. Après 1945, le monde est l’otage d’une menace planétaire et ne s’en est toujours pas affranchi, même si comme le montre Nicolas Roche dans un chapitre sur ce sujet, la prolifération constatée après 1998 transforme l’équation nucléaire et le « rendement » de la dissuasion. La crainte d’une catastrophe imminente s’est réduite. L’interdit moral et l’interdiction stratégique attachés aux logiques de pure dissuasion semblent à la fois s’effriter et se dissocier.
Le titre Guerre sans frontières exprime cette première évidence. L’allonge des missiles et les effets d’une frappe nucléaire au-delà de son point d’impact se moquent bien des frontières. Mais ce titre en exprime d’autres. Même confiné géographiquement, aucun conflit depuis 1945 n’échappe, dans le temps devenu réel de l’information et celui différé du jugement de l’opinion, à une exposition planétaire, pas plus le Vietnam que le Biafra (1967), pas plus le Rwanda que la Syrie. Mais il faut aller au-delà de cette simple observation. La globalisation de l’information participe d’une mondialisation des motifs de conflictualité et des enjeux idéologiques associés. Aujourd’hui, dans le monde hyper connecté et saturé de communication, on voit combien les croyances religieuses, les valeurs culturelles, les opinions nationales ont au moins autant tendance à s’affronter qu’à se nuancer au contact de l’autre. L’information qui tend à mettre sur le même plan tous les risques et les dangers fait, en outre, croître partout une insatiable demande de sécurité. Celle-ci fait voler en éclats toutes les catégories autrefois utiles pour penser la guerre et gérer la violence. Il n’y a, notamment, plus de solution de continuité entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure des États. La lutte contre Daech en témoigne. Elle fit intervenir à partir de 2014 aussi bien les services de renseignement et de police que les forces militaires des pays agressés (États-Unis, France, Royaume-Uni…) à la fois sur leur territoire national et dans des zones de conflits. Il en est de même de la réponse conjuguée des agences de sécurité et des armées face à la menace cyber. Ultimatum, déclaration de guerre, trêve, cessez-le-feu, armistice, toutes ces notions qui servaient à régler autrefois les conflits, à séparer juridiquement et politiquement le temps extraordinaire de la guerre et le temps ordinaire de la paix ont été remisées au magasin des accessoires. La place de la technologie, sur lesquelles revient Corentin Brustlein, est majeure dans les conflits contemporains et entraînent leur « déterritorialisation » progressive. Les avancées de la technologie ont, en effet, permis de s’affranchir des contraintes spatio-temporelles qui fixaient des limites physiques à la conduite des opérations militaires. Depuis plus de trente ans, les satellites (radars, d’observation, électromagnétiques ou de communication) permettent de recueillir, en tout temps et en tout lieu, des connaissances sur les moyens et les préparatifs d’un adversaire ; ils permettent aussi d’ordonner et d’exécuter des actions militaires préemptives ou de rétorsion. La guerre ne se fait plus nécessairement sur place. On peut téléguider, en direct et à distance, des frappes ciblées, ce qu’illustre l’emploi quotidien des drones dans les guerres d’Irak, de Syrie et du Mali. Affranchie des limites de temps et de lieu, la guerre s’aventure aussi dans les nouveaux espaces matériels ou immatériels que la science permet à l’homme d’explorer de façon infinie : espace extra-atmosphérique, grands fonds marins, espaces cyber, domaine des communications. Il n’a guère fallu attendre longtemps pour que ces espaces, dont l’exploitation était conçue pour demeurer pacifique, ne deviennent un lieu de compétition et d’affrontement tout en faisant l’objet d’une militarisation progressive.
Les conflits contemporains sont-ils l’un des symptômes de la multiplication des acteurs géopolitiques : États, organisations internationales, organisations supranationales, groupes armés transnationaux ?
Les conflits contemporains, le plus souvent intra-étatiques, impliquent des armées régulières mais s’accompagnent de la participation ou de l’implication de plus en plus active d’acteurs non étatiques (ONG, organisations terroristes, firmes multinationales, sociétés de sécurité, mercenaires, hackers, proxy…). Je vous renvoie sur ce point au chapitre de Pascal Venesson. Sur plusieurs théâtres, on observe une privatisation partielle de la guerre à travers la sous-traitance de certaines missions à des sociétés telles Haliburton ou Blackwater employées par les Américains en Irak ou le Groupe Wagner auquel les Russes eurent recours en Ukraine, en Syrie ou en Libye. Ces pratiques font penser aux « lettres de commissions » et aux corsaires ou aux compagnies de mercenaires d’antan.
Ce qui est nouveau, par rapport à ces exemples tirés du passé, c’est que certains acteurs non étatiques, par leur richesse et les profits accumulés, sont en en mesure d’entrer en concurrence avec les États. Le chiffre d’affaires de certaines grandes sociétés est supérieur au budget de beaucoup d’États. L’un des effets de la mondialisation a été de fragiliser la garantie ultime que les États sont censés apporter à leurs ressortissants. Pour les grands pays développés, cette garantie demeure : on l’a vu pendant la crise financière de 2008 ou, en ce moment, avec la pandémie. Dans certains pays fragiles, où l’État est en permanence menacé de paralysie, certains acteurs privés sont appelés pour les suppléer, y compris en matière de sécurité, pierre de fondation de la souveraineté. À côté de l’internationalisation de certaines organisations terroristes comme Al Qaïda ou Daech qui parasitent des États faillis, les solutions privées de sécurité se multiplient et changent la donne.
Vous écrivez que chaque conflit se produit sous les yeux du monde entier. Pourtant, la guerre comme phénomène n’est pas appréhendée de la même manière partout sur le globe. Quelles conceptions, quelles appréhensions de la guerre cohabitent aujourd’hui ?
C’est une question qui appelle forcément une réponse un peu schématique. Essayons néanmoins. Certaines régions sont des zones de concentration des conflits quand d’autres sont plutôt épargnées. Le Moyen-Orient, où se superposent terrorisme, conflits communautaires et interventions extérieures, est à feu et à sang. L’Afrique ne parvient pas à se sortir de conflits endémiques qui entravent son développement. Sur fond de prolifération nucléaire, de course aux armements, de tensions entre la Chine, les États-Unis et leurs alliés régionaux, l’Asie voit réapparaître le risque de conflits interétatiques durs. Quant à l’Europe qui, après la Guerre froide, se croyait débarrassée du spectre de la guerre, elle voit les désordres s’accumuler à sa périphérie et sa cohésion est mise à mal. Ce sont ses vulnérabilités qui l’exposent. Elle est plus menacée par des actions qui sapent sa sécurité et sa stabilité politique que par le risque d’une agression frontale. Chacun voit donc midi à sa fenêtre, c’est logique.
Ce qui est nouveau, c’est que certains acteurs non étatiques, par leur richesse et les profits accumulés, sont en en mesure d’entrer en concurrence avec les États. Le chiffre d’affaires de certaines grandes sociétés est supérieur au budget de beaucoup d’États. L’un des effets de la mondialisation a été de fragiliser la garantie ultime que les États sont censés apporter à leurs ressortissants.
Louis Gautier
Cependant, tant qu’un continuum de sécurité continuera d’exister entre plusieurs puissances nucléaires (Chine, Russie, États-Unis, France, Royaume-Uni, Inde) et à condition que le réaménagement des équilibres stratégiques dans la zone Asie Pacifique n’induise pas d’effet déstabilisateur massif, la paix mondiale, en dépit de l’existence de conflits, devrait pouvoir être préservée. C’est l’intérêt bien compris des grandes puissances.
La Chine est en phase d’épanouissement d’une puissance économique et militaire considérable. Mais les Chinois, sauf pour la domination de ce qu’ils considèrent comme leur espace de souveraineté et la protection de leurs voies de communication, n’ont pas besoin de la coercition militaire pour parvenir à leurs fins. La puissance économique et technologique suffit. Leur « vision du monde » fait une large place à la coopération et à une certaine forme de multilatéralisme même si leur politique extérieure ne reconnaît pas d’autre légitimité que la légitimité nationale. Difficile dans ces conditions de s’entendre avec eux sur la définition d’un monde commun, faisant notamment place à la démocratie et à la reconnaissance de la liberté politique.
La Russie a des marges d’action beaucoup plus étroites. Peu ou prou, son PIB est celui de l’Italie. Trente ans après la disparition de l’Union soviétique, elle s’applique à reconquérir une stature internationale en exploitant notamment les erreurs des Américains, en intimidant par des provocations et des actions en sous-main les Européens, en modernisant ses forces armées avec d’indéniables réussites technologiques dans certains domaines. Elle s’oppose aux valeurs de la démocratie libérale – rencontrant en cela un écho auprès de la Chine et chez certaines puissances émergentes – et conteste une donne internationale qu’elle estime à son désavantage. La Russie, limitée matériellement dans ses ambitions, notamment par la politique de sanctions économiques qui lui est infligée depuis l’annexion de la Crimée, ne peut cependant pas espérer retrouver le rôle mondial qu’elle jouait du temps de l’Union soviétique. Elle joue les troubles fêtes et empoche des victoires tactiques. Son intérêt n’est pas d’aller au clash. Même si comme la Chine, dont le régime est cependant plus stable et l’ordre social mieux tenu, un certain « aventurisme » militaire peut la tenter par nationalisme et à des fins internes. Instruits par les leçons de leur propre guerre en Afghanistan, les Russes, avant les Américains, ont mesuré les inconvénient d’une politique expéditionnaire. L’évolution de leur doctrine, comme l’analyse Yves Boyer dans son chapitre, en témoigne.
De leur côté, les Européens sont mal armés collectivement pour relever les défis stratégiques futurs, ceux qui s’expriment déjà dans de nouvelles dimensions de conflictualités (espaces cyber, extra-atmosphérique, sous-marin) ou qui impliquent le financement et la mobilisation de nouvelles technologies (hyper-vélocité, intelligence artificielle, ordinateur quantique…). Ces défis stratégiques sont de taille et aucun pays européen n’est en mesure d’y répondre individuellement de façon efficace. La défense européenne patine tout comme la prise en compte collective des enjeux de sécurité (sanitaire, cyber, terrorisme…). Dans l’absolu, les pays européens auraient tout intérêt à affermir leur contribution à cette mission de défense collective et à rationaliser des appareils militaires qui comportent aujourd’hui autant de redondances que de carences capacitaires. C’est cependant une entreprise de longue haleine qui suppose non seulement la convergence des processus d’acquisition en commun des équipements militaires européens mais aussi la consolidation de la base industrielle et technologique de défense de l’Union. Tous ces sujets touchent cependant à la souveraineté des Etats membres donc sont difficiles à traiter avec efficience. Comment à l’avenir l’Europe sera-t-elle en mesure de mieux se protéger dans les crises et d’assurer sa propre sécurité ? Est-elle encore en situation de faire prospérer, même seulement dans son environnement, les valeurs démocratiques et les droits de l’homme auxquels elle est attachée ? Comment défend-elle ses intérêts stratégiques face aux grandes puissances mondiales (Chine, Etats-Unis, Russie) et ses intérêts de sécurité face à des puissances régionales (Iran, Turquie…) qui cherchent à s’imposer ? Sans unité, les temps qui s’annoncent seront difficiles.
Quant aux Etats-Unis, dégrisés de leur superbe et revenus de la politique de Donald Trump qui, sur la scène internationale, a contribué à miner leur crédit, ils ont toujours beaucoup de cartes en main et pour ainsi dire toutes notamment sur les plans économique, technologique et militaire. On attend d’eux qu’ils jouent le rôle d’une puissance d’équilibre, capable de compromis. Il leur faut pour cela ne pas céder à deux tentations, celui du retour en arrière, en s’appuyant, sans intention de réforme, sur des institutions multilatérales dépassées ou celui de la fuite dans un antagonisme effréné avec la Chine.
Peut-on déjà parler d’une nouvelle Guerre froide entre les États-Unis et la Chine ?
Ceux qui, comme Graham Allison, prophétisent cela en entendant influencer la stratégie américaine, reproduisent un schéma mental funeste (on se souvient de la caricaturale théorie des Rogues states contre l’Iran ou l’Irak). La désignation d’un ennemi quand on fait la course en tête est généralement contreproductive.
Les États-Unis ne sont pas sûrs de fédérer derrière ce slogan leurs alliés. Au temps de la Guerre froide, l’enjeu pour de nombreux pays était existentiel, comme l’obligation de choisir un modèle de société. Une guerre froide entre Chine et États-Unis, c’est-à-dire entre deux formes de capitalismes mondialisés ? C’est un peu surréaliste, non ? Une nouvelle alliance des démocraties contre le modèle de société chinois ? Outre que l’agressivité n’est pas le meilleur vecteur de propagande des idéaux démocratiques, cette croisade pourrait-elle ignorer la situation des droits de l’homme en Russie mais aussi en Arabie saoudite ou en Turquie ?
Les États-Unis ne sont pas sûrs de fédérer derrière ce slogan leurs alliés. Au temps de la Guerre froide, l’enjeu pour de nombreux pays était existentiel, comme l’obligation de choisir un modèle de société. Une guerre froide entre Chine et Etats-Unis, c’est-à-dire entre deux formes de capitalismes mondialisés ? C’est un peu surréaliste, non ?
Louis Gautier
Surtout, les Chinois n’ont aucune envie de tomber dans le piège d’une course aux armements poussée à l’extrême, comme celle qui mit KO l’URSS. La compétition sera très vive, presqu’à couteaux tirés, mais se fera principalement dans des domaines technologiques d’application civiles ou duales.
J’ai en main le 4e volume de Mondes en guerre. Selon vous à quoi ressemblera le 5e volume ? Dans les trente ou quarante prochaines années, quelles seront les grandes évolutions de la guerre au XXIe siècle ?
On a eu du mal à trouver une couverture. Celle que nous avons choisie est une représentation d’une section d’infanterie apostée avec ses moyens de communication dans un environnement désertique et sous un ciel étoilé, qu’on imagine constellé de satellites. Le rôle de l’homme est toujours central dans les conflits de 1945 à nos jours. La guerre de demain pose une question vertigineuse : quelle y sera la place de l’homme ? Il y aura toujours la nécessité d’aller au contact, ne serait-ce que dans des situations qui supposent le rétablissement de paix civile. Certaines missions de combat complexes ou hautement sensibles impliquent la présence de l’homme en quelque sorte toujours seul maître à bord. Mais la tendance va vers un éloignement voire un effacement de l’homme dans la conduite de certaines actions opérationnelles. Les armes (missiles, drones, canons de dernière génération…) mettent de plus en plus de distance entre les combattants. L’intégration de l’homme dans la machine pose des problèmes d’ergonomie mais aussi de mise en œuvre opérationnelle des systèmes embarqués (furtivité, permanence de la manœuvre, subsituabilité…) que l’autonomisation, la miniaturisation et l’inflation des vecteurs simplifient. Autre constat, le point haut de la guerre, celui dont la maîtrise conditionne la supériorité militaire, se déplace de l’espace aérien vers ses dimensions exo et extra atmosphériques.
La pierre, le fer, le feu, l’atome, les armes de cinquième génération sont des bits. Une révolution de l’art de la guerre est à l’œuvre, non seulement au travers de sa nouvelle dimension numérique mais aussi grâce aux multiples applications de l’intelligence artificielle, de l’aide à la décision à la robotisation du champ de bataille. C’est sur cette révolution que se conclut Guerre sans frontières et sur le constat qu’un cycle pluriséculaire de l’histoire de la guerre dominé par la pyrotechnie est en train de s’achever sous nos yeux. L’électronique et l’intelligence artificielle n’évincent pas les armes classiques du champ de bataille mais elles les dirigeront de plus en plus en permettant, grâce à leur automation, de les affranchir des contraintes de milieux si limitatives pour l’homme.

