Encre sympathique
« Cette gamme musicale du souvenir, qui joue comme lui sur les effets de silence et de refrain, sur une indistinction croissante entre ce que l’on découvre, ce que l’on redécouvre et ce que l’on invente, donne la texture sensible du tâtonnement de l’écriture modianesque au contact de la matière fragile qu’est l’oubli. »
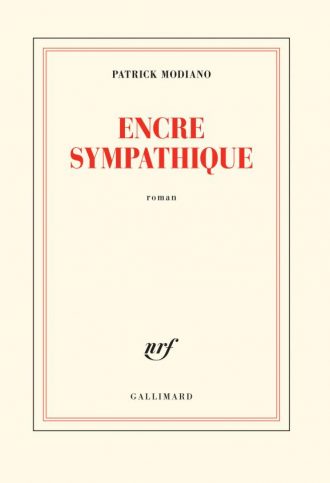
Encre sympathique : « encre qui, incolore quand on l’emploie, noircit à l’action d’une substance déterminée. » (p. 91) En nous rappelant la définition de cette étrange objet qu’est l’écriture invisible, la trace graphique inaccessible au premier regard, Patrick Modiano nomme non seulement ce qui caractérise la promenade déroutante que constitue son dernier livre, mais également ce qui pourrait être une métaphore de l’ensemble de sa quête littéraire.
À première vue, le dernier récit du Prix Nobel de littérature 2014 ne diffère pas fondamentalement des précédents. Il nous plonge dans un univers familier, fait de promenades parisiennes, d’une conscience aiguë du passage du temps qui produit à son tour une sorte de lucidité mélancolique propre au narrateur modianesque – les années 1960 répondent au contexte immédiat d’écriture du texte –, et d’un je-ne-sais-quoi qui habite spécialement les dialogues de Patrick Modiano, une sorte de douce incohérence, à la manière des films d’Aki Kaurismäki, vestige d’une époque – rêvée ou vécue – où il aurait été possible qu’une parole ne soit pas exactement la réponse à la question qui l’a suscitée.
Le roman raconte l’enquête lacunaire que mène le personnage-narrateur sur Noëlle Lefebvre, nom pseudonyme d’une jeune femme venue à Paris pour trois mois vers 1965, et disparue sans laisser de traces. D’abord menée dans le cadre d’une mission pour une agence de détectives privés, cette recherche devient progressivement, pour le narrateur modianesque, une quête existentielle, la recherche d’une affinité secrète entre les éléments parcellaires qu’il découvre dans la vie de Noëlle et les traces oubliées de son propre passé que ce travail d’enquête fait ressurgir. Tout se passe comme si ces découvertes progressives avaient été écrites d’avance, comme à l’encre sympathique, attendant d’être, au sens photographique du terme, révélées. En somme, il s’agit de retracer le fil discontinu de sa propre existence en se confrontant aux bribes éparses d’une vie inconnue, ou pour reprendre les termes de Paul Ricœur, de s’inventer soi-même comme un autre.
« L’avenue était déserte, et pourtant je devinais à mes côtés une présence, l’air était plus vif que celui que je respirais d’habitude, le soir et l’été plus phosphorescents. Et cela, je l’éprouvais chaque fois que je m’aventurais sur des chemins de traverse afin de pouvoir ensuite écrire noir sur blanc mon itinéraire, chaque fois que je vivais une autre vie — en marge de ma vie. » (p. 62)
À cet égard, le texte se place dans une double filiation modianesque. La première est celle de Dora Bruder (Gallimard, 1997), où l’auteur-narrateur partait à la recherche des rares traces laissées par une jeune fille juive, dont il avait appris le nom par hasard, en feuilletant un numéro de France Soir daté de 1942, plus de cinquante ans plus tard. Cachée par les religieuses du pensionnat du Saint-Cœur-de-Marie rue de Picpus pendant l’Occupation, Dora en a ensuite fugué, avant d’être raflée puis de mourir en déportation. Le mystère de la fugue, de cette décision inexplicable et du hasard qui a fait basculer le destin de cette jeune femme dans une tragédie tombée dans l’oubli, est au cœur du processus qui motive le récit d’enquête. De la même manière, le besoin de fuir semble un élément capital de l’économie romanesque d’Encre sympathique : « Eh bien, tout simplement la fugue était alors son mode de vie. […] Une fugue sans fin. » (p. 131) La plongée au cœur du mystère d’une existence, dont la fuite incessante hors des doigts de l’enquêteur redouble la fuite réelle qui a fondé sa disparition, transforme, dans le récit de 1997 comme dans le dernier roman de Patrick Modiano, l’enquête obsédante sur l’autre en quête inquiète sur soi.
La seconde filiation à l’intérieur de l’œuvre de Modiano à laquelle Encre sympathique se rattache est celle de Rue des boutiques obscures (Gallimard, 1978). Le personnage-narrateur, comme ici, y était d’abord détective dans la même agence, dirigée par le personnage énigmatique de Hutte. Seulement, la quête mémorielle et existentielle y était directement tournée vers le narrateur lui-même, puisque celui-ci était amnésique et cherchait à récolter des informations sur son propre passé. Comme dans Encre sympathique, le roman s’achevait à Rome – dans un cas via delle Botteghe oscure (rue des Boutiques obscures), dans l’autre dans une promenade autour de la boutique de photographies au nom évocateur de « Gaspard de la nuit », via della Scrofa. Néanmoins, l’amnésie est ici moins un phénomène nettement identifiable qu’une composante sourde de la mémoire de chacun des personnages. La quête d’identité se trouve du même coup dédoublée, notamment par le recours à une bascule au sein du récit : à partir de la p. 110 en effet, la narration, jusque-là assumée par le personnage de l’enquêteur qui s’exprimait à la première personne, passe à la troisième personne, et raconte l’histoire depuis les yeux de « Noëlle » (dont on apprend que ce n’est pas son vrai nom) elle-même.
Ce jeu subtil de décalage des points de vue n’est pas sans importance pour le propos du texte. En effet, il permet un entrelacement fécond des niveaux du réel et de l’imaginaire, augmentant le trouble, les impressions de déjà-vu, ou plutôt de déjà-lu qu’explore le récit. En outre, il permet de créer un troisième niveau de vertige, en introduisant (comme souvent chez Modiano) dans ce jeu de va-et-vient entre les points de vue des informations propres à la biographique de l’auteur lui-même. On découvre donc une articulation complexe des niveaux de la réalité – l’expérience de Patrick Modiano –, du vraisemblable de la fiction – la série de coïncidences qui mettent le personnage sur la piste de « Noëlle », la reconnaissance finale du personnage par « Noëlle » – et le rêve à l’intérieur de celle-ci – la projection imaginaire du personnage dans la vie qu’il s’invente, jusqu’à dire finalement : « J’ai toujours vécu dans le 15e arrondissement » (p. 132), alors que ce quartier est nouveau pour le personnage au début de son enquête, et qu’il est relativement nouveau dans la topographie parisienne des romans de Modiano.
Ainsi, la vague impression de ressemblance entre ce que le personnage-narrateur découvre de la vie de « Noëlle » et ce qu’il croit se rappeler avoir vécu – ressemblance tantôt attestée par sa vie, tantôt inventée de toute pièce pour gagner la confiance de témoins utiles à l’enquête – est ensuite répercutée par les impressions de « Noëlle » elle-même, se souvenant à la toute fin avoir déjà vu le profil de cet homme lorsqu’elle était jeune, dans le car qui menait les collégiens d’Annecy à Veyrier-du-Lac. Or Modiano a bien été pensionnaire dans cette ville, ce qu’il raconte sous un jour sombre dans Un pedigree. Un double mécanisme se produit alors : nous n’avons plus accès aux pensées du personnage-narrateur, mais nous retrouvons le même processus de remontée du souvenir chez Noëlle, à partir d’éléments eux-mêmes tirés de souvenirs réels de l’auteur, et dont nous ne savons pas bien si le personnage-narrateur les avait initialement rêvés ou vécus.
Cette gamme musicale du souvenir, qui joue comme lui sur les effets de silence et de refrain, sur une indistinction croissante entre ce que l’on découvre, ce que l’on redécouvre et ce que l’on invente, donne la texture sensible du tâtonnement de l’écriture modianesque au contact de la matière fragile qu’est l’oubli. En outre, cette entrée dans la dialectique délicate et mouvante du souvenir et de l’oubli à laquelle nous invite le texte est redoublée par l’effet de déjà-lu que nous procure la lecture d’un roman où se retrouvent de nombreux éléments déjà croisés dans l’œuvre de Modiano. À la limite, on pourrait dire d’Encre sympathique dans son œuvre ce que Modiano dit à propos de ce roman en particulier : « Il y a des blancs dans une vie, mais parfois ce qu’on appelle un refrain. » (p. 48) L’écriture se donne ainsi la tâche de dévoiler la fragilité constitutive du cheminement existentiel et scriptural, qui oscille sans cesse entre la mise au jour de ce qui semblait écrit d’avance mais attendait d’être rendu lisible, et la puissance mystérieuse du hasard, le vertige des coïncidences, des rencontres qui auraient pu ne pas avoir lieu ou de celles qui n’auront jamais lieu.

