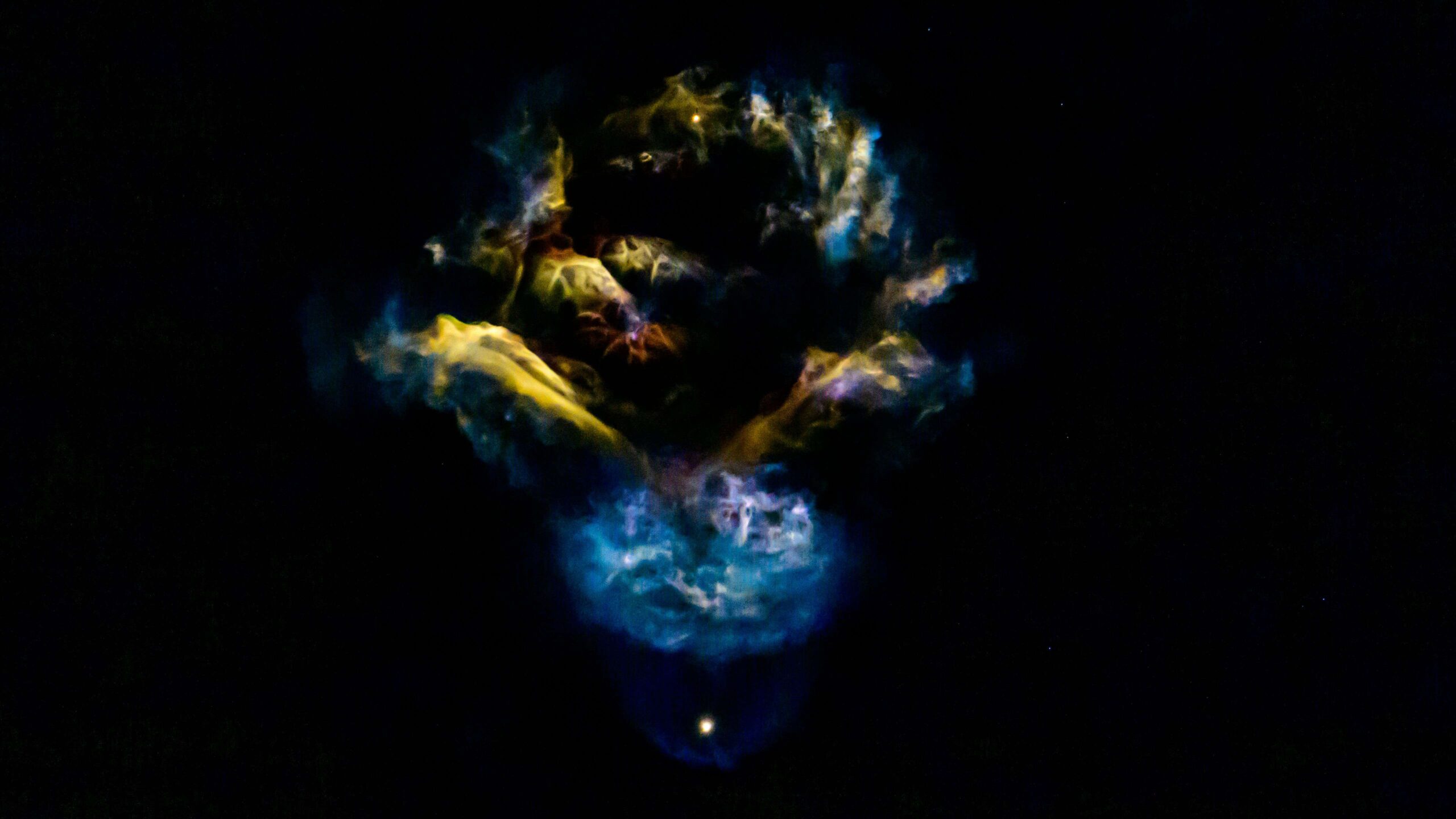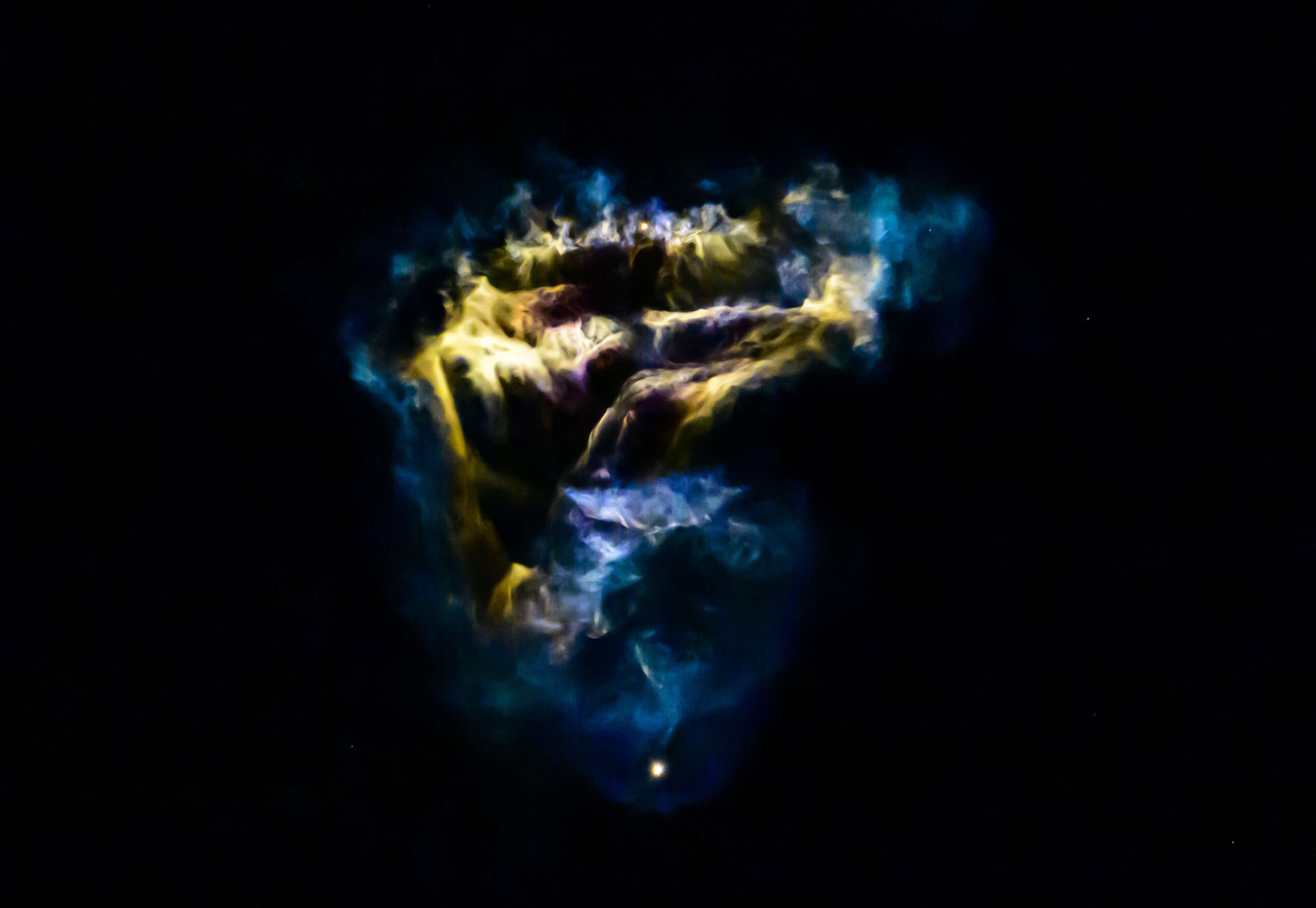Si vous nous lisez tous les jours et que vous que vous souhaitez contribuer à notre développement en toute indépendance, nous vous demandons de penser à vous abonner au Grand Continent
Les complotistes de l’Amérique profonde et les hommes les plus riches du monde peuvent-ils voter pour le même président ? L’alliance qui a porté Donald Trump au pouvoir pour la deuxième fois est fondamentalement différente de celle qui lui avait permis de battre Hillary Clinton en 2016.
Le président américain élu a donné forme à un nouveau deal passé avec la société américaine : richesse et accélération technologique d’une part ; préservation et protection identitaire de l’autre.
Le véritable facteur de rupture de l’élection est là, dans cette fusion entre l’establishment — ancien et moderne — et l’électorat le plus périphérique géographiquement, socialement et culturellement. Les fusées, les sondes spatiales projetées vers la possibilité d’une vie extraterrestre pour les humains, les robots, les voitures sans conducteur, le transhumanisme, la finance globalisée toujours à l’affût de la prochaine destruction créatrice, les industries de l’ancienne et de la nouvelle énergie font front commun avec un électorat qui se méfie du gouvernement, qui revendique la désobéissance à la culture progressiste qui prévaut dans les universités, qui cherche dans les sectes et les églises sa propre forme de résistance à la modernité, qui exige la protection contre les produits étrangers, qui veut relocaliser l’industrie et réduire drastiquement l’immigration.
Accélération. Réaction. L’alliage de ces deux métaux lourds — a priori incompatibles, en apparence contradictoires — définit l’alchimie qui a conduit Trump à la victoire en 2024.
D’un côté, l’accélération d’une partie des États-Unis qui veut s’affranchir de toute contrainte, de toute réglementation mais qui veut investir et s’élancer vers l’avenir ; une élite qui ne méprise pas la mondialisation mais veut la dominer ; un groupe au pouvoir qui entend imposer son propre canon linguistique et culturel dans une perspective futuriste.
Le nouveau deal de Trump est là : richesse et accélération technologique d’une part ; préservation et protection identitaire de l’autre.
Lorenzo Castellani
De l’autre, la réaction de l’Amérique des petites villes, du travail manuel et du concret. Les territoires des moins éduqués, où l’immigration est enchâssée au tissu productif.
C’est dans cette soudure mystérieuse qu’il faut comprendre le retour de Trump : elle est à la base de la nouvelle majorité électorale américaine.

Elle est au fondement de la structure sociale imposée dans laquelle le haut, en route vers le futur — l’élite technologique et capitaliste — coexiste avec le bas conservateur — le premier électorat de Trump et de sa promesse populiste.
Elle définira le regard que la nouvelle administration portera sur les États-Unis et le reste du monde.
Le véritable facteur de rupture de l’élection est là, dans cette fusion entre l’establishment — ancien et moderne — et l’électorat le plus périphérique géographiquement, socialement et culturellement.
Lorenzo Castellani
A New World — With An Old Soul 1
Les complotistes de l’Amérique rurale et les hommes les plus riches du monde ont donc voté pour le même président — et ils l’ont fait gagner. C’est ce que montre la victoire étonnamment large de Donald Trump, obtenue en construisant une alliance extrêmement hétérogène — cette nouvelle formule politique que nous proposons d’appeler accélération réactionnaire — qui a su unir les classes populaires et moyennes des zones rurales et des banlieues avec un pan important de l’establishment américain.
C’est la grande nouvelle de cette élection présidentielle américaine. Et elle demeure largement sous-estimée par la plupart des analystes. Le Trump de 2016 était un pur populiste, un maverick qui avait achevé de saccager un Parti républicain réduit au minimum de sa capacité politique, une sorte de Joker aimé seulement de l’Amérique en colère et désindustrialisée. Il avait réussi à gagner parce qu’il avait eu la chance de trouver sur son chemin Hillary Clinton.
L’hypothèse Trump avait tout, alors, d’un véritable saut dans l’inconnu : de nombreux intellectuels conservateurs en doutaient ; la quasi-totalité des magnats de l’industrie numérique et technologique s’en tenait éloigné ; Wall Street la contemplait avec anxiété ; et presque l’intégralité des médias la combattait. Mais le candidat qui a gagné cette année est une créature très différente de celle de 2016 — et surtout du président sortant défait qui, début 2021, donnait son blanc-seing à l’assaut du Capitole par ses partisans les plus violents. C’était un Trump subversif : répudié par les magnats de la Silicon Valley — il était alors banni de Twitter par son ancien CEO Jack Dorsey — ; jugé dangereux pour les institutions républicaines ; abandonné par son vice-président Mike Pence ; rejeté par l’appareil de renseignement.
Pour essayer de tirer les leçons de la victoire de Trump en 2024, il faut donc comprendre deux transformations fondamentales. D’une part, il a réussi à casser l’unité de l’establishment américain en construisant un nouveau courant au sein des élites. D’autre part, il a redonné au Parti républicain le vote populaire — une première depuis 2004.
Le candidat qui a gagné cette année est une créature très différente de celle de 2016.
Lorenzo Castellani
Comment ces bouleversements si profonds ont-ils pu se produire en si peu de temps ?
Pour essayer d’y voir plus clair, il faut aborder succinctement une série de facteurs.
Comment Biden a perdu les élites
Le premier est que de nombreuses idées du Trump de 2016 ont survécu à la présidence Biden. Le protectionnisme technologique à l’égard de la Chine et le protectionnisme industriel à l’égard d’une grande partie du monde ; l’augmentation des dépenses en matière de politique industrielle et la tentative de rapatrier la production ; un déficit fédéral plus important et un désengagement militaire international progressif sont des éléments qui, bien que sous des formes et dans un langage différents, ont été repris par l’administration démocrate sortante. Pour reprendre Adam Tooze, les Bidenomics ont été des « Trumponomics pour intellectuels ». Les idées très peu orthodoxes exprimées par Trump dès 2015 sont ainsi devenues monnaie courante dans la Maison-Blanche de Biden et du gouvernement américain en général.
C’est sur cet arrière-plan de continuité que la géopolitique est venue frapper à la porte — et exercer brutalement sa contrainte. C’est le deuxième facteur important.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie de Poutine a été un coup que l’administration Biden a très fortement subi. Certes, la diplomatie américaine s’est ensuite évertuée — avec un certain succès — à présenter la situation sous un autre angle, en réagissant au choc de l’invasion et en mettant tout en œuvre pour éviter que Kiev ne tombe en quelques semaines. La réalité est toutefois indéniable : la dissuasion américaine à l’égard de la Russie n’a pas fonctionné. Cet échec a non seulement obligé la Maison Blanche à s’engager dans une partie du monde dont elle voulait se tenir à l’écart militairement mais il s’est aussi traduit par de nouveaux engagements en matière de dépenses de défense — particulièrement mal supportés à la fois par l’électorat républicain et par une partie de l’électorat démocrate. L’argumentaire de Donald Trump à l’égard de la Russie et de Poutine s’en est quant à lui trouvé revitalisé.
Il en va de même à propos du Moyen-Orient. Sur ce dossier, l’administration démocrate s’est trouvée prise en tenaille entre sa tentative de freiner Netanyahou et les mouvements pro-palestiniens faisant pression sur le parti. Or là aussi, les efforts de la diplomatie de Joe Biden ont manifestement échoué. Une partie des élites a alors commencé à s’interroger : les choses auraient-elles été pires avec Trump ? Y aurait-il eu plus de stabilité internationale que sous Biden ? Après tout, au-delà des tweets, le premier mandat de Trump n’avait pas été si désastreux en matière de politique internationale — obtenant de bons résultats au Moyen-Orient et vis-à-vis de la Chine.
À ce contexte difficile s’est superposée une inflation qui s’est avérée fatale pour les relations entre une partie de l’establishment économique et les Démocrates. Dans une économie en croissance, l’administration Biden a choisi de creuser le déficit fédéral de manière excessive. En proportion, son administration a ainsi dépensé plus que celle de Franklin D. Roosevelt pendant les années du New Deal.
Il n’y a plus aux États-Unis d’oligarchie homogène qui veuille croire à la promesse de progrès, de fiabilité et de stabilité offerte par le Parti démocrate.
Lorenzo Castellani
L’inflation — c’est bien connu — touche d’abord les classes moyennes. Mais certains représentants du monde de la finance, comme Jamie Dimon, président de J. P. Morgan, se sont également trouvés parmi les critiques de la politique économique des Démocrates, jugée trop expansive et étatiste. Le projet climatique — l’un des chevaux de bataille de l’administration Biden — s’est lui aussi révélé être une limite, avec une finance environnementale peinant à décoller et une désillusion croissante de l’establishment américain à l’égard des politiques écologiques — en témoignent les rétropédalages du PDG de BlackRock, Larry Fink, en la matière. Les sondages étaient d’ailleurs assez clairs : pour l’opinion américaine, Trump était le plus fiable des deux candidats à la présidence pour reprendre en main l’économie.
Enfin, un quatrième facteur a joué à plein dans cette transformation : la réaction de la Silicon Valley aux excès du dirigisme économique de l’administration Biden et l’assaut contre les « woke politics » auquel se sont livrés certains pontes du capitalisme technologique comme Elon Musk ou Peter Thiel. Une guérilla culturelle née en réponse au débordement idéologique des universités de l’Ivy League, qui ont déraillé ces dernières années dans certains excès, conduisant à ébranler une partie du monde économique et financier. Bill Ackman, financier multimilliardaire, historiquement électeur démocrate, considéré par certains comme l’héritier de Warren Buffett, a choisi depuis un an de soutenir la croisade de Musk et d’autres gourous de la tech contre la gauche des campus américains. Un conflit que Musk a exploité pour acheter Twitter — devenu X — au nom de la liberté d’expression et créer un écosystème médiatique se nourrissant d’entreprises éditoriales autonomes comme celles de Joe Rogan et Tucker Carlson, capables de pousser Trump et d’éviter la censure dans ce qui demeure — cette élection le prouve sans doute en partie — le réseau social le plus influent politiquement et médiatiquement.
Pèse également dans ces choix de l’establishment en faveur de Trump le soutien à la cause palestinienne d’une aile du Parti démocrate et de sa composante intellectuelle, où une partie de l’élite modérée n’a pas digéré ce qui a été perçu comme une tolérance excessive à l’égard des actes terroristes du Hamas. Rappelons-nous ainsi que les grands financeurs des principales universités américaines comme Harvard et Princeton ont réclamé début 2024 la tête des présidents d’université qui avaient défendu des positions jugées antisémites.
Le coup ultime porté par Trump à cette fracture de l’establishment a été le retrait de Joe Biden — garant démocrate modéré qui était parvenu, par une forme d’inertie sans doute liée à sa longue carrière politique, à articuler ces différents mondes — et son remplacement précipité par une vice-présidente au leadership faible, perçue comme plus proche de l’aile gauche.
L’élection présidentielle de 2024 a acté un changement : Donald Trump n’est plus seulement le populiste charismatique qui avait réussi le tour de force de forger un lien viscéral à « l’Amérique profonde » et productive d’antan.
Lorenzo Castellani
Trump 2024
C’est dans cet entrelacs de brisures hétérogènes d’une élite déjà composite que naît l’hypothèse Trump 2024. Elle n’est plus un vaisseau sans capitaine : elle émerge sur des prémisses très différentes de celles de 2016 et de celles de 2021. Car c’est un mouvement de fond : tout ne se résume pas à Elon Musk et à son idée de Commission pour améliorer l’efficacité du gouvernement, ni à Peter Thiel et à ses idées techno-libertaires, ni au milliardaire de 30 ans engagé dans le développement de la réalité augmentée Palmer Luckey. De vénérables représentants du capitalisme américain traditionnel ont témoigné à son égard d’une attitude sinon de soutien, du moins d’ouverture au dialogue tout au long de la campagne. Citons par exemple le PDG de Blackstone Steve Schwarzman, le gestionnaire de fonds spéculatif Bill Ackman, le président de J. P. Morgan Jamie Dimon — véritable leader d’opinion du monde économique qui, lors du dernier Forum de Davos, en a surpris plus d’un en affirmant que Trump avait raison sur de nombreux points — et même le PDG de BlackRock Larry Fink — qui s’est montré plus ouvert envers le magnat que par le passé, tandis que le fonds Vanguard a massivement acheté des actions du Trump Media Group ces derniers mois.
En termes d’analyse des élites, l’élection présidentielle de 2024 a acté un changement : Donald Trump n’est plus seulement le populiste charismatique qui avait réussi le tour de force de forger un lien viscéral à « l’Amérique profonde » et productive d’antan. Il est le président qui intègre un fonctionnement élitaire étranger à la politique, à l’administration et à ses métiers et qui comprend les gourous de la tech, la finance, les médias et le monde intellectuel.

C’est là que se posera l’un des premiers défis pour le Trump de 2024 : la composition d’une équipe gouvernementale très étoffée pour soutenir l’action du président des États-Unis. S’il sera facile de dégager une équipe au sein du parti pour les postes du cabinet présidentiel, il sera beaucoup moins évident de rassembler du personnel à même de donner des garanties de stabilité et de compétence pour occuper les postes de la haute fonction publique, sélectionner les directeurs des nombreuses et puissantes agences administratives, et choisir les conseillers du président et les juges fédéraux.
Le premier mandat de Trump avait été un désastre à cet égard, avec une avalanche de nominations à court terme, des démissions répétées, des dizaines de nominations publiques qui n’avaient jamais abouti et un fonctionnement paralysé de la machine fédérale. Il reste à voir si une coalition pyramidale, mieux ancrée dans l’establishment des affaires et de la technologie mais dont le sommet est toujours Trump — et ses aspérités caractérielles —, sera également capable de générer une élite républicaine à même de gouverner sans s’auto-saboter, de ne pas crier chaque semaine au complot de l’État profond et de ne pas finir par nuire au travail politique de la Maison-Blanche.
En tout état de cause, ce qui est apparu ces derniers mois, c’est qu’il n’y a plus aux États-Unis d’oligarchie homogène qui veuille croire à la promesse de progrès, de fiabilité et de stabilité offerte par le Parti démocrate pour les raisons résumées plus haut. Au contraire, une très grande partie de la société américaine veut désormais renouer avec l’Amérique du travail et des provinces, et c’est pour cela qu’elle a choisi Trump.
On assiste au plus grand réalignement de l’establishment américain autour du plus improbable de ses membres — Donald Trump.
Lorenzo Castellani
L’avenir d’une contre-élite
Une élite ne peut survivre qu’à deux conditions : si elle ne perd pas totalement sa légitimité dans le régime dans lequel elle opère ; si elle ne se fond pas complètement en une unité indiscernable qui devient la cible idéale des tribuns de la plèbe. C’est ce qui s’était produit en 2016 et c’est la raison pour laquelle une contre-élite s’est créée autour de la deuxième aventure de Trump — une élite qui cherche un espace différent de celui qui était garanti par les Démocrates et qui ne lui avait pas été accordé par la première présidence Trump fondée sur le populisme, qui s’identifiait à certaines valeurs culturelles et marquait certaines priorités politiques alternatives à celles du vieil establishment d’extraction bushienne et clintonienne.
Aujourd’hui, cette contre-élite est arrivée au pouvoir. Elle a montré sa force politique. Elle est désormais confrontée à la difficile tâche de transformer une coalition électorale ayant réussi à faire triompher l’accélération réactionnaire en une élite gouvernante. Elle suit son cycle : la classe politique change ; l’ancienne élite capitaliste s’y adapte — et elle se transforme en même temps à la faveur de Trump. On assiste au plus grand réalignement de l’establishment américain autour du plus improbable de ses membres — Donald Trump. Car aussi singulier que soit le personnage qu’il a façonné, il reste incontestablement un membre de l’élite financière et dirigeante du pays.
Un profond remodèlement s’opère derrière cette figure : ceux qui soutiennent Trump veulent se re-légitimer aux yeux de « l’Amérique profonde », se distinguer de ceux — notamment dans l’élite académique — qui selon eux propagent « l’idéologie woke et la cancel culture » et participer au redécoupage de certains jeux internationaux perçus comme perdants. Cette transformation nous est sans doute apparue moins évidente parce qu’elle vient davantage de la finance et de l’industrie que des médias et du monde universitaire, mais elle est substantielle. Sur le plan électoral, tout cela a bien fonctionné : Trump est à la Maison-Blanche pour la deuxième fois, sur des bases différentes de la première.
Un nouveau mouvement sui generis est en train d’émerger d’Amérique : l’accélération réactionnaire.
Lorenzo Castellani
Une question reste maintenant en suspens, dont la réponse n’émergera que dans les mois à venir : cette coalition entre Trump et une part substantielle de l’élite américaine sera-t-elle capable de rester unie au moment de composer une équipe gouvernementale ? Le président choisira-t-il des hommes qui plaisent à ceux qui ont financé la campagne électorale et l’ont soutenu, ou retombera-t-il dans les allers-retours schizophréniques avec ses collaborateurs qui ont entaché son premier mandat ? Saura-t-il faire cohabiter les parties les plus radicales de l’électorat avec celles qui contribuent sous d’autres formes — souvent invisibles et très influentes — au gouvernement du pays ? Une coalition aussi large que composite pourra-t-elle rester unie en donnant au pays un gouvernement qui fonctionne et en reconstruisant un nouveau parti républicain capable de survivre, demain, à Trump et peut-être au trumpisme ? Comment réagira l’autre moitié de l’establishment aujourd’hui perdante : guerre totale — comme en 2016-2021 — ou recherche de l’apaisement avec Trump ? Sera-t-il possible pour un président âgé — le plus vieux de l’histoire — de gouverner les États-Unis sans les élites politiques et administratives ?
Les réponses à ces questions ne se développeront que dans l’année qui vient.
Ce qui est à peu près certain, c’est qu’avec l’élection du 5 novembre 2024, un nouveau mouvement sui generis est en train d’émerger d’Amérique : l’accélération réactionnaire.
Sources
- Refrain de la protest song paléo-conservatrice du trumpiste Anthony Oliver, hit country de l’an 2023 auquel le Grand Continent avait consacré une analyse.