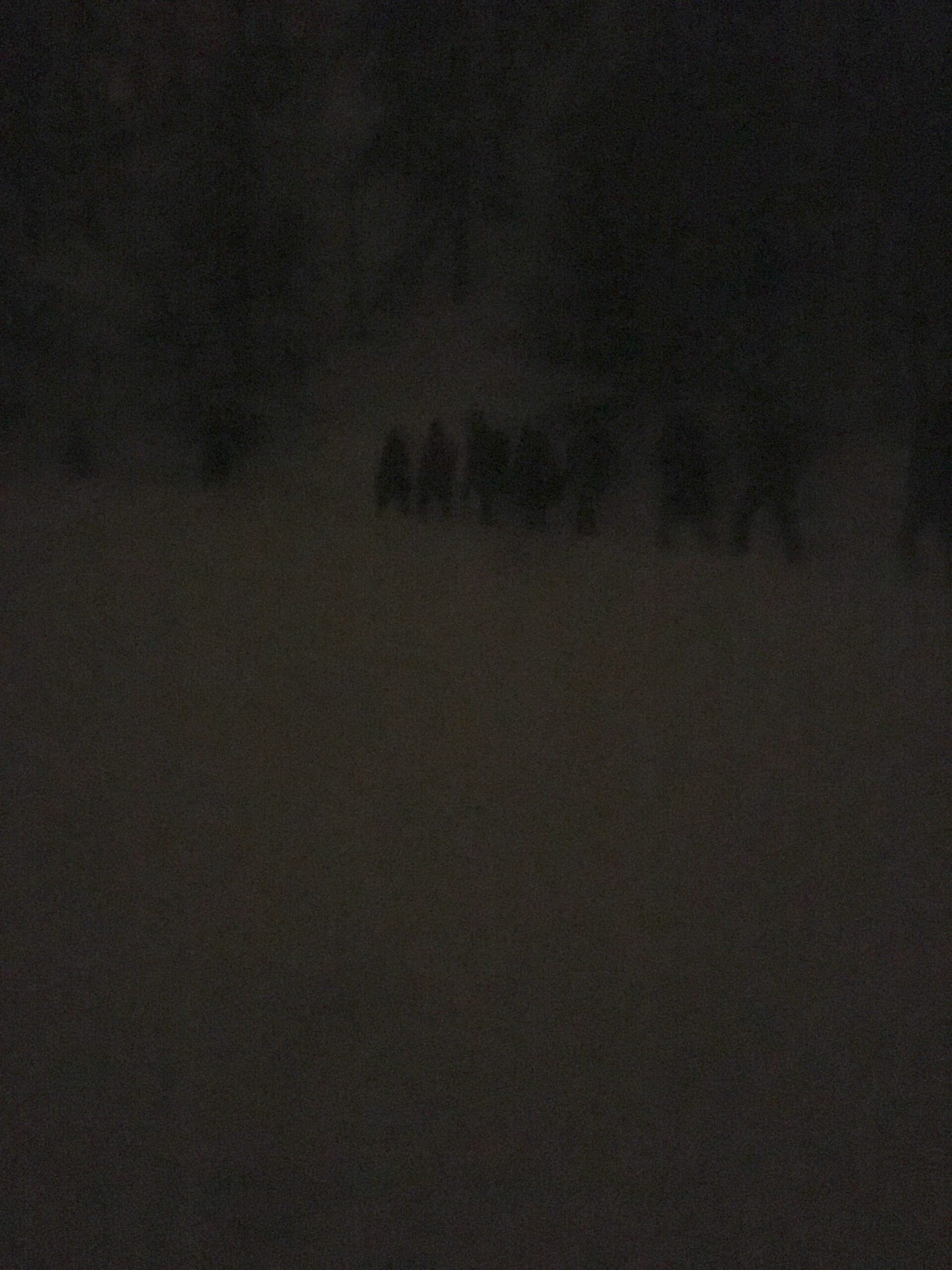Temps de lecture: 17 min
10. Col de l’échelle1
Être sauveteur, cela n’avait rien d’évident.
Les appels arrivaient généralement au milieu de la nuit. Ou au milieu du dîner. Ou quand il était fatigué. Simone n’était jamais tout à fait prêt. Il travaillait depuis des années comme volontaire pour les sauveteurs piémontais, mais cela demeurait épuisant. C’était difficile de courir jusqu’en haut des collines. Difficile de retrouver des randonneurs perdus, des cyclistes blessés ou des cueilleurs de champignons égarés et apeurés.
Il n’avait surtout jamais fait de vrai sauvetage. Un sauvetage de haute montagne.
Un sauvetage avec des avalanches ou des glissements de terrain.
Pour une raison inconnue, il ne recevait jamais d’appel lorsqu’il était là-haut.« J’habite à Turin, et je reçois ces appels. »
Pourtant, il était difficile de croire que les montagnes fussent pleines de morts. Mais ce n’étaient pas des rues, ce n’étaient pas des attractions.
Les Alpes étaient comme elle avaient toujours été. C’est pour cela qu’il les aimait.
C’est dans cet état d’excitation que le mettaient les virages sur la route qui monte depuis Turin. Les montagnes s’élevaient au-dessus de lui, enveloppées de forêts épaisses, noirâtres, brunes et vertes, comme les poils d’un énorme animal. C’est ce qui faisait battre son cœur à chaque fois. Ses yeux sur ces sommets déchiquetés comme des dessins d’enfants.
C’était toute sa vie. Il l’avait construite autour de tout cela. La photographie. L’écriture. Le service comme volontaire. Il y était presque tous les jours.« Je ne peux pas vivre trop longtemps loin de cet air. »
Il garait sa voiture à Melezet, au pied du ravin. Chaussait ses skis, commençait l’ascension. Les jours de soleil, la neige brillait derrière lui comme du cristal. Simone aimait être seul là-haut. Comme tout parent, il avait besoin de moment où il se sentait libre. Il laissait derrière lui chalets et pisteurs et, en arrivant au sommet, se retrouvait juste au-dessous du Col de l’Échelle.
« C’est une de nos passes les plus dangereuses. » Mais un de ses endroits préférés.
Ses plis, sa paroi de pierre grise, son sommet éclatant de blancheur.
Un de ces lieux où l’on ressent vraiment combien de siècles ont traversé les Alpes. Les éléphants d’Hannibal. Les soldats égarés de Napoléon Bonaparte. Les contrebandiers dans l’entre-deux-guerres. Ce passé semblait même figé dans ce nom : Colle della Scala, Col de l’Échelle. Une échelle entre les langues.

« Un tout petit reste de vie ancienne gelée. Il fut un temps où même les bergers ne pouvaient passer qu’en jetant une échelle sur les rochers. Aujourd’hui encore, cette route est impraticable pour les voitures en hiver. Ses deux tunnels et les virages en épingle à cheveux à 1 762 m d’altitude sont ensevelis sous la neige. Congelés. Fermés.
Escalader cette montagne, puis traverser les tunnels d’hiver ? Même un rat aurait du mal. C’est tout simplement impossible. »
On le sent encore, quand on monte plus haut. Jusqu’à cette minuscule chapelle, une grotte à demi, presque un clapier ; Notre Dame de Bonne Rencontre. On le sent en entrant. Quelque chose de dur et de désespéré. Parce que la peur de la montagne habite ce lieu : la chapelle est remplie de cierges, de madones, de chapelets et d’offrandes de fleurs ; les murs voûtés sont couverts d’ex voto remerciant la Vierge d’avoir sauvé ou assisté des personnes perdues dans la neige.
« C’est une montagne qui tue. »
Pourtant, la plupart du temps, ce n’était pas l’impression qu’on avait. On se serait plutôt cru dans la story Instagram de quelqu’un. On se serait cru dans un parc et non dans un monde où il était possible que quelqu’un eût à traverser ce col. Un monde où ses activités étaient principalement des loisirs. Le déclencheur de l’appareil photo attrapant un oiseau rare. Le frisson ressenti quand les flocons se mettent à tourbillonner. Son carnet de notes tenu dans ses mains froides au milieu des clairières. Un monde auquel Simone n’aurait rien voulu changer.
Mais cet hiver-là, quelque chose changea.
Il commença à voir des vêtements — polaires, sweats à capuche, pull-overs, jetés dans la neige — accrochés aux branches, sur le bord du chemin. Des traces de pas humaines qui faisaient un cercle. Ou bien une paire de chaussures, ou un Nike isolée, retournée sur le sentier — celui qui montait là-haut, jusqu’au Col de l’Échelle. Simone ne pensa tout d’abord rien.

Rien à part que c’était étrange.
Puis il commença à les voir. Traînant sur les trottoirs des routes de montagne, plissant les yeux face à des écrans de mauvais smartphones, essayant de trouver leur chemin. Puis il les voyait de nouveau. Lui était à skis, à mi-chemin de la pente, et eux passaient, en baskets, en sweats à capuche, dans des polaires toutes fines. Des Africains.
Ce sont des réfugiés, ou quelque chose du genre, lui dit-on au bar.
Des demandeurs d’asiles, qui n’ont pas le droit de travailler en Italie tant que leur demande n’a pas été approuvée. Alors ils essaient de passer en France.
Il discutait avec les sauveteurs en montagne, quand tout à coup cela lui apparut : ce qu’on voyait à la télévision était soudain ici. Mais que diable pouvaient-ils faire dans ces cols ?
Des policiers dans chaque gare et à chaque poste-frontière sont là pour les prendre. Ils ne sont pas autorisés à voyager librement en Europe. Donc ils essaient de traverser les montagnes.
Mais le Col de l’Échelle ? dit-il. C’est infranchissable !
Oui mais, tu vois, c’est la faute de leur téléphone, ils se font duper quand ils voient l’image sur l’écran.
Ils tapent l’itinéraire piéton sur Google Maps, et le chemin paraît plat et facile.
Certains sauveteurs avaient même entendu parler d’une app. Quelqu’un la leur vendait dans les camps de migrants : le chemin vers la France. Et les vêtements ? Simone savait déjà, mais il posa tout de même la question.
Si tu ignores la haute montagne, dès que tu commences à marcher, tu as chaud, tu transpires. Là, tu peux commettre une erreur fatale. Parce que tu ignores aussi que dès que tu t’arrêteras plus de cinq minutes, tu te mettras à geler. Hypothermie.
Les sauveteurs buvaient en silence. C’était l’un de ces restaurants de Melezet qui sentait le pin. Un endroit qui avait une atmosphère de refuge.
Il avait envie d’y retourner. Il allait y avoir du travail cet hiver. Au fil des semaines, il continua à s’agiter, il se mit à en voir de plus en plus lors de ses journées à Melezet. Ils étaient là. Des hommes africains, adolescents pour les plus jeunes, cinquantenaires pour les plus âgés, certains portant une casquette de baseball, la plupart des pulls bon marché. Aucun avec une vraie écharpe. Remontant péniblement les pistes. L’école de ski, les skieurs au bronzage orange et aux combinaisons Patagonia rutilantes qui envahissaient la piste olympique de snowboard ne prêtaient pas attention à eux. Mais lui, si. Comme tous les sauveteurs. Pourtant, toujours aucun appel.
« Ce n’est pas longtemps après ça qu’ils ont trouvé Mamadou. »
« Ils l’ont trouvé juste après la frontière, du côté français. » Ses jambes avaient gelé jusqu’aux genoux ; il marchait en pleurant.
Cet homme venait du Mali.
S’il pleurait quand il le trouvèrent, c’est parce qu’il avait tenté la traversée du Col la mauvaise nuit. Ils étaient deux amis. Ils avaient grimpé et trimé pour avancer dans une épaisse couche de neige, mais, peu avant la chapelle, ils avaient glissé dans un grand trou. Il neigeait, il faisait nuit, et ils s’accroupirent en tenant leurs genoux, s’y cramponnant pour ne pas s’endormir, attendant la lumière, essayant de tenir. Voilà ce qui arriva.
Le matin les trouva encore en vie. Ils utilisèrent le peu de forces qu’il leur restait à s’extraire de là. Mais l’ami de Mamadou ne pouvait pas continuer, et il s’effondra. Mamadou, dit-il en lui donnant le numéro de téléphone de sa mère, appelle-la, dis-lui que je suis mort ici. Mais toi, continue.
La lumière était dorée ce matin-là. Il fut retrouvé par une femme qui faisait du chien de traîneau, abîmé dans les larmes. Seul. Comme un fantôme du passé, ou peut-être du futur. Trois jours après, on l’amputa d’un pied qui avait complètement gelé.
« C’est cet épisode qui a vraiment déclenché l’alerte dans les vallées alentour. » Il y en eut alors de plus en plus.
Des groupes entiers, des dizaines de groupes, tentaient l’ascension. Mais Simone ne recevait toujours aucun appel.
« Je compris qu’ils avaient trop peur. »
Une tension le saisit, comme si des ongles s’enfonçaient dans sa peau. Puis une sensation : celle d’être inutile. Il y avait urgence. Ils étaient des dizaines là-haut, des centaines même, à franchir le col. Mais ils n’appelaient pas au secours. Rien que d’y penser, sa bouche se plissait. Cela lui retournait l’estomac de les regarder, depuis sa voiture, à l’aller comme au retour, en sachant qu’ils n’appelaient pas.
Que pour eux, il n’était pas différent de la police.
« Puis un jour, nous avons finalement reçu un appel. » Appel masqué, dans un italien approximatif. Mes amis, mes amis… problème..
Pas d’erreur possible. C’était un Africain.
« Nous ne savons pas qui nous a appelés. »
« Ni comment il était parvenu à nous joindre, mais nous avons accouru. »
Mais qui que ce fût, il n’était pas là-haut. Puis il raccrocha. On sonna l’alerte. Les sauveteurs criaient.
Où est-il ?
Prenez les motoneiges !
En deux minutes ils furent prêts : un étudiant en médecine, un opérateur de remontée mécanique, un employé d’un des hôtels et Simone. Il se dépêchait, le cœur battant à toute vitesse.
C’était son premier sauvetage en montagne. Et ce n’était pas un cueilleur de champignons égaré.
« Cette fois, c’était la bonne. »
« Nous sommes les vrais héros de la montagne. »
Très vite, ils franchirent la démarcation entre les deux pays.
On aurait dit une pierre tombale. Avalée par la neige. D’un côté : F, pour France. De l’autre : I, pour Italie. La frontière naturelle, elle, se dressait au-dessus d’eux comme un mur monstrueux, incurvée, semblable à un château gigantesque.
Ils dépassèrent les premiers signes. Danger d’avalanche. Puis les seconds. Danger de mort.
Après trois kilomètres, ils s’arrêtèrent. Ils étaient entassés sur leurs motoneiges qui crachaient de l’essence.
« On a vu la pile de vêtements grandir. »
Le sang de Simone se figea. Cela ne pouvait vouloir dire qu’une chose.
L’hypothermie avait frappé. Ils avaient transpiré. Ils avaient jeté leurs vêtements à terre, et maintenant, à mi-chemin entre cet endroit et le sommet, ils devaient être en train de geler sur place. Devant, il n’y avait que de la neige, des rochers et des traces de pas. Elles se dirigeaient vers ces virages en zigzag. Ce fut l’étudiant en médecine qui les vit le premier. Le cœur de Simone se serra, lorsqu’il vit ces traces qui n’auraient pas dû y être.
« Il y avait un chemin accidenté, un sentier battu que nous n’avions jamais vu auparavant, et qui indiquait que des centaines d’Africains avaient tenté l’expérience. Alors nous l’avons suivi. » Si vous connaissez les montagnes, vous savez cela.
Vous savez que les chemins des humains suivent ceux des animaux. Les chemins ont une longue histoire. Même si vous ne la trouverez peut-être jamais, chacun a sa logique.
Il faut toujours les suivre.
« Les Africains n’avaient pas suivi le chemin. »
« Ils s’étaient épargné les virages en épingle à cheveux pour monter les pentes en ligne droite. Il ne savaient pas qu’en montagne, il est plus facile et moins fatigant de ne pas prendre le chemin le plus court. Et que c’est cela qui vous sauve. »
L’opérateur des remontées mécaniques redémarra le contact. Le moteur vrombit.
Les motoneiges gargouillaient et gémissaient. La neige giclait lorsqu’elles rebondissaient sur les rochers et les congères. Ce jour-là, la lumière était étrange. Il était midi lorsque les sauveteurs avaient commencé la montée, mais il on était sur la face nord de la montagne, et par ce type d’hiver, la lumière du soleil avait déjà disparu. Simone et les sauveteurs s’arrêtèrent, éteignirent le moteur rugissant et écoutèrent.
Mais on n’entendait que le silence.
Ce silence qu’on ne trouve que dans les montagnes ; sans bruit d’eau ou d’oiseau. Comme si le bruit de fond lui-même s’était évanoui. Simone s’entendait respirer.
« Nous étions dans l’ombre. Cela forme une étrange lumière, cette ombre épaisse de montagne, parce qu’on voit le soleil partout autour de soi tout en étant au plus profond de l’ombre. C’est étrange aussi, car tout paraît un peu bleu. La lumière, la neige… tout semble bleu. Presque comme si on était sous l’eau. »
Toujours rien. Ils continuèrent.
Plus haut ! C’était l’étudiant en médecine.
Vite, allons-y !
Le chemin montait jusqu’au-dessus des pistes, au-dessus des forêts. Ils montèrent jusqu’à ce que tout leur semble minuscule, vu d’en haut. Les motoneige parcoururent quatre kilomètres, mais on ne trouva personne — seulement des vêtements sur le chemin, à l’endroit où les pentes étaient boisées. Puis Simone et les trois autres sauveteurs sautèrent de leurs engins et chaussèrent des skis.
Vous entendez ?
Rien. C’était dans leur tête.
Vous voyez ?
Toujours rien. Le soleil commençait à baisser à mesure qu’ils avançaient. Ils firent encore deux kilomètres à pied.
« C’est alors qu’on les a vus. »
À la porte du tunnel du Col de l’Échelle.
« Ils étaient en train de grelotter, dans un endroit très froid tout à fait à l’ombre. Je pouvais voir que l’un d’eux était très mal en point. »
Ils firent des signes. On répondit à leurs signes.
Simone cria : Nous ne sommes pas de la police !
Descendez, s’il vous plaît. Descendez ! Les hommes se serraient les uns contre les autres.« Ils avaient l’air fatigués et apeurés. »
Simone pouvait désormais voir leurs visages. C’est là qu’il le vit véritablement.
« On peut toujours déceler de la peur dans un regard. On la reconnaît à la façon dont un homme regarde autour de lui. Ce regard sur notre environnement change quand on a peur. On commence à percevoir un danger dans tout ce qu’on voit. »
« C’est cela, la peur. »
Ils étaient huit, tous la vingtaine. Ils dirent qu’ils étaient tous originaires de Guinée.
Baskets mouillées et jeans trempés par la neige, ils faisaient terriblement pitié.
« À leur manière de marcher, je pus voir qu’ils avaient des engelures.On aurait cru qu’il allaient tomber à chaque pas qu’ils faisaient. Ils ne posaient pas leurs pieds correctement sur la neige. » Ce jour-là, il faisait —6°C.
La lumière avait à moitié disparu.
La France, disaient-ils. On veut la France !
Les sauveteurs répondirent, en criant eux aussi.
On ne peut pas vous emmener en France !
Au moment où ils leur apprirent qu’ils ne pouvaient les ramener en bas que de ce côté-ci, une rumeur se répandit dans le groupe. Non. Ils ne feraient pas demi-tour.
« Ils débattaient dans leur langue, pour savoir quoi faire et s’il fallait continuer. Deux d’entre eux étaient bien décidés à continuer. Ils semblaient très déterminés. Nous avons essayé de leur dire que nous n’étions pas la police. Que nous étions là pour les aider. Mais ces deux-là crièrent : Non, non, laissez-nous. On va continuer.
Les sauveteurs commencèrent à s’agiter. Ils tentèrent de faire de nouveaux signes, de parler français, de crier plus fort — ils firent tout ce qu’ils purent pour les arrêter.
« Nous leur avons dit que c’était dangereux. Qu’ils allait bientôt faire nuit. Qu’ils y avait des avalanches. On leur a dit que nous-mêmes nous n’y serions pas allés à cette heure-là. Mais ils ne nous écoutaient pas. » Ils se levèrent. Le vent sifflait de façon plaintive.
Les sauveteurs criaient : Stop, stop ! On vous dit qu’il y a la police française de l’autre côté ! Ils vous attendent et ils vous ramèneront en Italie. Vous êtes en hypothermie. Vous pourriez mourir. Vous comprenez ? Vous pouvez mourir !
Ils ne répondirent que par un regard impassible.
C’est impossible, même pour nous, avec notre équipement.
Vous n’y arriverez pas. Même un renard ne pourrait pas passer. S’il vous plaît. Ces tunnels sont remplis de neige.
Mais c’était inutile.
Le soleil avait commencé à disparaître.
Un des hommes brandit un papier administratif en disant qu’il l’avait reçu quinze jours plus tôt, à son arrivée en Sicile.
« Il avait un visage calme, cet homme. Il ne semblait pas comprendre que ce papier lui interdisait précisément d’entrer en France. Ou peut-être le savait-il, d’une certaine manière. À cause de ses yeux, qui avaient l’air… résignés. »
Les sauveteurs gardèrent ces réflexions pour eux.
« Désormais ils débattaient très calmement entre eux. »
« Cependant, les deux plus déterminés dirent : Nous allons essayer de passer en France. Que vous nous suiviez ou non. »
Ils se levèrent en premier. Les autres eurent un moment d’hésitation, puis ils les suivirent. Laissant les sauveteurs derrière. Simone répondit à la radio.
Ils avancent.
Comme toujours dans les moments de choc, il sentit le froid s’emparer de son corps.
« Nous les avons regarder claudiquer jusqu’à ce qu’ils atteignent le tunnel. C’était un de ces moments où on ne sait pas quoi dire. Alors nous n’avons rien dit. Nous avons juste regardé. »
Il pouvait à peine cligner des yeux.
Ils n’avaient jamais rien vu de tel. Ils ne pouvaient pas prendre la mesure de la chose. Aucun d’entre eux, jamais, n’avait reçu un SOS en montagne puis été renvoyé. Ils descendirent en silence. L’horreur silencieuse s’amplifiait.
Cette scène, gravée dans leurs esprits. Ces silhouettes qui s’éloignent.
Ils ne pouvaient pas regarder en arrière. Cela leur semblait mal.
En bas, à la station, identique à toutes les autres, comme si elle se résumait aux chalets de location et aux moniteurs de ski, ils se séparèrent. Ils échangèrent une poignée de main. À bientôt, merci. L’étudiant en médecine, l’opérateur de remontée mécanique et le type qui travaillait dans l’un des hôtels s’éloignèrent.
Simone devait rentrer chez lui.
C’est alors qu’il se rendit compte qu’il tremblait. Ses mains s’agitaient nerveusement pendant qu’il essayait de mettre le contact. La frontière. C’était une chose à laquelle il n’avait jamais vraiment pensé. Pour eux, une ligne invisible. Pour eux, c’était tout. C’était presque comme s’il y avait deux catégories d’humains, pensa-t-il. Ceux qui peuvent, et ceux qui ne peuvent pas.
La route faisait des lacets. Les montagnes commençaient à se dissiper. La première bifurcation approchait. Il se sentit presque mal.
« J’avais l’impression que quelque chose s’était brisé. » Ils étaient toujours là-haut.
« On ne sait pas combien d’entre eux sont morts. On ne sait pas ce qu’il s’est passé. Aucun moyen de savoir combien se sont perdus. Aucun moyen de savoir combien ont été piégés là-haut, mais ont refusé d’appeler au secours par peur d’être arrêtés et expulsés. Aucun moyen de savoir combien ont fait demi-tour et combien ont continué seuls. »
Tout au long de l’hiver, ils avaient continué à trouver des vêtements.« Au printemps seulement, on comptera les corps. »
Les réverbères autoroutiers se succédaient au-dessus de sa tête tandis qu’il conduisait. Il pensait à ses enfants. Il pensait au fait que tout cela n’allait jamais s’arrêter. Cet état d’alerte. Il en était certain. Ils allaient continuer à venir. Et eux allaient continuer à essayer de les arrêter.
Turin — 50 km. Simone roulait plus vite. Mais il pouvait encore voir leurs visages.
La lumière. Cette lumière sous-marine. Comme s’ils se noyaient.