Le basculement de l’Afghanistan, une conversation avec David Martinon
15 août 2021 : Kaboul tombe aux mains des Talibans. Dans la panique généralisée, l'ambassadeur David Martinon reste sur place. Dans cet entretien fleuve, il revient sur cette séquence historique, les conditions profondes qui l'ont rendue possible — et l'avenir de l'Afghanistan.
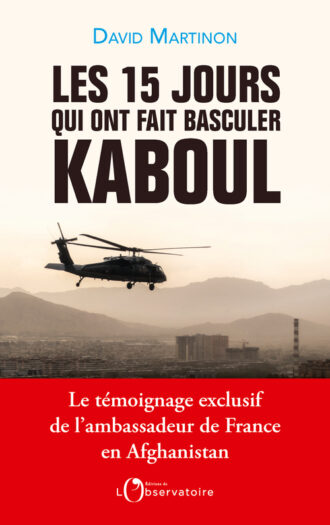
Sur les vingt dernières années, les États-Unis étaient probablement l’acteur principal sur le terrain afghan, ce qui a évidemment changé depuis leur retrait du pays en août 2021. Comment analysez-vous l’évolution de la position des États-Unis et la relation que Washington entretient aujourd’hui avec l’Afghanistan ?
Je voudrais d’abord rappeler le contexte. Les troupes américaines devaient quitter l’Afghanistan en application des accords de Doha du 29 février 2020, conclus avec les représentants des Talibans, parmi lesquels figurait l’influent Abdul Ghani Baradar. Or les troupes américaines sont finalement restées plus longtemps que ce qui avait été prévu par ces accords.
La signature de ces accords marquait en fait le point de départ d’une période d’incertitude. L’accord fixait une date limite pour le retrait américain au 1er mai 2021. Une telle date était néanmoins située au terme de la période électorale aux États-Unis, période durant laquelle le président Trump montrait son intention de se retirer le plus vite possible du pays, quitte à ce qu’un tel retrait ait lieu à marche forcée.
Au milieu de cela, il apparaissait de façon assez claire que les autorités afghanes de l’époque fondaient une partie de leurs raisonnements sur la conviction qu’il n’y aurait, en fait, pas de retrait. Une telle conclusion s’imposait, selon elles, car la victoire du président américain Joe Biden devait mener à un retour à la normale de la politique extérieure américaine, qui ne serait plus repliée sur elle-même.
De mon côté, je pensais que dans le cas où le président Donald Trump gagnerait l’élection, l’évacuation aurait lieu très rapidement. Souvenez-vous que Trump avait annoncé au milieu de sa campagne qu’il n’y aurait plus de troupes américaines en Afghanistan dès Noël, même si pour de nombreux observateurs un tel calendrier était intenable au moment où cet engagement était pris.
Je pensais que dans le cas où le président Donald Trump gagnerait l’élection, l’évacuation aurait lieu très rapidement.
David Martinon
Quant au candidat Biden, celui-ci disait et répétait de façon très claire, au cours de sa campagne, que sa priorité en matière de politique étrangère était la Chine. Dans ce contexte, chaque fois que l’on posait à Biden des questions sur le maintien éventuel d’une force américaine en Afghanistan, celui-ci répondait que la seule chose qu’il pouvait imaginer était le maintien d’une force de quelques centaines d’hommes — une force contre-terroriste.
Il me semblait néanmoins que, pour l’électorat américain, il n’y aurait pas une grande différence entre la présence en Afghanistan d’une force réduite de 1200 hommes et une force encore plus réduite de quelques centaines d’hommes.
Toutefois, il me semblait que ceux qui pensaient que le président Biden reviendrait sur l’engagement principal des accords de Doha — l’idée même du retrait — commettaient une erreur d’analyse. Ils prenaient trop peu en compte ce que le président Biden pense réellement de l’Afghanistan.
Biden s’est rendu à plusieurs reprises en Afghanistan en 2004 et en 2006 en tant que sénateur et membre du Committee on Foreign Relations du Sénat. Il y est retourné ensuite en 2009 en tant que vice-président. Les leaders afghans m’ont tous parlé de leur rencontre avec lui, qu’il s’agisse d’Ashraf Ghani, de Hamid Karzaï ou d’Abdullah Abdullah. Il ressortait de ces échanges, mêmes tenus à l’époque, que le Président Biden pensait que les États-Unis ne pourraient pas rester indéfiniment en Afghanistan et que les leaders afghans n‘étaient pas assez solidement implantés.
Un autre élément me semblait pouvoir jouer un rôle d’indicateur quant à la position de Biden en cas de victoire électorale démocrate. Joe Biden était le seul à s’être opposé à la politique du surge, décidée par le président Obama, qui avait conduit à une hausse exponentielle de la présence de troupes américaines dans ce pays à partir des années 2010 et 2011.
En tout cas, lorsque Joe Biden a été élu, de nombreux observateurs se sont mis à scruter avec soin les déclarations américaines pour deviner les intentions de Washington. Dans ce contexte, nous devions, côté français, nous préparer à toutes les éventualités. Nous avons anticipé le calendrier pour nous organiser. Nous avons pris comme hypothèse que Joe Biden annoncerait sa position sur la question d’un éventuel retrait autour de la première réunion ministérielle de l’OTAN, mi-février 2021.
De mon côté, en ce début d’année, je restais persuadé que les Américains souhaitaient retirer leurs troupes. C’est le moment où j’ai dit à mes contacts afghans et à mes interlocuteurs que l’engagement de retrait serait respecté par les Américains avec, par rapport à la date prévue du 1er mai, un retard probable de trois mois pour des raisons logistiques.
Les Américains auraient-ils pu partir encore plus tard qu’à l’été 2021 ? Je ne le pense pas. Tous les observateurs s’accordaient sur le fait que les Talibans auraient très mal pris le fait que les Américains décident de repousser une fois de plus la date de leur départ. Peut-être que les annexes secrètes des accords de Doha — ne pas s’en prendre aux villes et aux missions diplomatiques — n’auraient alors plus été respectées.
Le Président Biden pensait que les États-Unis ne pourraient pas rester indéfiniment en Afghanistan et que les leaders afghans n‘étaient pas assez solidement implantés.
David Martinon
D’après le général Kenneth F. Mackenzie1, les Américains auraient pu rester en Afghanistan en maintenant une présence de 2 000 hommes. La CIA y était apparemment favorable. Rétrospectivement, pourquoi le choix d’un retrait total a-t-il été effectué ? Certains ont pu supposer, lorsque Lloyd Austin a été choisi2 pour être ministre de la défense au lieu de Michelle Flournoy, dont le nom était régulièrement évoqué, que cela pouvait être indicatif d’une volonté de se retirer d’Afghanistan…
Le choix de Floyd Austin comme Secrétaire à la Défense de Biden est crucial : c’est lui qui avait mené l’opération de retrait d’Irak. Il est vrai que Mackenzie et les militaires du Pentagone voulaient garder une force sur place. Ainsi le délégué de l’OTAN, Stefano Pontecorvo, italien, dont l’opinion était proche de celle du Pentagone, disait qu’il n’était pas possible que les Américains partent aussitôt, parce que le général Miller avait besoin de 18 mois supplémentaires pour former les forces spéciales afghanes. Mais précisément, ce n’était pas au général Miller qu’il appartenait de prendre ce genre de décision, mais au président des Etats-Unis.
Par ailleurs, garder 2 000 personnes en permanence sur le terrain nécessite beaucoup de monde et de moyens. Les Américains auraient pu, en théorie, conserver la base de Bagram. Vous savez cependant que cette base a fait l’objet de tirs de roquettes quotidiens pendant 20 ans. C’est une base difficile à tenir, même si elle très bien protégée.
Il aurait été possible de mener des opérations de contre-terrorisme, mais il aurait alors manqué aux Américains les commandos afghans, parce qu’il est difficile d’envoyer la CIA ou les Delta Force sur le terrain dans un contexte aussi hostile. Or il est impossible d’avoir un commando afghan sur place si l’État est aux mains des Talibans ! Ce serait donc devenu progressivement une base militaire retranchée, isolée et donc inutile.
C’est pourquoi je n’ai jamais cru au maintien d’une force antiterroriste. Premièrement, parce que les Américains ont commencé à réduire les effectifs de la CIA très tôt, un an avant le retrait. Deuxièmement, parce que la CIA n’aurait pas pu travailler en ville ; elle n’aurait eu que difficilement accès aux sources. S’installer à Bagram uniquement ne suffit pas pour faire du renseignement.
Nous avions d’ailleurs pu le constater au cours des derniers mois précédant l’évacuation. Nous avions prévu que l’armée afghane se déliterait, parce qu’elle reposait trop sur l’aviation, qui nécessitait la présence américaine, à la fois pour la maintenance et pour les munitions. À partir du moment où les contractuels américains en charge de leur maintenance partiraient, les avions afghans ne pourraient plus être maintenus en état de fonctionner. En ce qui concerne les munitions, c’était pareil. L’armée afghane les épuisait rapidement, notamment les munitions intelligentes, si bien que les Américains ne parvenaient que difficilement à maintenir le rythme d’approvisionnement.
On a souvent fait un lien entre le retrait d’Afghanistan et la guerre en Ukraine. Quel bilan tirez-vous aujourd’hui de l’Afghanistan à la lumière de ce qui se passe en Ukraine ?
Il y a deux parallèles évidents. D’abord, il est vrai que le retrait d’Afghanistan a entraîné en Russie la perception d’un changement d’époque. Le Kremlin a pensé que les Américains n’étaient plus là pour tous leurs alliés. Par conséquent, il en a déduit qu’il était possible de faire quelque chose sur le terrain ukrainien. Il s’agissait à la fois d’une perception erronée et d’une erreur d’analyse, bien entendu.
Ensuite, la politique ukrainienne de Biden rappelle la politique afghane de Reagan, sauf qu’elle coûte beaucoup plus cher et que les proxies sont plus fréquentables que ne l’étaient certains des résistants afghans. Le résultat, dans les deux cas, est le même : fixer l’adversaire, le fatiguer, sans engager aucun soldat au sol. Précisons quand même que la guerre d’Afghanistan n’était pas perdue tout de suite pour les Soviétiques, comme le montrent les nombreuses incursions qu’ils sont parvenus à mener dans la vallée du Pandjshir, dans le fief du commandant Massoud. Tout a changé à partir du moment où la CIA a commencé à livrer des Stinger, à l’automne 1986. C’est un tournant stratégique : pendant tout l’automne de cette année, les résistants afghans détruisaient un aéronef soviétique par jour. En Ukraine, ce tournant stratégique a eu lieu beaucoup plus tôt, puisque les Manpads ont été distribués très vite, dès les premiers mois du conflit.
La politique ukrainienne de Biden rappelle la politique afghane de Reagan, sauf qu’elle coûte beaucoup plus cher et que les proxies sont plus fréquentables que ne l’étaient certains des résistants afghans. Le résultat, dans les deux cas, est le même : fixer l’adversaire, le fatiguer, sans engager aucun soldat au sol.
David Martinon
Est-ce que, selon vous, le retrait afghan a été décidé en raison d’un choix stratégique ou plutôt en raison d’une pression de l’opinion publique, liée par exemple à la diffusion des « Afghanistan Papers » par le Washington Post3 ?
Je crois que la pression de l’opinion publique américaine n’était pas si importante que cela. Donald Trump a été élu notamment sur la promesse de mettre fin aux guerres sans fin, certes, mais la population américaine n’était pas si impliquée que cela dans le retrait des troupes d’Afghanistan. Cela n’a rien à voir avec l’opposition à la guerre au Vietnam. En revanche, d’un point de vue stratégique, ce retrait s’inscrit dans le cadre du pivot chinois.
On a récemment parlé des projets d’investissements chinois, tels que l’annonce d’une liaison ferroviaire entre la Chine et l’Afghanistan4. Comment perceviez-vous la présence chinoise en Afghanistan quand vous y étiez ? Quel type de relation la Chine élabore-t-elle avec le régime taliban depuis l’été 2021 ?
Je ne pense pas que l’Afghanistan constitue un lieu stratégique pour la Chine. L’essentiel, pour la Chine, est la protection de sa frontière ouest, où les Chinois souhaitent contenir ce qu’ils perçoivent comme étant le « péril ouïghour ». Et concernant les terroristes ouïghours, regroupés dans le groupe dit « ETIM », ils le surestiment largement.
Quant aux intérêts économiques, la Chine est intéressée de façon générale par l’exploitation des terres rares et des métaux rares (lithium, cobalt). Cependant, cela n’a pas conduit les autorités chinoises à décider d’investissements massifs. Certes, les Chinois ont depuis des années la concession de la mine de Mes Aynak, qui est la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert au monde, dans la province du Lôgar.
Cependant, il s’agit aussi du plus grand site archéologique bouddhique à ciel ouvert. Avancer dans l’exploitation de la mine impliquerait une dégradation du site archéologique, ce qui gêne les autorités chinoises. Elles font le calcul qu’il serait trop coûteux politiquement de s’en prendre à un site d’une telle importance pour l’histoire et la culture bouddhiques.

Est-ce que pour vous l’Afghanistan est encore aujourd’hui perçu par la Russie comme sa frontière sud ? Quelle est la nature du soutien militaire russe apporté aux Talibans contre les forces américaines ?
La gestion par la Russie de sa frontière sud est une de ses préoccupations essentielles. C’est pourquoi les Russes stationnent des troupes dans les Républiques d’Asie centrale. Ils avaient également l’intention d’infliger des dégâts aux Américains. Il y a eu des livraisons d’armes et du mentorat, selon la CIA. Celle-ci a affirmé que des primes avaient été payées par la Direction principale du renseignement de l’état-major russe (GRU) pour chaque tête de soldat américain tué. Cette information n’est pas contestée.
En ce qui concerne le mentorat en particulier, il a été avancé qu’il était fait par des officiers russes de type centre-asiatique, comme du temps de l’intervention soviétique, où les unités d’élites qui ont mené le coup d’État de décembre 1979 étaient des officiers soviétiques d’origine turkmène, tadjike ou ouzbek.
Vous portez un regard assez critique sur les effets de l’aide internationale qui a été apportée à l’Afghanistan. Vous dites par exemple que « l’Occident a enrichi la couche supérieure de la société afghane, mais pas le pays ». Quels sont les aspects de l’aide internationale qui vous semblent les plus utiles et les plus nécessaires ? Lesquels sont moins bien calibrés ?
Il n’est pas possible de donner une réponse toute faite à cette question. Il faut reconnaître que nous avons tout à reprendre. On doit admettre, pour commencer, qu’on ne peut pas changer en vingt ans un pays comme l’Afghanistan. Ce n’est pas l’Allemagne de 1945, qui n’a besoin que de quelques années pour redémarrer. L’Afghanistan n’avait, en 2001, qu’une économie de subsistance et de contrebande.
Ensuite, je suis convaincu que le premier facteur de développement d’un pays est la bonne gouvernance. Cela s’est vu en Afghanistan. Si la gouvernance n’assure pas à la population les services publics élémentaires et les services de base, si elle est confisquée par des prédateurs qui pillent, cela va nécessairement gangréner toute la société. Pour parvenir à une bonne gouvernance, il faut mettre en place un État de droit, voire un État démocratique. Mais mettre en place une démocratie implique des transformations sociales et anthropologiques profondes.
Prenons l’exemple de l’agriculture, car le développement d’un pays implique le plus souvent, au départ, un surplus agricole. En Afghanistan, nous sommes très loin de cette situation de surplus, et cela ne devrait qu’empirer dans les années à venir en raison de l’érosion des sols. Je suis allé à Bâmiyân, où l’on a mis en place des projets de culture de pommes de terre. Elles sont excellentes et abondantes. Pourtant, les pommes de terre que l’on mange en Afghanistan aujourd’hui sont importées du Pakistan. Cela montre que le projet a été pensé et mené à bien de façon incomplète, sans réflexion sur la distribution finale des matières premières agricoles.
De même, on s’est trompé sur le coton. Les autorités afghanes demandaient à produire du coton, donc nous les avons aidées. C’était une erreur, parce que le coton nécessite beaucoup d’eau, laquelle est de moins en moins abondante dans ce pays, ce qui fait que la production de coton en Afghanistan ne pouvait être compétitive. En revanche, certains projets de niche ont bien fonctionné. La France par exemple a formé des apiculteurs qui produisent aujourd’hui du miel afghan d’excellente qualité.
Il y a néanmoins une culture agricole que l’Afghanistan maîtrise de bout en bout : le pavot, culture pour laquelle ils sont les meilleurs au monde, pour la culture, la transformation et la distribution. Le produit final n’est désormais pas du pavot coupé ou de l’opium de base, mais une héroïne d’une qualité telle qu’elle est directement commercialisable sur le marché européen. Il faut réfléchir aux manières d’employer autrement ces compétences. Ainsi a-t-on commencé à cultiver du safran à Hérat. C’est un produit qui n’est pas aussi rentable que le pavot, mais dont la culture présente des similitudes.
De façon générale, si une aide massive est indispensable, il faut qu’elle s’accompagne de conditions, d’une reddition très claire des comptes et d’un renforcement du cadre juridique, afin d’améliorer la gouvernance du pays. Le plus efficace consiste à engager la société civile dans cette mission d’observation des politiques menées par les acteurs publics. C’est pour cela que nous avons soutenu l’entrée de l’Afghanistan dans le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, et que nous avons aidé la société civile afghane à établir son Plan d’action.
De plus en plus, des Talibans pakistanais conduisent des attentats au Pakistan, comme le Tehrik-e-Taliban Pakistan5, qui avait fait allégeance à la « Choura de Quetta », principale organisation talibane entre 2001 et 2020. Quel bilan tirez-vous des relations entre le Pakistan et l’Afghanistan aujourd’hui ?
Que l’Afghanistan soit dans un état d’anarchie ou que l’Afghanistan soit gouverné par un gouvernement infréquentable, il a toujours été évident pour nous qu’aucun de ces deux scénarios n’est à l’avantage du Pakistan, qui a besoin non pas d’une profondeur stratégique, mais de voisins avec lesquels il puisse commercer pour nourrir sa nombreuse population et l’enrichir.
D’une façon paradoxale, certains observateurs avancent que la sécurité d’États comme l’Iran, la Russie ou la Chine a été négativement affectée par le retrait des Américains. Est-ce qu’il n’était pas préférable pour ces États qu’il y ait une présence américaine dans la région ?
On peut voir dans la réaction de ces États à la décision de Trump une confirmation de cette hypothèse. Ils disaient que le retrait américain, exécuté avec une telle rapidité, allait créer un « vide stratégique ». Ce constat est contradictoire avec le fait de vouloir que les Américains partent. En revanche, il est évident que les vagues migratoires vont se poursuivre, en Iran et au Pakistan. En effet, le régime taliban et ses méthodes ne font que provoquer chez les Afghans l’envie de fuir le pays.
Sur le terrain, on a pu constater avec étonnement que les Talibans ont pris assez vite Nimrooz. Le chemin Ouest a donc été fermé assez tôt — une telle progression de la percée talibane vous a-t-elle surpris ?
Les annexes secrètes de l’accord de Doha prévoyaient que les Talibans ne s’attaqueraient pas aux centres-villes. Cela explique pourquoi les Talibans ont commencé par avancer partout, sauf dans les centres-villes, à l’exception des raids qu’ils menaient pour libérer leurs frères d’armes des prisons de la république.
Pourquoi s’en sont-ils tenus à ces clauses secrètes ? Je dis souvent que les Talibans sont comme des patients paranoïaques. Avec de tels patients, la méthode dure ne fonctionne pas, car elle les renforce dans leur conviction que le reste du monde veut leur mort ; la méthode douce non plus, qu’ils interprètent comme de la faiblesse. Seuls l’établissement d’un rapport de force et le rappel à la loi peuvent fonctionner. Les Talibans sont attachés au droit. En ce cas-là, la seule référence qu’ils ont en commun avec les Américains est l’accord de Doha et ses annexes secrètes.
Je dis souvent que les Talibans sont comme des patients paranoïaques. Avec de tels patients, la méthode dure ne fonctionne pas, car elle les renforce dans leur conviction que le reste du monde veut leur mort.
David Martinon
Par ailleurs, comme en 1995, ils partent du Grand Sud pachtoune (les provinces de Kandahar, du Helmand, de Zabul, de l’Uruzgan) ; mais ils sont bloqués à Kandahar, à Lashkar Gah et à Kaboul par les forces spéciales de la République, sous le commandement du jeune général Sami Sadate, formé et propulsé par les Américains, qui confirment leur détermination et leur efficacité.
Plutôt que de s’obstiner, les Talibans décident alors d’opérer une bascule, en passant à l’Ouest et au Nord. Ce faisant, ils ont plus de résultats : d’abord ils ne sont plus bloqués ; ensuite, ils n’apparaissent pas comme une force ethnique provenant uniquement du sud pachtoune ; ils prennent de vitesse les warlords (« seigneurs de guerre ») du Nord, et enfin s’assurent très rapidement le contrôle de tous les points de passage frontaliers.
En appliquant une telle stratégie, les Talibans coupent donc les Républicains afghans de leurs ressources en les privant des « taxes » aux frontières. Vis-à-vis de la communauté internationale, ils donnent une impression de souveraineté.

La première ville qu’ils prennent est Nimrooz, aux confins de l’Afghanistan, de l’Iran et du Pakistan, terre de trafics, jamais véritablement contrôlée par le pouvoir central ; mais cela aurait tout aussi bien pu être une autre ville, la chronologie a été dictée par le rythme de leur progression sur le terrain.
Dans votre livre, vous décrivez le personnel diplomatique ainsi que les agents de droit local. Vous donnez l’exemple de Gulbuddin, un garde afghan qui était resté dans l’ambassade de France de 1996 à 2001, alors que les Talibans étaient au pouvoir. Pourriez-vous revenir sur l’importance, dans un pays comme l’Afghanistan, de ces employés de droits locaux pour préserver la mémoire diplomatique et la compréhension du pays ? Savez-vous ce que ces employés sont devenus depuis leur arrivée en France ?
Tous sont aujourd’hui en France. Certains voulaient aller en Iran mais ont finalement changé d’avis à la chute de Kaboul. Ils vivent la vie de réfugié. Certains maîtrisaient bien le français et avaient des compétences qui leur permettent de travailler, comme comptables par exemple. Mon interprète a été embauché au ministère des Affaires étrangères. Un des conducteurs a été accueilli avec sa femme et ses enfants par la ville de Val-de-Reuil, pour laquelle il travaille désormais comme conducteur de bus.
La mémoire conservée par les employés de droit local est très importante pour moi. Elle a fait la différence au moment de l’analyse de la situation que nous avons menée au début de l’année 2020. Je me suis plongé dans l’histoire afghane. Au-delà des livres, j’avais demandé à ce qu’on retrouve Gulbuddin, que vous mentionnez, pour qu’il me raconte comment s’était passée l’arrivée des Talibans à Kaboul en 1996. Il avait quand même assisté à la pendaison du président Najibullah et de son frère, à un lampadaire situé à cent mètres de l’ambassade de France. C’était important pour moi de savoir, d’un point de vue pratique, comment l’ambassade avait pu tenir à cette époque.
J’étais par ailleurs aidé par ma conseillère spéciale, Farida Akram, qui a travaillé avec tous mes prédécesseurs depuis 2001, et qui nous a aidés par la suite au Quai d’Orsay lors des évacuations. Elle avait la mémoire de la grande et de la petite histoire. Elle connaissait les relations interpersonnelles entre les dirigeants afghans ; par exemple, les relations entre Ahmed Zia Massoud et Younous Qanouni ; entre Mohammed Qasim Fahim et Abdullah Abdullah ; entre Hamid Karzaï et Aschraf Ghani. Il s’agissait là d’informations très précieuses.
Vous décrivez l’ensemble du personnel français impliqué : les forces françaises aux Émirats arabes unis ou une section du 5ème régiment de cavalerie. On voit se déployer tous les acteurs d’une diplomatie de crise. Pourriez-vous faire un panorama des acteurs français qui interviennent lors d’une évacuation, sur la base de votre expérience ?
Les premiers décideurs, ce sont bien évidemment les autorités françaises, dont on doit obtenir l’approbation pour prendre des décisions telles qu’évacuer les employés afghans de l’ambassade de France.
Quand j’avais dit au directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, 15 mois avant l’évacuation, qu’il allait falloir fermer l’ambassade pour des raisons politiques et de sécurité si les Talibans arrivaient, j’ai ajouté que je ne voulais laisser personne derrière, comme cela avait pu être le cas ailleurs par le passé. Je ne voulais pas vivre cela.
Il fallait également éviter à tout prix le scénario de la chute de Saïgon, et plus encore la chute de Phnom Penh. À Phnom Penh, comme notre collègue François Bizot l’avait raconté dans son livre Le Portail, les Khmers rouges avaient obligé les employés de l’ambassade de France à faire sortir les gens liés à la République qui s’y étaient réfugiés. Ceux qui étaient sortis avaient tous été tués.
Ensuite, en plus des autorités politiques, la Direction de la sécurité diplomatique jouait un rôle de terrain très important, notamment pour aider à la mise en sécurité des emprises diplomatiques, et ensuite pour valider notre planification de sécurité (par exemple, le plan d’évacuation des Français et du personnel de l’ambassade).
Enfin, les derniers maillons de l’évacuation étaient l’ambassadeur avec son équipe diplomatique, qui travaillait sur place avec la DGSE, avec la Mission de Défense, avec le détachement de sécurité – en l’occurrence des policiers, gardes de sécurité diplomatique et opérateurs du RAID – et le Service de Sécurité intérieure, dirigé par l’Attaché de Sécurité intérieure (un colonel de Gendarmerie et son adjoint policier) pour préparer, planifier les opérations en s’assurant de la plus grande sécurité. C’était un travail collectif très concret, et absolument critique.
Il fallait par exemple trouver les voies de sortie du pays. J’en avais parlé à Gulbuddin. En 1994, quand la guerre civile s’était propagée dans Kaboul avec l’utilisation de l’artillerie, nos prédécesseurs avaient dû partir en une nuit, après qu’un tir de roquette a tué trois de nos gardes afghans. Ils étaient partis par la route vers Termez, ville ouzbèke à la frontière avec l’Afghanistan. J’ai donc demandé qu’on regarde toutes les routes et qu’on établisse les différents scénarios possibles. Nous en avions identifié quatre. Pour chacune, nous avons compté le nombre de pleins à prévoir pour nos véhicules blindés, le nombre de véhicules possibles pour conserver une certaine agilité au cortège, qui risquait d’être pris sous le feu, donc le nombre de passagers maximal, entre autres choses. Et assez vite, aucune route ne s’est révélée praticable. Nous étions certains que toutes allaient être rapidement contrôlées par les Talibans, entièrement ou en partie.
Comment faire, dans ce contexte, pour identifier les routes qu’il faut privilégier ? Est-ce qu’un service interministériel est impliqué ?
Dans de telles situations, l’ambassadeur doit prendre beaucoup de décisions, car nous nous trouvons au niveau tactique. Nous dialoguons bien sûr constamment avec le Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO), le centre opérationnel du ministère des Armées. Ils regardent ce que l’on propose et nous disent ce qu’ils peuvent nous fournir.
Ensuite, j’avais fait valider ma planification très en avance, en définissant notamment des critères, des jalons qui devaient m’amener à déclencher certaines étapes dans le plan. Pour moi, le dernier jalon était la chute de Jalalabad, à 150 km à l’Est de Kaboul. Quand Jalalabad tombait, il fallait que nous soyons partis dans les 48 heures.
Le dernier jalon était la chute de Jalalabad, à 150 km à l’Est de Kaboul. Quand Jalalabad tombait, il fallait que nous soyons partis dans les 48 heures.
David Martinon
En somme, j’étais le chef au niveau tactique. De leur côté, les unités impliqués, comme le RAID ou le Commando Parachutiste de l’Air n°10 (CPA 10), informaient aussi leur hiérarchie parisienne, mais celles-ci n’étaient pas sur place. Pour vous donner un exemple concret, le commandant du CPA 10 était aussi mon conseiller militaire tactique, avec mon Attaché de Défense. Evidemment, je ne décide aucunement de l’engagement des forces spéciales – puisque cela relève d’une décision du Président de la République – mais le chef du commando était là pour m’assister dans mes décisions tactiques.
Nous avions par ailleurs tous les jours des réunions téléphoniques avec les directeurs de cabinet des deux Ministères, respectivement des Affaires étrangères et des Armées. À ces réunions participaient l’état-major, le CPCO et le Centre de crise et de soutien (CDCS) du Quai d’Orsay.
Pourriez-vous revenir sur ce rôle du Centre de Crise et de soutien du Quai d’Orsay et les interactions entre le CDCS et vous ?
Le directeur adjoint du Centre de crise et de soutien du Quai d’Orsay était celui que l’on pouvait joindre à tout instant, à n’importe quel moment. Mon n°2 l’appelait plus souvent que moi.
Par ailleurs, j’ai rapidement eu l’instruction de ne plus traiter en direct les gens qui, depuis la France, me demandaient d’évacuer telle ou telle personne. Cela nous a protégé et permis de travailler plus efficacement. Toute seconde passée au téléphone était une seconde que l’on ne passait pas à évacuer des personnes. Le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères nous a libérés de cette tâche, en confiant au CDCS et à la direction Asie le soin de centraliser l’information et d’attirer notre attention sur les personnes à sortir.
Vous évoquez dans votre livre le rôle des réseaux sociaux. Quelles leçons en tirez-vous sur l’utilité des réseaux dans la gestion de crise et plus généralement dans la diplomatie française ?
La diplomatie publique est fondamentale. J’ai déjà dit qu’il faut que l’on assume, en tant que diplomates, d’être des agents d’influence, autrement dit des influenceurs. Les réseaux sociaux sont un outil efficace et peu coûteux pour conduire ce travail d’influence.
Mon utilisation des réseaux sociaux à Kaboul pendant cette quinzaine était tactique et concrète. A un moment, par exemple, il fallait tout simplement que je trouve un moyen d’indiquer ma position à mes autorités à Paris, à l’OTAN, aux Américains et accessoirement à ma femme, parce que dans ces moments de crise il n’y a plus de communication téléphonique. Les réseaux sociaux permettent, avec un minimum de connectivité, d’envoyer un message que tout le monde reçoit instantanément.
Indiquer sa position, donner des preuves, notarier : il faut prendre des photos de tout ce que l’on fait, non pas pour se faire plaisir, mais pour la mémoire longue et pour la mémoire immédiate.
Je savais qu’il y aurait des polémiques. Il a fallu par exemple que je poste une photo de nous en train de travailler dans nos conteneurs Thalès à l’aéroport, le 16 août, parce que des gens malveillants colportaient la rumeur que j’étais parti d’Afghanistan. Or tout au contraire, à ce moment-là, avec l’ambassadeur d’Espagne et le Délégué de l’Union européenne, nous étions les seuls ambassadeurs présents à l’aéroport.
Cela m’a aussi servi pour résoudre un problème concret. Lorsque l’évacuation a commencé, un certain nombre de personnes se sont réfugiées à l’ambassade, mais ne pouvaient pas sortir, car la foule massée devant les portes de l’ambassade était trop importante pour qu’on puisse les ouvrir. Donc j’ai indiqué dans un tweet que l’ambassade se trouvait désormais à l’aéroport et qu’on ne délivrerait plus de visa dans l’ancienne ambassade. Ce sont les Talibans eux-mêmes qui sont allés montrer le tweet aux gens devant l’ambassade pour les faire partir. C’est comme ça que nos gardes ont pu actionner le portail et faire sortir ceux qui y étaient bloqués.
Après l’attentat du 26 août, qui a tué près de 200 personnes, j’ai utilisé Twitter pour dire aux Afghans de quitter la zone, face à la menace d’un second attentat, et pour dire à nos proches qu’aucun Français n’était présent à ce moment-là à l’endroit où l’attentat avait eu lieu. Ce n’était donc pas pour moi de la communication ; ces réseaux sociaux étaient de véritables outils d’information.
En tant que diplomate en poste dans un pays comme l’Afghanistan, parvient-on également à interagir avec des personnes ordinaires ? Comment ne pas rester en vase clos avec les élites locales et internationales ?
Dans l’ensemble, les ambassades parlaient tout le temps aux mêmes. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai fait une sélection, entre les personnes que je voulais rencontrer et celles avec qui les interactions me semblaient de moins en moins utiles.
Régulièrement, je recevais des délégations de provinces éloignées. C’était des parlementaires, des maires, des gouverneurs. Les gens ordinaires, je pouvais les rencontrer sur le terrain, en voyageant, notamment à Bamyan, dans le Pandjshir, à Hérat, à Istalif, ou à Mazar é charif. A chaque fois que je me rendais dans une de ces villes, j’y rencontrais des représentants de la société civile.
En ce qui concerne les questions de politique intérieure, vous portez dans votre livre un jugement critique sur Aschraf Ghani (président de 2014 à 2021), et un jugement plus positif sur Abdullah Abdullah (premier ministre de 2014 à 2020, puis Président du Haut Conseil pour la réconciliation nationale en 2020-2021). Pourriez-vous revenir sur leurs bilans respectifs ?
Aschraf Ghani mérite énormément de critiques. C’est un homme intelligent, un technocrate de la Banque mondiale devenu un politicien qui parvenait souvent à ses fins mais qui incarnait la corruption de la République, et qui était complètement hors sol. Nous avions la sensation qu’il n’était plus en prise avec les réalités de son pays.
On peut aussi lui reprocher de n’avoir pas réussi à renforcer l’unité nationale. En effet, il a su s’imposer aux seigneurs de guerre, mais n’a pas respecté les accords qu’il concluait avec eux, ce qui a créé beaucoup de frustrations et de ressentiments à son encontre.
Or les chefs de guerre sont indispensables pour défendre le pays : je pense à Atta Mohammad Nour ou à Abdul Rachid Dostom. Désarmés par la police et l’armée de la République, ils n’ont pas tenu le choc face aux Talibans. Je tiens néanmoins à dire que la chute de Kaboul n’est pas de la seule responsabilité de Ghani. Mis à sa place, même le général de Gaulle, même Churchill n’auraient pas pu empêcher la chute de Kaboul.
Le docteur Abdullah est quelqu’un pour qui j’ai beaucoup de respect. C’est quelqu’un de modéré et de raisonnable. Je lui reprocherai d’avoir été trop respectueux des règles, au sens où, à un moment, puisque Ghani prenait de mauvaises décisions qui consistaient notamment à retarder l’entrée dans les négociations, le docteur Abdullah aurait dû défendre plus vigoureusement ses vues. Abdullah est par ailleurs le seul avec Hamid Karzaï à être resté à Kaboul aujourd’hui, où leur vie est loin d’être facile.
Vous montrez dans votre livre comment Achraf Ghani a mené une politique pro-pachtoune au sein des élites de la République, mais aussi comment les Talibans ont réussi à ne pas se présenter comme uniquement pachtounes pour obtenir des soutiens dans le Nord. Comment avez-vous vu ces évolutions ? À quel point cette grille de lecture ethnique est-elle importante pour comprendre la victoire des Talibans et la faiblesse du gouvernement Ghani ?
La ligne est très étroite. Il faut reconnaître à Ghani qu’il a réussi à soumettre les seigneurs de guerre, ou ce qu’on appelle les « ethnarques », c’est-à-dire les chefs militaires et parfois politiques des groupes ethniques. Je reste persuadé que pour bâtir un Afghanistan stable, il faudra que les Afghans dépassent leurs seules identités ethniques. C’était d’ailleurs l’intuition qu’avait le roi Amanullah Khan lors de la création du Royaume d’Afghanistan en 1926. Il s’est rendu compte que pour forger un sentiment national, pour cet État nouveau qui était un agrégat de tribus, il fallait dépasser de telles appartenances.
Rappelons à cet égard que les Pachtounes et les Tadjiks constituent certes des groupes ethniques, mais ils n’ont pas de volonté de rattachement. Il y a plus de Pachtounes au Pakistan qu’en Afghanistan, mais les Pachtounes d’Afghanistan ne demandent pas à être rattachés au Pakistan. Les Tadjiks d’Afghanistan n’ont jamais eu l’idée d’un rattachement au Tadjikistan. Il en va de même pour les Ouzbeks afghans. Et j’ajoute que ni le Tadjikistan ni l’Ouzbekistan n’ont jamais exprimé le moindre irrédentisme à l’égard de ces communautés afghanes.

L’identité d’un individu découle de ce que l’on dit de lui et de celle que lui-même s’assigne. Un Afghan va être tadjik s’il se dit tadjik et si on dit qu’il l’est. Je dis cela car au sein de la jeunesse urbaine, ces divisions n’étaient pas présentes. Ma conseillère Farida Akram, par exemple, n’a jamais voulu me dire à quelle communauté ethnique elle appartenait. Pour beaucoup de jeunes Afghans, ces critères sont dépassés.
Cependant, si dans l’administration on continue à ne favoriser que les Pachtounes, les Tadjiks seront frustrés. Cette frustration s’exprime par un repli sur l’ethnie et sur l’ethnarque. Mais ce que l’on a vu, c’est que dès lors que l’ethnarque se comporte de façon autoritaire, comme un seigneur féodal sur ses terres et sujets, et qu’il malmène ceux qu’ils considèrent comme des concurrents, il les conduit invariablement à se tourner vers les Talibans.
Pensez-vous que les Talibans ont encore l’intention de mettre en place un Pachtounistan ?
Je pense que les Talibans sont des nationalistes afghans, ce qui explique la mise à distance d’avec les Pakistanais et l’impossibilité, même pour les Qatariens ou les Iraniens, de les influencer réellement. Cela explique aussi pourquoi, lorsqu’un pays musulman tente de les influencer en proposant d’envoyer des oulémas plus raisonnables, ces oulémas sont rejetés. On entend souvent dire qu’il faudrait leur envoyer des oulémas d’Al Azhar ou des oulémas indonésiens. Les Talibans considèrent qu’ils ont la bonne interprétation du Coran et que les autres sont dans l’erreur.
Enfin, pour finir de répondre à votre question, je dirais que si les Talibans sont des nationalistes afghans, pour eux, afghan signifie pachtoune !
Sur l’évolution intérieure du pays, on voit l’existence d’une concurrence croissante entre les Talibans et l’État islamique du Khorasan (ISIS K). Cela affecte la façon dont la légitimité du gouvernement taleb est perçue. Comment percevez-vous l’interaction entre ces deux groupes et l’évolution du rapport de force ?
Les Talibans ne se montrent qu’imparfaitement capables de tenir leur promesse de stabilité, ce qui est démontré tous les jours. Il existe trois formes de résistance en Afghanistan : le National Resistance Front, constitué par des résistants pandjshiris et ceux du Badakhchan, qui sont durement réprimés car ils sont les plus « présentables » ; il y a à l’évidence une opposition interne au pouvoir Taleb, et en particulier à l’encontre de l’émir Haibatullah et de son cercle restreint de Kandahar, mais cette opposition ne prévaut pas. Elle n’est que latente. Enfin, il y a Daesh. On sait qu’il y a des cellules de l’État Islamique au Khorassan, la branche afghane de Daesh, au Pakistan aussi, dans les villes déjà un peu éloignées de la frontière. Daesh n’a jamais eu de problème pour recruterdes gens d’un niveau d’éducation souvent plus élevé que les Talibans, dans les provinces de Kunar ou du Logar, mais aussi à Kaboul.
Toute la campagne de reconquête du pays par les Talibans explique comment Daesh a pu se recomposer aussi rapidement. En effet, au début, quand les Talibans libéraient les prisons, ils tuaient systématiquement les Daeschis, puis ils ont progressivement cessé de le faire et ont fini par laisser libres les combattants après avoir tué les chefs.
C’est pourquoi, à la fin d’août 2021, on a vu converger vers Kaboul une force daeshie de plusieurs centaines d’hommes. Ce sont eux qui ont planifié l’attentat du 26 août. Depuis, on a vu l’effroyable mortalité provoquée par les attentats de Daesh : contre les Hazaras, pendant le Ramadan ; lors de l’attaque de la maternité de Dasht-e-Barchi, dans le quartier chiite de Kaboul, après laquelle le docteur Bina a sauvé la jambe d’un bébé né il y a 40 minutes, qui avait pris une balle de kalachnikov ; l’école des filles du même quartier (96 mortes, les quatre classes sortaient de l’école au moment de l’explosion) ; les hindous ; les sikhs ; certains responsables talibans ; et désormais, la communauté diplomatique. Daesh a tué deux agents diplomatiques russes ; ils ont tenté de tuer l’ambassadeur du Pakistan et ont attaqué la guest house habituelle des diplomates et des hommes d’affaires chinois.
Dans leur volonté de fédérer les communautés pour mener une résistance armée dans tout le pays, les Talibans avaient envoyé des signaux censés indiquer qu’ils voulaient inclure des personnes venant d’ethnies non-pachtounes. L’ambivalence d’une telle ouverture est illustrée par le sort de Mahdi Mujahid, premier Taliban hazara (de confession chiite), qui a rejoint le mouvement avant de choisir de mener une insurrection contre lui. Il finira par être tué en août 2022. Avant leur conquête de Kaboul, les forces armées des Talibans comptaient-elles de nombreux combattants non-pachtounes ? Cette « inclusivité » affichée était-elle réelle ou une simple stratégie de communication ?
Je n’ai jamais cru à ces promesses d’ouverture. Ils restent profondément des Pachtounes. Certes, il y a un Turkmène dans le gouvernement, un Hazara, mais les autres sont tous des Pachtounes, et d’ailleurs majoritairement de la tribu des Nourzaï ; ce qui explique les massacres perpétrés récemment contre la tribu des Achekzaï, considérés comme ayant été trop proches du général Abdul Raziq Achekzaï qui était, depuis Kandahar, le chef de toutes les forces de police dans le grand Sud pachtoune. Les Nourzaï, qui constituent la principale tribu pachtoune, ont donc utilisé la dénonciation de cette proximité pour écarter les Achekzaï. Il ne fallait pas croire à leurs promesses : les Talibans modérés n’existent pas.
Est-ce que vous diriez que l’idée d’une division des Talibans entre les partisans d’une ligne dure, proche de Seraj Haqqani, et ceux d’une ligne plus ouverte à la négociation et au compromis, proche d’Abdul Ghani Baradar, est factice ? Faut-il prendre au sérieux les rumeurs faisant état de supposées dissensions internes ?
La culture de gouvernance taleb est une culture du consensus. Chez les Talibans, il y a une choura militaire, une choura politique qui, après consultation de la choura religieuse, transmettent une proposition de décision à l’émir. Celui-ci décide soit d’accepter, soit de refuser, soit de demander des modifications à ce qui lui est proposé. Par ailleurs les Haqqani, qu’on disait les plus jusqu’au-boutistes, se sont eux aussi impliqués dans les négociations avec les Américains, ne serait-ce que pour obtenir la libération de prisonniers. En même temps, les Talibans étaient tous d’accord quant au fait de vouloir obtenir une grande victoire militaire. Ils donnaient peut-être à certains l’impression qu’il y avait plusieurs voix au sein de l’insurrection. Mais ils n’ont jamais cessé d’être d’accord sur les grands principes et les grandes orientations stratégiques, ce qui n’a jamais été en contradiction avec l’organisation décentralisée de l’insurrection.
Certes, il y a eu des règlements de compte. D’autres sont partis chez Daech et se sont faits tuer. Mais à part cela, les relations entre Yaqoub, Haqqani et Baradar étaient finalement assez fluides. C’était un mouvement divers et décentralisé, mais avec un commandement unique qui a bien fonctionné.
Il est vrai qu’il y a eu au moment de la prise de Kaboul des rivalités de pouvoir. Haqqani et Iaccoub ont obtenu la part du lion. Mais c’est un mouvement dans lequel, s’il y a de la contestation, pour autant, à la fin, une seule voix prévaut : celle de l’émir. Je récuse l’idée qu’il y ait des Talibans modérés à qui il faudrait parler. Certains pensent qu’il faut savoir parler à la communauté internationale, mais ça ne change rien au fait qu’à la fin, c’est l’émir qui décide.

Dans les rapports de force actuels, où en est la résistance dans le Pandjshir, et pourquoi n’a-t-elle pas davantage réussi ?
Quand on est dans le Pandjshir, si on s’avance vers le fond de la vallée, on atteint des chemins qui, en rejoignant les cols, amènent vers le Nuristan et le Badakhshan, ce qui prend 15 jours de marche. Quand il le fallait, le commandant Massoud partait et revenait ensuite, quand la situation était moins critique. Mais aujourd’hui, le Nord du Panjshir est contrôlé par les Talibans.
Il est donc désormais impossible de quitter la vallée du Panjshir pour rejoindre des bases arrière dans le Nord, et il n’y a plus de liaison possible avec le Nord et le Tadjikistan, donc pas de livraison d’armes ou d’argent.
Pour autant, comme les Talibans s’échinent à répéter les erreurs du passé, ils connaîtront les mêmes conséquences qu’auparavant. En Afghanistan, la colère finit toujours par s’armer.
Vous avez dit que les Talibans répétaient les erreurs du passé. Diriez-vous que les faiblesses du gouvernement actuel sont plus grandes ou moins grandes que celles du précédent ?
Je ne saurais pas dire combien de temps le régime taliban peut tenir. Pour le moment, ils ne sont pas tellement corrompus. Ils ont aussi une capacité à inspirer la crainte et à se faire obéir en conséquence. Par ailleurs, Gilles Dorronsoro et Adam Baczko ont montré dans leurs études sociologiques que les Talibans avaient bénéficié de l’absence d’État, notamment en substituant dans les provinces la justice chariatique à la justice de la République, qui s’est décrédibilisée d’elle-même.
C’est la corruption des juges qui a considérablement affaibli la République. Tout le monde en Afghanistan vous confirmera, même ceux qui étaient très attachés à la République, que la justice républicaine était corrompue, imprévisible et lente, quand elle n’était pas totalement absente de certaines provinces. Par conséquent les gens, même sans affinité avec les Talibans, allaient voir les juges taleb, qui administraient une justice brutale mais prévisible, rapide, et non corrompue. Si vous lisez David Galula, Contre-insurrection : théorie et pratique, vous voyez qu’une insurrection prospère là où il n’y a pas d’État et pas de justice.
Enfin, il semble que les Talibans parviennent aujourd’hui à lever les taxes, ce qui est essentiel.
Que peut-on tirer comme leçons, du point de vue de l’histoire diplomatique, de l’accord de Doha ?
Tout d’abord, les Américains ont commis des fautes tactiques. Quand Obama dit qu’il va engager des négociations tout en fixant une date limite de départ, il affaiblit irrémédiablement sa position : les Talibans répètent souvent cette expression afghane : « vous avez les montres ; mais nous, nous avons le temps ».
Trump ne fait pas la même erreur en apparence, mais il est évident que son objectif est de retirer ses troupes. Or il est difficile d’obtenir des concessions si le départ est absolument certain et recherché avec hâte. Cela a habitué les Talibans à ne faire aucune concession dans la négociation.
Ensuite, du côté de la République d’Afghanistan, ses représentants se plaignaient de n’être pas inclus dans la négociation, mais — et c’est la responsabilité principale du président Ghani — ne prenaient pas les mesures nécessaires pour peser tout de même sur les négociations. Khalilzad assumait en effet de ne parler qu’aux Talibans. Ce faisant, il a mis les autorités de la République dans une situation impossible, mais il aurait fallu qu’elles refusent ce diktat et s’engagent réellement dans la négociation inter-afghane, au lieu de procrastiner par instruction de Ghani.
Par exemple, quand ils étaient sommés de libérer des prisonniers en vertu des accords signés entre Américains et Talibans, ils auraient pu dire publiquement qui étaient ces combattants dont les Talibans exigeaient nominativement la libération : pour un grand nombre d’entre eux, c’étaient des trafiquants de drogues, des violeurs ou des criminels de guerre. Faire la vérité sur la nature des demandes talebs aurait permis d’engager la bataille des récits avec les Talibans. Dans une négociation, tout peut compter. Les seules batailles qu’on est toujours certain de perdre sont celles qu’on ne livre pas. Les républicains afghans n’ont pas livré celle-ci.
Il est vrai que l’accord de Doha était particulièrement déséquilibré, avec des engagements fermes, vérifiables et datés incombant aux Américains et partant, à leurs alliés, et des promesses vagues et non vérifiables du côté des Talibans. J’avais vite noté que les Talibans ne cherchaient pas à négocier de bonne foi mais simplement à gagner du temps pour atteindre la date-limite du 1er mai 2021, sans donner aux Américains le moyen d’actionner la clause de conditionnalité générale de l’accord. La rédaction de cette clause révélait par ailleurs l’absence d’intention d’en exciper.
Contrairement au narratif qu’on essayait de nous vendre, il était clair pour moi que les Talibans n’avaient pas changé. Notre position, isolée au départ, est finalement devenue majoritaire sous la pression des décisions brutales et absurdes du nouveau régime. La talibanisation du pays était pourtant à l’œuvre sous nos yeux. De partielle, elle deviendrait complète avec deux événements : l’oppression totale des femmes, et la reprise, comme entre 1995 et 2001, des exécutions publiques, femmes incluses.
Sources
- « Afghanistan : Biden was advised to keep 2,500 troops, say generals », BBC News, 28 septembre 2021.
- https://www.politico.com/news/2021/04/28/lloyd-austin-pentagon-chief-484874 ; https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/12/10/around-the-halls-brookings-experts-on-defense-react-to-the-nomination-of-gen-lloyd-austin/
- Craig Whitlock, « At War with the Truth », The Washington Post, 9 décembre 2019.
- Xinhua, « Land corridor via rail connects Afghanistan to China as 1st freight arrives », Global Times, 24 septembre 2022.
- « Pakistan Taliban warn of more attacks against police after compound raid », France 24, 18 février 2023.

