Les Taliban ont-ils gagné la guerre par le droit ? Une conversation avec Adam Baczko
Pour comprendre la défaite américaine en Afghanistan, les explications avancées semblent toujours tomber dans des impasses culturelles et militaires. Adam Baczko, dans La guerre par le droit, les tribunaux Taliban en Afghanistan (CNRS éditions) apporte un nouveau regard sur la question en montrant que la guerre a peut-être été perdue du fait d'une défaite juridique et anthropologique. Dans cet entretien, il revient sur le système Taliban, la logique des opérations américaines et les leçons à en tirer.
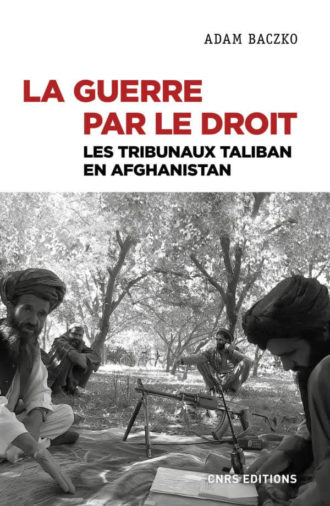
L’approche sociologique des guerres civiles1 est au cœur de vos travaux. Pourriez-vous développer votre méthode expérimentale, et notamment dans le cadre de l’opposition que vous dessinez avec la méthode dite « néopositiviste », qui se fonde sur la théorie dite du choix rationnel ?
Le point de départ, c’est de comprendre qu’une grande partie des travaux en sciences sociales sur les conflits armés, et l’Afghanistan n’y fait pas exception, sont fondés sur ce qui devient aujourd’hui le courant dominant en économie et en sciences politiques, c’est-à-dire des travaux qui présupposent les intentions des acteurs en se fondant sur l’idée qu’ils sont des acteurs exclusivement rationnels, mus uniquement par des intérêts économiques. Les conflits sont alors définis par ce qui est capturable, ce que l’on définit en metrics et par un usage abondant mais parfois trop simpliste des statistiques, avec une faible prise en compte des complexités d’un contexte de conflit armé. N’être centré que sur les questions de violence et ne pas voir les processus sociaux profonds qui se jouent dans les guerres civiles aplatit ces phénomènes, nous empêche de voir leur complexité.
Je propose donc de sortir de ce sens commun des guerres civiles comme des moments de paroxysme violent, de chaos, d’anarchie, d’effondrement des sociétés pour regarder au contraire l’extraordinaire productivité sociale qui se joue dans ce contexte : ce sont des moments révolutionnaires, d’ascensions ou de déclins sociaux, de transformations des hiérarchies de genre, d‘âge, des hiérarchies ethnico-religieuses, ainsi que des moments de production institutionnelle intense, et cela se voit particulièrement dans le domaine juridique.
Je l’explique dans mon livre, une situation de guerre civile n’est pas une situation de non-droit mais au contraire de multiplication des revendications à faire du droit. L’apport principal d’une approche sociologique des guerres civiles est donc de décrire les effets sociaux d’une guerre et les processus sociaux qui sous-tendent leur évolution et leurs trajectoires : le fait qu’une guerre civile se prolonge, qu’elle se finit, les modalités à travers lesquelles elle se fait.
Une telle approche permet également de montrer qu’une guerre civile n’est pas qu’un conflit interne, contrairement à l’idée fausse qu’a inspirée la philosophie politique, ce sont au contraire des moments d’internationalisation. Et ce que montre une approche sociologique des guerres civiles, c’est la centralité des processus internationaux, y compris pour des phénomènes qui paraissent locaux au premier regard.
Qu’est-ce que les guerres civiles ont à nous apprendre ? Ont-elles quelque chose à nous apprendre sur l’individu ainsi que sur la construction de l’État et la place du droit dans cette construction ?
Les guerres civiles sont intéressantes car, comme elles sont des cas radicaux de processus politiques que l’on retrouve ailleurs, elles jouent un rôle de révélateur. Elles dénaturalisent le monde social. Tout le problème des sciences sociales est que dès que nous rentrons dans des situations de violence politique, il y a une tendance à faire de ces situations des exceptions et à proposer d’utiliser des outils d’analyse exceptionnels.
Le projet du groupe que nous formons avec Gilles Dorronsoro, et qui a été l’objet du programme européen « Social Dynamics of Civil Wars »2, c’est de rattacher les guerres civiles à la sociologie générale, de cesser de penser qu’on peut faire de la sociologie en France, mais pas en Afghanistan. Au contraire, il s’agit même de mettre en lumière les processus sociaux que l’on voit à l’œuvre au Mali, en Syrie ou en Afghanistan, dont certains sont étonnamment familiers et, à l’inverse, des processus exceptionnels en Afghanistan qui le sont beaucoup moins en France. J’ai beaucoup travaillé de manière comparative car l’explosion des litiges privés, par exemple en Afghanistan, ou la multiplication des revendications à faire du droit, ce n’est pas une spécificité de l’Afghanistan mais c’est ce que l’on retrouve dans toutes les guerres et cela montre quelque part qu’une guerre civile est un moment d’extrême questionnement sur l’ordre politique, sur les rapports entre ordre politique et problèmes personnels, un moment de politisation des questions personnelles. Et c’est en même temps un moment de réarticulation d’une société, de ses institutions politiques avec l’ordre international.
La guerre civile est un moment d’extrême questionnement sur l’ordre politique, sur les rapports entre ordre politique et problèmes personnels, un moment de politisation des questions personnelles.
adam baczko
Les guerres civiles ne se déroulent pas dans des pays comme le Canada ou la Suisse mais dans des zones marginalisées dans le système international et économique. Ces zones marginalisées dépendent non seulement d’éléments qui structurent le système international, comme la fixité des frontières, mais également de la reconnaissance internationale et des importantes ressources qui l’accompagnent. On peut gouverner pendant 20 ans le Somaliland dans la paix, si cette entité n’est pas reconnue, elle est autre chose qu’un État, et ce même si elle en a tous les marqueurs.
Les guerres civiles reprennent cette double logique d’un système international qui repose sur les États mais qui met également en place des politiques d’organisations internationales ou transnationales qui contournent les États, qui fonctionnent de moins en moins en construisant des politiques publiques mais qui s’appuient sur des dynamiques plus locales et qui ont, dès lors, des effets de fragmentation très importants.
La première insurrection, dans les années 1980, est placée devant son échec pour résoudre des situations juridiques complexes, notamment du fait des conflits entre commandants. N’avons-nous pas ici le premier exemple de la nécessité d’une instance centralisée ?
Les années 1980 sont intéressantes, notamment du fait de cette multiplicité de commandants qui mettent en place une multitude de systèmes juridiques locaux : l’Afghanistan des années 1980 est un laboratoire juridique hors du commun par son intensité, comparable uniquement à une guerre où il y a des multiplicités d’acteurs militaires, comme la Syrie de 2011-2012.
Ce qui est intéressant, c’est que le domaine judiciaire a des contraintes propres, qui ne se retrouvent pas dans le domaine de la santé par exemple. Il se construit en effet fondamentalement dans des logiques de compétition intense entre différents acteurs. Nous retrouvons ici, finalement, les problématiques de la sociologie du droit telles que développées en France ou aux États-Unis. Un système juridique est produit grâce à des logiques de reconnaissance et se traduit par, à un moment, la définition de qui est légitime à dire le droit, qui juge, au nom de quelles règles, quels sont les recours possibles, avec en bout de course le problème de la définition d’une autorité suprême.
On se retrouve en permanence devant ces questions dans les années 1980 quand, dans une partie du pays, des juges décident de mettre en place un système judiciaire indépendant des commandants et la question devient alors : qui applique les décisions ? Que fait-on si un commandant refuse d’appliquer les verdicts ? À qui fait-on appel, quelle est l’autorité de dernier recours ? Et la justice, par sa technicité mais aussi par le fait qu’elle n’est jamais tout à fait autonome et qu’elle dépend d’une autorité politique et d’un usage de la coercition est un révélateur de la difficulté à produire une forme du discours qui accompagnerait un tel niveau de violence ou d’une coercition qui accompagnerait le droit à partir du moment où une multiplicité d’acteurs a des revendications parallèles.
Pour commencer à comprendre le mouvement taliban, une première question s’impose. Comment expliquer que la forte intrication du politique et du religieux ne débouche pas sur une contradiction ? Le religieux, en l’espèce la charia, réussit-il à fournir une structure juridique cohérente et fonctionnelle ?
Les Taliban sont un exemple intéressant à cet égard car ils sont un mouvement du clergé sunnite, des diplômés en théologie et en droit islamique des écoles religieuses, ou à tout le moins d’étudiants. C’est un mouvement armé composé donc de juges, qui revendiquent l’exercice de la justice et leur compétence à gouverner.
Cette idéologie Taliban tire ses origines d’un courant religieux, le déobandisme, en vogue en Asie du Sud. Celui-ci se développe contre la colonisation britannique, à une époque où le droit anglo-musulman – après la révolte des Cipayes de 1866, donne aux juges britanniques la prérogative d’appliquer le droit islamique, la retirant donc au clergé. Le déobandisme va alors se développer à partir de la ville de Deoband, au nord de l’Inde, ou des membres du clergé sunnite proposent une réforme à partir de deux fondements : un enseignement rationaliste inspiré de la colonisation en matière d’enseignement, une meilleure organisation du clergé, une logique plus bureaucratique dans son fonctionnement ; et en même temps une interprétation fondamentaliste des textes, une lecture plus littérale, une revendication de retour aux fondamentaux de l’Islam.
Ce double appui va à la fois amener le déobandisme à créer un clergé plutôt cohérent pour le sunnisme, qui est normalement plus fragmenté, et en même temps à promouvoir une vision parmi ces clercs de leur rôle historique à réguler les rapports sociaux, à gouverner, à arbitrer les conflits. Chez les Taliban, il n’y a pas de contradiction entre le politique et le religieux, au contraire la légitimité religieuse est celle qui permet de gouverner de manière morale, de bien gouverner et d’éviter des mœurs dissolues qui sont pour les Taliban la cause de la guerre civile qui perdure.
Chez les Taliban, il n’y a pas de contradiction entre le politique et le religieux, au contraire la légitimité religieuse est celle qui permet de gouverner de manière morale.
adam baczko
Quand vous écoutez les discours de Mollah Omar ou des juges que j’ai pu interroger, ils ne parlent pas d’une guerre qui aurait des enjeux géopolitiques ou une concurrence entre des groupes sociaux (par exemple entre les diplômés de l’université et ceux des madrasas) – deux visions très pertinentes de la guerre. Pour eux, la guerre est un problème de mœurs dissolues qu’il faut réguler pour éviter les guerres civiles : c’est parce qu’à un moment des gens laissent des adultères se commettre que d’autres vont collaborer avec l’étranger, abandonner la religion et abandonner toute probité dans l’espace public.
Et cette vision, très ancrée dans une moralité individuelle, dans la nécessité de re-moraliser la société, légitime d’autant plus, du point de vue des Taliban, leur revendication en tant que religieux d’être les plus à même de gouverner.
Il est d’autant plus étonnant d’observer que, si l’intrication entre le religieux et le politique est fondamentale, la hiérarchie politique n’est pas liée à la hiérarchie cléricale. Comment interpréter une dissociation si forte entre capital religieux et capital politique quand la correspondance entre capital juridique et capital religieux semble être parfaite ?
C’est toute la complexité de ce mouvement. Il revendique le fait que la hiérarchie cléricale devrait se traduire dans le politique, et donc le fait que les savants islamiques devraient gouverner. Or c’est un mouvement dont le chef lui-même, Mollah Omar, n’a une éducation que primaire, il n’est personne dans la hiérarchie religieuse, c’est la vraie différence avec l’Iran par exemple où le mouvement révolutionnaire va être dominé par un ayatollah parmi les plus reconnus.
Les Taliban vont résoudre cette contradiction en s’appuyant sur des logiques charismatiques : Mollah Omar va gouverner par son absence beaucoup plus que par sa présence, il est très peu présent, très peu visible. C’est quelque chose que nous voyons encore dans le mouvement taliban, mawlawi Haibatullah Akhundzada, le dirigeant actuel des Taliban, reste peu visible, comme un dirigeant absent dont on sait la place justement parce qu’il n’est pas là. Et dans le même sens, il y a toute une série de mécanismes au sein du mouvement taliban qui permettent de démontrer ce charisme au quotidien : les rêves de mollah Omar, qui sont très importants pour le mouvement. Mollah Omar rêve et quand il rêve, il parle au prophète, et en discutant avec le prophète, il aurait un accès plus direct aux sources de la religion que celui qui a un diplôme religieux.
C’est également pour résoudre ce problème que les Taliban font le geste très symbolique de nommer Mollah Omar émir Emir al-Mouminin, « commandeur des croyants », le titre du prophète, en 1996 juste après la chute de Kaboul devant 3000 dignitaires religieux d’Asie du Sud en lui faisant mettre le manteau du prophète, la plus grande relique religieuse en Afghanistan conservée à la mosquée de Kherqa Sharif à Kandahar. Cette cérémonie a permis de prendre une des deux seules photos que nous avons de Mollah Omar. Les Taliban répondent ainsi à leur problème fondamental : ils ont une idéologie qui dit que le religieux doit déterminer la compétence politique, donc ils donnent à leur chef, dont le statut religieux est faible, une place exceptionnelle, celle de réincarnation du prophète.
Cela ne représente pas véritablement une revendication mondiale, à la manière de l’État islamique en 2014. La version talibane était d’abord un appel à l’histoire afghane car, à la fin du XIXe siècle, le roi fondateur de l’État moderne afghan, Abdul Rahman Khan, s’était aussi fait nommer commandeur des croyants mais cela représente également une tentative de résoudre une contradiction fondamentale dans leur fonctionnement.
Concernant les ambitions de l’Afghanistan, il est frappant de voir que, contrairement à l’État islamique par exemple, les Taliban n’ont pas de prétention internationale, il s’agit uniquement de mettre en place un régime islamique en Afghanistan.
La véritable ambiguïté des Taliban se situe dans le fait que, si leur revendication est de gouverner l’Afghanistan et si la nomination de mollah Omar comme commandeur des croyants se fait dans un contexte plus national qu’international, leur internationalisme se limite à l’accueil de mouvements qui ont des agendas globaux.
Les Taliban sont un mouvement qui s’efforce de construire une autorité nationale dans une logique étatiste. Il n’est pas dans une logique de remise en cause du système international et des principes de la souveraineté étatique, à l’instar de ce que fait l’État islamique. Pour autant, il adopte une solidarité avec les autres mouvements djihadistes, et c’est bien ce que nous voyons quand mollah Omar accueille des membres d’Al Qaïda ou des groupes Cachemiris, Ouïghours ou Ouzbeks dans les années 1990. Ils sont dans une logique d’accueil de mouvements extérieurs mais ils restent dans une stratégie nationale.
Gilles Dorronsoro parle d’une « si prévisible défaite »3. Pourquoi la défaite était-elle si prévisible ? La guerre aurait-elle finalement été perdue, comme semble le laisser entendre votre ouvrage, dès le tournant des années 2000 ?
Il faut rappeler que, dans un premier temps, la guerre était gagnée car en 2002, mollah Omar, au nom du mouvement taliban, fait passer une lettre de reddition en échange d’un accord selon lequel les combattants talibans ne seraient pas inquiétés par les forces spéciales et les combattants de l’Alliance du Nord sur lesquelles les forces spéciales américaines s’appuient pour envoyer les Taliban dans les prisons secrètes de la CIA, à Bagram ou à Guantanamo, ou les exécuter.
C’est dans les premières années de la guerre qu’une victoire va être transformée en défaite parce que cette guerre, fondamentalement, n’est pas perdue dans les derniers mois, mais bien dès 2011-2012. Lorsqu’Obama déclare le retrait, il acte une défaite.
Vous citiez Gilles Dorronsoro et son ouvrage récemment paru mais il est encore plus frappant de voir qu’il avait écrit en 2012 un rapport intitulé En attendant les Taliban pour le Carnegie Endowment for International Peace4 où il disait déjà que la question était maintenant : que faire face à la prise de pouvoir des Taliban. Celle-ci paraissait probable au vu des erreurs et des catastrophes produites.
Mais alors, pourquoi un si long engagement ?
Cette question est particulièrement complexe. Ce qui a failli en Afghanistan, ce sont l’expertise et les dispositifs de production de l’action militaire et civile. Il est nécessaire de remettre en cause les modalités d’intervention occidentale suite à ce qui s’est passé en Afghanistan dans le domaine militaire : les forces spéciales, les exécutions ciblées, l’emploi de milices, les politiques de développement et de state building, et des experts qui passaient leur temps à louer des pratiques désastreuses dont le caractère contre-productif était pourtant de plus en plus évident.
Une chose véritablement frappante à la lecture de votre livre est la mise en place d’un système juridique tout à fait hors-sol par les autorités internationales et les différents pays acteurs du conflit. Vous montrez que des concepts juridiques tout à fait étrangers au droit afghan et donc aux juges afghans ont été introduits dans le droit national.
Personne ne fait volontairement des choses absurdes, ce qui inclut les responsables au sein des organisations internationales ou des agences de coopération. Ce qui a d’abord posé problème en Afghanistan était de l’ordre de l’idéel, des nombreux stéréotypes apposés sur ce pays. Même aujourd’hui, pour expliquer la défaite, un certain nombre d’idées reçues sont mises en avant, par exemple le fait que les Afghans seraient rétifs à l’État, à l’autorité. D’élégants surnoms sont d’ailleurs donnés à l’Afghanistan : « le cimetière des empires », « le royaume de l’insolence », qui alimentent la vision d’un agrégat de tribus, d’ethnies localistes qui rejettent toute autorité centrale. Cette image fausse de l’Afghanistan – il y a dès le XIXe siècle un processus d’étatisation et de sécularisation du pays – a nourri l’idée que l’État en Afghanistan était une tabula rasa, qu’il fallait partir de zéro pour construire les institutions.
On voit ici un culturalisme extraordinaire, avec un éloge de l’anthropologie, voire son instrumentalisation au service de la guerre, mais sans les anthropologues, sans leurs travaux qui montraient la détribalisation du pays dans toute la seconde moitié du XXe siècle, la relativité des identités et l’absence de groupes ethniques homogènes. On a d’ailleurs beaucoup vu ces cartes colorées sur la répartition des ethnies qui circulent sans cesse alors qu’elles ne reflètent absolument pas ce que les Afghans disent et font. Elles ne permettent notamment pas de comprendre, par exemple, que les Taliban ont gagné la guerre par le Nord, c’est-à-dire par la région où les Pachtounes sont minoritaires.
Ce qui a failli en Afghanistan, ce sont l’expertise et les dispositifs de production de l’action militaire et civile.
adam baczko
Cette image de l’Afghanistan a joué un rôle énorme dans le state-building. Comme l’Afghanistan avait besoin d’un vrai chef pour cet agrégat de tribus et d’ethnies, les États-Unis imposent Hamid Karzaï et contribuent à son élection frauduleuse de 2009, alors qu’il y avait une demande populaire d’alternance et de démocratie. Sur le plan juridique, les puissances étrangères affirment que l’Afghanistan est une tabula rasa et importent donc des concepts juridiques car elles considèrent qu’il n’y a pas de normes ou de pratiques juridiques à aller chercher dans l’histoire afghane. Cette vision est flagrante dans certains exemples que je donne dans mon ouvrage, par exemple lorsque, pour réécrire le Code de procédure pénale entre 2004 et 2006, le Code pénal de 1975 ou le Code de procédure pénal de 1977 ne sont même pas consultés. La mission italienne refait donc un tout nouveau Code de procédure, en partie inspiré du Code de procédure pénale italien avec des éléments tout à fait contradictoires avec le reste du droit afghan, et qui ne fait qu’un quart du Code de procédure pénale afghan de 1977.
L’Afghanistan devient le théâtre des dérives des politiques néolibérales avec des sous-traitances en cascade, induisant une déconnexion entre les programmes et les ressources investies dans ces programmes. Pour ce qui concerne ces sommes, seulement 20 % de l’argent arrive effectivement en Afghanistan, produisant une privatisation généralisée de l’argent public. Ce n’est pas de la corruption dans un sens pénal, mais une forme directe de transfert du public au privé. Et concernant les 20 % restants, les programmes sont déconnectés des demandes sociales et des besoins sociaux, à l’instar de ce professeur américain qui donne un cours de droit constitutionnel à partir du cas américain aux procureurs afghans puisqu’il ignore tout de la constitution afghane. Il y a donc véritablement de très gros écarts entre les besoins des juristes afghans et les formations accélérées sur 3 semaines comme celle donnée par ce professeur américain payé plusieurs dizaines de milliers de dollars.
En plus de ces explications d’ordre anthropologique, n’y a-t-il pas un double temps dans la pensée même de la construction de l’État ? L’établissement de ces structures inadaptées correspondrait-il à une vision de long terme tandis que leur contournement – notamment pour s’appuyer sur des instances « tribales » – correspondrait à des buts de plus court terme ? Et, de fait, cela rappelle un double objectif avec également deux temporalités distinctes : rétablir les droits humains et les droits des femmes dans le long terme mais lutter contre le terrorisme à tout prix sur le court terme.
Il y avait effectivement une double logique dans l’intervention, qui était d’ailleurs visible par les deux opérations : l’opération Enduring Freedom sous commandement américain, opération antiterroriste, où les forces spéciales ont la main, et la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) qui avait un mandat de « stabilisation ». Cette mission de stabilisation se traduit par un investissement financier et militaire considérable, notamment dans les structures judiciaires. Il ne faut pas négliger cette volonté de construction étatique de la part des opérateurs occidentaux, avec un investissement fort en termes d’hommes, d’argent et de compétences dans la mise en place de ce système juridique, avec des effets désastreux d’ailleurs.
De l’autre côté cependant, il y a un appui sur des instances de conciliation qui constituent une réinvention de la tribu, avec des programmes qui sont en fait de l’importation de logiques de médiation anglo-saxonnes des années 1980 faites pour désengorger le système juridique américain. Cet éloge des logiques de médiation et de négociation circule dans les décennies suivantes, par la Banque Mondiale, dans toute une série de politiques de développement partout dans le monde, avec un ensemble d’entreprises qui se sont spécialisées dans la question et qui mettent en place des instances de conciliation censées mieux prendre en compte les manières locales d’arbitrer les disputes mais qui proviennent en réalité de normes extérieures.
Ces deux logiques parallèles de transnationalisation ont des effets profondément contradictoires, la mise en place d’instances conciliatrices parallèles achevant de miner le système judiciaire fragile du régime.
Vous montrez par ailleurs que les belligérants, et en premier lieu les États-Unis, ont bafoué le droit international à de nombreuses reprises, notamment à travers les exécutions ciblées, auxquelles vous vous intéressez dans votre ouvrage. Que signifie pour un État qui se fonde sur le droit international le non-respect de ce même droit par les puissances qui lui servent de garantes ?
C’est tout le paradoxe de l’Afghanistan. La guerre en Afghanistan montre la prégnance du droit international, même si, à première vue, l’échec des procédures pénales internationales tend à faire penser le contraire. La manière dont les militaires américains ont agi hors de tout cadre légal – les forces spéciales ont été laissées libres d’agir sans supervision – a eu des conséquences catastrophiques. Elles ont conduit à l’exacerbation des conflits, elles ont traqué des individus à partir de renseignements souvent biaisés. En effet, pour traquer des militants qui vivent au milieu du reste de la population, il est nécessaire de disposer d’informateurs, et les forces spéciales ont donc cherché des alliés pour les guider et, de manière récurrente, se sont intégrées dans des rivalités locales induites par 23 années de guerre entre 1978 et 2001. Les forces spéciales américaines s’allient avec les chefs de guerre de l’Alliance du Nord, les commandants honnis pour avoir mené les guerres intestines des années 1990 qui ont rendu les Taliban populaires en 1994.
La guerre en Afghanistan montre la prégnance du droit international, même si, à première vue, l’échec des procédures pénales internationales tend à faire penser le contraire.
ADAM BACZKO
Ignorant du contexte, ne maîtrisant pas les langues, les militaires américains se laissent manipuler : Gul Agha Sherzaï, le premier gouverneur de Kandahar, peut ainsi placer son frère, ses cousins, son neveu comme traducteurs et dirige des Forces Spéciales pour éliminer non pas des Taliban, mais ses rivaux. Les Américains deviennent le bras aveugle des conflits locaux, participant à attiser les tensions. L’ampleur de la déconnexion des soldats américains apparaît au grand jour à la fin des années 2000, dans un reportage de la chaîne ABC news, où en reprenant les images filmées, les journalistes font traduire les interactions entre les soldats et des villageois. Or, le traducteur ne parle pas pachtoune et dit n’importe quoi aux militaires américains. Et lorsque l’on fait une enquête sur les traducteurs pachtounes sous-traités par une entreprise américaine, on découvre qu’une majorité ne parle pas pachtoune.
Comme vous l’écrivez dans votre ouvrage, l’armée américaine n’a pas mené 13 ans de guerre mais un an de guerre treize fois : la défaite était-elle donc marquée dans les racines de l’action des instances internationales ?
Je paraphrase un acteur important de la guerre au Vietnam, John Paul Vann. Il disait que le problème de la guerre du Vietnam n’était pas que les États-Unis avaient mené 12 ans de guerre mais 12 fois une année. Et l’on peut dire la même chose de l’Afghanistan, voire un peu plus puisque les déploiements étaient réduits à 6 mois, voire à 4 mois pour certains pays occidentaux, et il y avait donc une perte d’expertise cyclique qui montrait que, depuis la décolonisation, les pays occidentaux ont perdu la capacité de produire une connaissance institutionnelle sur le reste du monde. Il y a encore des endroits où c’est le cas, par exemple en Afrique de l’Ouest pour l’armée française, mais de manière générale, il y a de moins en moins la capacité de la part des institutions d’investir le terrain de manière suffisamment longue pour que les acteurs militaires et civils maîtrisent des contextes locaux et nationaux.
En Afghanistan, cela a été un des éléments essentiels de la guerre. Je cite à un moment dans mon ouvrage le général en charge du renseignement, Michael T. Flynn, illustrement connu aujourd’hui pour son soutien à Trump, mais qui à l’époque était une figure de l’armée américaine. Après 10 ans d’intervention, il reconnaît la mauvaise qualité du renseignement que ses hommes réunissaient. Son bilan est sans concession : le renseignement américain est catastrophique et parfois même contreproductif. La défaite en Afghanistan est une défaite des forces spéciales, une défaite du renseignement, c’est une défaite liée à l’ignorance.
Vous parlez tout de même d’un tournant avec l’arrivée de Barack Obama, d’une reprise en main du conflit et d’un renouvellement de l’action, en 2009, mais qui, encore une fois, se fonde sur une vision erronée du système juridique local.
Il y a effectivement un moment de réinvestissement avec Barack Obama, qui avait promis le retrait et qui essaie, de manière assez classique, de faire le retrait par le surinvestissement. Il espère mettre assez de ressources pour obtenir une victoire. Les années 2008-2009 sont au fond le dernier moment où les Américains ont la possibilité de ne pas perdre la guerre, mais comme ils se fondent sur cette vision complètement erronée de l’Afghanistan, d’un Afghanistan tribal, traditionnel, les ressources sont investies dans des endroits qui n’ont aucun sens, l’Helmand par exemple : croire que la guerre allait se dessiner dans cette province périphérique était une compréhension très pauvre du conflit. La guerre allait se gagner ou se perdre à Kaboul et depuis le début, tout se jouait autour des villes afghanes. À l’époque de Barack Obama, il y a effectivement un réinvestissement mais également une continuité des stéréotypes, de l’orientalisme qui amène les cadres américains à prendre de mauvaises décisions. Lors de la présidence Obama, tout le monde parle de contre-insurrection mais en réalité l’augmentation des ressources produit surtout une accélération des exécutions ciblées, près de 10 000 exécutions par an entre 2008 et 2011. Ces années sont donc celles d’une exacerbation des effets négatifs de l’intervention américaine, une multiplication des milices, toute une série de mauvaises décisions qui rendront les Taliban populaires dans les campagnes par rejet de l’action américaine.
Nous avons reconstitué, avec Gilles Dorronsoro, dans plusieurs districts, les moments de retournement où les Taliban prennent la main, avec à chaque fois le même déroulement : ce sont les rejets de l’armée américaine suite à des opérations aux effets catastrophiques qui amènent des habitants à soutenir les Taliban, voire à les rejoindre.
Pour continuer sur ce point, alors même que les cadres américains pensent retourner le cours de la guerre, ils participent à une exacerbation des tensions, avec l’appui sur des instances tribales notamment.
Tout à fait, il va de plus en plus y avoir un appel à la réinvention d’instances tribales, les jirgas et les shuras qui sont ces programmes de médiation informelle dont je parlais plus tôt, et surtout l’armement de segments sociaux de la population, la multiplication de milices – il y a des milices mises en place par l’armée et la CIA dès 2002, mais ces programmes se multiplient à la fin des années 2000, minant l’appareil sécuritaire du régime de Kaboul, concurrençant l’armée et la police et donnant au régime et à l’armée américaine l’image de ceux qui provoquent le chaos. Beaucoup de gens que j’ai interrogés, en dépit de leur rejet des Taliban et, parfois même d’une adhésion au régime, m’exprimaient souvent leur volonté que les Américains se retirent.
Ce désir du retrait américain peut également se comprendre à partir du phénomène massif de corruption. En effet, il semble qu’à la faiblesse de ces puissances étrangères à comprendre la réalité de l’Afghanistan correspond également la capacité qu’ont les dignitaires du régime mis en place à s’enrichir, à mettre en place un réseau de corruption particulièrement dense. Pouvez-vous revenir là-dessus ?
La partialité des Occidentaux qui cherchent des alliés et de l’autre côté la faiblesse des processus institutionnels ont entraîné la mise en place d’un système de népotisme et de corruption généralisée. L’élite politique à Kaboul s’enrichit en sciant la branche sur laquelle le reste de la société est assis, en détournant les fonds de l’aide, en tirant parti de l’impunité et s’enrichissant par le trafic de drogue. Jusqu’en 2014, le gros du trafic de drogue ne transite pas par les Taliban mais bien par les dignitaires du régime puisque les Taliban contrôlent alors seulement la culture du pavot, mais la transformation et le transport, autrement plus lucratifs, sont dans les mains de ces potentats, qui sont d’ailleurs mis parfois à la tête des programmes internationaux de lutte contre le trafic de drogue. Lorsque Gul Agha Sherzai et Ahmed Wali Karzai sont en charge de lutte contre le trafic de drogue, alors qu’ils en sont les plus grands acteurs, on rationalise le marché. Il n’est pas étonnant que la production augmente durant cette période.
Ce sont les rejets de l’armée américaine suite à des opérations aux effets catastrophiques qui amènent des habitants à soutenir les Taliban, voire à les rejoindre.
ADAM BACZKO
L’accaparement foncier par ces dignitaires liés au régime est également un phénomène très important, car il provoque un fort rejet du régime chez les personnes dont les terres sont spoliées. C’est tout un système de corruption qui va miner l’État puisque les postes de chefs de la police, de juges, tous les postes importants de l’administration en somme sont à vendre, produisant une logique générale de déconstruction de l’État, qui explique son délitement une décennie plus tard. Et cela n’a rien à voir avec la culture afghane ou un rejet historique de l’État. Le régime communiste des années 1980 n’est pas corrompu. Cela a beaucoup plus à voir avec ce mélange de procédures de contournements de l’État, de constructions par programmes par sous-traitance propre aux modalités contemporaines d’interventions occidentales et enfin, le fait de décider que l’on va s’appuyer sur les gens à qui l’on peut parler : Hamid Karzaï, les proches de Massoud qui vont s’approprier une part importante de l’aide. Les chefs de guerre des années 1990 cessent ainsi d’être des chefs de guerre pour devenir des parasites qui s’enrichissent aux dépens de l’État, de l’aide internationale et surtout de la société afghane.
La figure d’Hamid Karzaï m’a interrogé durant ma lecture. Parachuté, il semble être le dirigeant d’un régime fantoche. Pourtant, il est également à la tête de ce réseau de corruption et double même parfois les instances internationales, notamment sur les questions du commerce de la drogue. Quel rôle joue-t-il véritablement durant le conflit ?
Hamid Karzaï est tout l’inverse de l’image qui en est faite lorsqu’il est placé à la tête du pouvoir. Ce n’est pas du tout un moderniste, mais, au contraire, plutôt un fondamentaliste. Karzaï propose à la fin des années 1990 ses services aux Taliban, ce qu’ils refusent puisqu’ils recrutent les cadres de l’État parmi le clergé.
Karzaï vient d’une petite famille de notables du Sud, et lorsqu’il est mis au pouvoir, il n’a aucune légitimité. C’est quelque chose dont profitent pendant un certain temps les membres de l’Alliance du Nord pour s’emparer de pans de l’État. Simultanément, les États-Unis vont donner à Karzaï, en particulier par le biais du représentant spécial du président Georges W. Bush, Zalmay Khalilzad, des prérogatives très importantes lui permettant de réécrire la Constitution et de la biaiser en faveur du président. En même temps, les États-Unis lui interdisent l’élimination des chefs de guerres des années 1990. C’est tout le paradoxe de l’action occidentale : on va à la fois autoriser Karzaï à miner le Parlement et le système judiciaire, mais on ne va pas l’autoriser à éliminer les chefs de guerre qui empêchent l’exécutif de fonctionner dans le même contexte. Ce paradoxe est essentiel pour comprendre que la seule manière par laquelle Karzaï peut rester au pouvoir, c’est une logique systémique, celle d’acheter les gens qui ont des hommes armés en leur offrant des pans de l’État. C’est donc ce système de contraintes multiples qui amène Hamid Karzaï à être un homme qui gouverne par la nomination, en permettant l’appropriation par pans entiers de l’État. Lui-même fait de même parce que, outre les profits de la drogue, il va être l’un des principaux bénéficiaires de la fraude de la Kabul Bank, avec des sommes faramineuses distribuées à ses proches. Il est également impliqué, par le biais de son ministre des Finances, Hazrat Omar Zakhilwal, dans la perception de la moitié des revenus du poste de douane le plus important du pays, celui de la province du Nangarhar.
Les tribunaux talibans
Vous montrez que les tribunaux talibans, s’ils n’ont pas été la priorité du mouvement, ont tout de même été mis en place dès 2003-2005 selon les témoignages que vous avez recueillis. Qu’est-ce que cela nous dit sur la formation de l’État ? Est-ce cohérent avec les constructions théoriques, notamment philosophiques et sociologiques ?
Il y a deux choses intéressantes. D’abord, leur attention au droit est très révélatrice de qui sont les Taliban sociologiquement, le fait qu’ils se voient comme des juges islamiques. Par ailleurs, le fait de mettre en place un système judiciaire répond de la part des Taliban à une réflexion sur la nature du conflit armé. Les Taliban dédient une part importante de leurs ressources limitées à l’instauration de ces tribunaux. Ils investissent des hommes, des compétences et une énergie considérable dans l’idée qu’un pays s’administre par le droit.
Je suis en train de travailler au Mali, j’ai travaillé en Syrie, en Afghanistan, en République démocratique du Congo et en Irak, et, dans une perspective comparative, c’est une bonne analyse de ce qui se joue dans une guerre civile. Le droit et la justice sont toujours au centre de la préoccupation des gens. Une guerre civile n’est pas un moment où les gens arrêtent de s’occuper de leurs problèmes intimes pour se dédier pendant des décennies à la lutte politique, mais également une situation où ils ont des conflits d’héritage, des problèmes liés aux mariages, aux divorces, des litiges commerciaux. Ces questions restent les principales préoccupations des gens et leur exacerbation par la guerre donne au droit une place tout à fait particulière à leurs yeux.
Par ailleurs, le droit permet de déterminer les rapports entre les différentes fonctions essentielles de la vie politique, notamment la branche armée. Si l’on veut parler d’une manière sociologique, le droit opère une détermination des rapports entre champs. Le droit est l’espace social dans lequel sont définies les limites, les règles de ce qui va se jouer ailleurs, c’est un des espaces de lutte autour de la définition de ces normes.
Vous décrivez une véritable organisation pyramidale du système judiciaire Taliban, ainsi qu’un système de rotation des juges plus ou moins respecté. Est-ce qu’un tel système est véritablement fonctionnel, au moment de sa mise en place mais également sur le long terme ?
Fonctionnel, il l’est en tout cas par le simple fait que ces tribunaux traitent des milliers de cas. Le système Taliban compte environ 700-800 juges à la fin des années 2000, soit autant que le système du régime. Les Taliban s’inspirent de la Constitution afghane de 1964, en reprenant les réflexions de l’Émirat islamique Taliban des années 1990. Le système judiciaire a donc une structure institutionnelle à trois niveaux : des cours d’instance, des cours d’appel et une Cour de cassation (inspiration française de la constitution de 1964).
Ce système, avec un ensemble de mécanismes de rotation, d’inspecteurs clandestins, de procédures relativement déterminées, de la plainte jusqu’à l’archivage ou le recours, permet aux Taliban d’avoir des pratiques relativement cohérentes à l’échelle nationale. Relativement car le mouvement développe son système judiciaire dans un contexte de guerre civile et le degré de formalisation reste tout de même très limité.
Il reste que j’ai trouvé beaucoup de similarités dans les différents endroits où j’ai mené des entretiens, les paroles des juges sont relativement cohérentes du Nord au Sud et à l’Est du pays les trois régions où j’ai conduit mes terrains, et ces juges ont une capacité à résoudre certains conflits et à notamment apparaître comme une autorité extérieure, relativement impartiale pour ces gens.
Plus précisément, quel est véritablement le lien qu’entretiennent les juges avec la population ? Comme vous le dites, si la population d’une région est contente d’un juge, il peut parfois rester là où il est affecté. N’est-ce pas étonnant qu’il y ait une participation des Afghans sur des questions qui touchent des Taliban et des juges talibans ?
Ces choses-là se font de manière assez discrète et il est intéressant de voir que les juges eux-mêmes ont un rôle dans ce processus de décision et eux, en tant que personnes, ont démontré une certaine réflexivité sur cette question quand j’ai mené mes entretiens. Ils savaient l’importance de rester extérieurs aux relations locales, ils savaient l’utilité qu’avait le système de rotation pour maintenir leur extériorité et ils savaient surtout à quel point leurs actes étaient à la fois des actes politiques qui avaient un rôle dans la guerre, que bien juger était un moyen de gagner la guerre.
Les Taliban investissent des hommes, des compétences et une énergie considérable dans l’idée qu’un pays s’administre par le droit.
ADAM BACZKO
Cette réflexivité des juges montrait leur compréhension des processus à l’œuvre et permettait au système judiciaire taliban d’être plutôt cohérent dans un contexte de guerre et en même temps assez pragmatique. Il y a un mélange de pragmatisme et d’idéologie dans ce mouvement qui explique sa capacité à produire un système de justice sophistiqué, très sévère dans les peines, très strict, avec un degré de formalisation et pourtant à arrêter un jugement, par exemple un conflit entre deux villages où, justement, de manière très politique, le juge renvoie la décision à sa hiérarchie qui lui dit de ne pas en prendre. Il y avait ce mélange de pragmatisme et de foi dans l’importance de mettre en place un système judiciaire extérieur, neutre, impartial, pour s’imposer localement, pour incarner l’État.
Vous étudiez les évolutions du droit taliban et vous montrez qu’un texte comme le Code de bonne conduite des moudjahidins connaît des changements importants, notamment entre 2006 et 2009. Alors, quelle est la vitesse de production normative des Taliban ? Est-ce qu’il y a une véritable volonté de produire du droit ? Et si oui, n’est-ce pas étonnant compte tenu du caractère essentiel que constitue la charia ?
C’est quelque chose de systémique dans le droit islamique et pour tous les acteurs qui revendiquent d’appliquer le droit islamique. Tout le problème vient du fait que tous les mouvements islamiques revendiquent l’application de la charia mais qu’il est très compliqué de définir ce qu’est le droit islamique. Le fonctionnement jurisprudentiel impose certaines logiques de décision, mais laisse néanmoins une marge très importante ; et il y a une place importante accordée à l’interprétation des juges.
Il y a donc des controverses, des instructions de la direction du mouvement et des évolutions de celles-ci car à partir des mêmes sources de légitimité religieuses, les Taliban justifient d’attaquer les écoles ou les cliniques en 2006 ou, à l’inverse, d’interdire ces attaques quelques années plus tard. À cet égard, on voit également à quel point l’une des forces de faire reconnaître les juges comme compétents, comme des autorités, c’est qu’elle permet de prendre des décisions très pragmatiques, mais aussi contradictoires. Les Taliban vont changer de politique en prétendant être cohérents de manière récurrente dans les années 2000 et 2010 et continuent de le faire aujourd’hui.
On discute beaucoup, dans les médias notamment, des changements au sein du mouvement Taliban. Plus précisément, une question revient souvent : les Taliban d’aujourd’hui sont-ils si différents des Taliban d’avant 2001 ? Vous montrez qu’il y a, d’un côté, des points communs, notamment entre les oulémas d’avant et d’après 2001, et de l’autre qu’il y a un rajeunissement des commandants talibans, ce rajeunissement induisant dès lors une certaine brutalisation du mouvement. La tendance est-elle donc au changement ou à la continuité ?
Cela dépend effectivement des différents échelons du mouvement. Du côté des dirigeants et des juges, la dynamique est plutôt la continuité. Une continuité est frappante lorsque l’on voit les nominations actuelles du nouveau gouvernement taliban de tous les membres de l’ancienne garde, qui ont survécu dans les années 2000 et 2010, dans les instances dirigeantes. Il est ici évident que les Taliban sont véritablement un parti politique au sens d’un mouvement capable de former des cadres sur des décennies. Les juges agissent de concert avec la direction du mouvement, d’abord parce qu’ils viennent du même creuset, les écoles religieuses déobandies au Pakistan.
Là où il y a un vrai renouvellement, c’est du côté des commandants et des combattants. La guerre est très violente, et les Taliban perdent 10 000 à 20 000 combattants par an, ce qui induit, pour un mouvement qui compte 80 000 à 100 000 combattants, un renouvellement régulier de la hiérarchie militaire. La nouvelle génération qui monte est souvent moins éduquée et est plus affectée par les transformations de la société afghane dans les vingt dernières années. Aujourd’hui, l’une des questions majeures est celle de la relation entre les élites juridiques, dans la continuité du mouvement avant 2001, et ces élites militaires qui sont les grandes gagnantes de la guerre, mais qui ont une sociologie un peu différente.
Votre ouvrage traite également de la relation réciproque entre le mouvement taliban et les instances internationales.
Vous montrez d’abord que ces instances, et certains des pays belligérants, notamment l’Angleterre, reprennent certaines parties des outils normatifs talibans dans ce qui semble être dès lors une reconnaissance de la légitimité des Taliban dans une certaine mesure.
Ce rapport est vraiment complexe.
Du côté des Occidentaux et des organisations internationales, il y a longtemps eu une ambivalence : faut-il reconnaître les Taliban pour les intégrer et les amener à se normaliser avec le temps ou les ostraciser dans le but qu’ils s’effondrent ? C’est une question qui, dès les années 1990, s’est posée ainsi avec des réponses contradictoires parce que, par exemple, les États-Unis suivent une stratégie de normalisation jusqu’en 1998 avec tout un effort d’engagement avec les Taliban, notamment autour de l’idée de produire un gazoduc entre le Turkménistan et le Pakistan qui passerait par l’Afghanistan. En même temps, à partir de 1998, suite aux bombardements des camps d’Al Qaïda, on a au contraire une logique d’ostracisation. Ces contradictions concernant le rapport aux Taliban se retrouvent avec d’autres acteurs, comme le CICR ou le Bureau des droits de l’Homme des Nations Unies. Dans la guerre, ces organisations internationales font le choix de considérer les Taliban comme des interlocuteurs, avec des effets profonds sur les Taliban.
D’un autre côté, on voit, par exemple au travers d’un de vos entretiens où un juge affirme qu’il faut aller « dans le sens de la communauté internationale », que les Taliban ne méprisent pas tout à fait les normes de la communauté internationale.
Du côté Taliban, il y a toujours eu une volonté de reconnaissance internationale et en même temps une grande ignorance du fonctionnement de ces organisations internationales. Les crises des années 1990, comme la destruction des Bouddhas de Bamiyan par les Taliban, sont assez révélatrices de l’incompréhension à l’époque du mouvement concernant le fonctionnement de ces organisations, par exemple sa mauvaise interprétation des actions de l’UNESCO concernant les questions patrimoniales.
Les Taliban ont beaucoup appris tout au long des années 2000, par exemple par une intense coopération avec le bureau des Droits de l’Homme des Nations Unies autour de la protection des civils et de la distinction entre civil et combattant. Les Taliban se sont impliqués dans des discussions avec les représentants des Nations Unies, induisant une évolution de leurs doctrines. Ainsi, leurs « Codes de conduite » sont des documents effectivement très intéressants par les évolutions qui les traversent entre la version de 2006 et la version de 2009-2010, montrant à la fois la volonté des Taliban de s’adapter aux normes internationales et, en même temps, de ne pas justifier leurs textes par ce corpus de normes internationales, mais par le droit islamique.
Le fait que le mouvement taliban ait été structuré durant une guerre civile dans et par la violence ne risque-t-il pas d’entraîner son effondrement, notamment du fait de la volonté d’indépendance des commandants, mais aussi du fait du caractère dorénavant national du régime taliban, qui ne pourra plus se contenter de privilégier les membres de l’insurrection ?
Pendant la guerre, contrôler les combattants et les commandants était très compliqué dans la mesure où, les Taliban n’ayant pas de police, les juges devaient s’appuyer sur la branche militaire du mouvement pour faire appliquer leurs décisions. Cela donnait aux combattants une force de résistance vis-à-vis des juges. Désormais, le régime taliban va s’installer plus durablement et les juges auront plus de pouvoir sur les combattants. Le mouvement annonce par exemple qu’il va reconstruire des forces de sécurité nationales en intégrant des combattants talibans et des anciens combattants ou policiers du régime.
Aujourd’hui, l’une des questions majeures est celle de la relation entre les élites juridiques, dans la continuité du mouvement avant 2001, et les élites militaires qui sont les grandes gagnantes de la guerre, mais qui ont une sociologie un peu différente.
ADAM BACZKO
Le vrai problème des Taliban est que la popularité des juges, notamment dans les campagnes, provenait fondamentalement de la comparaison avec les cours du régime, du fait de l’impopularité des Occidentaux. Et cela montre que ce qui a rendu les Taliban populaires dans la guerre ne fonctionnera plus maintenant qu’ils sont au pouvoir. Si les Taliban ne sont pas menacés dans leur emprise sur le pays car ils n’ont pas de groupes capables de s’opposer à eux, en retour, ils doivent incarner l’État, ils doivent payer des fonctionnaires, faire fonctionner une administration, et faire face à toute une série de défis. Il faut également gouverner des villes – l’Afghanistan est aujourd’hui un pays à majorité urbaine en dépit des statistiques qui sont erronées dans le pays. Il faut gouverner des métropoles, avec toutes les difficultés que cela pose, avec une population plus éduquée que dans les campagnes, avec des demandes sociales différentes. Le mouvement taliban pourrait donc se retrouver face à des contestations importantes. Celles-ci ne menaceraient peut-être pas leur pouvoir mais rendraient plus difficile l’exercice de leur administration.
Pour finir, intéressons-nous rapidement au cas français. Il y a un imaginaire, notamment à l’extrême droite, pour décrire l’état de la France, qui est justement celui de la guerre civile. Avez-vous une clé de lecture à proposer pour comprendre ce fantasme ?
Dans ces contextes de polarisations politiques, les sciences sociales permettent de comparer les discours de certaines personnalités publiques avec la situation réelle. Les faits sont simples, il n’y a pas en France les éléments constitutifs d’une guerre civile. Une guerre civile, cela implique l’existence d’un parti organisé qui coordonne des hommes et des ressources considérables, cela implique un sanctuaire dans un pays voisin. Cela implique également des pays qui financent ce mouvement armé et il n’y a pas ce genre de choses en France. Les banlieues françaises ne sont pas des territoires qui seraient contrôlés par un groupe armé capable de mobiliser des combattants. L’Allemagne, l’Espagne, la Belgique, la Suisse ou l’Italie ne sont pas en train d’offrir un sanctuaire à partir duquel des groupes armés pourraient mener des actions sur le territoire français. Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant : il n’y a pas de risque de guerre civile en France.
Mais une fois que l’on a dit cette évidence, il devient intéressant de voir ce qui se joue dans la récurrence d’un discours manifestement faux. Pourquoi des hommes politiques qui savent ce que je viens de dire alimentent la crainte d’une guerre civile ? La guerre civile joue le rôle d’un spectre qui permet de justifier toute une série de pratiques autoritaires. Fondamentalement, le qualificatif de guerre civile aujourd’hui joue moins le rôle d’un descripteur de la société française qu’un épouvantail qui permet de justifier des mesures autoritaires du côté de la répression des manifestations par la police, du côté des modalités d’intervention dans les zones les plus paupérisées de France, une moindre prise en compte des demandes sociales et qui justifie un moindre investissement dans les services sociaux, dans les universités, dans les hôpitaux, dans tous les services publics, dans les infrastructures routières et ferroviaires. Tout cela au nom d’un problème qui serait d’abord identitaire et qui empêche aussi de parler des problèmes pressants : la marginalisation de toute une partie de la population rurale, la marginalisation des populations des périphéries urbaines et ainsi de justifier à la fois des politiques qui entraînent une exacerbation des inégalités et en même temps une logique de plus en plus répressive dans nos régimes de moins en moins démocratiques.
Sources
- Adam Baczko, Gilles Dorronsoro, “Pour une approche sociologique des guerres civiles”, Revue française de science politique, 2017, (vol.67), pages 309 à 327 (Cairn)
- Social Dynamics of Civil Wars, About us
- Gilles Dorronsoro, Le gouvernement transnational de l’Afghanistan. Une si prévisible défaite, Éditions Karthala (Recherches Internationales), 2021, 288 p
- Gilles Dorronsoro, “Waiting for the Taliban in Afghanistan”, Carnegie Endowment for International Peace, 20 septembre 2012

