L’auteur débattra de cet article avec Dominique Méda et Lucas Chancel lors d’un mardi du Grand Continent à l’École normale supérieure le 13 décembre à 19h30 — inscriptions ici.
Un demi-siècle après le premier Sommet de la Terre, la destruction du vivant se poursuit à large échelle et les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter inexorablement. Cette incapacité à changer résolument de cap s’explique d’abord par la résistance des piliers de l’économie carbonée, dont les multinationales des énergies fossiles forment la pointe avancée. Mais ces obstacles objectifs ne suffisent pas à expliquer notre inertie. Si nous avançons si lentement, c’est aussi parce que nous ne parvenons pas à convaincre que changer radicalement nos modes de production et de consommation ne constitue pas forcément un renoncement, mais peut être au contraire synonyme de progrès et de plaisirs pour une immense majorité des humains.
Il est plus sûr de faire envie que de faire peur
La critique du monde actuel, condition première d’un mouvement vers une autre forme d’organisation sociale, est de mieux en mieux étayée. L’histoire des faits et des idées nous enseigne que c’est en cherchant la liberté dans l’abondance que nous avons perdu le sens des limites naturelles et physiologiques 1. Ancrés dans le régime capitaliste, nos modes de production et de consommation renforcent en outre les rapports de domination patriarcale et coloniale. Les luttes sociales, féministes, environnementales, antiracistes pourraient théoriquement converger 2 et jeter les bases de cette « classe écologique » dont Bruno Latour cherchait, dans ses dernières interventions, à cerner les contours 3.
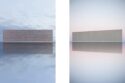
Mais une critique sociale, aussi puissante soit-elle, ne suffit pas à bouleverser les rapports de domination. Les révolutions démocratiques et sociales des trois derniers siècles n’auraient pas pu abattre les ordres anciens si elles n’avaient pas mobilisé une vision du monde, un imaginaire et des symboles indiquant l’horizon souhaitable. Or les diverses formes d’écologie politique qui se sont affirmées au cours du dernier demi-siècle ne sont pas parvenues à concevoir une éthique publique suffisamment puissante pour affronter l’éthos d’accumulation, de consommation et de distinction sur lequel repose le régime capitaliste. Quand il énonce son Principe responsabilité en 1979, le philosophe allemand Hans Jonas, qui reste une référence majeure dans les milieux écologistes, fait le pari d’un nouvel ascétisme. Puisqu’« à l’âge de la civilisation technique devenue « toute puissante » (…) l’homme est devenu dangereux non seulement pour lui-même mais pour la biosphère entière », écrit-il, le temps est venu de substituer à « l’éthique du progrès et du perfectionnement », qui domine la pensée occidentale depuis le XVIIe siècle, une « éthique de la conservation, de la préservation, de l’empêchement » 4. À contre-courant d’une société de consommation en pleine expansion, il affirme que « la restriction beaucoup plus que la croissance devra devenir le mot d’ordre » 5. L’ascèse que le christianisme avait pu imposer au grand nombre au nom de l’Au-delà doit être imposée à nouveau, mais « au nom de l’ici-bas » 6.
Les révolutions démocratiques et sociales des trois derniers siècles n’auraient pas pu abattre les institutions des ordres anciens si elles n’avaient pas mobilisé une vision du monde, un imaginaire et des symboles indiquant l’horizon souhaitable.
Paul Magnette
Jonas n’a pas cherché à étayer historiquement son propos. Il aurait pourtant pu rappeler que toutes les sociétés humaines se sont donné des limites. Les peuples de chasseurs-cueilleurs décrits par Marshall Sahlins, Pierre Clastres, James Scott ou David Graeber ont inventé mille manières d’empêcher l’accumulation de richesses et la concentration du pouvoir. Les principales écoles philosophiques antiques, épicuriennes et stoïciennes, ont défendu les valeurs de frugalité et de modération, et sous-tendu les lois et institutions qui, en Grèce et à Rome, limitaient les consommations ostentatoires et forçaient les plus riches à redistribuer une partie de leur fortune (fêtes liturgiques, banquets, jeux, spectacles, distributions de blé…). Toutes les religions, bouddhisme, taoïsme, judaïsme, premier christianisme (et ses régénérations dominicaine ou franciscaine), Islam… ont fait, d’une manière ou d’une autre, l’apologie de la pauvreté. Les lois somptuaires de la Renaissance ont sévèrement réglementé les manières de se vêtir, de se nourrir et de faire la fête. Les romantismes modernes ont dénoncé le luxe et autres vices de la civilisation et célébré la contemplation de la nature. Ces valeurs ont pénétré la modernité : le premier socialisme, tout en promettant l’abondance aux travailleurs affamés, a mobilisé un imaginaire de frugalité heureuse, que les mouvements communistes ont repris à leur compte. Notre société du « no limit » 7 constitue donc l’exception plutôt que la règle dans l’histoire humaine, ce qui pourrait rendre crédible l’hypothèse ascétique de Jonas. Sauf que cette histoire montre aussi que la frugalité a généralement été une norme imposée par les élites dirigeantes — qui se l’appliquaient rarement à elles-mêmes — et que quand elle fut réellement volontaire, elle est restée très minoritaire 8. La limitation librement consentie, autonome, démocratique, reste à inventer.
Il nous faut la vie large
Depuis que nous avons atteint un niveau d’abondance qui nous permettrait, en théorie, d’éradiquer le règne de la nécessité et ce qu’il reste de pauvreté dans nos sociétés productivistes, les signes d’épuisement de l’éthos capitaliste se multiplient. Le monde du travail en est le témoin privilégié, accumulant stress et burn-out, troubles musculo-squelettiques et dépressions, absentéisme et vagues de démission. Tout se passe comme si nous disions à travers nos souffrances notre désir d’autres rapports sociaux. La généralisation de « l’insécurité de l’existence », pronostiquée par Engels quelques années après la mort de Marx, pointe dans la même direction : les craintes de l’exclusion ou du déclassement, le sentiment d’anomie et la perte de sens, les douleurs provoquées par la dégradation des cadres de vies, humains et naturels, en sont les signes les plus visibles. À l’inverse, la multiplication des expériences qui tentent d’échapper à la logique de la marchandisation révèle une aspiration diffuse à d’autres formes d’organisation sociale et de rapport à la nature. Les conversions professionnelles vers des filières artisanales et à taille humaine, l’aspiration à des modes de travail plus autonomes, les nouvelles formes d’habitat, d’alimentation et d’éducation fondées sur la coopération, la lutte contre le gaspillage et l’obsolescence programmée, l’engagement dans la préservation et la régénération des cadres naturels, le succès des disciplines tournées vers le soin du corps et de l’âme, le bénévolat et même la mode des thérapies de développement personnel… tout cela exprime la recherche de rapports naturels et sociaux apaisés. Mais, reconnaissons-le, ces signes pèsent peu face à la puissance érotique de la consommation, au désir de distinction sociale, et aux moyens financiers immenses mobilisés par le régime capitaliste et son appareil de propagande. La gauche elle-même, politique ou syndicale, oublie trop souvent de rappeler qu’au-delà d’un certain niveau de prospérité, indispensable à mener une vie digne et épanouissante, l’accumulation de richesses et consommation ne font pas le bonheur. Or quand la gauche renonce à fonder une éthique autonome et abandonne à d’autres le principe de plaisir 9, elle laisse le champ libre à l’imaginaire capitaliste.
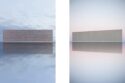
Dans ses premières années, le mouvement ouvrier n’avait pourtant pas promis de bâtir une nouvelle Sparte. « Nous ne sommes pas des ascètes, il nous faut la vie large », s’exclamait Jaurès, répliquant aux bourgeois qui lui reprochaient de vouloir leur imposer un train de vie austère. Et bien qu’il n’ait pas défini ce que recouvrait son appel à la « vie large », on devine à le lire qu’il ne s’agissait pas de reproduire le mode de vie oisif et philistin de la bourgeoisie de la Belle époque, mais de créer les conditions matérielles qui permettent à tout humain d’exprimer les capacités d’émerveillement et de création inscrites dans ses facultés physiques, morales et esthétiques. Le socialisme, alors, se concevait comme une morale, et cherchait à opposer au matérialisme vulgaire du monde de l’argent un idéal fait de voluptés frugales et de jouissances immatérielles 10.
Quand la gauche renonce à fonder une éthique autonome et abandonne à d’autres le principe de plaisir, elle laisse le champ libre à l’imaginaire capitaliste.
Paul Magnette
Il renouait en ce sens avec l’épicurisme, la plus ancienne tentative connue de fonder une éthique des plaisirs. Ostracisée par le christianisme, parce qu’elle refusait les doctrines de la création divine et de l’immortalité de l’âme, la doctrine d’Épicure fut si souvent caricaturée qu’elle reste perçue aujourd’hui comme une pure apologie des jouissances, centrée sur l’immédiat, et versant rapidement dans la luxure et la dépravation. Or si la philosophie d’Épicure — à laquelle le jeune Marx consacra sa thèse de doctorat — est bien matérialiste, elle n’est en rien une invitation à jouir sans entraves. En substituant la recherche du plaisir à la définition d’un bien abstrait, elle fonde une « discipline des désirs » 11. Épicure classe les plaisirs en trois catégories : ceux qui sont naturels et nécessaires (nos besoins élémentaires), ceux qui sont naturels mais pas nécessaires (la chair et la chère), et ceux qui ne sont ni l’un ni l’autre (les « désirs vides »). Il invite ses disciples à cultiver les premiers, à mesurer les seconds et à chasser les derniers. Le secret d’une vie libérée des déplaisirs du corps et des troubles de l’âme réside dans la capacité résister au luxe, à la luxure, au désir de domination, de gloire ou d’immortalité. Accepter notre inévitable sénescence, jouir de l’instant présent et se remémorer les joies du passé ; cultiver l’amitié, contempler la nature et ouvrir sa conscience au sentiment de l’existence 12.
Nous ne sommes donc pas forcés de choisir entre la consommation sans entrave et l’ascétisme. Nous pouvons aussi emprunter la voie d’une autolimitation, c’est-à-dire d’une définition démocratique des besoins humains qui doivent être garantis à tous, et des bornes qui doivent être imposées à la production et à la consommation pour satisfaire ces nécessités sans briser les équilibres naturels. L’éthique d’Épicure est un guide utile mais insuffisant. Elle promet à qui la pratique de n’éprouver « de trouble ni en songe ni dans la veille », et de vivre « comme un Dieu parmi les hommes » (Lettre à Ménécée), mais elle se vit dans une méditation pratiquée dans la solitude ou l’amitié. Ces exercices spirituels sont nécessaires, comme l’écrivait le sociologue et Résistant Georges Friedmann : « Nombreux sont ceux qui s’absorbent entièrement dans la politique militante, dans la préparation de la Révolution sociale. Rares, très rares, ceux qui, pour préparer la Révolution, veulent s’en rendre dignes » 13. Mais la méditation solitaire ne peut, à elle seule, étayer une pratique politique — le rejet explicite de toute forme d’engagement civique par les épicuriens leur vaudra d’ailleurs le reproche éternel des stoïciens. Mais toute doctrine finit par échapper à son fondateur et au cercle de ses premiers disciples. Redécouvert dans l’Italie humaniste du quattrocento, l’épicurisme a inspiré une puissante morale publique, conciliant la discipline des désirs et l’implication dans les affaires de la cité 14. Morale dont Machiavel a donné l’expression la plus claire, et qui nourrit ensuite Spinoza, Harrington, Montesquieu, Rousseau, les socialistes utopiques et le jeune Marx… À l’idée de la liberté posée par les libéraux, reposant sur la centralité de la propriété et sur la protection des droits personnels contre toute intervention publique, s’oppose depuis lors une autre idée de la liberté, ressuscitant l’idéal antique de l’engagement dans la cité 15. Dans cette vision de la liberté, la propriété n’est pas sans borne, la concentration de la richesse doit être combattue parce qu’elle conduit à la concentration du pouvoir et à à la corruption des institutions républicaines — comme l’ont rappelé Montesquieu et Rousseau, tous deux lecteurs de Machiavel. L’engagement civique et le respect de la nature vont de pair : herboriser ou cultiver son jardin, c’est garder à l’esprit que nous faisons partie de la nature, et mesurer à la fois la puissance et les limites de l’agir humain 16 – comme l’ont écrit Rousseau ou Jefferson, eux aussi lecteurs de Machiavel. C’est dans les termes de cette morale publique que raisonnaient les premiers mouvements socialistes et libertaires qui préfigurèrent la prise de conscience écologique 17, et c’est cet esprit que tentèrent de revivifier les premiers théoriciens de l’écosocialisme, d’André Gorz et Cornelius Castoriadis à Murray Bookchin.
Penser les boucles de rétroaction politiques
Cette éthique des plaisirs n’est toutefois pas parvenue à s’imposer dans le champ politique. En 1977, le dirigeant communiste italien Enrico Berlinguer appelait de ses vœux une « moralité nouvelle » 18, fondée sur les valeurs de la « rationalité, la rigueur, la justice, la jouissance de biens authentiques, c’est-à-dire la culture, l’instruction, la santé, un rapport sain et libre à la nature » 19. Machiavel n’aurait pas dit autre chose. Deux ans plus tard, le président démocrate américain Jimmy Carter déclarait dans un discours solennel à la nation américaine : « nous avons découvert que posséder des choses et consommer ne satisfait pas notre désir de sens. Nous avons appris que l’accumulation de biens matériels ne peut combler le vide d’existences sans confiance ni but ». On croirait entendre Epicure. Mais ces appels durèrent ce que durent les roses. Quelques mois plus tard, Ronald Reagan gagnait les élections présidentielles américaines, et donnait au fantasme de la consommation illimitée une nouvelle incarnation, qui trouva plus tard en Silvio Berlusconi et Donald Trump des représentations hypertrophiées. Depuis lors, l’avidité, l’arrogance, le mépris et l’obscénité forment une nouvelle morale publique 20. Et toute tentative de limiter l’accumulation des richesses ou la domination des mâles blancs et riches fait l’objet d’un procès instantané en « wokisme » et en écologie punitive.

La gauche ne peut espérer inverser la tendance si elle se contente de corriger à la marge le régime et l’imaginaire dont les Berlusconi et Trump sont les symptômes. Reagan et Thatcher avaient compris que seule une rupture radicale pouvait mettre fin à l’hégémonie du paradigme social-démocrate, et la gauche contemporaine devrait s’en souvenir. C’était déjà le pari de Jaurès : une « évolution révolutionnaire » devait introduire « dans la société d’aujourd’hui des formes de propriété qui la démentent et qui la dépassent, qui annoncent et préparent la société nouvelle, et par leur force organique hâtent la dissolution du monde ancien » 21 — ce qu’en langage d’aujourd’hui on appellerait des « boucles de rétroaction » politiques.
La transformation des structures de la société reste fragile quand elle ne s’accompagne pas d’une évolution culturelle et morale correspondante.
Paul Magnette
Les « petits gestes » des pionniers de la transition anticipent le mouvement : les citoyens qui s’impliquent dans les jardins partagés, les repair cafés, l’habitat collectif, la protection de la biodiversité, les écoles alternatives… ne suffiront pas à contrer la puissance du capital, mais ils contribuent à démontrer la possibilité d’un autre monde et à diffuser une contre-culture. L’enjeu est d’amplifier le mouvement, de passer de la petite échelle à l’hégémonie culturelle. De ce point de vue, l’histoire du mouvement ouvrier est riche d’enseignements qui gagneraient à être davantage exploités. Depuis sa fondation et jusqu’au tournant néo-libéral, la gauche européenne a toujours tenté de refaçonner simultanément les rapports sociaux et les consciences, la vie matérielle et la culture. L’expérience des « régimes sociaux-démocrates » montre que les libertés syndicales, l’impôt progressif, l’investissement dans les services publics et la sécurité sociale réduisent les inégalités et renforcent la cohésion sociale et la santé publique 22, mais aussi que ces institutions nourrissent en retour le sens de la solidarité et les préférences publiques pour les solutions collectives 23. Les institutions ne peuvent pas imposer à elles seules une morale publique, mais elles contribuent à consolider certaines valeurs et à les transformes en normes sociales. Après un siècle de réformes visant à démarchandiser les rapports sociaux, on peut identifier les choix politiques susceptibles d’amplifier et d’intensifier la transition climatique, et de transformer à la fois nos modes de production et de consommation, nos rapports sociaux et nos préférences morales.
Il nous faut réaffirmer la nécessité de contenir la concentration des richesses. Parce que les hyper-riches produisent infiniment plus de CO2 que les autres groupes sociaux, et qu’on ne peut pas demander au grand nombre de réduire sa consommation si une oligarchie échappe à la règle commune et continue de jouir sans entraves. Et parce que la concentration de la richesse corrompt la démocratie, comme le montre le lobbying indécent des multinationales des énergies fossiles. Contenir la concentration des richesses, c’est faire le choix de répondre aux besoins sociaux essentiels en développant les services publics (éducation, santé, logement, mobilité, alimentation, culture, accès à la nature…), qui offrent les réponses les plus parcimonieuses en ressources, créent des postes de travail soustraits à la logique marchande, et favorisent la cohésion sociale et l’attachement aux biens communs. Il nous faut réhabiliter la norme. Parce que taxer les comportements nuisibles ne suffit pas à les éradiquer, creuse les inégalités entre ceux qui peuvent continuer à en jouir et les autres, et nourrit un sentiment général d’iniquité. Les débats que suscite la norme ont en outre le mérite de revitaliser l’espace public démocratique — comme le montre l’histoire des règlementations centrées sur la santé, le temps et les conditions de travail, la sécurité routière, la pollution de l’eau et de l’air… Et en faisant reposer les choix de production sur des valeurs collectives plutôt que sur les décisions des consommateurs individuels, la norme évite de stigmatiser certains comportements et de dresser les groupes sociaux les uns contre les autres et renforce le sens commun.

Si l’avènement d’une nouvelle morale publique ne se décrète pas, elle n’est pas non plus le fruit de transformations culturelles insondables.
Paul Magnette
Ce ne sont que quelques exemples 24. Ils nous rappellent que si l’avènement d’une nouvelle morale publique ne se décrète pas, elle n’échappe pas non plus totalement aux pratiques politiques. Toutes les civilisations antérieures à la nôtre ont tenté de limiter l’accumulation des richesses et la concentration du pouvoir. Et même la société productiviste a su, dans les moments où elle a pris conscience de la gravité de l’instant, s’imposer de telles limites — comme le montrent les législations limitant le temps de travail ou taxant les revenus très élevés au lendemain des grandes récessions et des guerres. Ce faisant, elles ont cultivé les valeurs de dignité et de solidarité, les habitus de coopération et le sentiment d’appartenir à une communauté morale. Si la production et la consommation sans entraves causent les désastres écologiques et humains que l’on sait, et si l’ascétisme ne fait pas recette, pourquoi ne pas tenter de retrouver le plaisir de se donner librement des limites ?
Sources
- Cf. Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’événement Anthropocène, La Terre, l’histoire et nous, Paris, Seuil, deuxième édition, 2016 ; Pierre Charbonnier, Abondance et liberté, Une histoire environnementale des idées politiques, Paris, La Découverte, 2021.
- Cf. Aurélie Trouvé, Le bloc arc-en-ciel, Pour une stratégie politique radicale et inclusive, Paris, La Découverte, 2021.
- Cf. Bruno Latour et Nicolas Schultz, Mémo sur la nouvelle classe écologique, Paris, La Découverte, 2022.
- Hans Jonas, Le principe responsabilité, Une éthique pour la civilisation technologique, Paris, Editions du Cerf, 1995, pp. 187 et 192.
- Ibid., p. 218.
- Hans Jonas, Une éthique pour la nature, Paris, Arthaud, 2017, p. 93.
- Cf. Giorgos Kallis, Éloge des limites, Par-delà Malthus, Paris, PUF, 2022 et Christophe Bouton, Pour une anthropologie de l’anthropocène, Le grand continent, 2022.
- Cf. Emrys Westacott, The Wisdom of Frugality, Why Less is More — More or Less, Princeton, Princeton University Press, 2016.
- Cf. Michael Fœssel, Quartiers rouges, Le plaisir et la gauche, Paris, PUF, 2022.
- Cf. Thomas Bouchet, Les fruits défendus. Socialisme et sensualité du XIXe siècle à nos jours, Paris, Stock, 2014.
- Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Paris, Gallimard, 1995.
- Cf. Charles Senart, Carpe diem, Petite initiation à la sagesse épicurienne, Paris, Les Belles Lettres, 2022.
- Georges Friedmann, La puissance et la sagesse, Paris, 1970, p. 359.
- Cf. Alison Brown, The Return of Lucretius to Renaissance Florence, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2010.
- Cf. Quentin Skinner, La liberté avant le libéralisme, Paris, Seuil, 2016.
- Cf. Joëlle Zask, Ecologie et démocratie, Paris, Editions Premier Parallèle, 2022.
- Cf. Serge Audier, La société écologique et ses ennemis, Pour une histoire alternative de l’émancipation, Paris, La Découverte, 2017.
- Enrico Berlinguer, Austerità, Occasione per trasformare l’Italia, Rome, Riuniti, 1977, p. 19.
- Ibid., p. 54.
- Cf. le prémonitoire et toujours très actuel Raffaele Simone, Le monstre doux, L’Occident vire-t-il à droite ?, Paris, Seuil, 2010.
- Jean Jaurès, “République et socialisme”, 17 octobre 1901, in Ce que dit un philosophe à la cité, Paris, Les belles lettres, 2010, p. 141.
- Cf. Kate Pickett, Richard G. Wilkinson, The Spirit Level : Why more equal societies almost always do better, Londres, Allen, 2009 ; Anthony Atkinson, Inequality, What can be done ?, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2015 ; Ian Gough, Heat, Greed and Human Need, Cheltenham, Edward Elgar, 2017 ; Thomas Piketty, Capital et idéologie, Paris, Seuil, 2019.
- Cf. Benjamin Radcliff, The Political Economy of Human Happiness : How Voter’s Choices Determine the Quality of Life, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
- J’ai développé plus largement ces réflexions dans La vie large, Manifeste écosocialiste, Paris, La Découverte, 2022.


