L’œil de James Scott
« La lisibilité est la condition de la manipulation. Toute intervention étatique — vacciner une population, produire des marchandises, prélever des impôts, mobiliser des soldats, arrêter des criminels — requiert l’invention d’unités qui sont visibles. »
Le livre le plus important de l'anthropologue anarchiste est pour la première fois traduit en français.
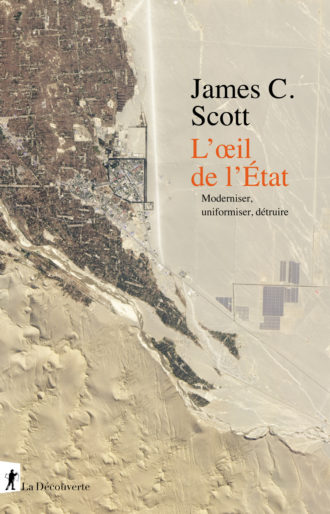
À plus de deux décennies de sa publication en anglais, le livre le plus célèbre et célébré de James Scott est désormais traduit en français, et offre une possibilité de se pencher sur une œuvre fondamentale dans le paysage des sciences humaines et sociales contemporaines. La production bibliographique de Scott mérite elle-même un détour, compte tenu de la cohérence de son projet intellectuel, à savoir une contre-histoire de la modernité visant à proposer une critique anarchiste de l’État. Si son ouvrage le plus récent, Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers États (La Découverte, 2018), s’élevait contre l’association commune entre sédentarisation, civilisation et formation des premiers États durant le néolithique1, ses œuvres précédentes décrivaient les formes de résistance directes à la domination étatique à travers l’histoire prémoderne — La Domination et les arts de la résistance (Amsterdam, 2009) — ou de décrire l’anarchisme en acte des communautés des haut-plateaux du Sud-Est asiatique — dans Zomia, ou l’art de ne pas être gouverné (Seuil, 2013). S’inspirant de Pierre Clastres, toute l’œuvre de Scott s’efforce de rendre compte de la formule lapidaire de l’anthropologue français dans La Société contre l’État (1974) : « L’histoire des peuples qui ont une histoire est, dit-on, l’histoire de la lutte des classes. L’histoire des peuples sans histoire, c’est, dira-t-on avec autant de vérité au moins, l’histoire de leur lutte contre l’État. »
Des forêts prussiennes aux villes nouvelles haut-modernistes
Comment l’État a pu, s’interroge Scott, établir un tel contrôle sur ses sujets et son environnement ? Ce processus d’uniformisation et de manipulation de la complexité des environnements et des sociétés par l’État prend le nom pour Scott de « lisibilité », le désir de soumettre le territoire à la carte, à la fois littéralement et métaphoriquement, par l’instauration de cadastres et registres de l’état civil, ou par l’uniformisation du langage. Cette complexité et illisibilité inhérente aux sociétés est ainsi transformée et détruite afin de se plier aux catégories de l’État moderne. À cet égard, le sous-titre français de l’ouvrage, Moderniser, Uniformiser, Détruire, illustre mieux que le sous-titre original [How certain schemes to improve the human condition have failed] la radicalité de sa critique de l’État. Dans la continuité de la réflexion foucaldienne, Scott voit en effet dans la production-même de taxonomies le déploiement de la rationalité étatique et de son pouvoir. « La lisibilité, » écrit-il, « est la condition de la manipulation. Toute intervention étatique — vacciner une population, produire des marchandises, prélever des impôts, mobiliser des soldats, arrêter des criminels — requiert l’invention d’unités qui sont visibles. »
C’est tout d’abord dans l’organisation de l’espace naturel que Scott voit naître cette rationalité de l’État moderne. Le développement de la sylviculture à la fin du XVIIIème siècle dans les forêts prussiennes en est à ses yeux un parfait exemple. La forêt en devient réduite à un gisement de ressources, du bois en l’occurrence, à exploiter sans s’intéresser à la richesse et à la diversité de ces espaces. L’écosystème complexe de la forêt, aussi bien sa faune que sa flore, est rendu lisible en étant transformé en variable de rendement de bois par les ingénieurs prussiens de l’époque. Ces méthodes de rationalisation et de quantification établies, la gestion de l’espace devient fin à elle-même, au-delà de l’exploitation des ressources, afin de délimiter la taille et les limites des villages situés aux lisières. Le territoire, la nature et les hommes doivent être rendus lisibles statistiquement par l’État pour rationaliser son contrôle et les manipuler avec plus de facilité2. Lors de sa leçon à l’occasion de la remise du prix Hirschmann en décembre 2020, dont le titre — In Praise of Floods [« Éloge des Inondations »] — était évocateur, Scott s’est penché sur les efforts d’aménagements et de canalisation du Rhin au XIXème siècle, et une de ses phrases a donné à voir la nature anti-prométhéenne de sa pensée : « Le Traité pour la Rectification du Rhin, voilà un nom intéressant, comme si Dieu n’avait pas fait ce fleuve proprement et qu’il fallait que l’Homo sapiens le corrige. »
Par-delà les espaces naturels façonnés, uniformisés et détruits par l’État moderne, Scott consacre une partie de l’ouvrage aux espaces urbains, et en particulier aux villes nouvelles, apanage emblématique des régimes haut-modernistes du XXème siècle. C’est à travers cet urbanisme, celui des Brasilia et des Chandigarh, que Scott appréhende celle qui est à son sens l’hybris de l’État. Se rapprochant des travaux de John F.C. Turner, auteur de Housing By People en 1976, Scott critique l’urbanisme moderniste comme une vision qu’il qualifie d’antisociale, car négligeant les processus informels et les connaissances locales qui forment les communautés urbaines. Face au Corbusier, voué aux gémonies, se dresse dans l’ouvrage la figure de Jane Jacobs, la New Yorkaise qui tint tête aux désirs modernistes de Robert Moses dès les années 1950, en défendant la vie de quartier et les modes d’organisation établis par les habitants du West Village à Manhattan.
Scott critique l’urbanisme moderniste comme une vision qu’il qualifie d’antisociale, car négligeant les processus informels et les connaissances locales qui forment les communautés urbaines.
Ayan Meer
Poursuivant cette opposition entre deux types de vision de l’émancipation, l’une moderniste, à savoir pour Scott hors-sol et opprimante, l’autre vernaculaire et donc échappant à la rationalité étatique, l’ouvrage dresse un portrait à charge du haut-modernisme dans son ensemble, et donc à un de ses plus importants représentants, Lénine. S’attelant tout le long d’un chapitre à un exercice de démolition du Bolchévisme qui n’aurait rien à envier aux œuvres anti-communistes du siècle dernier, Scott se revendique toutefois d’une tradition inspirée du mutualisme libertaire et anarchiste. Dans son analyse de la collectivisation soviétique, Scott voit avant tout la « négation du monde rural existant », un remplacement total de la paysannerie et de ses modes d’existence par une révolution économique et culturelle, un rapprochement des mondes urbains et ruraux. « La logique [des kolkhozes] », écrit Scott, « n’est pas si différente de la gestion des McDonald’s : des unités similaires et modulables, produisant des produits identiques. » En mettant ainsi dos-à-dos capitalisme et communisme, l’ouvrage renforce son argument contre les modernismes de tout type, mais perd malheureusement en nuance historique et en rigueur théorique, en particulier lorsque Scott ressasse une vieille caricature d’un Marx méprisant les paysans et le monde rural3.
La mètis, le savoir pratique contre l’État technocratique ?
La critique de l’État moderne proposée par Scott n’est pas seulement liée aux formes d’uniformisation et de destruction des territoires et des sociétés qu’il engendre, mais également à sa profonde inefficacité, à l’idée que ces projets de développement ne peuvent que se solder par des échecs. L’ouvrage se veut en effet une démonstration que « l’impérialisme » haut-moderniste court vers sa propre perte en faisant table rase du monde existant, en ignorant les connaissances et le savoir-faire des communautés qu’il entend contrôler, jugement étayé par une série d’échecs de réformes agraires et de projets urbains dans les pays du Sud—la villagisation due à la politique Ujamaa dans la Tanzanie de Nyerere, notamment.
L’argument principal de Scott est que toutes les sociétés sont caractérisées par des épistémologies vernaculaires qui ne se plient pas à l’uniformisation étatique. Ce savoir, transmis à travers un temps long et par un apprentissage pratique plutôt que théorique, est associé au concept grec de mètis. S’inspirant des travaux de Jean-Pierre Vernant et Marcel Detienne à ce sujet4, Scott voit dans la mètis la ressource principale des sociétés, ressource négligée et détruite par l’État moderne, au nom de ses prérogatives centralisatrices. Ce savoir informel s’oppose à la science abstraite déployée par l’État et ses technocrates, et il s’apprend en le pratiquant, dû à son déploiement expérientiel dans un environnement imprévisible.
Les exemples de mètis que donne Scott laissent toutefois place à des doutes quant à son incompatibilité avec l’État moderne. Mis à part les formes de mètis des communautés à la marge des États, l’auteur en guise de conclusion cite également de façon élogieuse la pensée de Thomas Jefferson, notamment son idée que le développement d’un esprit paysan yeoman chez les États-Uniens formerait un terreau fertile à l’émergence d’un citoyen idéal. Paraphrasant Jefferson, Scott défend l’idée que « l’autonomie et le savoir-faire requis dans l’agriculture paysanne forment le citoyen à être responsable, à posséder assez de propriété afin d’éviter la dépendance sociale. » Or, il est évident que l’idéal yeoman de Jefferson relève plus du mythe que de la réalité, lorsque l’on connaît la force étatique moderne qui fut nécessaire à la colonisation de peuplement sur le continent Nord-Américain.
L’argument principal de Scott est que toutes les sociétés sont caractérisées par des épistémologies vernaculaires qui ne se plient pas à l’uniformisation étatique. Ce savoir, transmis à travers un temps long et par un apprentissage pratique plutôt que théorique, est associé au concept grec de mètis.
AYAN MEER
Par ailleurs, Scott cite également les travaux du sociologue Robert Putnam5 sur le succès persistant des entreprises industrielles familiales dans l’Émilie-Romagne italienne, qui s’appuie sur des réseaux de solidarité denses et restreints, plus à même de s’adapter aux vicissitudes de la désindustrialisation et d’être plus flexibles dans les processus de production. Érigée en mètis institutionnelle idéale, ce maillage territorial et industriel italien a cependant prospéré lors des Trente Glorieuses, dans une région gouvernée pendant des décennies par le Parti Communiste Italien et son profond modernisme étatique. Si, dans le sillon de Putnam, il s’agit de faire l’éloge de la mètis comme une forme de capital social sur lequel s’appuyer institutionnellement, l’ouvrage de Scott se révèle moins radical dans sa critique de l’État.
Niché dans une note de bas de page de la conclusion, Scott admet enfin que la mètis est tout aussi omniprésente dans les sociétés modernes, mais qu’elle prend des nouvelles formes avec chaque transformation des sociétés. L’œil de l’État est-elle l’œuvre d’un anarchiste viscéralement opposé à l’État dans la lignée de Clastres, ou bien celle d’un auteur attaché à la reconnaissance par l’État de formes d’autonomie communautaires et individuelles, et donc à la prise en compte de ses limites et à la restriction de son espace d’action ?
Hayek et le plan
Cette critique est préemptée par Scott. Tout le long de l’ouvrage, il entretient un flou élégant dans son rapport au libéralisme, aux coordinations visibles de l’État moderne et à celles dites invisibles du marché. Dès son introduction, il prend soin de démarquer sa critique de l’État de celle de néolibéraux tels Friedrich Hayek et Milton Friedman. « Comme nous allons le voir », écrit-il, « les conclusions qui peuvent être tirées des échecs des projets modernes d’ingénierie sociale s’appliquent tout autant à la standardisation engendrée par le marché qu’à l’homogénéité bureaucratique. » Tout en faisant l’éloge de Jane Jacobs contre les urbanistes new yorkais, Scott concède que celle-ci a tendance à « naturaliser » la ville non planifiée, comme Hayek tend à naturaliser le marché. En effet, le West Village aujourd’hui n’est certes pas traversé par une autoroute haut-moderniste, mais il a subi une gentrification outre mesure et une spéculation immobilière débridée lors des derniers quarante ans. Enfin, dans son éloge des savoirs ancestraux et sa critique des révolutions, Scott se défend explicitement des connotations burkéennes que ceux-ci pourraient prendre.
Toutefois, ces prémisses clairement posées, l’ouvrage s’attelle à proposer presque mot pour mot les idées que Hayek exprime dans L’Utilisation de la connaissance dans la société, article paru en 1945. S’opposant à la planification de l’économie, le philosophe autrichien n’en critique pas seulement les bases politiques et économiques, mais défend l’idée qu’aucun organisme central ne pourrait répliquer le système décentralisé du prix, fondé sur la connaissance individuelle de tous les agents s’exprimant sur un marché. Scott ne partage pas le modèle économique vers lequel tend cette mètis hayekienne, mais il en partage le diagnostic de la futilité de toute forme de planification étatique. Il le répète à plusieurs reprises dans son ouvrage, notant même que « il existe une curieuse unanimité à ce sujet entre les critiques de droite de l’économie planifiée comme Friedrich Hayek et les critiques de gauche de l’autoritarisme communiste comme Pierre Kropotkine, qui déclarait ‘Il est impossible de légiférer pour l’avenir’. »6
Cet œil de l’État oscille ainsi entre puissance destructrice et institution vouée à l’échec, entre « lisibilité totale » et « vœu pieux » planificateur. Les échecs des projets développementaux modernistes du Tiers Monde sur lesquels se penche Scott, en employant le terme de « fiasco », ont-ils été dû aux faiblesses inhérentes à l’État qu’il identifie, ou bien à d’autres facteurs ? Il est troublant de noter que dans son analyse des échecs de la villagisation Tanzanienne par exemple, l’impérialisme n’est jamais évoqué, comme si le régime de Nyerere n’était pas également soumis à de fortes dépendances internationales dû au contexte de décolonisation et de Guerre Froide.
Cet œil de l’État oscille entre puissance destructrice et institution vouée à l’échec, entre « lisibilité totale » et « vœu pieux » planificateur.
AYAN MEER
À l’aune des succès de la Chine lors des derniers trente ans au regard des indices de développement, Scott parlerait-il toujours de « fiasco » à l’égard de tels projets ? Nous devons nous pencher sur les coûts environnementaux et sociaux des dernières décennies en Chine, mais nous nous devons également de noter que, avec une relative indépendance par rapport à d’autres pays du Sud face aux pressions financières et militaires internationales, le taux de pauvreté en Chine est passé de plus de 65 % en 1990 à moins de 1 % en 20157. Face à des chiffres aussi frappants, difficile de ne pas noter une vraie force émancipatrice des projets de développement modernistes, que nous jugions une émancipation de ce type positive ou moins.
De plus, l’impérialisme que Scott attribue au haut-modernisme se mue aisément dans une vision décentralisée, différenciée et antimoderniste. En effet, dès les années 1960, des organisations de développement comme USAID ont entrepris de délaisser la grandiloquence haut-moderniste au profit de projets moins ambitieux, locaux, en s’associant à des structures communautaires préexistantes8. Au même moment où émergeait la souveraineté étatique des anciennes colonies, le secteur du développement international a initié à vanter les mérites d’un État moins présent, d’une souveraineté décentralisée, des connaissances locales. Le capitalisme international et ses bras armés étatiques ne procèdent pas uniquement par un désir de lisibilité, mais par une tension entre lisibilité et illisibilité, uniformisation et différenciation. Comme le souligne l’anthropologue James Ferguson9, les forces étatiques contemporaines, dans la panoplie de formes que celles-ci prennent, cartographient certains espaces mais en laissent d’autres non cartographiés, afin de les contrôler et de les manipuler également.
Enfin, bien que L’œil de l’État conserve, à plus de vingt ans de sa publication, toute sa cohérence argumentative ainsi que l’élégance de la plume de James Scott, nous sommes en droit de questionner la pertinence de sa critique. Lui-même observe dans l’ouvrage que critiquer les plans étatiques « à l’époque du capitalisme triomphant » relève d’une « archéologie d’un monde désuet »10. À l’ère des crises sanitaires, écologiques et économiques, la planification étatique est-elle véritablement l’ennemie des peuples ? Si le marché et son système de prix décentralisé s’est montré incapable d’organiser la production afin de subvenir aux besoins de la population mondiale tout en protégeant l’environnement, une économie planifiée annoncerait-elle des malheurs plus importants que ceux que nous subissons ? Les formes que prendraient les structures étatiques la mettant en acte pourraient être plus ou moins uniformisatrices, plus ou moins destructrices, mais aussi plus ou moins démocratiques et émancipatrices. Entre un Prométhée déchaîné et un James Scott le condamnant à une peine éternelle, il s’agira de se frayer un chemin plus nuancé.
Sources
- Le titre original du livre est Against the Grain (« contre le grain », dans le sens littéral mais également comme expression idiomatique signifiant « à contre-courant »), qui rend compte de la critique radicale de ce qu’a pu représenter le passage à cette agriculture sédentaire pour Scott.
- Une citation apocryphe de Peter Drucker, célèbre théoricien du management, traduit cette idée de façon lapidaire : « Si vous pouvez le mesurer, vous pouvez le gérer. »
- Idée pourtant battue en brèche depuis un certain temps, notamment par Hal Draper dans le second volume de Karl Marx’s Theory of Revolution (1978).
- Marcel Detienne, Jean-Pierre Vernant, Les Ruses de L’Intelligence. La Mètis des Grecs, Flammarion, 1974.
- Robert Putnam, Making Democracies Work : Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, 1993.
- À deux reprises dans l’ouvrage, Scott cite également la critique de l’État d’Isaiah Berlin, autre penseur libéral avec qui il partage cette « curieuse unanimité ».
- Selon les données de la Banque Mondiale accessibles au lien suivant : https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=CN
- Cette évolution est le sujet de Daniel Immerwahr, Thinking Small. The United States and the Lure of Community Development, Harvard University Press, 2015.
- James Ferguson, « Seeing Like an Oil Company : Space, Security, and Global Capital in Neoliberal Africa », American Anthropologist, vol. 107, n°3, 2005, p. 377-382.
- Même si la souveraineté et l’existence de l’État doivent continuer à interroger les sciences humaines et sociales. Voir à ce sujet la publication récente de Pierre Dardot, Christian Laval, Dominer. Enquête sur la souveraineté de l’État en Occident, La Découverte, 2020.
