La « Banque-providence », une conversation avec Eric Monnet
« L'association entre la création de l’État-providence et des banques centrales publiques au milieu du XXe siècle n’a pas été abandonnée. » Shahin Vallée s'est entretenu avec Eric Monnet à propos des propositions formulées dans son dernier essai La Banque-providence. Démocratiser les banques centrales et la monnaie, paru aux éditions du Seuil.
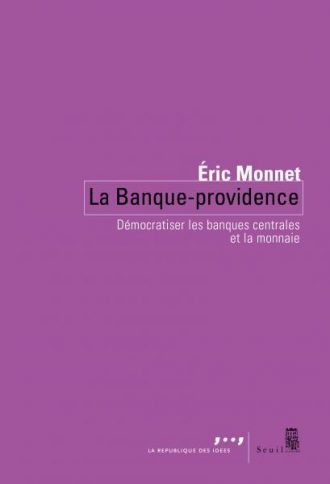
Dans votre ouvrage, vous commencez par une distinction assez élémentaire mais centrale entre monnaie, système monétaire (que vous décrivez comme un bien public) et système de crédit ? Pouvez-vous expliquer ces trois notions et la place de la Banque centrale pour chacune d’entre elles ?
Il est en effet très important de rappeler cette distinction pour parler de politique monétaire et de banques centrales, c’est-à-dire de questions macroéconomiques ou de politiques publiques. Car lorsque l’on évoque la monnaie, on parle de quelque chose à laquelle la plupart des gens ont d’abord un rapport privé : la monnaie, au sens de l’argent, est quelque chose que nous utilisons ou accumulons à des fins individuelles. Il est donc important de faire la distinction entre ce qui relève du bien privé – l’argent que tout le monde utilise – et la monnaie au sens d’un système monétaire, qui est véritablement un bien public. Si nous parlons de bien public, c’est qu’il y a des formes d’utilisation de la monnaie qui peuvent dégrader l’utilisation de ce bien par d’autres personnes. C’est là où il est important d’avoir une puissance publique – l’État mais plus particulièrement ici la Banque centrale – qui agit pour garantir que le système monétaire reste un bien public. Il est alors important de voir ce qui garantit que le système monétaire soit un bien public : la relative stabilité de la valeur de la monnaie (éviter trop de déflation ou d’inflation), mais également l’accessibilité à toutes et à tous de la monnaie qui repose sur le fait qu’il s’agisse d’un bien à la fois universel et anonyme. Le système de crédit – autrement dit le système financier – ne peut intégralement être vu comme un bien public mais il ne peut non plus être pensé de manière isolée du système monétaire. Et c’est là que se pose toute la question politique sous-jacente à l’activité des banques centrales, puisque leur mission de service public d’assurer la stabilité et universalité du système monétaire se fait en pratique surtout par des interventions au sein du système financier.
Est-ce cette distinction entre usage privé et bien public qui explique le scepticisme que vous semblez avoir pour les crypto-monnaies ?
Je parle de ces distinctions dans mon ouvrage à la fois au tout début – pour penser le rôle de la Banque centrale en démocratie – et j’y reviens ensuite sur une autre question plus précise qui est celle des crypto-monnaies. L’enjeu politique suscité par les crypto-monnaies, ou comment créer une monnaie digitale publique anonyme pour éviter la privatisation du système monétaire, me paraît aujourd’hui fondamental mais trop peu discuté dans le débat public. Il est pertinent de faire la différence entre les monnaies privées (comme le bitcoin) et la monnaie publique émise par un État, qui fait en sorte d’en garantir la stabilité et l’universalité. Les monnaies privées qui prétendent répliquer la stabilité des monnaies publiques (stablecoins), comme celle imaginée par Facebook, n’offrent pas de meilleures perspectives. Il faut en effet voir que ces monnaies privées sont un véritable risque pour cette dimension universelle de bien public qu’est la monnaie puisque, in fine, rien ne garantit leur stabilité et leur accessibilité à tous et à toutes.
Il est important de faire la distinction entre ce qui relève du bien privé – l’argent que tout le monde utilise – et la monnaie au sens d’un système monétaire, qui est véritablement un bien public.
Eric Monnet
La création des crypto-monnaies répond tout de même à une certaine demande et peut-être aux lacunes ou aux faiblesses des monnaies fiduciaires actuelles. Il est donc assez étonnant de voir les Banques centrales internationales aujourd’hui tenter de produire leur propre crypto-monnaie presque en réponse à un activisme privé qui mêle des enthousiastes de la technologie et libertariens sceptiques quant au rôle des Banques centrales et des monnaies fiduciaires. Est-ce qu’il faut, au fond, lire dans l’action des banques centrales dans ce domaine une tentative de mise sous contrôle ou de lutte contre la privatisation de la monnaie ?
Les propositions des Banques centrales d’émettre des monnaies électroniques que l’on appelle « monnaies digitales de Banque centrale » sont une réaction à la multiplication des crypto-monnaies privées, typiquement le bitcoin, mais aussi à la disparition de la monnaie fiduciaire (pièces et billets) dans les transactions monétaires : nous utilisons aujourd’hui d’autres moyens, principalement la carte bancaire ou le téléphone.
Chacun de ces deux phénomènes pose un problème différent. Les moyens de paiement comme la carte bleue ne sont ni anonymes ni universels, mais ils reposent in fine sur l’existence d’une monnaie publique garantie par la banque centrale. Le problème serait qu’ils finissent par éclipser totalement l’existence d’une forme monétaire anonyme et universelle, représentée aujourd’hui par le billet de banque. Les monnaies privées, crypto-monnaies, ont quant à elles été créées en pensant des nouveaux usages qu’il était difficile d’avoir avec les monnaies publiques traditionnelles mais aussi avec une idéologie qui va contre l’État, une défiance face à la monnaie publique émise par l’État.
C’est donc en réaction à ces deux bouleversements que les Banques centrales cherchent aujourd’hui à créer des monnaies digitales publiques, c’est-à-dire des équivalents digitaux de la monnaie fiduciaire. On peut le voir comme une sorte de reprise de contrôle dans ce secteur, mais c’est également une défense du statut public de la monnaie.
Mais pourquoi ne pas simplement interdire les monnaies électroniques privées plutôt que de créer des monnaies électroniques publiques, concurrentes des monnaies privées ?
Il y a deux points. D’abord, les monnaies publiques électroniques, donc digitales, ne répondent pas seulement aux cryptomonnaies comme le bitcoin mais aussi à la disparition du cash, comme je viens de l’expliquer. Ensuite, on ne peut pas interdire toutes les transactions, qui sont en réalité des transactions d’actifs financiers : les bitcoins et les autres monnaies électroniques sont des types d’investissement, ou plus prosaïquement, des types de jeux d’argent comme le casino. Interdire totalement tout type d’investissement et de jeu est très compliqué mais on peut les réguler fortement, tout en créant des alternatives de monnaie publique évitant de laisser penser que l’anonymat n’est que synonyme de privatisation.
Vous êtes historien et vos travaux académiques portent beaucoup sur le rôle des Banques centrales dans la période de l’après-guerre, la période de Bretton Woods. Vous décrivez dans vos travaux, à la fois des changements profonds dans le rôle des banques centrales entre cette période-là et l’époque moderne et, en même temps, une certaine continuité.
L’histoire des Banques centrales, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et ce qui est communément appelé le « tournant néolibéral des années 1980 », est l’histoire d’une intégration très forte de ces institutions au sein de l’appareil d’État, État par ailleurs très interventionniste dans différents domaines de l’économie (la politique industrielle étant emblématique de ces interventions).
Les Banques centrales, tout en ayant un rôle de stabilité monétaire – j’insiste – vont être intégrées à cet appareil étatique interventionniste, et vont participer à ces différents types d’intervention, notamment pour faire en sorte que le crédit et les financements aillent dans les secteurs auxquels l’État donne la priorité. La Banque centrale donne par exemple ouvertement la priorité à certains secteurs ou activités lorsqu’elle refinance les banques.
Les monnaies privées ont été créées en pensant des nouveaux usages qu’il était difficile d’avoir avec les monnaies publiques traditionnelles mais aussi avec une idéologie qui va contre l’État, une défiance face à la monnaie publique émise par l’État.
ERIC MONNET
Ce principe est remis en cause dans les années 1980 par un mouvement simplement lié à la remise en cause plus générale de l’interventionnisme étatique dans beaucoup de domaines économiques. Ce tournant libéral des banques centrales fut au fondement de la redéfinition de la notion d’indépendance de la Banque centrale dans les années 1990. La notion d’indépendance – qui est aussi ancienne que les banques centrales elles-mêmes mais avec des définitions changeantes au cours de l’histoire – devient donc synonyme d’un désengagement de la banque centrale de l’interventionnisme étatique dans l’allocation du crédit.
C’est évidemment une transition forte, mais qui ne doit pas cacher des continuités. Dans ce livre – contrairement au précédent – j’insiste plutôt sur les continuités car il me semble que si nous prenons une perspective historique sur deux siècles d’histoire des banques centrales, la véritable rupture se situe au milieu du XXe siècle, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il est décidé de faire des banques centrales des institutions publiques intégrées à l’appareil d’État, ce sur quoi nous ne sommes pas revenus.
C’est pour cela que ce livre a pour titre « la Banque-providence » : l’association entre la création de l’État-providence et des banques centrales publiques au milieu du XXe siècle n’a pas été abandonnée. La banque centrale est intégrée à l’État providence en deux sens. Tout d’abord, elle assure dans le domaine monétaire et financier des rôles assurantiels attribués au gouvernement dans d’autres domaines économiques. Deuxièmement, elle garantit in fine la valeur de la dette publique, une dette publique qui, contrairement à avant 1945, finance majoritairement le fonctionnement de l’État providence. L’évolution des banques centrales dans les années 1980-1990 est d’ailleurs le miroir des mutations libérales de l’État providence, pas une rupture avec ce dernier. Et ce simple point-là me semble important pour penser la situation actuelle. D’abord, la réaction des banques centrales après la crise de 2008 et encore plus avec le Covid-19, d’une certaine manière réactive ou prolonge leur rôle « providentiel », avec des ambiguïtés inhérentes au libéralisme sur le soutien au système financier privé au nom de l’intérêt public. Si on ne pense pas cette continuité, on ne peut comprendre pourquoi les banques centrales ont réagi si différemment de lors de la crise des années 1930. On ne comprend pas non plus pourquoi il est inscrit dans les traités de l’Union Européenne que la banque centrale doit « soutenir les politiques générales de l’Union », un énoncé très général qui ouvre la porte à de nombreuses interprétations sur la coordination entre la BCE et les autres instances de gouvernement européen.
Le deuxième point, c’est que nous voyons que cette idée du lien entre la Banque centrale et l’État-providence pose à la Banque centrale des problématiques très classiques qui sont posées à d’autres secteurs de la politique économique, c’est-à-dire : est-ce que c’est vraiment à l’État d’intervenir, et ne faut-il pas plutôt laisser faire le marché ? L’État, lors de ses interventions, ne favorise-t-il pas trop – ou au contraire pas assez – certains groupes et secteurs ? Une grande partie du livre a donc pour but de réintégrer les banques centrales au sein d’une réflexion plus générale sur la politique économique et sur ses aspects allocatifs, redistributifs.
L’évolution du rôle de la notion d’indépendance de la Banque centrale pose, et c’est la question nodale qui traverse votre livre, la question de la démocratie, du contrôle démocratique de l’action de la Banque centrale. Vous évoquez une controverse assez intéressante entre deux lectures du contrôle démocratique. La théorie portée par Rudiger Dornbusch du constitutionnalisme économique et une autre, portée par Joseph Stiglitz, de la nature délibérative de la décision. Pouvez-vous nous éclairer sur ces deux notions ?
Cela renvoie à ce que nous disions tout à l’heure à propos du fait que les années 1990, notamment en Europe, vont être une époque de redéfinition de la notion d’indépendance de la banque centrale. L’indépendance de la banque centrale n’est pas du tout nouvelle : dans l’histoire, les banques centrales sont par nature fonctionnellement indépendantes du Trésor et la question des relations politiques, financières et juridiques entre les deux est aussi ancienne que ces institutions.
La redéfinition de l’indépendance dans les années 1990 va se centrer sur l’idée d’une délégation totale. Cela est d’ailleurs lié au retrait de l’interventionnisme dont nous parlions tout à l’heure, et à l’idée qu’il est possible de laisser le marché fonctionner seul de manière efficace. L’État – le Parlement ou le gouvernement – délègue à une institution le pouvoir d’agir sur un secteur avec des objectifs précis et l’institution est totalement indépendante, elle ne reçoit pas d’instructions de l’État. Puisque les marchés monétaires et financiers fonctionnent efficacement, il n’y a pas vraiment matière à débat. Le rôle de la banque centrale est de fixer les taux d’intérêt sans troubler les marchés. Mais qu’implique vraiment cette délégation ? Et en quoi est-elle différente si on reconnaît que la banque centrale a en fait un rôle actif de soutien au marché, plutôt que d’encadrement distant ?
L’association entre la création de l’État-providence et des banques centrales publiques au milieu du XXe siècle n’a pas été abandonnée.
ERIC MONNET
C’est là qu’il y a deux manières de voir les choses. Une première vision est de penser que cette délégation signifie soustraire totalement l’activité de cette institution indépendante au débat démocratique – une vision défendue par la théorie du constitutionnalisme économique, en affirmant qu’il y a des secteurs de l’économie qui doivent être soustraits au débat démocratique puisque la démocratie est inefficace pour les institutions de ce type de politique.
Il y a une autre vision, que j’emprunte surtout aux travaux de Pierre Rosanvallon, notamment dans La légitimité démocratique, où il insiste sur le fait que la délégation elle-même n’est jamais suffisante pour garantir la légitimité démocratique d’une institution, y compris les autorités indépendantes. Rosanvallon insiste sur deux points qui doivent accompagner la délégation : l’impartialité et la réflexivité. Pour que ces institutions soient véritablement légitimes, tout en étant indépendantes, elles doivent toujours montrer qu’elles sont impartiales vis-à-vis de différents pouvoirs, mais aussi qu’elles sont réflexives. Cette réflexivité signifie qu’elles reconnaissent que leurs actions ont des conséquences imprévues, qui peuvent être distributives vis-à-vis de l’économie et qu’elles font toujours face à des arbitrages, à des choix et que non seulement ces choix doivent être débattus démocratiquement mais qu’elles prennent en compte ce débat démocratique pour leurs décisions.
Une des propositions est l’idée d’établir en Europe un « conseil du crédit » qui permettrait d’encadrer l’action de la BCE. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnerait ce Conseil du crédit et en quoi il se distinguerait de quelque chose qui existe, qui a été créé en réponse à la crise financière de 2008-2010 et qui s’appelle le Conseil européen du risque systémique, réunissant à la fois les gouverneurs des Banques centrales mais aussi les ministères des Finances dans le but de développer ce que les économistes appellent une politique macro-prudentielle ?
Ce qui procède à mon avis d’une insuffisance de la légitimité démocratique des banques centrales est le fait qu’elles prennent leurs décisions en étant elles-mêmes juges et parties de ces décisions : elles produisent la justification de ces décisions sans un véritable débat dans une enceinte qui garantirait un équilibre politique et un équilibre des expertises.
Ce que nous devrions imaginer aujourd’hui est que la Banque centrale, quand elle doit faire des choix qui engagent des sujets sociétaux ou économiques généraux – on peut penser au sujet écologique – le fasse dans un cadre de délibération, dans un cadre réflexif, en arrêtant de déterminer sa position sans discussion avec d’autres acteurs sur les conséquences et la légitimité de ses actes.
Ce qui manque donc ici, c’est d’abord l’enceinte, c’est-à-dire le lieu où ce débat doit se dérouler. Il y a déjà des discussions entre la Banque centrale et le Parlement, il y a des auditions de la BCE au Parlement mais elles sont assez rares et, surtout, elles sont trop déséquilibrées. On arrive avec une Banque centrale qui a un monopole de l’expertise, qui a déjà des positions très arrêtées et se retrouve à expliquer sa position devant un Parlement qui manque des armes suffisantes pour avoir une opinion qui puisse produire un équilibre face aux autres.
Ce qui est assez intéressant en Europe, c’est qu’à l’inverse des États-Unis, nous n’appelons pas cela des « auditions » mais des « dialogues » car la Banque Centrale considérait qu’une audition aurait potentiellement entamé son indépendance.
La Banque centrale refuse l’idée d’audition, qui la soumettrait au pouvoir parlementaire.
C’est en partie pour cela que je propose la création d’une institution au niveau européen, qui permettrait au Parlement d’être à égalité avec la BCE lorsqu’il discute de sujets financiers, économiques, sur lesquels cette dernière a un impact, direct ou indirect, impact sur lequel le Parlement doit statuer. Nous savons que dans les traités européens, la Banque centrale doit garantir la stabilité des prix. Mais elle doit aussi soutenir les politiques générales de l’union économique. Il faut bien débattre quelque part de la manière dont la BCE peut soutenir les politiques de l’Union européenne. C’est pour cela que je pense qu’il serait intéressant d’avoir un conseil qui soit directement lié au Parlement européen pour que celui-ci puisse avoir ce débat d’égal à égal à la Banque centrale.
Ce qui procède d’une insuffisance de la légitimité démocratique des banques centrales est le fait qu’elles prennent leurs décisions en étant elles-mêmes juges et parties de ces décisions
ERIC MONNET
Il serait nommé « conseil du crédit européen » car il serait chargé de discuter de ces questions économiques et financières. Vous dites à raison qu’a été créé, après la crise de 2008, un Conseil européen du risque systémique qui, d’une certaine manière, est d’un esprit proche de la structure que je propose puisqu’il fait le lien entre la Banque centrale et les gouvernements sur la question de la stabilité financière. Il existe non seulement au niveau européen mais est également décliné au niveau de chaque pays – en France c’est le Haut conseil à la stabilité financière. Et la raison d’être de ces institutions est justement que la banque centrale n’a pas, seule, la légitimité suffisante pour agir dans les domaines financiers.
Je pense néanmoins que le Conseil européen du risque systémique souffre de trois problèmes.
Premièrement, c’est une structure purement intergouvernementale, qui n’a donc pas la légitimité du Parlement européen, et qui a toute la lourdeur de l’intergouvernementalité.
Deuxièmement, l’expertise de ce comité n’est pas assez déconnectée des banques centrales.
Troisièmement, il a été créé en réponse à la crise financière de 2008-2009 et son rôle est donc limité à la stabilité financière. C’est beaucoup trop restreint pour pouvoir discuter de ce qui importe aujourd’hui économiquement et démocratiquement : la coordination entre la politique de la BCE et les autres politiques économiques, sociales et environnementales. Nous ne sommes plus en 2008, c’est maintenant la crise écologique qui doit avoir la priorité.
Vous insistez sur la notion de stabilité monétaire plutôt que sur celle de stabilité des prix, ce qui est peut-être une manière discrète d’élargir le mandat de la BCE non plus à un mandat étroit de ciblage de l’inflation mais un mandat beaucoup plus large incluant la stabilité financière. Vous acceptez donc l’idée que la Banque centrale joue un rôle allocatif.
Mais ne pensez-vous pas qu’accepter un rôle allocatif mène nécessairement à accepter un rôle redistributif, car en vertu de politiques allocatives, la BCE créerait de la redistribution, que ce soit une redistribution entre pays, entre catégories sociales ou entre individus ?
Au fond, ce que vous décrivez est plus que de la simple stabilité financière ou stabilité monétaire, c’est en fait faire rentrer la BCE dans toute une gamme de décisions de politique économique qu’on pensait jusqu’alors être le domaine exclusif de la politique budgétaire et des gouvernements ?
Deux points sur ces questions très importantes.
D’abord, je parle beaucoup de stabilité monétaire, plus que de stabilité des prix, et ce pour insister sur ce point, qui me paraît important et qui lie l’émergence des banques centrales modernes à la question de l’État-providence. La défense de la stabilité des prix n’est pas une obsession, comme ce qui pouvait être le cas avant 1945, avec l’obsession pour l’étalon-or. Si nous pensons que la stabilité des prix est bonne, c’est parce que nous pensons que l’État-providence, pour fonctionner, a besoin d’une sorte de stabilité monétaire suffisante. Sinon, cela n’a aucun sens.
Le deuxième point porte sur l’aspect redistributif. Là, je pense qu’il est important de reconnaître et d’avoir des instances qui permettent de discuter du fait que quand la BCE agit, achète de la dette publique, refinance certaines activités financières, cela a des effets sur de nombreux champs économiques qui ne sont pas seulement maîtrisés par la Banque centrale. Aujourd’hui, l’exemple typique est la dette publique. Lorsque la Banque centrale détient un tiers de la dette publique d’un pays, cela a un effet sur son prix. Nous pourrions peut-être en parler plutôt que de faire comme si cela n’existait pas. De même sur la question déjà beaucoup débattue sur les actifs : est-ce que ce sont des actifs verts ou des actifs polluants ?
Si nous pensons que la stabilité des prix est bonne, c’est parce que nous pensons que l’État-providence, pour fonctionner, a besoin d’une sorte de stabilité monétaire suffisante.
ERIC MONNET
Il faut donc discuter de ces questions, il faut assumer que la BCE a parfois un rôle allocatif et redistributif, surtout lorsqu’elle a atteint un tel poids financier comme aujourd’hui. Mais pour assumer cela, il faut revenir sur ce qu’est la Banque centrale et ne pas la mélanger avec d’autres institutions de l’intervention de la puissance publique dans les domaines financiers.
J’insiste beaucoup sur cela dans mon livre : si nous voulons penser la coordination des banques centrales avec d’autres politiques publiques, il faut d’abord bien délimiter le rôle des premières. Qu’est-ce que la puissance financière de l’État dans l’économie ? C’est trois types d’institutions : le Trésor avec la politique budgétaire, les banques publiques d’investissement qui sont vraiment le bras financier armé de l’État, et les banques centrales pour la stabilité monétaire. Donc il ne faut surtout pas commencer à mélanger ces institutions et à faire faire de la politique budgétaire à la banque centrale, ou alors prendre la BCE comme une banque d’investissement. Il faut distinguer ces trois institutions pour penser leur coordination.
Mais penser leur coordination, c’est aussi reconnaître que, parfois, les actions d’une ont des effets sur les autres.
Vous insistez beaucoup sur la dimension assurantielle de la politique monétaire. Mais est-ce que, dans un univers de capitalisme financier, ce rôle assurantiel ne revient pas à faire jouer à la Banque centrale un rôle de protection du système financier, de ses actionnaires et de ses créditeurs. Donc ce que vous décrivez comme la protection d’un bien public, c’est-à-dire la stabilité financière, est aussi et peut-être surtout la protection d’un actif privé : celui des rentiers, des actionnaires et des créditeurs du système financier. Comment fait-on cette distinction entre le besoin de stabilité financière et le risque d’une protection illimitée d’un système financier et de ceux qui en tirent le plus de profit ?
C’est une question fondamentale qui devrait être au centre des institutions démocratiques. On ne peut pas laisser cette question à la Banque centrale elle-même car ce n’est pas elle qui va nous expliquer qui elle décide d’aider ou non sans que nous ayons un débat sur cela. On devrait discuter par exemple de la légitimité et de l’efficacité de prêter aux banques à des taux inférieurs au taux auquel les dépôts de ces dernières sont rémunérés à la banque centrale, ce qui correspond à une subvention. Nous ne pouvons pas faire sans la fonction assurantielle de la banque centrale : c’est son rôle de porter assurance au système financier – et donc à l’État – dans son ensemble.
Le problème, c’est que le système financier a changé. Nous sommes passés d’un système financier très régulé par l’État, où l’on évitait que le système financier puisse faire des gains privés trop importants, à un système dérégulé. Le système financier régulé limitait, d’une certaine manière, l’augmentation du prix des actifs, et donc des gains non seulement des acteurs du système financier eux-mêmes mais également des patrimoines individuels. Cela renvoie finalement à la question de « quel système financier veut-on ? ».
Je déplace un peu le débat parce que la Banque centrale est là dans son rôle d’assurer le maintien de la stabilité financière et du système monétaire. Ce n’est pas à elle de décider quelle forme doit prendre le système financier. Du point de vue de l’action de banque centrale, se pose d’une part la question des conditions qui doivent être imposées au système financier en échange de l’assurance fournie, et, d’autre part, la question des instruments de politique monétaire à choisir pour minimiser des effets sociaux et économiques contradictoires avec les objectifs d’autres politiques gouvernementales. La banque centrale mène des opérations financières pour stabiliser le système financier et le niveau des prix. Mais, conditionnellement à ces objectifs, la forme de ces opérations est-elle la plus appropriée ? Pourrait-on atteindre les mêmes effets sans augmenter autant le prix des actifs – et donc les inégalités de patrimoine -, sans favoriser tel type d’institutions financières par rapport à d’autres, sans favoriser telles activités polluantes, sans pousser les gouvernements à s’endetter plutôt que d’augmenter les impôts ou réduire les dépenses ? La banque centrale ne sort-elle pas de son champ de compétence et est-elle l’institution la plus appropriée pour mener telle ou telle politique ? Ce sont des questions techniques mais démocratiques qui ne doivent pas seulement avoir lieu au sein de la Banque centrale mais au sein de la société et au Parlement.

