Conquérir la paix, une conversation avec Stella Ghervas
Dans ce long entretien, Stella Ghervas revient sur ses hypothèses, ses méthodes de travail, et la spécificité disciplinaire d’une approche historique de la paix en Europe. Alors que son ouvrage se termine à l’époque contemporaine, sa perspective historique sur la paix résonne forcément, au moment où la guerre apparaît en pleine mutation pendant que les organisations internationales qui ont émergé après la Seconde Guerre mondiale paraissent toujours plus impuissantes.
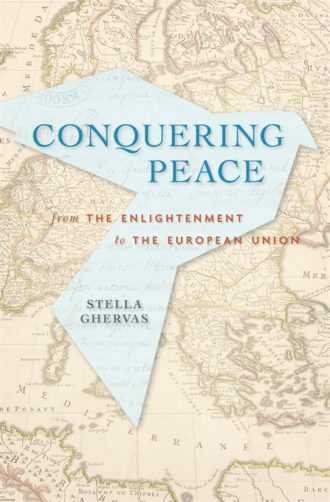
Stella Ghervas est professeure d’histoire à l’Université de Newcastle. Spécialiste de l’Europe moderne et contemporaine, ses travaux explorent l’histoire diplomatique et intellectuelle du continent. Elle lie l’analyse des grands actes diplomatiques à leur contexte philosophique d’émergence. Nous l’avons interrogée à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Conquering Peace : From the Enlightenment to the European Union (Harvard University Press, 2021).
Dans ce livre ambitieux, Stella Ghervas s’attaque à un sujet paradoxalement peu traité dans l’histoire de l’Europe : la paix. Alors même que le syntagme, « l’Europe c’est la paix », a souvent été utilisé dans le champ médiatique comme une justification (que d’aucuns pourraient qualifier d’a-minima) de l’existence de l’Union européenne, la majorité des histoires du continent se concentre sur son passé guerrier. Dans Conquering Peace : From the Enlightenment to the European Union, Stella Ghervas prend le contrepied de cette approche en faisant une histoire au long-cours de la paix en Europe, du début du XVIIIe siècle à nos jours. Entre ces bornes chronologiques, elle illustre comment la paix est devenue une notion constitutive de l’idée européenne. Pour cela, elle renverse la perspective de nombre d’ouvrages consacrés aux conflits européens, dans lesquels la paix, et sa négociation, sont souvent réduits à la fonction de codicille en fin d’ouvrage. En croisant les œuvres de penseurs ayant réfléchi à la paix, les archives diplomatiques, celles des négociateurs, elle s’attache à la fois à montrer l’évolution d’un concept et ses appropriations multiples par ceux qui cherchent à la faire.
Stella Ghervas décrit aussi comment les différents projets de paix (perpétuelle ou universelle) sont relus au fil du temps, donnant lieu à de nouvelles interprétations qui, à leur tour, viennent nourrir l’action diplomatique. De ce fait, elle fait un passionnant travail de généalogie, incarné dans cinq « esprits » européens de la paix qu’elle décrit, et par lesquels on voit évoluer le concept.
Pourquoi un livre sur la paix et l’Europe ? Quel a été votre point de départ ?
C’est le prisme historique de la paix politique. D’innombrables ouvrages ont mis l’accent sur les périodes de guerre sur le Vieux Continent, notamment pour raconter la gloire passée des empires, les faits et gestes des généraux, les grandes batailles. Et il y a une bonne raison à cela : aussi loin que l’on remonte dans son histoire, l’Europe a eu un passé violent. Après tout, les deux Guerres mondiales ont commencé sur ce continent. De plus, les histoires et les biographies de commandants militaires se vendent extrêmement bien comme l’illustre par exemple le bicentenaire de la mort de Napoléon en France.
Le sujet de la paix ne m’est pas venu par hasard : en faisant une revue des valeurs contenues dans les traités fondateurs de l’Union européenne j’avais été frappée par le fait que de toutes, la paix était de loin la plus importante. Et je me suis donc demandé pourquoi. La réponse n’était pas évidente. Pour y répondre il m’a fallu revenir en arrière de plusieurs siècles ; et de fil en aiguille je suis remontée à un écrivain, l’Abbé de Saint-Pierre et son fameux Projet de paix perpétuelle publié en 1713, l’année de la Paix d’Utrecht. On pourrait dire que ce moment constitue la naissance de l’idée politique moderne de l’Europe. Il y avait bien entendu eu une période de gestation qui avait commencé au lendemain du traité de Westphalie de 1648 (qui est plutôt une clôture de l’époque précédente). Et ensuite j’ai retracé les pas des philosophes, des diplomates et des chefs d’État jusqu’à nos jours.
Le sujet de la paix ne m’est pas venu par hasard : en faisant une revue des valeurs contenues dans les traités fondateurs de l’Union européenne j’avais été frappée par le fait que de toutes, la paix était de loin la plus importante.
Stella Ghervas
Mon livre présente un autre genre d’histoire, en contrepoint : j’ai décidé de me concentrer sur cinq périodes de paix après une grande guerre, après qu’un Empire eut tenté de conquérir toute l’Europe… et échoué lamentablement. Ainsi, au lieu de considérer les déclarations de guerre, ou les moments de commotion maximale, j’ai considéré que nos jalons devaient être les moments de calme relatif qui ont suivi : la naissance de la paix. De plus, une telle approche est loin d’être aussi ennuyeuse qu’il n’y paraît. En fait, les conférences de paix sont des histoires à suspense et rebondissements, dignes d’Alexandre Dumas ou de Gaston Leroux.
Il y a donc une façon autre d’approcher le temps long de l’Europe : l’histoire d’après le cessez-le-feu, ce moment surréel et poignant, où le silence remplace soudain le fracas des armes et on entend à nouveau les oiseaux. C’est un récit de comment on parvient à reconstruire un ordre international, et parfois même rebâtir une nouvelle civilisation, sur les décombres du passé. C’est ce que j’appelle « Conquérir la paix ».
J’examine ainsi cinq moments-clés, chacun avec son propre « esprit », qui ont eu lieu peu après de grands bouleversements géopolitiques de l’histoire européenne, où le continent venait d’échapper à la menace imminente d’un empire pan-européen : la tentative de Louis XIV d’atteindre l’hégémonie européenne (1701-1714) ; Napoléon et l’Empire français (1799-1815) ; les empires allemands pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918) et la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) ; et l’hégémonie soviétique sur la moitié orientale de l’Europe pendant la guerre froide (1947-1991).
En somme, mon livre est une fresque historique sur la paix et le rétablissement de l’équilibre politique en Europe au cours des trois derniers siècles, avec une perspective qui s’étend de l’Atlantique à l’Oural, et du Cap Nord au détroit de Sicile – ce qui inclut la Russie et l’Anatolie. C’est cette perspective que j’appelle « L’Europe élargie » dans l’espace et dans le temps.
Avant de travailler sur la construction de la paix en Europe, vous aviez travaillé sur une histoire de l’Europe du Congrès de Vienne. Pourriez-vous revenir sur ce projet de recherche ?
Mes recherches antérieures avaient en effet porté sur la pensée politique de l’Europe post-napoléonienne, et sur le nouvel ordre qui émergea durant le Congrès de Vienne. J’avais publié un livre, Réinventer la tradition : Alexandre Stourdza et l’Europe de la Sainte-Alliance, qui suivait cette évolution à travers le regard et l’interprétation d’un intellectuel est-européen, Alexandre Stourdza, diplomate et écrivain au service du tsar Alexandre Ier1.
Pour prendre le contrepied de l’approche des sciences politiques – qui tend à jeter un regard d’aujourd’hui sur les événements du passé – j’avais voulu me concentrer sur l’interprétation des événements qui avaient mené à la chute de Napoléon, et ensuite à la création d’un nouvel ordre en Europe, tels qu’ils avaient été vécus et interprétés par les témoins oculaires de ces événements. C’était donc de l’histoire intellectuelle, qui se voulait soigneusement attentive au contexte et à comprendre les schémas de pensée des différents acteurs.
Une des questions que j’avais voulu examiner à l’époque était le processus intellectuel par lequel les dirigeants et les diplomates avaient réinventé l’ordre européen au Congrès de Vienne et par quels raisonnements ils étaient parvenus à établir une paix durable après une longue période de guerres en Europe. Par nécessité liée à ce moment de l’histoire j’avais dû inclure la Russie et l’Empire ottoman dans le tableau. Ce n’était pas négociable, car la géostratégie de l’Europe l’exigeait, ne serait-ce que pour traiter de la Question d’Orient, c’est-à-dire essentiellement la mer Noire et les Détroits.
Peut-on considérer la Sainte-Alliance comme un projet chrétien et contre-révolutionnaire de paix perpétuelle ?
Oui et non. J’ai voulu décortiquer et analyser sérieusement ce traité signé en 1815, que beaucoup d’historiens ont considéré à tort comme un OVNI diplomatique. C’est vrai que si on le lit d’un point de vue qui serait celui du monde d’après 1945, voire de l’immédiateté politique comme c’est fréquent aujourd’hui, il paraît incompréhensible. Mais si on prend la peine de l’approfondir en le replaçant dans les enjeux intellectuels, politiques et diplomatiques de l’époque, il prend soudain tout son sens. Je consacre une section importante sur ce sujet dans le chapitre II de Conquering Peace.
Donc je répondrais oui à votre question, mais uniquement à condition de replacer les événements dans leur contexte et dans l’ordre correct. C’est parce que ce traité s’inscrivait dans le prolongement de projets de paix perpétuelle du dix-huitième siècle, que son auteur, le tsar Alexandre Ier avait voulu mettre un point final à la période révolutionnaire et aux guerres napoléoniennes, afin d’assurer une base pérenne à la paix en Europe. Même si cela paraît contre-intuitif, la Sainte-Alliance est un texte qui plonge ses racines profondes dans les Lumières. Comme la plupart de leurs contemporains, les souverains européens et les diplomates de 1815 s’étaient abreuvés à ces sources philosophiques. Ils savaient que l’Ancien Régime était bien mort et rejetaient toute velléité de le rétablir ; pour preuve, ils firent en sorte que la France soit dotée d’une charte constitutionnelle. Quant au chancelier autrichien Metternich et aux diplomates prussiens, c’étaient des disciples d’Emmanuel Kant.
Mais pour l’aspect chrétien, il nous faut faire attention, car la rhétorique religieuse n’était qu’un habit de cérémonie pour le peuple : l’idéologie illuministe qui sous-tendait la Sainte-Alliance n’avait pas grand-chose à voir avec la religion qui se pratiquait le dimanche à l’église. Aujourd’hui on ne perçoit plus qu’il y avait quelque chose de profanatoire, dans ce texte œcuménique qui mettait les trois branches chrétiennes (le catholicisme, le protestantisme et l’orthodoxie) sur un pied d’égalité. Nombre de penseurs catholiques comme Joseph de Maistre en avaient été fous de rage car en renversant l’alliance du trône et de l’autel qui s’était établie en Occident depuis Charlemagne, ce document ouvrait porte en grand au droit international moderne : la Sainte-Alliance était du vitriol jeté à la figure du pape. C’était d’ailleurs un affront prémédité, de la part de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse, pour le remettre à sa place, en quelque sorte, en lui signifiant qu’il ne serait plus qu’un souverain italien.
Ainsi malgré tout le mal que Metternich a dit de la Sainte-Alliance dans ses mémoires, il est évident qu’il s’en est frotté les mains. D’ailleurs, nous savons grâce aux archives qu’il avait pris une part active à sa mise au point ! Ce texte n’était pas tant un acte d’idéalisme, qu’un acte de refondation radicale de l’idée de l’Europe.
Enfin pour son aspect contre-révolutionnaire, ou plus précisément anti-démocratique : bien entendu. Quasiment toutes les mouvances politiques, des plus conservatrices aux plus progressistes s’accordaient sur un point : il fallait éviter à tout prix de répéter les excès de la Révolution française qui s’étaient matérialisés sous la Terreur avec la mise à mort du roi, les violences arbitraires et les exécutions de masse. En 1815, il n’y avait quasiment plus un seul révolutionnaire dans toute l’Europe, du moins comme on l’avait entendu pendant la Révolution française.
Quasiment toutes les mouvances politiques, des plus conservatrices aux plus progressistes s’accordaient sur un point : il fallait éviter à tout prix de répéter les excès de la Révolution française qui s’étaient matérialisés sous la Terreur avec la mise à mort du roi, les violences arbitraires et les exécutions de masse.
Stella Ghervas
Bien sûr, il allait y avoir bientôt de nouvelles révolutions en Europe, mais il ne faut pas s’y tromper. Elles étaient d’un esprit tout à fait différent : dans les années 1820 c’étaient des insurrections bourgeoises, voire aristocratiques, pour l’indépendance nationale, qu’on pourrait donc qualifier d’élitistes. Contrairement à 1789, il n’était plus question de donner la voix au peuple dans son ensemble, et encore moins de l’associer au pouvoir. En 1815, cette idée est morte et enterrée, – le mot « démocratie » étant devenu un vilain mot assimilé au chaos et à la violence. Et même pour les plus progressistes, ces révolutions étaient le retour triomphal de la distinction entre classes sociales.
Tout cela pour dire l’importance de l’épaisseur historique, quand on aborde l’époque du Congrès de Vienne et plus largement les événements politiques. C’est tout le problème de la science politique ainsi que la source de mes désaccords avec certains de mes collègues. Si l’on fait de la science politique sans utiliser en même temps les méthodes de l’histoire intellectuelle, on risque de fabriquer des objets politiques atemporels, distillés et donc trop volatiles, qui n’ont d’existence que l’espace d’un livre.
Le titre de votre livre est un apparent paradoxe : comment peut-on conquérir la paix ?
En effet, c’est la thèse de philosophie politique qui est centrale à mon livre : que la guerre devient une nécessité pour les États ou les chefs politiques en situation de faiblesse morale, alors que la paix est un luxe que seuls les forts (sur le plan moral autant que politique) peuvent s’offrir. Le titre que vous citez en est une application directe. C’est une référence à une pièce de Shakespeare (Henri IV, deuxième partie) : « La nature de la paix est celle d’une conquête. Car les deux parties se soumettent noblement et aucune n’est perdante. » La conduite de la guerre — il suffit de lire Sun-Tzu — est fondée sur la supercherie ; faire la guerre c’est mentir, et le mensonge politique est une forme de guerre. Pour parvenir à signer une paix après une guerre, il faut se décider à sortir de cet état d’esprit et commencer à parler vrai. Pour y parvenir, il faut avant tout faire acte de confiance en soi et en la contrepartie. La sincérité n’est pas pour les esprits inquiets et faibles.
En une phrase, Shakespeare avait capturé l’essence de la négociation diplomatique après une guerre, au sens le plus élevé du terme. Deux États qui négocient un traité de paix doivent avant tout se faire violence à eux-mêmes pour renoncer à la violence. Déposer les armes est un acte difficile car contraire à la pente naturelle, surtout après plusieurs années de guerre où il y a une telle accumulation de rancœur. Mais s’ils y parviennent, ils seront parvenus à la fois à sauver la face et s’assurer un avenir plus serein.
C’est vrai qu’on ne risque pas de se faire tuer quand on s’assied face à son ancien adversaire. Mais si on se trompe par malheur, des centaines de milliers de personnes en souffriront pendant des décennies. C’est une responsabilité qui pèse très lourdement sur les épaules des négociateurs. Et quand on arrive enfin à la signature et que le résultat est satisfaisant, c’est un immense soulagement. Le malheur est que le résultat n’est pas toujours à la hauteur, comme dans le cas du Traité de Versailles en 1919.
C’est pourquoi je conclus le livre en remarquant qu’il y a eu quelque chose de véritablement héroïque chez certains participants à une conférence de paix. La plupart l’ont vécue comme une expérience initiatique qui les a laissés transformés.
Votre histoire de la paix en Europe embrasse une vaste chronologie, qui s’étend sur presque trois siècles, de 1713 à la fin du XXe siècle. Quelles sont les lignes de continuité et, en creux, les grandes ruptures que vous avez identifiées ?
Je vais commencer par les ruptures, parce que ce sont elles qui déterminent le début de chaque épisode : chaque grande guerre continentale en Europe a été un moment de chaos terrifiant. Les deux Guerres mondiales ont ceci de commun avec les guerres napoléoniennes ainsi que la guerre de Succession d’Espagne au début du XVIIIe siècle, que les contemporains avaient eu le sentiment d’une immense catastrophe qui remettait en cause plus que l’ordre politique du continent européen. L’idée dominante – je dirais même l’angoisse dominante – était que le monde avait été tellement bouleversé qu’il ne serait plus jamais le même.
Ces périodes de l’après-guerre immédiat ont bien été plus qu’une redéfinition des frontières des États et des rapports entre ces États : c’est tout l’imaginaire de la politique européenne (au sens des représentations socialement partagées) qui s’est retrouvé complètement redéfini. Une conférence de paix, dans ces conditions, est une genèse au sens biblique : c’est un nouvel univers mental qui se crée en l’espace de quelques semaines et qui, en se développant, va encadrer la vie de tous les Européens pendant des décennies. C’est l’invention et la mise au point de la nouvelle normalité quotidienne à l’échelle d’un continent.
Ces périodes de l’après-guerre immédiat ont bien été plus qu’une redéfinition des frontières des États et des rapports entre ces États : c’est tout l’imaginaire de la politique européenne (au sens des représentations socialement partagées) qui s’est retrouvé complètement redéfini.
Stella Ghervas
Évidemment, les enjeux sont colossaux ! Cela nous ramène au thème développé par Léon Tolstoï dans son roman Guerre et Paix : celui de la frêle barque des gouvernants sur l’océan déchaîné des événements. Voilà ce qu’est une guerre continentale comme à la période napoléonienne : c’est un immense événement qui remet en cause tout votre univers mental et amène sa destruction.
Pour mieux me faire comprendre je vais utiliser l’image de l’ingénieur civil : conclure un traité de paix dans ces conditions, c’est un peu comme revenir aux décombres de la maison commune après un tremblement de terre de très grande magnitude. Il faut vaincre le découragement et penser à reconstruire, si possible mieux ; en tout cas plus solide. Quand vous voulez créer un nouvel ordre politique après une telle catastrophe, votre préoccupation est de faire de l’architecture antisismique. C’est ce que j’ai appelé dans mon livre l’ingénierie de la paix.
On a dit que l’histoire de l’Europe a été une histoire de conflits et de guerres pas seulement pendant quelques années, mais pendant des siècles. Et quand c’est la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième et même la cinquième fois que cela se reproduit, eh bien vous commencez à créer, subjectivement, un fil d’Ariane dans votre tête. Quand vous êtes un ingénieur de la paix européenne, vous allez chercher les anciens projets de paix européenne élaborés par vos prédécesseurs. S’ils ont vu le jour, vous vous demandez pourquoi ils n’ont pas été adéquats. Pourquoi les murs se sont effondrés lors du dernier séisme ? Quelles erreurs ont été commises ? Comment pourrait-on les éviter à l’avenir ? Et s’ils étaient restés sur le papier, est-ce que cela ne serait pas une occasion toute trouvée pour les mettre en œuvre ? Ou, au moins, pour s’en inspirer ?
Ce fil d’Ariane, ténu mais incassable, que l’on retrouve dans ces périodes post-apocalyptiques de l’histoire européenne est une grande tradition qui remonte au dix-huitième siècle : aux projets de paix perpétuelle de l’abbé de Saint-Pierre à Rousseau et à Kant. Le but de mon livre a été de le dérouler à nouveau, pour le bénéfice des lecteurs de notre époque.
Vous arguez que l’Union européenne serait l’aboutissement d’un processus intellectuel et diplomatique de pacification du continent engagé au XVIIIe siècle. Pourriez-vous l’expliquer ? Comment expliquer cette spécificité européenne ?
Oui, avec cette réserve que je n’aime pas le terme « aboutissement », qui donne l’idée que l’histoire européenne irait dans une direction précise. En elle-même, l’histoire européenne est tellement chaotique qu’on peut affirmer qu’elle ne va nulle part de précis. C’est la proverbiale mer qui se déchaîne occasionnellement, même si elle s’est assez aplatie récemment avec l’Union européenne. Je continue à dire qu’il n’y a pas de destinée manifeste dans l’histoire de ce continent, et qu’à moins de disposer d’une boule de cristal, il est impossible de savoir de quoi sera fait le lendemain.
Je fais donc une distinction claire entre l’Idée de l’Europe (dans le sens politique) et l’histoire de l’Europe, et notamment son dernier avatar, l’Union européenne. L’Idée de l’Europe, quant à elle, est un vecteur qui va dans une direction bien déterminée : celle de l’unité politique du continent. Elle est ancienne et remonte au moins au XVe siècle, à l’époque de Machiavel. Mais, comme je l’ai déjà évoqué, sa définition politique ne prend une forme claire qu’au début du XVIIIe siècle avec les réflexions de philosophes et de diplomates, tels que William Penn et l’abbé de Saint-Pierre.
Le but que poursuit l’Idée de l’Europe est la coexistence pacifique des États européens souverains sur un pied d’égalité. Le problème que les projets de paix perpétuelle essaient de résoudre depuis des siècles est la succession interminable des guerres entre États. Ainsi j’ai pu rassembler plus d’une centaine de projets de paix perpétuelle écrits entre la fin du XVIIe et le début du XXe siècle. Tout le monde a réfléchi, à sa manière, sur ce qu’il croyait être la meilleure solution, avec un consensus qui a émergé : il fallait signer une alliance de paix, pour fonder une société de pays européens civilisés tenue par contrat social, où chaque État particulier devrait se sentir responsable de la stabilité de l’ensemble parce que c’est dans son intérêt. Pour utiliser une image chère aux philosophes du XVII et du XVIIIe siècles, on passe de l’état de nature à un état de société civile, avec ses mœurs et ses règles de fonctionnement. Mais au lieu de réunir des personnes physiques, la société européenne réunit des personnes morales, des États civilisés. C’est ce qu’Emmanuel Kant voulait dire quand il écrivait que l’état de paix devait être institué par un contrat d’alliance.
L’histoire quant à elle est aveugle, elle ne suit aucune direction précise. L’Union européenne n’est qu’une parmi plusieurs tentatives successives de matérialiser cette vieille Idée de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles se signe le Traité de Maastricht en 1992, à la suite de la chute du Bloc de l’Est, de la réunification de l’Allemagne, et de l’effondrement soudain de l’Union soviétique, sont exceptionnelles et accidentelles. C’est le moins qu’on puisse dire. L’UE est une institution et les institutions ne sont pas éternelles. Il est parfaitement possible qu’elle se désagrège un jour. Ce serait sans doute une mauvaise nouvelle pour la paix européenne, mais il ne faudrait pas craindre pour l’Idée de l’Europe : elle a bien survécu à deux guerres mondiales et à l’hégémonie de l’Armée rouge sur la moitié de l’Europe qui a duré cinquante ans.
Alors qu’un ordre européen est une réalité fragile et forcément temporaire, il est très difficile de tuer une idée. Et c’est bien dans ce fait que se trouve toute la puissance de l’Idée de l’Europe. Si la maison commune s’effondrait à nouveau, cela remettrait en cause la volonté des acteurs ou leurs moyens, mais en aucun cas l’Idée de l’Europe. Comme l’avait si bien exprimé Robert Schuman, les Européens apprendraient de leurs erreurs et feraient mieux la prochaine fois, à condition toutefois de ne pas complètement succomber. Car avec les évolutions technologiques, chaque nouvelle guerre continentale est invariablement plus meurtrière et dangereuse que la précédente. La construction de l’Europe est donc confrontée à une compétition constante entre la volonté politique de survivre (la paix) et les instincts de destruction (la guerre).
« La construction de l’Europe est donc confrontée à une compétition constante entre la volonté politique de survivre (la paix) et les instincts de destruction (la guerre). »
Stella Ghervas
Pour David Bell, les guerres de la Révolution et de l’Empire marquent une rupture — c’est la première guerre « totale ». Que pensez-vous de cette analyse ? Cela transforme-t-il la manière dont on cherche à faire la paix en 1815 ?
David Bell fait une observation judicieuse, quoique je serais un tout petit peu prudente avec ce terme « guerre totale » — vous commencez à comprendre ma passion pour la définition des termes. Dans mon esprit, la guerre totale au sens littéral est apparue dans le contexte de la Première Guerre mondiale. C’est alors qu’elle prend son sens, parce que la Révolution industrielle est passée par là. Pourquoi ? Parce que Berlin et Londres ne sont plus qu’à quelques heures l’une de l’autre par la voie des airs (par dirigeable ou par avion). Et donc Paris et Londres qui sont régulièrement bombardées dès 1914, sont elles-mêmes devenues des champs de bataille. L’essence de la guerre totale c’est cela : c’est la mort soudaine qui vient du ciel. Une petite fille qui marche dans la rue au même titre qu’un ouvrier qui produit des canons ou des obus dans une usine d’armement, voire un paysan qui produit des vivres pour approvisionner l’armée, deviennent désormais des combattants qui risquent leur vie, jour après jour. Et désormais, pour aller au front, il suffit de sauter dans un taxi à Paris et vous y êtes en quelques heures. Si la chaîne de logistique s’arrête même pour quelques heures, tout le front risque de s’effondrer. La guerre totale se manifeste essentiellement à travers les canons à longue portée, le bombardement aérien stratégique et, dès 1944, les missiles.
Je suis en revanche d’accord pour dire que d’une certaine façon on voit les germes de ce mouvement à l’époque de Napoléon, par la mobilisation des armées de masse, l’importance des moyens matériels investis dans la guerre, et la dimension des événements qui est véritablement continentale. À la réserve près qu’on est encore à une époque préindustrielle : les canons avaient une portée limitée de deux kilomètres au plus. On en était encore aux fusils qui ne tirent qu’un coup et qu’il faut du temps pour recharger, raison pour laquelle on alignait les soldats en rang serrés ! En tant que voyageur, vous pouviez encore traverser toute l’Europe sans prendre trop de risques, à condition de ne pas croiser le chemin d’une armée en campagne ou de vous trouver à proximité d’un champ de bataille. Un siècle plus tard, c’était devenu entièrement impossible à cause des lignes de front. Plus le temps passe et plus l’espace géographique de l’Europe se rétrécit.
Quant à savoir si le changement de la nature de la guerre a vraiment changé la façon de faire la paix en 1815, je n’en suis pas convaincue. La perception des contemporains avait certes été celle d’une apocalypse. Toutefois, ce n’était pas tant la cruauté ou la dimension des batailles qui avait choqué les contemporains, mais les victoires spectaculaires des armées révolutionnaires et notamment celles que dirigea Napoléon (qu’ils plaçaient volontiers dans le rôle de l’Antéchrist). Les puissances victorieuses s’étaient rendu compte que l’ancien ordre politique de l’Europe basé sur l’équilibre des puissances avait été submergé par une seule puissance, la France. En soi, cela ne remettait pas en cause l’équilibre des puissances en tant qu’outil nécessaire à gagner une grande guerre. Mais cela les a obligées à concevoir de nouvelles façons de s’associer dans la construction de la paix : d’où la création de cette alliance de paix entre les grandes puissances, la création des commissions internationales, et la naissance du Système des Congrès – qui est le lointain ancêtre du Conseil de sécurité de l’ONU.
Plus le temps passe et plus l’espace géographique de l’Europe se rétrécit.
Stella Ghervas
Vous parlez de l’Esprit de Genève, qui se manifeste avec la Société des Nations dès 1920. En quoi se distingue-t-il de celui de Vienne, ou de Versailles, et des autres qui l’ont précédé ?
En effet mon livre a été organisé autour de cinq « Esprits européens » qui se sont constitués après de grandes guerres et après qu’un empire à l’échelle du continent ait échoué lamentablement : l’Esprit des Lumières, l’Esprit de Vienne (de 1815), l’Esprit de Genève d’après la Première guerre mondiale, l’Esprit européen de l’après-guerre, et enfin l’Esprit de l’Europe élargie qui a suivi l’effondrement du bloc communiste. Chacun des cinq esprits a ses caractéristiques propres, liées à sa propre époque et à son propre lieu. Celui de Genève est particulier parce qu’il n’est pas sur le terrain des grandes puissances européennes. Ce qui est significatif est que Genève est un anti-choix du lieu : c’est la sélection intentionnelle de l’endroit le moins adapté de toute l’Europe pour y placer le siège d’une alliance de paix, en tout cas pour les critères qui avaient prévalu jusque-là. Et paradoxalement, c’est la modestie même de Genève, voire son provincialisme, qui lui a conféré sa dimension globale et son statut de symbole universel pour tous les peuples de la terre.
Il faut consacrer quelques mots à ce choix, qui a profondément influencé l’Esprit qui a émergé. Le Président Wilson a joué un rôle important, car il voulait un lieu consensuel qui ne puisse être associé à des schémas du passé. Il ne voulait ni Londres ni Paris, et pour cause. Berlin et Vienne étaient exclues. Et que restait-il de Bruxelles ? La population belge avait trop souffert de la guerre pour qu’une réconciliation avec l’Allemagne soit envisageable à court terme. Restaient les Pays-Bas et la Suisse, deux pays neutres. La Haye aurait pu être un candidat crédible. Mais ce sont les convictions républicaines de Wilson qui ont prévalu : il ne voulait pas que « son » alliance pacifique fût placée sur les marches d’un trône. Alors c’est la Suisse et finalement Genève qui a prévalu.
Et donc, c’est l’esprit de ce lieu qui s’est imposé. On oublie volontiers combien cette petite ville était alors inadéquate à sa tâche, et combien les premières années de la Ligue ont été une improvisation. Genève n’avait même pas un centre de congrès pour accueillir l’Assemblée de la Société des nations, qui avait investi une salle religieuse protestante, parce que c’est tout ce qu’il y avait à disposition. De même, son Secrétariat s’était installé dans un petit hôtel provincial à côté. Autant l’Esprit de Vienne d’après 1815 avait été brillant et aristocratique, autant celui de Genève n’était même pas bourgeois : il était populaire. Encore aujourd’hui, on croise des grands de ce monde dans la rue ou au café à Genève comme s’ils étaient vos voisins. Chacun est chez soi et tout le monde se tolère, mais sans se déranger mutuellement.
Ce qui rend l’Esprit de Genève exceptionnel, c’est la rupture brutale, presque traumatique, avec l’idée que la politique internationale était l’apanage des grandes puissances impériales. Malheureusement cela n’a été qu’une parenthèse, car l’ONU a pour ainsi dire remis les petits États à leur place dès 1945, en réduisant l’Assemblée à un rôle de corps consultatif et en donnant pouvoir de vie et de mort aux membres du Conseil de sécurité sur leurs voisins grâce à leur droit de véto. Un droit que l’URSS de Staline exploita sans vergogne et sans voie de recours pour étendre sa domination sur les pays d’Europe centrale et de l’Est ; mais que les États-Unis ont finalement également exploité à nombreuses reprises par la suite.
La Société des Nations avait bien tenté (à défaut de toujours y parvenir) d’apporter un certain égalitarisme dans la politique internationale, en pleine période coloniale. Et c’est bien Strasbourg et Bruxelles qui ont hérité de cet esprit égalitaire après la Seconde guerre mondiale, même si c’est en partie et à l’échelle réduite ; et non pas New York. Il y a une fracture nette entre l’esprit parlementaire de la Société des Nations et celui directorial de l’ONU : un divorce déchirant qui fait que la Suisse ne s’y est pas reconnue pendant des décennies. Elle n’a accepté d’en devenir membre de plein droit qu’en 2002. Mais aujourd’hui, encore, l’Esprit de Genève se sent emprisonné dans l’ONU qui lui fut imposé contre son gré, comme un fait accompli. Ce que les États-Unis avaient gracieusement offert à Genève en 1919, ils le lui ont confisqué en 1945.
Le traité de Maastricht intervient après une guerre qui, en Europe du moins, est restée sans combats. Comment fait-on la paix dans ces conditions ?
C’est vrai que la période entre 1945 et 1992 est en effet ce que certains historiens ont appelé « la longue paix » (Long Peace)2. Mais, c’est une vision partielle, vue des États-Unis ou d’Europe occidentale. En réalité, il y avait une ligne de front qui traversait l’Allemagne avec deux puissantes armées qui étaient constamment prêtes à en venir aux mains. C’est bien sûr une chance que cela ne se soit pas produit, mais appeler « paix » l’ambiance qui régnait, c’est faire preuve de beaucoup d’imagination car c’était une paix armée dans le cadre d’une « guerre froide ». Et à l’Est du Rideau de Fer, il y avait une occupation militaire par l’Armée rouge qui a duré quarante-cinq ans, avec des États-fantoches. Si on y pense bien : l’économie de la Pologne avec ses pénuries chroniques et ses rationnements était une économie de guerre. Berlin-Ouest était une enclave occidentale entourée par un mur et qui avait fait l’objet d’un blocus avec pont aérien pour être ravitaillé.
Pour plusieurs pays d’Europe de l’Est, la Seconde Guerre mondiale a commencé par une invasion non pas par l’Allemagne mais par l’Union soviétique en 1939, après le pacte Molotov-Ribbentrop. Ce fut le cas de la Finlande, des trois républiques baltes et de la Roumanie. Ainsi, pour les populations d’Europe de l’Est, il n’y avait pas vraiment de séparation entre les périodes de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Pour elles, ce n’était qu’un « va-et-vient » entre deux puissances totalitaires : le Troisième Reich et l’Union soviétique.
Sur le plan formel, l’Europe n’a pas connu une seule journée de paix pendant quarante-cinq ans après 1945. Il faut en effet relever un fait stupéfiant : il n’y eut pas de traité de paix à propos de la principale puissance vaincue, contrairement à toutes les époques précédentes. Il y a donc une date absolument capitale pour l’histoire de l’Europe : le Traité de Moscou du 12 septembre 1990. Ce traité est le règlement définitif de la question allemande après la Seconde Guerre mondiale. On l’appelle le « traité quatre plus deux », car il implique les quatre puissances alliées (les États-Unis, l’URSS, le Royaume-Uni et la France), ainsi que les deux Allemagnes (RFA et RDA). L’Allemagne était un pays (deux pays) sous tutelle étrangère. Avec ce traité de Moscou, on a enfin pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale, un état de paix en Europe, avec des États souverains. Ce traité a marqué tout autant la fin définitive de la Seconde Guerre mondiale que celle de la Guerre froide.
Certes l’Europe occidentale connut une paix durable, grâce notamment à la réconciliation franco-allemande. Il ne faudrait toutefois pas considérer les choses uniquement par le petit bout de la lorgnette : cette région du monde n’était qu’une petite oasis pacifique alors que l’Asie et l’Afrique ont connu des guerres ouvertes de façon quasiment perpétuelle. Donc appeler cela de la paix, me paraît une vision un peu idéaliste, qui a des relents d’« occidentalo-centrisme ». La réalité est que les pays membres des Communautés européennes ont vécu confinées à l’intérieur de frontières infranchissables, avec l’Atlantique à l’Ouest, la Méditerranée au Sud et le Rideau de fer à l’Est. C’était donc un environnement insulaire : ce que j’appelle « un système de paix enfermé dans un système global de guerre ».
Le traité de Maastricht de 1992 vient donc immédiatement après la fin de la Guerre froide, la chute des régimes communistes dans les pays de l’Est, la retraite de l’Armée rouge et surtout, l’effondrement de l’Union soviétique qui fut un désastre géopolitique majeur. Faire la paix dans ces conditions n’est plus du tout un acte intentionnel, prudent et pas-à-pas, comme cela avait été le cas pour la fondation des communautés européennes et la réconciliation franco-allemande dans les années 1950. Après 1989, et avec l’adhésion de l’Autriche puis des autres États de l’Est, toute l’Europe a été emportée par une vague d’événements colossale. D’une certaine façon, ses élargissements successifs ont été la course d’un attelage qui s’est emballé et que personne n’a pu arrêter. Le problème pour l’Union européenne a surtout été d’éviter de le surcharger ou de le renverser.
Dans le récit que donnent les institutions communautaires et une partie des élites européennes, la singularité de l’Europe depuis la seconde moitié du XXe siècle serait d’être en paix. Comment comprenez-vous cette représentation ? N’est-ce pas hypocrite dans la mesure où un certain nombre d’armées européennes sont toujours engagées sur de nombreux terrains d’opération hors d’Europe ?
C’est moins hypocrite que schizophrénique : c’est-à-dire que ceux qui tiennent sincèrement ce double discours de la paix et de la guerre n’ont toujours pas conscience de sa contradiction. Ce n’est pas nouveau : la conférence de Berlin de 1878 qui fut essentiellement un découpage de l’Afrique par des empires, s’est déroulée sous une rhétorique exaltée de la paix. Mais cette histoire de notre continent est faite d’êtres humains en chair et en os, avec leurs joies, leurs ambitions et leurs drames.
Pour revenir à la comparaison que vous évoquez entre la paix perpétuelle en Europe et le colonialisme européen, elle pose la question de la Règle d’Or : de ne pas faire pas à autrui ce qu’on ne voudrait pas qu’il nous fasse. C’est un thème central de mon livre.
Le message que j’aimerais toutefois faire passer est que les grandes puissances européennes ont pratiqué la destruction, l’oppression et l’esclavage contre les Européens eux-mêmes pendant des siècles, avant de l’exporter au-delà des mers. Les Européens ordinaires ont aussi été victimes de l’oppression des empires continentaux de l’Europe. L’impérialisme continental en Europe et l’impérialisme colonial sont deux faces de la même pièce.
Les Européens ordinaires ont aussi été victimes de l’oppression des empires continentaux de l’Europe. L’impérialisme continental en Europe et l’impérialisme colonial sont deux faces de la même pièce.
Stella Ghervas
Est-il possible de faire une histoire de la paix sans faire une histoire de la guerre ?
Absolument pas : la notion de guerre est nécessaire pour expliquer la paix et il faut la notion de paix pour expliquer la guerre. La définition la plus simpliste de la paix est que c’est une absence de guerre. Tous mes chapitres commencent par une guerre européenne cataclysmique, qui est le point de départ d’un processus de paix.
J’admire ceux qui veulent faire la paix par la non-violence : Gandhi fut un saint ; j’ai une grande sympathie pour le Flower Power. Mais lorsqu’un empire totalitaire en arrivait à lancer ses divisions blindées et ses bombardiers contre le reste de l’Europe il n’y avait raisonnablement plus le choix : c’est ainsi que les Polonais, les Français, les Anglais et bien d’autres ont dû prendre les armes et faire la guerre, même si cela n’a pas été de gaieté de cœur.
Et comme condition du retour à la paix, il faut saisir ce qui la distingue de la guerre ; et notamment par quels processus on glisse de l’état de paix vers l’état de guerre, et par quels processus on sort de l’état de guerre pour rétablir celui de paix. Et c’est seulement après, quand on a vraiment compris ce qu’est la guerre, ce que cela coûte en efforts matériels et en pertes humaines et combien c’est long et difficile de rétablir la paix, qu’on réalise pourquoi une philosophie politique de la paix est rentable, et a contrario pourquoi les idéologies militaristes sont le seul bien que des États instables ou économiquement en difficulté peuvent s’offrir.
On pourrait avancer une théorie selon laquelle les penseurs et les politiciens « réalistes » qui considèrent qu’un était de paix durable est impossible, sont ceux qui se considèrent au fond d’eux-mêmes incapables d’affronter une négociation de paix entre puissances, parce qu’ils sentent qu’ils n’en auraient pas la force morale. Dans mon esprit, ce manque de fermeté intellectuelle fait d’eux des utopistes de la guerre, et leur fait croire que ce serait une solution viable aux problèmes de l’humanité… alors qu’elle a souvent apporté beaucoup de malheur en regard des bénéfices escomptés.
Depuis un demi-siècle, la guerre évolue et se transforme. Comment faire la paix dans un monde de guerre en grappe — c’est-à-dire de guerres diffuses dans lesquelles se multiplient les acteurs ?
Le drame ne date pas d’aujourd’hui. Il a commencé à Yalta dans l’hiver 1945, quand le rêve de paix mondiale du Président Roosevelt a volé en éclat face à Joseph Staline.
Comme alliance de paix universelle, l’ONU était morte-née. L’Assemblée générale n’a jamais pu pleinement exercer ses prérogatives. Le Conseil de sécurité n’a jamais été qu’un directoire de grandes puissances comme le Système des congrès qui avait gouverné l’Europe de 1815 à 1822, et qui avait montré ces limites. En effet, un tel système ne fait que rétablir la paix après un conflit. Il ne peut la maintenir longtemps, car il assure l’immunité juridique aux membres du directoire ; inévitablement, ceux-ci commettront des abus qui finiront par les dresser entre eux, en compromettant la paix.
La faute des guerres régionales ne revient pas forcément aux pays périphériques. On pourrait aussi bien la trouver au beau milieu de New York, sur l’Île Roosevelt, au QG de l’ONU. Ce n’est pas nouveau. Au début des années 1820, les grandes puissances européennes avaient envoyé leurs armées tirer sur les populations du continent qui voulaient plus de liberté et de droits. Et la cause de la mort de la Société des Nations à la fin des années 1930, doit avant tout être recherchée dans la trahison des grandes puissances. Les vrais coupables furent dans l’ordre : l’Allemagne, puis le Japon, puis l’Angleterre, la France et l’Union soviétique, n’est-ce pas ? Est qu’avaient ces pays en commun ? D’être les membres du Conseil, les Gardiens de la Société des Nations.
Les choses ont-elles fondamentalement changé avec le Conseil de sécurité de l’ONU ?
Entre histoire diplomatique et histoire des idées, pourriez-vous revenir sur les sources que vous avez mobilisées ? Comment les avez-vous croisées ? Ne craignez-vous pas que l’on vous reproche de faire une histoire de la paix « par en haut », principalement centrée sur les chefs d’État, leurs conseillers et des grandes figures intellectuelles ?
Les traités après les guerres sont généralement signés par les plénipotentiaires d’États. Mais cela ne veut pas dire que la société civile n’ait eu aucune influence sur le processus de paix. Le quatrième chapitre de mon livre traite du rôle des sociétés de la paix au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la fondation du Conseil de l’Europe. Le cinquième chapitre parle d’une « révolution par le bas » : l’Automne des peuples de 1989 contre l’hégémonie de l’Union soviétique en Europe de l’Est. Un siècle auparavant, en 1848, les peuples d’Europe essayèrent vainement et maladroitement de se libérer au moment du Printemps des peuples. Et chaque conférence de paix après une grande guerre, fut un moment intensément humain. On peut certes écrire des récits qui racontent les entreprises de Louis XIV ou de Napoléon. Mais on peut aussi raconter celle des ingénieurs de la paix, comme celles du tsar Alexandre Ier, de Woodrow Wilson, de Robert Schuman ou de Mikhaïl Gorbatchev, comme je l’ai fait.
On pourrait argumenter que la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950 fut, au niveau de l’humanité, une victoire française plus éclatante et durable qu’Austerlitz et Iéna. Schuman a réussi à faire l’Europe alors que Napoléon a misérablement échoué et laissé la France à terre. À la fin, c’est le résultat qui compte : l’Union européenne qui a suivi les Communautés européennes est une institution qui existe de façon stable depuis soixante-quinze ans. Et pendant ce temps, les rêves impériaux de Louis XIV, de Napoléon ou du Kaiser Guillaume II, prennent la poussière dans les musées. Cela méritait d’être relevé.
À la fin, c’est le résultat qui compte : l’Union européenne qui a suivi les Communautés européennes est une institution qui existe de façon stable depuis soixante-quinze ans. Et pendant ce temps, les rêves impériaux de Louis XIV, de Napoléon ou du Kaiser Guillaume II, prennent la poussière dans les musées. Cela méritait d’être relevé.
Stella Ghervas
Vous travaillez actuellement sur la mer Noire comme un espace d’échange culturel et politique, mais aussi comme foyer de conflits continuels. Comment cette nouvelle enquête s’articule-t-elle à vos travaux précédents ?
J’ai plutôt repris ce projet qui date depuis le tout début de mes recherches sur l’Europe : comme on revient toujours à ses anciennes amours. C’est simple : la paix et l’Europe, l’Europe et la paix. L’« Europe élargie » de mon livre que j’ai mentionné en début de notre entretien, peut être représenté dans l’espace comme un triangle, avec trois points : Paris ou Londres, Moscou ou Saint-Pétersbourg et Constantinople ou Istanbul selon les époques historiques.
La mer Noire a longtemps été tournée vers Constantinople (aujourd’hui Istanbul), la Ville par excellence. Cette région a été une zone grise, exclue de la paix européenne parce que l’Empire ottoman n’avait pas été inclus dans les règlements territoriaux du Congrès de Vienne de 1815. À l’époque on appelait cela la Question d’Orient. C’est la guerre de Crimée (1853-1856), en mer Noire, qui avait mis fin à l’Alliance de l’époque post-napoléonienne entre les grandes puissances en Europe.
Cela pose la question du voisinage de l’Europe, et de la politique de l’Union européenne sur ses marges orientales. La Question d’Orient est plus présente que jamais, avec le chaos politique qui règne toujours en mer Noire et au Moyen-Orient : que l’on cite l’Ukraine avec la Crimée et le Donbass, la Moldavie avec la Transnistrie, ainsi que la Grèce et la Turquie avec Chypre. Et plus loin : la Géorgie et l’Arménie avec l’Azerbaïdjan, la Turquie et la Syrie avec le Kurdistan, ainsi que les situations de conflit en Israël, Irak et Iran ; et plus loin encore, de l’Afghanistan. Sauf que le mal est devenu si chronique que plus personne ne semble plus s’apercevoir que l’état de santé politique de ces régions voisines de l’Europe n’est pas bon. Ces multiples conflits risquent perpétuellement d’entraîner une partie du Vieux Continent dans de nouvelles guerres, à cause des intérêts de grandes puissances qui aujourd’hui comme hier, souhaitent consolider leur position sur l’échiquier international. Aujourd’hui l’OTAN, la Turquie, la Russie, et plus récemment le Royaume-Uni, font des manœuvres militaires dans la région de la mer Noire. Dans le même temps la Turquie, l’Iran, l’Égypte aussi bien que l’Arabie Saoudite sont en lutte pour une hégémonie régionale d’autant plus importante pour l’avenir de l’Europe, qu’elle porte sur des points de passage maritimes qui contrôlent le transit du grand commerce international, les migrations humaines, ainsi que les ressources minérales et alimentaires de ces régions. Or, ces activités, ainsi que la course aux armements qui se poursuit, sont une voie d’autant plus préoccupante qu’on en connaît les antécédents – et donc les risques pour la paix internationale.
En somme, ma vision de l’Europe est celle d’une Europe élargie, qui ne se limite pas à l’Occident, mais inclut aussi l’Europe de l’Est et du Sud-Est, y compris la Russie historique et les Détroits. Elle se préoccupe de la paix des peuples voisins, sans laquelle notre paix sera toujours précaire. Dans Conquering Peace, j’ai tenu à donner aussi une voix aux Européens sur les marges orientales et sud-orientales ; car la paix européenne devra se faire avec eux, ou elle ne se fera jamais de façon durable.
Sources
- Stella Ghervas, Réinventer la tradition : Alexandre Stourdza et l’Europe de la Sainte-Alliance, Paris, Honoré Champion, 2008 (Prix Guizot de l’Académie française, 2009 ; Prix Xenopol de l’Académie des sciences de Roumanie, 2010).
- Voir notamment, John Lewis Gaddis, The Long Peace : Inquiries into the History of the Cold War, New York, Oxford University Press, 1987 ; James J. Sheehan, Where Have All the Soldiers Gone ? The Transformation of Modern Europe, Boston, Mariner Books, 2008 ; Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature : Why Violence Has Declined, New York, Viking, 2011.

