Qu’est-ce que l’économie d’appartenance ?
Martin Sandbu est le spécialiste de l’économie européenne du Financial Times. Il est l'auteur de trois livres sur l'éthique des affaires, l'euro et « l'économie d'appartenance ». C’est dans le cadre de la publication de cet ouvrage que nous l’avons rencontré pour une conversation autour de son livre et de sa vision des enjeux économiques internationaux actuels.
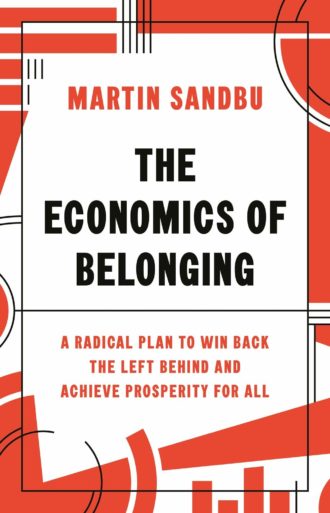
Dans votre ouvrage, vous partez du constat que le « contrat social » des sociétés occidentales post- Seconde Guerre mondiale est profondément remis en cause par l’érosion du « sentiment d’appartenance économique ». Quelles sont les origines de ce changement de paradigme ?
Selon moi, le contrat social des sociétés occidentales d’après-guerre repose sur trois piliers : la démocratie libérale, l’économie sociale de marché et le principe d’élimination progressive des frontières. Je suis convaincu que c’est principalement l’érosion du pilier économique qui est à l’origine du rejet de ce modèle dans sa globalité par les mouvements populistes de droite comme de gauche. La question est dès lors de savoir comment nous en sommes arrivés là.
Il s’agit d’abord de la conséquence d’un processus d’évolution technologique qui a engendré un changement profond des structures économiques, tout particulièrement vis-à-vis des emplois industriels. La technologie a fait augmenter la productivité industrielle de façon spectaculaire. Évidemment, cet impact technologique ne se limite pas seulement à l’industrie : l’avènement d’internet a profondément bouleversé le commerce de proximité, l’automatisation menace les emplois ouvriers tout comme les emplois de bureau et l’intelligence artificielle aura un impact significatif sur de très nombreuses professions.
Si ces mutations technologiques sont des vecteurs de productivité qui accroissent globalement les niveaux de vie, le déclin des emplois qu’elles engendrent a des conséquences particulièrement négatives pour une grande partie de la population : les laissés-pour-compte de la mondialisation. C’est autour d’eux que les structures d’organisation du contrat social des Trentes Glorieuses avaient été bâties, dans une perspective de répartition égalitaire de la croissance. Ces structures s’étendaient sur l’ensemble du territoire national, permettaient le dialogue entre partenaires sociaux et conféraient un pouvoir de négociation fort à la représentation syndicale. En somme, la structure technologique de l’économie trouvait une traduction politique qui n’était pas nécessairement pacifiée, mais qui avait le mérite d’être relativement claire et définie. Chacun pouvait avoir le sentiment d’occuper une place dans cet ensemble. Les promesses d’augmentation du niveau de vie, de diminution des inégalités et de garantie de la dignité des classes ouvrières sous-tendaient l’équilibre de ce modèle.
Depuis, cette structure a profondément évolué et il aurait été nécessaire d’adapter les institutions publiques en conséquence. Ces adaptations n’ont toutefois pas été réalisées – particulièrement aux États-Unis et au Royaume-Uni – alors que l’on constate les mêmes dynamiques de changement économique structurel un peu partout. Le sentiment d’abandon des laissés-pour-compte est la conséquence directe de ce manque d’action, dont on constate aujourd’hui les effets concrets au travers de la résurgence d’inégalités fortes. Ainsi, alors qu’elles avaient chuté dans les trois premières décennies d’après-guerre et qu’elles tendent à se réduire entre les pays, les inégalités à l’intérieur des pays ont refait surface depuis les années 1980 pour atteindre de nouveaux sommets désormais.
Cette double dynamique – aux allures de « courbe de l’éléphant » selon la fameuse typologie de Branko Milanovic – se traduit par une paupérisation de la classe moyenne des sociétés occidentales et l’accroissement des richesses d’une élite perçue comme relativement détachée de la sphère nationale, car elle a largement bénéficié de l’internationalisation des échanges. Ce phénomène est à l’origine de ce que je qualifie de « fin du sentiment d’appartenance économique ». Certes, il y a eu de nombreux autres bouleversements politiques depuis les années 1980, mais la similitude des transformations économiques dans des pays, ayant pourtant des cultures politiques parfois très hétérogènes, est frappante. Il s’agit donc bien d’un phénomène commun que j’attribue au changement structurel des économies occidentales.
Il me semble que si l’on étudie précisément les transformations économiques réelles, on constate que le phénomène de fin d’appartenance économique précède l’avènement du processus de mondialisation économique. Ce processus a réellement commencé vers la fin des années 1980 et s’est accéléré à partir des années 1990. La Chine rejoint le mouvement 10 ans plus tard. La mondialisation en tant que phénomène n’est donc pas intrinsèquement responsable de cette situation. On voit notamment que ce ne sont pas les pays les plus mondialisés qui ont le plus souffert sur le plan socio-économique. Les pays scandinaves, très libéraux, sont à ce titre un bon exemple. A contrario, l’économie américaine est peut-être la moins ouverte du fait de la taille de son marché intérieur. Les États-Unis sont pourtant très affectés par le phénomène de fin d’appartenance économique, dont la traduction en termes politiques y est aussi intense que manifeste. On le constate aisément au regard de la période électorale qui vient de s’achever. La mondialisation n’est donc pas la cause principale de ce phénomène.
Vous parlez d’un « mythe de l’usurpation » : quel phénomène décrivez-vous par cette expression ?
Selon moi, toute dynamique politique est enracinée dans un phénomène économique. Le « mythe de l’usurpation » est le récit commun aux différents mouvements politiques qui affirment que l’ouverture aux économies plus pauvres engendre la confiscation des emplois des pays développés par une main-d’œuvre moins coûteuse. Cette rhétorique est présente chez Trump vis-à-vis de la Chine, elle l’était chez les partisans du Brexit à propos des pays de l’Est. Ce fantasme – très efficace électoralement – participe à la création d’un récit fallacieux mais redoutablement limpide pour ceux qui y sont sensibles, et par conséquent éminemment dangereux. Il s’appuie sur l’abandon réel des populations par les structures économiques, et exploite l’érosion du sentiment de contrôle personnel et politique qui en découle. Pourtant, le déclin de l’industrie et la croissance du secteur des services à forte valeur ajoutée étaient inévitables. Cette fable qui en attribue la responsabilité aux travailleurs étrangers exerce un pouvoir d’attraction politique très fort. Ce pouvoir est tel que les partis établis ont eux-mêmes incorporé ce mythe de l’usurpation dans leurs discours.
Au Royaume-Uni, les conservateurs utilisent cette rhétorique en proposant une offre politique de plus en plus nationaliste. Il n’y a pas vraiment eu de contradiction vigoureuse à cette analyse. Pourtant, je pense que cela est essentiel car la fermeture des frontières et le protectionnisme sont de faux remèdes à un vrai mal. Les laissés-pour-compte ne seront pas sauvés par un renversement de la mondialisation. Au contraire, cela deviendra beaucoup plus dangereux lorsqu’ils se rendront compte que leur situation n’a pas évolué malgré la promesse de protection et de résistance face aux forces de la mondialisation.
Vous déconstruisez trois boucs émissaires souvent invoqués pour justifier les maux des sociétés modernes : le commerce international, l’immigration et la mondialisation financière. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Une des intentions du livre est de déconstruire le mythe portant à croire que les dirigeants nationaux sont impuissants face aux forces de la mondialisation. Ces boucs émissaires sont invoqués car il s’agit de manifestations tangibles de la mondialisation. Mondialiser – pour utiliser du jargon économique – c’est faciliter les flux et les mouvements d’un facteur de production. Il s’agit bien là de quelque chose qui traverse les frontières. Des personnes, des biens, du capital ou encore des services. Cette analyse des dimensions de la mondialisation économique est très simpliste, mais elle permet de constater comment ces dynamiques singulières se transposent dans les rhétoriques politiques. Dans chaque cas, je souhaite encourager les lecteurs à se poser la question suivante : « l’origine du problème réside-t-elle intrinsèquement dans la dynamique de mouvement à travers les frontières ou résulte-t-elle d’un manque de gouvernance et de régulation à l’intérieur de chaque pays ? » J’essaie de démontrer que, la grande majorité du temps, ce sont les politiques publiques qui échouent à contenir et minimiser les externalités négatives.
Prenons l’exemple relatif à la migration économique. Les gouvernements ont le pouvoir de limiter les excès ou la baisse des salaires en bas de l’échelle des rémunérations. Un exemple que je trouve utile est celui de la comparaison des politiques menées par la Norvège et le Royaume-Uni concernant les flux migratoires en provenance d’Europe de l’Est après 2004. Si la Norvège a enregistré un taux relatif plus élevé qu’au Royaume-Uni, le sentiment de pression sur les salaires ainsi que la réaction politique envers les populations immigrées ont été bien moins virulents. De fait, la Norvège a eu recours à une série de politiques publiques visant à réduire l’impact de cette migration sur le marché du travail et le niveau de vie, en améliorant par exemple significativement la formation professionnelle afin de faciliter les reconversions ou en déployant des mesures permettant d’empêcher une trop forte pression à la baisse sur les salaires. Par ailleurs, cette migration économique a eu des conséquences économiques positives qui s’inscrivent rarement dans le débat public.
Autre exemple, la financiarisation de l’économie aggrave la tendance post-industrielle à laisser certaines personnes au bord de la route. Elle détourne les ressources des investissements les plus productifs. L’ingénierie financière déplace l’équilibre des pouvoirs et la répartition du revenu national en faveur des détenteurs de capitaux et au détriment des revenus du travail, ce qui accroît également les inégalités régionales. Mais la financiarisation provoque ces effets au travers de mécanismes de dérégulation largement nationaux, et le ferait aussi dans des systèmes économiques parfaitement fermés. Il s’agit là de quelques exemples qui soutiennent une thèse plus large : les gouvernements ont les moyens politiques d’atténuer les externalités négatives des mouvements transfrontaliers. Dans mon livre, j’essaie de démontrer que des outils de régulation existent, mais que dans la majorité des cas, les dirigeants politiques ont choisi de ne pas y avoir recours. Il ne faut donc pas confondre ces manquements décisionnels, idéologiquement ancrés dans une perspective de dérégulation, avec un effet intrinsèque de la mondialisation.
Vous considérez donc qu’une confusion subsiste entre la dynamique de mondialisation et celle de dérégulation. Dans le domaine de la régulation, la question d’échelle semble cruciale pour évaluer la capacité des puissances économiques à imposer leurs conditions commerciales. Comment appréhendez-vous l’avenir de cette lutte d’influence normative, où l’activité économique transfrontalière s’accompagne d’une concurrence exacerbée autour des règles qui la régissent ?
C’est une dimension très importante. Je pense qu’une confusion intellectuelle entre mondialisation et dérégulation s’est profondément ancrée dans l’inconscient collectif au cours des dernières décennies. Cela s’explique par le fait que ces deux phénomènes sont advenus simultanément. Le concept de « troisième voie » témoigne bien de cette double dynamique, dans la mesure où il a été formulé dans les années 1990 et 2000 par une gauche particulièrement centriste et libre-échangiste, dans une volonté de dissociation de ses références historiques et intellectuelles traditionnelles.
Si elle est profondément ancrée dans les mentalités, cette confusion n’est toutefois pas indépassable. La question de l’échelle est ici effectivement cruciale. Si l’on souhaite imposer des règles contraignantes et effectives aux accords de libre-échange, il faut non seulement que cela soit une véritable priorité politique au plus haut niveau, mais aussi que cet impératif trouve une traduction concrète à l’échelon politique le plus à même d’influencer l’ordre commercial international. Pour les « petits pays », la mondialisation pose comme difficulté, non pas la régulation des économies nationales, mais la capacité à s’imposer dans les rapports de force du commerce international. Si les règles d’un petit marché sont très différentes des autres, le commerce devient moins accessible, la compétitivité est moindre dans la concurrence mondiale, le pouvoir de négociation et l’indépendance sont réduits. Il est ainsi essentiel de se rendre compte que l’échelle européenne permet aux pays européens d’être collectivement partie prenante de la lutte d’influence normative, alors qu’aucun des États membres ne pourrait le faire seul. L’échelon européen renforce donc la capacité nationale à réguler la mondialisation.
Si l’on ne participe pas à cette bataille des normes à l’échelle européenne, les Européens vont tout simplement être les grands perdants de cette « guerre commerciale ». Les préférences et standards européens n’auront pas force de loi sur l’échiquier des règles internationales. Les principaux rapports de force et variables d’ajustements du libre échange moderne se concentrent autour de cet enjeu des normes, c’est-à-dire s’accorder (ou non) sur les règles selon lesquelles les producteurs d’un pays peuvent vendre leurs biens et services dans un autre pays. Cela est très différent de la situation qui prévalait au XXe siècle lorsque le principal levier commercial était celui des droits de douane.
Ainsi, la mondialisation n’est pas interchangeable avec le phénomène de dérégulation. L’activité économique, dans la mesure où elle est internationale, s’adapte aux forces dominantes. Mais, à l’intérieur de ce système international, il y a beaucoup d’outils de régulation qui sont tous compatibles avec une ouverture économique, tant que les flux qui traversent les frontières s’y ajustent. C’est le principe de « l’effet Bruxelles », la capacité à imposer des normes sur lesquelles les entreprises de pays tiers s’alignent de facto afin de réaliser des économies d’échelle et de conserver un accès à l’incontournable marché européen. Il est important de se rendre compte qu’il y a une lutte qui s’intensifie autour de cette question, notamment dans la mesure où le commerce international se développe majoritairement autour des services, et non des biens traditionnels. C’est donc une lutte pour la domination économique qui se joue, avec la question de savoir quelles sont les règles du jeu qui vont dominer la production et l’échange de ces services.
Par ailleurs, dans la mesure où l’activité économique est exponentiellement liée au domaine du numérique, ces régulations sont d’autant plus politiques car elles ont une très forte influence sur nos modes de vie et choix de société. Nous l’avons vu avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe. Il ne s’agit donc pas uniquement d’une question économique, mais d’une question d’influence sur les facteurs déterminant nos vies quotidiennes, la préservation de nos vies privées, les interactions qui rythment nos sociétés, etc.
Vous présentez une stratégie qui comporte de multiples dimensions politiques, budgétaires et même monétaires qui vous semblent devoir être menées de concert. Dans quelle mesure vous semble-t-il concevable de voir émerger un nouveau paradigme politique capable de mener l’ensemble de ces combats d’un seul front ?
Je propose effectivement tout un éventail de réformes dans mon livre. Elles ont cependant toutes un même objectif : viser à une répartition la plus égalitaire possible de la productivité. On parle beaucoup d’égalité, il s’agit principalement à mes yeux d’assurer une répartition des opportunités d’activités productives permettant à celles-ci de s’étendre à une majorité, sinon à la totalité de la population. Les laissés-pour-compte sont abandonnés à des emplois précaires ou au chômage et se retrouvent dépourvus de rôle économique productif à remplir dans la société. Je pense que la pandémie de Covid-19 offre paradoxalement une occasion d’agir bien plus radicalement qu’auparavant. Il y avait déjà un mouvement dans cette direction au sein des partis établis, notamment centristes, qui observaient le succès électoral des populistes avec impuissance et inquiétude, s’interrogeant sur la meilleure façon de juguler cet essor en donnant un rôle plus engagé et plus actif à l’État.
Le virus a forcé la quasi-totalité des dirigeants du monde à rapidement devenir des radicaux. Les politiques de confinement sont de fait éminemment radicales en matière de restriction des libertés individuelles – les plus extensives en temps de paix – mais également d’un point de vue économique. Chaque pays a mis en place des mécanismes compensatoires de grande ampleur comme le chômage partiel. Les banques centrales ont promptement agi et les Européens valident actuellement un plan de relance sans précédent dans l’histoire de l’Union européenne. Au regard de ces transformations, nous nous habituons très rapidement à être radicaux. Cela rend mon programme plus réaliste.
Je commence le livre par une référence appuyée à Roosevelt et au New Deal car il y a un parallèle évident entre l’ampleur du choc de cette crise et le choc de la Grande Dépression. Je pense ainsi que les réponses politiques ne se présenteront pas en matière de choix entre radicalisme ou absence de radicalisme mais sur la forme de radicalisme que nous aurons. La stratégie que je propose comporte effectivement de multiples dimensions, mais il n’y a rien qui soit indépassable dans le contexte actuel et j’ai personnellement une préférence pour un radicalisme au service d’un projet social et d’ouverture.
Vous affirmez que les racines économiques des choix politiques sont souvent plus visibles à l’échelle des « lieux » qu’à celle des « individus ». C’est donc avant tout parce qu’elles sont économiquement vulnérables que de nombreuses communautés se tournent vers une offre politique illibérale, autoritaire ou nationaliste ?
Ce qui m’inquiète beaucoup, c’est que la fracture du paysage politique s’aligne irrémédiablement sur cette division entre ruralité et urbanité. Si aucun parti ne peut proposer une politique qui s’adresse à ces deux réalités, il est difficile d’envisager comment surmonter une telle division. C’est notamment le cas dans la mesure où les communautés politiques restent, dans une large mesure, des communautés territoriales. Lorsque les styles de vie s’éloignent trop entre différentes régions d’un même pays, il y a un risque d’avoir des communautés perpétuellement divisées. On le voit par exemple s’agissant de la politique environnementale. Les Gilets jaunes en France, mais aussi les mouvements similaires dans d’autres pays, posent la question de savoir comment s’accorder sur un programme politique qui soit à la fois avantageux pour l’économie nationale et acceptable pour ces régions les plus abandonnées. La taxe carbone est une parfaite illustration de cette dichotomie. Il existe des propositions pour la mettre en place tout en s’assurant que cela ne se fasse pas au détriment des populations les plus dépendantes des énergies fossiles. On peut ainsi penser à une redistribution du produit de cette taxe, de façon à garantir que ces populations perçoivent directement les avantages d’une politique environnementale. C’est le concept de « transition juste » qu’il est impératif de développer concrètement. En France par exemple, le CESE a étudié cette possibilité au travers de l’émission de chèques carbone.
Plus globalement, une véritable réflexion sur les mesures de justice fiscale (impôt sur les grandes fortunes, réforme de l’imposition des sociétés, etc.) doit être menée sans tabou pour envisager la résorption de ces fractures.
En écho aux travaux de Dani Rodrik vous appelez de vos vœux l’avènement d’une mondialisation alternative en émettant une critique du triangle d’incompatibilité. Quelles perspectives pour sauver la mondialisation d’elle-même ?
Dani Rodrik est un ami et nous avons de nombreuses discussions à ce propos. Selon lui, mon raisonnement est proche du sien et il est vrai que dans le détail des propositions concrètes, nous sommes la plupart du temps d’accord. Notre principal divergence réside dans le fait que je considère qu’il reste beaucoup de pouvoir entre les mains des États que les dirigeants nationaux peuvent mobiliser, même au sein du régime de mondialisation actuel. Je suis ainsi en désaccord avec le trilemme de l’économie mondiale. Selon moi, le régime actuel permet non seulement de reconstituer une économie d’appartenance nationale, et il est même probablement plus facile de le faire dans une économie mondialisée.
Si mon analyse est correcte, que la mondialisation n’est qu’un bouc émissaire, cela signifie que restreindre la mondialisation rendrait plus difficile ce que Dani et moi estimons nécessaire, à savoir réformer les économies nationales. Il faut donc préserver la mondialisation, pour avoir l’essor de productivité permettant justement de faciliter les changements que l’échelon national a le pouvoir de réaliser. Il s’agit en quelque sorte d’une inversion du trilemme. Ce constat est crucial afin de réfuter les arguments antimondialisation, tout en portant un regard lucide sur le fait que toute une partie de la population a été abandonnée par les changements économiques et politiques des quarante dernières années.
Jusqu’ici, notre analyse se concentre essentiellement sur les économies des sociétés occidentales, mais il est également nécessaire de reconnaître les conséquences internationales de cet échec. Après la crise de 2008, le modèle phare des États-Unis est tombé en disgrâce auprès de nombreux acteurs internationaux. Plus qu’une remise en question de son hard power, cette chute s’accompagne surtout par une réduction drastique de l’attractivité du modèle américain et, plus largement, du soft power occidental. Cette remise en cause est d’ailleurs particulièrement exacerbée par l’émergence de modèles alternatifs puissants, au premier rang desquels le modèle chinois.
Cependant, on ne parle pas de la même mondialisation aujourd’hui qu’il y a vingt ou trente ans. Je pense que l’interdépendance économique et politique est un fait durablement ancré dans le paysage économique international. Qui gouverne cet espace ? Qui définit les termes et les règles de cette interdépendance ? La Chine peut aspirer de façon réaliste à prendre les rênes de cette mondialisation, de la même façon que les États-Unis menaient le jeu jusqu’ici. L’émergence de nouveaux enjeux comme celui des interdépendances issues des chaînes de valeurs mondiales est aussi une illustration des nouvelles manifestations de la mondialisation. Dans ce contexte, il est essentiel que l’Europe agisse pour défendre sa vision. J’ai beaucoup de confiance dans le modèle européen, il est porteur de valeurs que je crois universelles. Cependant, il est difficile de les rendre attirantes au-delà de nos frontières si elles sont attachées à un système économique qui ne fonctionne pas pour tous.

