Comment écrire de la fausse histoire globale
Trois spécialistes de l'histoire globale expliquent tout ce qu'il ne faut pas faire en histoire globale.
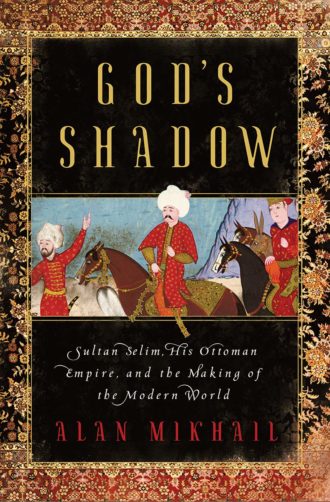
Un historien de l’université de Yale, Alan Mikhail, a récemment publié une biographie du sultan ottoman Selim (r. 1512-20) destinée au grand public et parue sous le titre God’s Shadow : Sultan Selim, His Ottoman Empire, and the Making of the Modern World (Liveright, 2020). L’auteur affirme modestement qu’il s’agit d’une contribution « innovante, voire révolutionnaire » (p. 3) à l’histoire mondiale. Il a rapidement été salué par la presse, alors que d’autres études récentes au sujet du même sultan, publiées par de jeunes universitaires, n’ont pas reçu une telle attention. Cela n’est pas tout à fait surprenant étant donné que God’s Shadow (GS ci-après) a fait l’objet d’une campagne publicitaire vaste et efficace menée par l’auteur, son agent et leur entourage. Agents et admirateurs d’Alan Mikhail ont veillé à ce qu’il ait amplement l’occasion de faire connaître le résumé de son livre et ses arguments à la suite de sa parution. Ainsi, le 20 août 2020, le Washington Post a publié dans sa section « Made by History » un long article signé par Mikhail et intitulé « Le sultan ottoman qui a changé l’Amérique », avec le sous-titre sensationnaliste « l’Amérique, le protestantisme et le café ont tous une histoire musulmane ». Les quelques critiques d’universitaires compétents n’ont pas tout à fait partagé cet enthousiasme. Elles ont au contraire souligné les nombreuses erreurs factuelles et logiques que comportent le livre, accompagnées de graves erreurs d’interprétation qui suggèrent que Mikhail – jusqu’à présent un historien de l’environnement, principalement de l’Égypte du XVIIIe siècle – n’a pas les qualifications nécessaires pour écrire au sujet de l’Empire ottoman du début du XVIe siècle, encore moins de son impact sur le monde. Ces mêmes critiques ont également souligné que l’auteur dépend, sur plusieurs points cruciaux, de sources qu’on ne peut facilement identifier, encore moins vérifier. Il y a évidemment des « avantages » à passer outre le processus habituel d’évaluation par les pairs qui aurait mis ces lacunes en évidence.
Dans son article, Alan Mikhail écrit que son intention est de persuader « les Américains qui ne savent même pas ce qu’est l’Empire ottoman », qu’il s’agit d’un empire important dont l’histoire mérite d’être étudiée. Nous sommes d’accord avec cela. Nous ne contestons pas non plus son point de vue selon lequel, plutôt que de toujours considérer l’Islam comme un « Autre menaçant » l’Occident, il vaut la peine d’examiner les interactions variées et complexes qui ont existé entre Musulmans et non-Musulmans tout au long de l’histoire. Cependant, nous sommes déconcertés par les méthodes et les arguments auxquels Mikhail a recours pour faire valoir son point de vue tant ceux-ci jettent le discrédit sur l’Histoire comme discipline professionnelle sérieuse. Nous nous concentrerons ici que sur quelques points, bien que de nombreux autres pourraient être soulevés, ce livre n’ayant fait l’objet pour l’instant que de rares analyses critiques par des universitaires compétents. En effet, si l’on entreprenait de réfuter systématiquement toutes les erreurs factuelles et interprétations douteuses de l’ouvrage, on se retrouverait sans doute avec un texte de plusieurs centaines de pages.
Le livre d’Alan Mikhail s’inscrit dans une tendance malheureuse par laquelle « l’histoire mondiale » est devenue une excuse employée par certains auteurs afin de défendre des thèses farfelues, en se fondant sur la conviction qu’ils ne seront pas soumis à l’examen scientifique habituel.
Cornell Fleischer, Cemal Kafadar, Sanjay Subrahmanyam
Le livre d’Alan Mikhail s’inscrit dans une tendance malheureuse par laquelle « l’histoire mondiale » est devenue une excuse employée par certains auteurs afin de défendre des thèses farfelues, en se fondant sur la conviction qu’ils ne seront pas soumis à l’examen scientifique habituel. Le livre primé du politologue Romain Bertrand, L’histoire à parts égales (Le Seuil, 2011), constitue un bon exemple de cette tendance en France, une compilation hétéroclite de contenus non digérés extraits des travaux d’universitaires spécialisés, le tout enveloppé dans un emballage politiquement correct de tiers-mondisme « Rive Gauche ». Dans le sillage de Bertrand, l’histoire globale en France s’est souvent réduite à des encyclopédies conçues de manière indifférente comme L’histoire mondiale de la France (Le Seuil, 2017) ou à des ouvrages qui empruntent lourdement à des travaux d’universitaires anglophones sans trop les citer. Plus récemment, dans le monde anglophone, il y a également l’ouvrage de vulgarisation d’une autre historienne de Yale, Valerie Hansen, intitulé The Year 1000 : When Explorers Connected the World – and Globalisation Began (Scribner, 2020). On y retrouve les mêmes descriptions génériques des marchés orientaux « exotiques » que chez Mikhail, descriptions qui semblent sortir tout droit d’une brochure touristique. (À Trabzon, sous le règne de Selim, Mikhail prétend qu’il y avait déjà des « piments indiens rouge feu » bien avant que ces derniers n’arrivent en Inde en provenance d’Amérique : GS, p. 67). Hansen va jusqu’à affirmer qu’en l’an 1000 de notre ère, le tour du monde a été possible pour la première fois grâce aux Vikings (ou aux Norses) qui avaient pris contact avec le nord-est de l’Amérique mais également – hypothèse hasardeuse non appuyée par les grands spécialistes – avec les Mayas. Comme l’a écrit le célèbre historien Noel Malcolm dans une critique de ce livre parue dans The Telegraph (19 avril 2020) : « Hansen déclare triomphalement qu’en l’an 1000 ces Norses avaient ‘bouclé la boucle globale’ et que ‘pour la première fois, un objet pouvait faire le tour du monde’. Mais il convient de se poser la question : quand bien même les archéologues trouveraient-ils des Buddhas en bronze ayant appartenus aux Vikings à Terre-Neuve, pourrions-nous en conclure quoi que ce soit de tangible au sujet du processus global ? Cette question du ‘processus’ ne reprend qu’avec les voyages de Christophe Colomb ; et même si les Vikings étaient restés bien plus longtemps, ils n’auraient pas trouvé dans le nord-est de l’Amérique le réseau commercial nécessaire pour ce genre d’échanges. La globalisation implique bien plus qu’un contact ponctuel aux confins d’un continent ». Pour construire leurs châteaux de cartes, les auteurs comme Mikhail et Hansen s’inspirent d’histoires globales aux idées obsolètes et spéculatives. Dans un autre compte-rendu sceptique au sujet de travaux plus anciens – en particulier ceux de Carol Delaney sur Christophe Colomb –, le grand spécialiste de Christophe Colomb qu’est Felipe Fernández-Armesto déclare dans le Wall Street journal (17 septembre 2011) qu’ils font preuve « d’une incompétence dans la recherche, d’un manque de jugement critique et d’un culot qui rappelle celui de Christophe Colomb lui-même ». Plus loin, il ajoute que ces auteurs (y compris Carol Delaney) « se sont lancés dans leur odyssée à bord de navires qui prennent l’eau, dotés de voiles remplies d’air chaud et non de vents rapides ». Mais les auteurs évoqués par Fernández-Armesto ne sont pas des historiens professionnels en poste au sein de départements d’histoire d’universités prestigieuses. Pourtant, Columbus and the Quest for Jerusalem (Free Press, 2011), le livre de Carol Delaney que la critique décrit comme « étranger à la cohérence narrative et à la chronologie rationnelle », est une source majeure (cité treize fois) de la première section du livre de Mikhail, dans laquelle il essaye de manière improbable de lier Christophe Colomb aux Ottomans. Ce que les experts avaient à dire sur le sujet n’a vraisemblablement pas suscité son intérêt.
S’agissant de ces histoires mondiales douteuses, le critique a donc l’embarras du choix. Mais revenons au livre d’Alan Mikhail et à ses ramifications dans la presse populaire. Il est évident dès le départ que Mikhail pratique encore une forme dépassée et grossière de l’histoire des « grands hommes » au sein de laquelle seuls les dirigeants et autres personnages héroïques exceptionnels « font l’histoire ». Il compare ainsi son héros, le sultan Selim, à Christophe Colomb, Martin Luther et Nicolas Machiavel, dont il considère qu’ils sont les principaux acteurs du début du XVIe siècle, acteurs qui auraient littéralement « changé le monde » par leurs actions (GS, p. 304). Cette vision de l’histoire a été abandonnée depuis longtemps par les historiens qui n’adhèrent pas aux cultes de la personnalité. L’expansion de l’Empire ottoman dans les années 1510 n’est pas le résultat des actions d’un seul homme, mais le produit de l’interaction de plusieurs systèmes politiques et militaires complexes. Il est par ailleurs absurde de comparer un conquérant à la tête d’une armée à un philosophe et penseur politique, comme s’ils appartenaient à une sorte de « Hit Parade » de l’histoire. Einstein a-t-il plus « changé le monde » que Mao Zedong ? C’est précisément ce type de questions, cette manière de penser l’histoire que nous conseillons à nos étudiants en licence d’éviter. Mais Mikhail s’engage dans cette voie et s’enferme dans une perspective historique où un seul homme qu’il décrit comme un « fin stratège politique » (GS, p. 211) peut tout façonner, de la montée du protestantisme à la conquête espagnole de l’Amérique, en passant par la propagation mondiale de la consommation de café. Pour ce faire, il doit tordre le cou aux faits, déformer les lois du temps et de l’espace et parfois recourir au mensonge pur et simple.
Einstein a-t-il plus « changé le monde » que Mao Zedong ? C’est précisément ce type de questions, cette manière de penser l’histoire que nous conseillons à nos étudiants en licence d’éviter.
Cornell Fleischer, Cemal Kafadar, Sanjay Subrahmanyam
Mikhaïl recourt à un type d’écriture historique que nous croyions depuis longtemps oublié, à savoir le « primordialisme ». Il nous offre ainsi un éclairage millénaire sur l’histoire de l’Eurasie comme on commencerait une biographie de Charles Quint par les premiers Indo-Aryens : « Les peuples qui deviendront plus tard les Ottomans ont commencé à marcher vers l’ouest à partir de la Chine dès le sixième siècle, traversant l’Asie centrale jusqu’à la Méditerranée. Pendant près d’un millénaire, ils ont poursuivi leur longue marche » (GS, p. 5). Il s’agit sans doute d’un « récit épique », mais sans réel rapport avec le processus historique qui a présidé à la formation de l’entité politique ottomane. Quant à la « marche vers l’ouest à partir de la Chine » – peut-être une référence à l’« essence » militariste des Turcs – l’auteur veut sans doute dire « dans les environs de la Chine », expression par laquelle ceux qui s’intéressent vraiment à l’histoire eurasienne comprendront la Mongolie extérieure, où l’on trouve les premières traces écrites en langue turque.
Qu’en est-il donc des principaux faits de cette affaire ? Alan Mikhaïl souhaite représenter son héros, le sultan Selim, comme ayant joué un rôle sur tous les fronts. Prenons le cas de l’Asie et de l’océan Indien. À partir de 1516-17, les Ottomans ont en effet contrôlé le Hidjaz et la mer Rouge, en partie à travers une domination indirecte. Mais il est tout à fait faux d’affirmer que Selim « détenait les clés de la domination globale » grâce à la « monopolisation des routes commerciales entre la Méditerranée, l’Inde et la Chine » (GS, p. 305), même si les Ottomans ont pu être un facteur de perturbation dans le commerce. De nombreux commerçants issus de différentes régions d’Asie, y compris des non-Musulmans, ont continué à emprunter ces routes non seulement dans les années 1510 mais aussi tout au long du XVIe siècle. La question des ambitions orientales limitées de Selim a été soigneusement examinée dans un article du brillant historien français Jean Aubin (« La politique orientale de Selim Ier »), que Mikhaïl n’a manifestement pas lu, puisqu’il va jusqu’à affirmer que Selim possédait des territoires en Inde occidentale et qu’il a envoyé une vaste flotte de « trente navires et des milliers de marins » dans l’océan Indien en février 1519 (il s’agit là d’une grossière erreur de lecture du journal de Sanuto, qui dit exactement le contraire) (GS, p. 328). Mais ses étranges théories ne s’arrêtent pas là.
Malgré ce qu’il affirme, Selim ne possédait pas « de ports sur toutes les grandes mers et tous les océans de l’Ancien Monde » (GS, p. 305). Voici quelques exceptions significatives : toute la côte est de l’Atlantique, la mer Baltique, le golfe Persique, le golfe du Bengale, toute la partie occidentale de l’océan Indien (une fois sorti de la mer Rouge), la mer de Chine méridionale, la mer du Japon, etc. Selim ne possédait des ports que sur trois mers : la mer Noire, la Méditerranée et la mer Rouge. Ce qu’affirme Mikhail à ce sujet relève de l’ineptie et résulte d’une arrogante négligence à l’égard de la géographie la plus rudimentaire. Il multiplie les affirmations de ce type : On s’attendrait à ce qu’un spécialiste de l’Empire ottoman sache que, même en 1530, les Musulmans ne constituaient pas une nette majorité au sein de l’empire (ils représentaient 1,6 million de ménages sur un total de 3,45 millions d’après les données de recensement partiel). On pourrait également s’attendre à ce qu’un spécialiste de l’histoire islamique sache qu’il est très tendancieux de prétendre que Selim « possédait une autorité religieuse sans égale dans le monde musulman [en 1517] » (GS, p. 305), puisque son autorité était rejetée en Iran et en Irak et qu’elle n’a pas été reconnue par de nombreux musulmans dans d’autres régions telles que l’Asie du Sud et le Maroc. Pour appuyer cette théorie absurde, Mikhail invente des lettres soi-disant envoyées par les Safavides à Selim, or ces lettres sont introuvables dans la source qu’il cite (GS, p. 443). Plus tard, au XVIe siècle, des intellectuels ottomans de premier plan comme Mustafa Âli reconnaissaient eux-mêmes la légitimité des prétentions « califales » et dynastiques des Safavides et des Moghols. Comme l’illustre un passage central de son livre, Mikhaïl ne semble même pas connaître la différence entre le sultan mamelouk et le calife abbasside, et ces détails ont peut-être échappé à son attention. En réalité, le « califat abbasside » juridique que Mikhaïl décrit avec tant d’assurance comme ayant été transféré à Sélim en 1517 (GS, p. 309), était en grande partie resté lettre morte depuis la conquête de Bagdad par les Mongols en 1258. Aux XVe et XVIe siècles, le statut de calife a été revendiqué par plusieurs souverains mais il n’avait rien à voir avec les Abbassides comme le démontrent clairement plusieurs ouvrages récents et faisant autorité sur le sujet, que Mikhail ignore.
Les lecteurs qui connaissent le règne de Charles Quint seront également surpris d’apprendre que l’Europe à la fin des années 1510 était « un continent de petites principautés et de villes-États héréditaires (sic) qui se chamaillent », ou que Selim constituait la principale raison pour laquelle le protestantisme a réussi à se développer.
Cornell Fleischer, Cemal Kafadar, Sanjay Subrahmanyam
Passons aux théories et aux spéculations plus larges du livre. L’une d’entre elles est que Selim était en quelque sorte responsable du succès de la Réforme protestante et ce pour deux raisons : d’abord parce que Luther était apparemment persuadé que la « dépravation morale » de l’Église catholique avait « permis aux Ottomans de répandre l’Islam dans le monde entier » (GS, p. 371) ; ensuite, parce que la peur qu’éprouvaient les puissances catholiques à l’égard des Ottomans les empêchait d’envoyer des troupes supplémentaires pour réprimer les premières rébellions protestantes. Cela impliquerait que l’on devrait accorder à Selim tout le « crédit » dans cette affaire parce qu’il aurait instillé la peur de l’Islam chez les Européens et parce qu’il aurait constitué une menace pour l’Europe, idée à laquelle Mikhail semble s’opposer par ailleurs. Mais surtout, rien de cela n’est soutenu par les spécialistes. De son vivant, Selim représentait une menace bien plus importante pour les Musulmans que pour l’Europe chrétienne. Selim et ses Ottomans n’ont pas été une grande préoccupation de Luther, comme en témoignent plusieurs nouvelles études importantes.
Les lecteurs qui connaissent le règne de Charles Quint seront également surpris d’apprendre que l’Europe à la fin des années 1510 était « un continent de petites principautés et de villes-États héréditaires (sic) qui se chamaillent », ou que Selim constituait la principale raison pour laquelle le protestantisme a réussi à se développer. Mais Selim ne s’est apparemment pas contenté de toutes ces réalisations : « son influence s’est étendue au-delà même de l’Europe et du Moyen-Orient, par-delà l’Atlantique jusqu’en Amérique du Nord », de sorte que « de la Chine au Mexique, l’Empire Ottoman a façonné le monde connu au tournant du XVIe siècle » (GS, p. 2). Comment le savons-nous ? Au moment même où Selim « conduisait les troupes ottomanes au Caire pour la prendre aux Mamelouks » (GS, p. 131), la flotte espagnole d’Hernández de Córdoba (qui a probablement eu vent de cela sur internet) est arrivée dans la péninsule du Yucatán. Ces Espagnols étaient apparemment hantés par la figure de Selim, « possédés par des fantômes ottomans », puisqu’ils ont comparé un centre urbain maya à la ville du Caire, qu’ils considéraient – au passage – toujours comme la capitale mamelouke. Le seul lien réel entre la conquête du Mexique et les Ottomans est apparu bien plus tard, lorsque Hernán Cortés a participé à l’expédition ratée d’Alger en 1541. À cette époque, Selim était déjà mort depuis longtemps.
Son héritage principal en matière de religion n’a rien à voir avec le protestantisme, il s’agit du souvenir amer de la répression sanglante de l’« hérésie » au sein de sa propre population musulmane, un épisode fort malheureux souvent ignoré dans ce genre d’ « histoire de super-héros », mais qui mérite d’être rappelé au moment où la violence d’État est dans l’esprit de chacun grâce au mouvement Black Lives Matter.
Selim est peut-être le héros d’Alan Mikhail, mais pour beaucoup en Turquie et au Moyen-Orient ce n’est pas du tout le cas. Compte tenu du genre d’histoire qu’il a produit dans son livre, sa tentative de conclure sur une note sarcastique – plutôt que sur une vraie critique – au sujet du néo-Ottomanisme dans la Turquie contemporaine (une position de rigueur de nos jours si l’on veut s’entourer d’une compagnie libérale), apparait comme une posture politique stratégique. On le voit avec la « coda » un peu bancale (GS, pp. 399-405) manifestement rajoutée en toute hâte juste avant la publication du livre, mais aussi dans la tribune que l’auteur a publié dans le magazine Time (3 septembre 2020). Contrairement à ce qu’il affirme, l’écrasante majorité des Alévis de Turquie ne se considère pas comme chiite (voir GS, p. 402) et ne souhaite pas être considérée comme telle malgré ses liens avec les Safavides au début de l’ère moderne. Cette affirmation grossière rappelle le carcan que constitue le terme « hispanique » que les États-Unis imposent à des millions de personnes qui le trouvent sans intérêt, excluant, ou les deux à la fois.
Compte tenu du genre d’histoire qu’il a produit dans son livre, sa tentative de conclure sur une note sarcastique – plutôt que sur une vraie critique – au sujet du néo-Ottomanisme dans la Turquie contemporaine (une position de rigueur de nos jours si l’on veut s’entourer d’une compagnie libérale), apparait comme une posture politique stratégique.
Cornell Fleischer, Cemal Kafadar, Sanjay Subrahmanyam
Cela nous amène enfin au café. Alan Mikhail affirme que c’est l’armée de Selim qui aurait découvert au Yémen « une étrange baie de couleur rouge vif dans un buisson » et qui aurait entrepris de la préparer et de la vendre (GS, p. 318). Là encore, cette affirmation est tout simplement fausse. Il existe une littérature importante qui montre que le café et son utilisation étaient déjà bien connus des Musulmans au XVe siècle et peut-être même des Éthiopiens avant cela. Sa légalité en tant que substance intoxicante a été débattue par les intellectuels de La Mecque, de Médine et du Caire avant la conquête de ces villes par les Ottomans. Sa propagation a été le résultat d’un certain nombre d’initiatives privées, et non d’une décision politique ottomane. Il n’y a tout simplement aucune raison d’affirmer que la propagation du café s’est faite grâce « à une institution omniprésente que Selim a légué à l’humanité – le café [le lieu] » (GS, p. 318), encore moins qu’ « un sultan ottoman [Selim] a été le premier à transformer le commerce en géopolitique, en monopolisant l’offre de l’un des premiers biens de consommation de masse au monde ». Il n’existe pas une seule preuve documentaire reliant directement Selim à la propagation du café. Nous ne savons même pas s’il en a lui-même consommé ou s’il était au courant de son existence. Il s’agit simplement de l’invention d’un historien moderne qui ne sait pas faire la distinction entre les faits et la fantaisie, entre la vérité et « juste un peu d’exagération ».
Il est clair que God’s Shadow constitue un excellent exemple de la manière dont l’histoire mondiale ne doit pas être écrite. Heureusement, il existe d’autres ouvrages, publiés aussi bien par des éditeurs universitaires que par des éditeurs grands publics, qui nous font garder espoir sur la manière dont l’histoire mondiale peut et doit être écrite.
Cornell Fleischer, Cemal Kafadar, Sanjay Subrahmanyam
Nous ne pouvons pas lire dans l’esprit de nos collègues historiens, et encore moins dans celui d’un souverain du début du XVIe siècle. La raison qui pousse un historien issu d’une université respectable à concocter un tel tissu de mensonges, de demi-vérités et de spéculations absurdes demeure pour nous un mystère. Pourquoi un journal comme le Washington Post publierait-il une série d’affirmations à ce point infondées et en bloquerait ensuite les réponses ? C’est également là une question qui mériterait d’être examinée. Le responsable de la rubrique « Made by History » du journal, un historien d’Hollywood et de la politique américaine, a d’abord refusé de publier notre réponse à l’article au motif que sa « rubrique fait partie d’une section d’informations et non d’opinions ». Le rédacteur en chef de la rubrique a ensuite généreusement ajouté : « s’il y a une erreur factuelle spécifique dans l’article et si vous souhaitez envoyer des détails précis à ce sujet afin que nous puissions modifier (sic) une correction, nous serions heureux de la prendre en considération car nous voulons que tous nos articles soient précis sur le plan factuel ». Nous avons ensuite fourni une liste de sept erreurs factuelles majeures présentes au sein de l’article. Après quelques jours de silence, le rédacteur en chef a répondu : « Nous avons réexaminé l’article en question et avons demandé à l’auteur de nous fournir certaines preuves documentaires. Il les a fournis et nous pensons qu’aucune correction n’est nécessaire au regard de ces preuves. Je vous encourage également à lire son nouveau livre, vous y trouverez des éléments documentaires plus précis à ce sujet ». Naturellement, ni ces « éléments documentaires » ni leur provenance ne nous ont été communiqués.
Considérons plus largement les ramifications politiques de cet ouvrage. Sur les réseaux sociaux turcs, le livre d’Alan Mikhail a été rapidement acclamé par certains groupes qui y ont trouvé une confirmation de leur opinion selon laquelle Selim était un grand homme qui a changé le monde mais dont la mémoire a été jusque-là négligée. C’est une digne cause que de vouloir faire connaitre à un public plus large l’impact profond de l’Empire Ottoman sur l’histoire mondiale, mais pas si cela est fait au nom d’un « révisionnisme » superficiel et pas sur la base d’un pseudo-savoir. Comme l’écrit l’éminente historienne Caroline Finkel dans la Literary Review (5 septembre 2020) : « Mikhail s’appuie énormément sur un livre qui, du moins dans sa version originale en Turc, ne comporte pas de notes de bas de page et dont l’auteur m’est inconnu, de même qu’aux collègues que j’ai consultés » (l’ouvrage en question, signé par Fatih Akçe, est cité trente et une fois). N’est-il pas irresponsable d’avoir recours à ces recherches « originales » alors qu’il y a pléthore de sources primaires pertinentes en arabe, en persan et en turc ? D’autant plus qu’Alan Mikhail met lui-même en garde la presse occidentale contre les dangers de l’usage politique de l’histoire ottomane. Quoi qu’il en soit, il est clair que God’s Shadow constitue un excellent exemple de la manière dont l’histoire mondiale ne doit pas être écrite. Heureusement, il existe d’autres ouvrages, publiés aussi bien par des éditeurs universitaires que par des éditeurs grands publics, qui nous font garder espoir sur la manière dont l’histoire mondiale peut et doit être écrite. Il serait dommage que les « sceptiques de l’histoire mondiale », qui sont de plus en plus nombreux, sautent sur l’occasion et prennent les pires exemples pour faire valoir leur point de vue.

