« Ma nuit au musée de l’Acropole », une conversation avec Andrea Marcolongo
Dans ce deuxième épisode de l’été de notre série « Grand Tour », Andrea Marcolongo partage avec nous une expérience inédite au musée de l’Acropole d’Athènes. Face aux frises du Parthénon, elle s’interroge : nous aimons à placer l’origine de notre « identité » en Grèce. Mais de quelle Grèce parle-t-on ? Une veillée nocturne face aux mythes grecs…
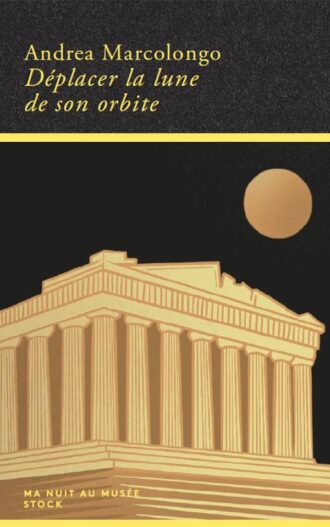
Retrouvez ici les autres épisodes de notre série d’été « Grand Tour ».
Déplacer la lune de son orbite : pourquoi ce titre ?
« Déplacer la lune de son orbite » est une phrase que rapporte un archéologue présent lors de l’enlèvement des marbres du Parthénon au début du XIXe siècle, et qu’il aurait entendue prononcer par les Athéniens. Je trouve cette expression fascinante. On y entend la prescience d’une catastrophe, l’idée que cet arrachement n’est pas seulement une erreur ou une injustice, mais un geste d’une ampleur bien plus grande, par lequel se produit une brisure dans un ordre supérieur, presque cosmique.
Cet ouvrage s’inscrit dans une collection intitulée « Ma nuit au musée » (publiée chez Stock), dont le principe consiste à permettre à des auteurs de passer une nuit complète dans le musée de leur choix, et d’en tirer un récit. Vous avez choisi de passer la nuit au musée de l’Acropole à Athènes, face à ce qui reste des frises du Parthénon, dont la majorité ont quitté la Grèce au début du XIXe siècle pour rejoindre le British Museum, puis d’autres musées européens. Dans votre cas, la nuit au musée a-t-elle été un prétexte, ou bien a-t-elle déterminé la façon dont vous avez écrit ce livre ?
C’est une bonne question. Ce type d’expérience est toujours un pari éditorial. Une nuit peut-être intense, puissante, émouvante, mais cela ne suffit évidemment pas pour faire un livre. La nuit n’est évidemment pas le moment de l’écriture lui-même : tout ce livre a été préparé avant et écrit après. L’expérience elle-même peut fournir un bon reportage, mais cela ne fait pas a priori de la littérature. On pourrait aussi imaginer de passer une nuit dans un musée sans en faire un livre, bien sûr. Dans mon cas, ma chance a été que le gouvernement grec et l’administration du musée ont mis presque un an à nous donner l’autorisation. Cette année de préparation a été un moyen pour moi de me documenter, d’anticiper le moment de la nuit lui-même — et donc de commencer à construire ce livre, en amont de ce moment, selon une dynamique qui donne finalement une sorte d’impatience, d’attente, de tension à mon récit, du moins je l’espère. Je dirais donc que l’expérience de cette nuit dans le musée de l’Acropole n’a pas été un simple prétexte dans la genèse de ce livre.
Votre récit est construit, à la façon d’une épopée grecque, autour d’un anti-héros, Lord Elgin, l’homme qui a commandité le vol des frises du Parthénon, et de son envers héroïque, Lord Byron, qui a transformé notre regard sur la Grèce seulement quelques années plus tard.
En effet, cette histoire est tellement romanesque, plus que cela, tellement puissamment tragique, qu’elle paraît invraisemblable. Lord Elgin, ambassadeur à Constantinople, a tout eu, puis tout perdu. Il a été touché par ce que Byron lui-même a appelé « la malédiction de Minerve », perdant finalement une partie de « ses » marbres (dans des naufrages), sa fortune, sa réputation, sa femme, ses fonctions, et jusqu’à son apparence physique, puisqu’il fut atteint d’une espèce de gangrène qui a mangé son visage, comme les statues qu’il a mutilées et enlevées du Parthénon.
Mais cette tragédie est aussi géopolitique de part en part. Le rôle d’Elgin aurait pu être tenu par n’importe quel autre ambassadeur anglais, profitant comme lui de la nouvelle alliance entre la Couronne et l’Empire ottoman à la suite du recul des armées françaises en Égypte sous le Consulat. Lord Elgin n’est pas un héros (ou un anti-héros) de tragédie à lui tout seul. À mes yeux, il incarne plutôt la synthèse du regard de l’Europe sur la Grèce au tournant du XIXe siècle. La Grèce est alors une sorte de banlieue de l’Europe, une région pauvre de l’Empire ottoman. Personne n’avait l’idée de protéger ou de défendre la Grèce.
Au tournant du XIXe siècle, la Grèce est alors une sorte de banlieue de l’Europe, une région pauvre de l’Empire ottoman. Personne n’avait l’idée de protéger ou de défendre la Grèce.
Andrea marcolongo
D’où vient l’hubris de lord Elgin et sa passion dévorante pour les frises du Parthénon, qu’il ne connaît pas au départ et qu’il a fait enlever sans même les avoir vues ?
Athènes était alors une petite ville, sale et inculte, où l’on raconte qu’il n’y avait plus qu’un vieillard qui maîtrisait le grec ancien. Lord Elgin, comme beaucoup d’aristocrates européens de la fin du XVIIIe siècle, ignore presque tout de la Grèce. Il voit seulement une pure opportunité d’assouvir son ambition, un moyen de se faire valoir auprès de la Couronne britannique.
Ce « vol » a d’ailleurs lieu à titre purement privé. Elgin, ambassadeur d’Angleterre à Constantinople, use de son pouvoir pour se faire délivrer un firman, un document officiel du sultan qui l’autorise à faire décrocher des frises du Parthénon pour les ramener chez lui, en Angleterre. C’est seulement dans un second temps que ce rapt individuel, privé, est devenu le problème géopolitique qu’on connaît aujourd’hui. C’est un autre versant de cette histoire très romanesque. Tout ce qu’a fait Lord Elgin, il l’a fait à titre privé, protégé par l’autorité que lui donnait son titre d’ambassadeur. S’il a finalement vendu les marbres – bien en dessous de leur valeur – au British Museum, c’est pour tenter d’éponger les dettes colossales que cette aventure lui avait coûtées. Mais le British Museum a tout de suite compris l’importance de cette acquisition.
Dans les années 1800, Elgin emporte en son nom des marbres qui appartiennent à une ville de l’Empire ottoman ; aujourd’hui, l’État grec en demande la restitution au Royaume-Uni. Tous les acteurs de cette histoire ont changé.
Entrer dans cette histoire m’a profondément fait réfléchir sur notre rapport au patrimoine historique, sur le sens des musées, la conception même du musée, sa dimension universelle. Lorsque j’ai commencé à écrire ce livre, aucune restitution n’avait eu lieu. Entre-temps, le Vatican, l’Italie et l’Autriche tout récemment ont rendu à la Grèce les marbres du Parthénon qu’ils possédaient.
Entrer dans l’histoire de Lord Elgin m’a profondément fait réfléchir sur notre rapport au patrimoine historique, sur le sens des musées, la conception même du musée, sa dimension universelle.
andrea marcolongo
Y a-t-il des similitudes entre le cas grec et le cas des œuvres d’arts africaines, dont 90 % se trouvent aujourd’hui dans des musées occidentaux ?
Il y a deux cents ans, la Grèce était l’Afrique de l’Europe. Les reproches et les prétextes qu’on a opposés à la Grèce pour ne pas rendre les frises du Parthénon pendant des décennies – vous ne sauriez pas les conserver, vos musées ne sont pas assez grands, assez modernes ou assez sûrs, etc. –, c’est exactement ce qu’on dit à l’Afrique aujourd’hui.
C’est un sujet passionnant, et en même temps infiniment délicat. Les deux écueils sont l’hyper-émotivité et le nationalisme brutal. Toutes les œuvres étrangères des musées ne sont évidemment pas le résultat d’un vol. Il serait absurde d’assigner à chaque œuvre la « nationalité » du pays actuel qui correspond au lieu où elle a été créée. Mais, de même que l’Europe a inventé l’idée même du musée universel, je crois que c’est à l’Europe qu’il revient d’inventer la nouvelle étape de l’histoire du musée. On doit bien sûr associer les pays qui demandent des restitutions à la réflexion, mais on ne peut pas leur demander de mener ce travail de critique interne de notre conception du musée à notre place.
De même que l’Europe a inventé l’idée même du musée universel, je crois que c’est à l’Europe qu’il revient d’inventer la nouvelle étape de l’histoire du musée.
andrea marcolongo
La réflexion engagée par le rapport Savoy-Sarr me semble un bon début. Ses conclusions ne s’en tiennent pas à des remarques logistiques sur les restitutions. Elles invitent aussi à l’invention de nouvelles manières de faire circuler le patrimoine artistique. Aujourd’hui, nos musées sont tellement bondés qu’ils sont devenus des attractions touristiques qui n’ont presque plus rien à voir avec l’art. Les gens font des milliers de kilomètres pour voir des œuvres d’art. Pourquoi ne pas imaginer le contraire, et penser des musées itinérants, où des œuvres d’art qui sont un patrimoine mondial véritablement universel iraient à la rencontre de publics à travers le monde ?
En 1812, la révolution des regards de l’élite européenne sur la Grèce s’est produite grâce à Lord Byron : la publication et la très large diffusion de Childe Harold a véritablement produit un miracle géopolitique. On observe un cercle vertueux entre les mondes intellectuel, public et politique. Une telle circularité serait évidemment souhaitable aujourd’hui. Je ne prétends pas qu’il puisse y avoir un Lord Byron dans chaque pays. Mais je crois que les intellectuels doivent s’emparer – sincèrement – de ces questions, et prendre leur part à ce débat, engager un dialogue avec le monde de la décision politique.
Pourquoi ne pas imaginer le contraire, et penser des musées itinérants, où des œuvres d’art qui sont un patrimoine mondial véritablement universel iraient à la rencontre de publics à travers le monde ?
andrea marcolongo
Vous écrivez, p. 185 : « Les racines culturelles dont nous prétendons être le fruit, tout comme le monde tordu que nous habitons, ne sont pas les nôtres, mais nous avons désespérément besoin de le croire. » Que voulez-vous dire par-là ?
On aime à placer l’origine de notre « identité » en Grèce. Mais de quelle Grèce parle-t-on ? La Grèce du Ve siècle avant notre ère, celle de Périclès ou celle d’Aristote cent ans plus tard ? Le Péloponnèse, Athènes, Sparte ? À l’horizon de ces distinctions, je crois plutôt qu’il s’agit d’une Grèce imaginaire que nous ont léguée les Latins. C’est une Grèce que nous continuons d’inventer. Mais on a besoin de placer quelque part cette idée de racine. Ce sont d’ailleurs des racines très tangibles, quoique imaginaires : on peut les projeter dans des textes, des marbres, des paysages méditerranéens.
Mais où cela mène-t-il ? On sait à quel point les notions de racine ou d’identité peuvent être utilisées à des fins néfastes. Je crois qu’il faut savoir assumer ces concepts en sachant les nuancer, les délester de leur part négative. On ne peut pas vivre comme des rhizomes, qui flottent sans racine. Si l’on file la métaphore, je m’étonne d’entendre aussi souvent parler des prétendues racines – grecques, romaines, judéo-chrétiennes, etc. –, qui sans doute existent dans une certaine mesure et comptent dans l’arbre que sont nos sociétés ; mais qu’on parle beaucoup plus rarement des fruits, qui sont la véritable chose qui compte, ce qui se passe dans le présent. Nos racines ne déterminent pas ce qu’on choisit de faire aujourd’hui, elles sont simplement une donnée historique.
Nos racines ne déterminent pas ce qu’on choisit de faire aujourd’hui, elles sont simplement une donnée historique.
andrea marcolongo
Doit-on alors accepter les termes de l’accusation d’appropriation culturelle, qui taxe d’imposture le fait de s’emparer d’un sujet qui ressortit à une aire culturelle à laquelle on n’appartient pas par naissance ?
Je ne crois pas. Le mot racines s’accompagne de positions très conservatrices : on vient de là, il ne faut rien changer, et ce qui s’écarte de là d’où l’on vient n’a pas le droit d’accéder à l’arbre. Et en fait, cette position rejoint finalement, quoique par un bout politique apparemment opposé, celle de l’appropriation culturelle, qui taxe d’imposture, voire de forfaiture le fait de se saisir d’une quelconque façon créative ou récréative d’une culture à laquelle on n’« appartient » pas. Dans ce cas, sans « appropriation culturelle », l’idée même de la Grèce aurait disparu il y a 2 000 ans. En écrivant ce livre, j’ai souvent connu ce syndrome d’imposture, j’en parle à plusieurs reprises. Je crois qu’il faut vivre avec cette précaution, mais savoir la surmonter.
Quel est le plus grand sacrilège, le vol ou l’amnésie ?
L’amnésie, l’amnésie collective sans aucun doute. Dans notre rapport à la Grèce, il y a toujours eu une part de vol et une part d’amnésie. Mais quelque part, c’est peut-être moins grave encore lorsque c’est le vol qui prend le dessus, car c’est le signe d’une curiosité, d’un intérêt, d’une fascination, d’une activité imaginaire – plutôt que lorsqu’on laisse cette idée même sombrer dans un oubli tranquille.
Je pourrais passer ma vie à militer pour le retour des marbres du Parthénon. Mais si l’on se focalise sur des pierres, des belles pierres – les plus belles du monde sans doute – on perd peut-être de vue la défense de la culture humaniste, qui est en train de disparaître exactement comme les frises sont parties d’Athènes il y a plus de 200 ans : dans l’indifférence générale. Pour moi, le Parthénon est un symbole de la culture qu’on laisse disparaître passivement, en songeant peut-être à certains moments, qu’on est en train de voir déplacer la lune de son orbite.
Pour moi, le Parthénon est un symbole de la culture qu’on laisse disparaître passivement, en songeant peut-être à certains moments, qu’on est en train de voir déplacer la lune de son orbite.
andrea marcolongo
Votre regard sur la Grèce semble évoluer d’un apprentissage scolaire et académique vers une connaissance plus intime de la Grèce contemporaine. Que percevez-vous différemment ?
Notre rapport à la Grèce est en effet captif du passé. Si vous cherchez des auteurs grecs dans une librairie, vous trouverez toujours plus d’auteurs morts il y a plus de 2000 ans que d’auteurs vivants. La Grèce elle-même est piégée dans cet imaginaire touristique, dont elle souffre. Le discours sur l’âge d’or de la Grèce classique et l’éclipse qu’aurait constitué l’époque ottomane crée une sorte de schizophrénie historique. Pourtant, les Grecs qui disent cela aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec les Grecs de la Ligue de Délos. Il est aussi absurde d’essentialiser cette filiation que de parler, en France, de « nos ancêtres les Gaulois ». C’est aussi à cela que sert le fait d’assumer la part d’imaginaire que contient cet héritage, et de savoir qu’une fécondité imaginaire a du sens si elle nous libère, pas si elle nous enferme.
Il est important de savoir décentrer notre regard sur la Grèce : ne pas seulement la regarder depuis Rome, mais aussi depuis la Turquie ou les Balkans. La Grèce est aussi un pays d’Asie mineure. Les textes d’Orhan Pamuk sont peut-être ceux qui ont le mieux saisi cela. Son dernier livre traduit en français, Les Nuits de la peste (Gallimard, « Du monde entier », 2022), décrit une île imaginaire, où la population est moitié grecque, moitié turque – c’est peut-être une version fictionnelle d’Izmir. La revisitation la plus belle que j’aie jamais lue d’un mythe grec, c’est toujours Pamuk, qui a su mêler le mythe de Médée avec un mythe ottoman. On peut, on doit aussi s’efforcer de lire et de regarder la Grèce depuis la Turquie, pour rendre notre regard plus nuancé et plus complexe.

