Pierre Moscovici nous a accueillis dans les locaux parisiens de la Commission Européenne pour un entretien informé par son riche parcours politique. Actuellement Commissaire européen aux Affaires économiques et financières, à la Fiscalité et à l’Union douanière, il a été député européen (1994-1997), Ministre chargé des affaires européennes du gouvernement Jospin (1997-2002), Vice-président du Parlement européen (2004-2007) et Ministre de l’économie des gouvernements Ayrault (2012-2014). Une perspective pour préparer la prochaine année électorale et le grand chantier qu’elle ouvrira sur le futur de l’Union.
Votre parcours politique est étroitement lié à la social-démocratie, le courant politique qui paraît traverser aujourd’hui la crise la plus aiguëe de la politique européenne. Quels ont été à votre avis les moments principaux de cette formation à l’échelle continentale ?
J’ai pu participer à deux moments où la social-démocratie était puissante dans une bonne partie de l’Union. D’abord, avant l’élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale, ce qu’on a appelé « l’Europe rose » des années 1990. À l’exception de l’Espagne, tous les grands pays de l’Union étaient alors gouvernés par des sociaux-démocrates, avec trois figures marquantes : Gerhard Schröder en Allemagne, Lionel Jospin en France et Tony Blair au Royaume Uni. Quinze ans plus tard, quand je suis revenu au gouvernement en 2012, il y avait encore un équilibre entre les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates et une place importante pour ces derniers, notamment parce que la France et l’Italie avaient des gouvernements sociaux-démocrates.
Ce qui nous conduit à la crise contemporaine — comment la comprenez-vous ? Quelles sont à votre avis les sources et les origines de l’éclatement de la social-démocratie ?
D’abord il y a de longue date un épuisement intellectuel et une grande difficulté à trouver un positionnement commun au sein de la social-démocratie, ce qui explique largement l’échec des années 1990 et ses difficultés actuelles. Je me souviens très bien de la période où Tony Blair offrait sa Third Way, Shröder son Neue Mitte, et où Jospin leur répondait « Oui à l’économie de marché, non à la société de marché ». C’était une excellente formule et une forte position. Elle n’a pas pour autant réussi à se greffer sur un appareil théorique suffisant. En effet, même si ce furent des années de croissance forte, de réduction du chômage marquée, un paradigme social-démocrate n’a jamais vraiment pu s’installer. La social-démocratie n’a pas réussi à imprimer des changements durables de gouvernance, elle n’a pas non plus réussi à transformer les structures économiques. Enfin, elle a abandonné le terrain de la réflexion.
Le cas paraît particulièrement évident en France…
J’ai été à la direction du Parti socialiste presque continûment de 1990 à 1997, et il y avait à l’époque une vie intellectuelle au sein du Parti. J’y suis revenu en 2002. Sans vouloir faire de procès à personne, j’ai l’impression que les années Hollande ont été marquées par une démobilisation intellectuelle qui s’est faite petit à petit, jusqu’à produire une sorte de jachère des idées.
La crise de 2008 intervient justement dans ce contexte…
Oui, la crise et ses dégâts. Les socialistes se sont trouvés au gouvernement dans plusieurs pays, dont la France, dans une période où il y avait des réformes à faire qui n’étaient pas de nature sociale-démocrate. On peut penser au CICE proposé par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ou à la réduction des déficits publics que j’ai menée en tant que ministre en 2012-2013, avec en arrière-plan un choc fiscal qui n’a pas épargné complètement les classes moyennes. On peut penser aussi à la réforme des retraites ou à la réforme El Khomri dont je n’ai pas apprécié la méthode, mais dont je suis toujours prêt à défendre la nécessité. Ces réformes nécessaires percutaient de manière radicale les attentes de notre électorat. Nous avons un peu partout perdu en crédibilité et en soutien. Ce phénomène ne s’observe pas qu’en France : l’identité des sociaux-démocrates allemands est aujourd’hui devenue illisible, le PD de Matteo Renzi a été balayé. La crise économique a joué un rôle particulier dans l’éclatement de la social-démocratie, en révélant ses impensés. Quand vous n’avez pas de théorie et que vous avez une pratique éloignée, du fait des circonstances, des attentes de votre électorat, il ne peut y avoir à la clef qu’une déception profonde des électeurs.
Vous parliez tout à l’heure des figures marquantes de l’Europe rose, on remarque dans la deuxième vague social-démocrate une absence de leadership capable de s’exprimer à l’échelle continentale. S’agit-il à votre avis d’une troisième cause de la crise contemporaine ?
Je m’y risque avec prudence mais je pense que oui. Ce dont les sociaux-démocrates ont pâti comme les autres formations politiques, voire davantage, c’est l’affaiblissement du leadership collectif dans chaque pays de l’Union. Alors que nous vivons dans une période où la politique a besoin de plus en plus de s’identifier à une personne, les sociaux-démocrates n’ont pas eu de chef depuis une quinzaine d’années. Tony Blair est une personnalité considérable mais contestable, et il n’était pas social-démocrate. Gerhard Schröder était aussi une personnalité forte. Mais ils n’ont jamais rassemblé autour d’eux. Lionel Jospin incarnait un courant plus à gauche, il était respecté mais isolé. Dans les années 2012-2017, qui précèdent la percée populiste, la gauche n’était pas du tout incarnée. François Hollande n’a pas pu ou pas voulu assumer son rôle de leader. Matteo Renzi n’a pas réussi à s’imposer comme tel. Sans parler du PS d’aujourd’hui, où l’absence d’une direction digne de ce nom conduit à la quasi- disparition du parti lui-même. Même si la social-démocratie défend une ligne plus collective que les autres, la disparition d’un leadership est un phénomène politique majeur. À un moment donné, il faudra bien que quelqu’un se lève et parle pour cette famille.
L’absence de théorisation, la crise économique et un défaut de leadership sont à votre avis à l’origine de la crise de la social-démocratie. Alors que faire ?
Il faut mesurer l’ampleur de la crise que nous traversons et en étudier les origines. Il faut aussi en relativiser l’impact, car la social-démocratie représente encore en Europe environ 20 % des électeurs – beaucoup moins hélas en France – et reste la deuxième force politique.
Lorsqu’on s’intéresse à un vecteur, sa norme compte, mais il faut aussi étudier sa direction — la social-démocratie est-elle une force qui se dirige vers le passé et qui verra ces 20 % définitivement éclatés en une série de forces hétérogènes, ou bien est-elle capable de proposer une base pour un rebond ?
C’est toute la question. A l’heure actuelle, le premier scénario est le plus probable. J’observe que ce qui nous a marqué les quinze dernières années est plus présent que jamais : l’insuffisance de théorisation, l’hétérogénéité idéologique et la faiblesse du leadership. Nous cumulons ces trois handicaps et nous ne sommes pas non plus capables de proposer des réformes de progrès. Quand je vois la façon dont se déroule la préparation des élections européennes, je vois toute la difficulté qu’il y a à construire une plateforme commune et l’absence de leadership, qu’il soit collectif ou individuel. Je suis donc très préoccupé par l’état de la social-démocratie et par ses perspectives.
D’où pensez-vous que la social-démocratie devrait partir afin de se proposer comme une force du futur en Europe ?
Il faut partir de trois questions essentielles – sans oublier la nécessité de garantir la sécurité intérieure et extérieure de l’Union, ou celle de donner une réponse efficace et humaniste à la question migratoire. D’abord, tout doit tourner autour de l’enjeu environnemental et de la lutte contre le réchauffement climatique. La social-démocratie de demain doit être écologiste. Si elle ne l’est pas, elle ne sera pas. Pour rester le cœur de la gauche, il faut aussi être capable d’agréger toutes les forces politiques vivantes, quitte à dépasser les vieilles bases intellectuelles de la social-démocratie. Ensuite, nous devons revenir à la question éternelle et centrale des inégalités, d’autant plus centrale dans une période où le populisme se nourrit de ces dernières. La social-démocratie doit repenser les inégalités d’aujourd’hui dans leur diversité et dans leur complexité, qu’elles soient sociales, entre les genres, ou encore territoriales. Cette problématique doit être le cœur de toute réflexion d’avenir. Enfin, une troisième cause doit être essentielle. C’est le combat pour la démocratie libérale, pour l’État de droit et ses valeurs, pour des sociétés ouvertes, pour des gouvernances plus transparentes dans toute une série de domaines.
La social-démocratie de demain doit être écologiste. Si elle ne l’est pas, elle ne sera pas.
Pierre Moscovici
Justement, la crise de la social-démocratie n’est-elle pas aussi, voire surtout, une crise de la démocratie représentative et de cet arbitrage parfois introuvable entre la complexité des décisions contemporaines et leur caractère démocratique ?
La social-démocratie est la combinaison entre une politique sociale et une approche démocratique. Elle consiste aussi à donner le pouvoir à ceux qui en étaient dessaisis, ceux qui étaient laissés de côté dans la société. Ce sont les deux piliers qu’il faut reconstruire. La social-démocratie d’aujourd’hui souffre de n’être ni assez sociale, ni assez démocrate. Elle est incomplète sur ces deux piliers, auxquels j’ajoute le pilier écologique. Du coup, elle est peu lisible.
Comment envisagez-vous ces trois questions dans votre pratique concrète du politique ?
Si l’on prend la question des inégalités territoriales, on observe, en France comme dans les autres pays, une polarisation croissante entre des métropoles qui vont bien et une périphérie, pour reprendre une expression que je n’approuve pas totalement par ailleurs, qui se trouve déclassée et reléguée, et qui entre dans une révolte qui prend la forme du populisme. Cela a une conséquence directe sur les électorats. C’est l’Amérique de Trump contre l’Amérique bleue, la France de Marine Le Pen contre la France de Macron en 2017. Et cette France risque d’ailleurs de devenir majoritaire demain si la tendance ne s’inverse pas. C’est la France dont j’ai été pendant longtemps l’élu, faite d’électeurs jadis communistes, devenus socialistes et aujourd’hui très clairement FN. Je les connais. Et je sais qu’il y a une bataille à mener sur le plan des inégalités, intellectuellement et politiquement.
En quoi une démocratisation qui passerait par une plus grande ouverture ou par une plus grande transparence serait-elle en mesure de donner une réponse à cet électorat ?
Il y a une question que j’aime explorer et qui pourrait apporter des réponses, c’est la question de la transparence fiscale, qui représente un combat politique très visible aujourd’hui. Il y a aussi une question plus profonde, mais qui demeure essentielle, c’est la lutte pour la transparence dans la gouvernance des institutions européennes. Je suis depuis six ans à l’Eurogroupe, voilà le type même d’instances – même pas d’institutions – dont le pouvoir est absolument majeur, massif, dont l’impact des décisions est considérable et qui est totalement dépourvu de contrôle de toute nature, médiatique, parlementaire.
Vous aviez parlé de scandale démocratique pour désigner l’Eurogroupe…
Oui, tout à fait. Mais il faut comprendre que le scandale ne réside pas tant dans les décisions que l’on prend, qui n’ont pas manqué d’efficacité au demeurant malgré des tâtonnements et des erreurs, mais dans le processus de décision. C’est pourquoi il faut réinventer et revivifier la démocratie au niveau européen, en commençant par « détechnocratiser » la gestion des règles. J’appartiens à l’Eurogroupe depuis plus de six ans. Or qu’est-ce que cette instance ? Elle se réunit dans une salle où l’on trouve dix-neuf ministres, le commissaire en charge, moi-même, le président de la Banque centrale européenne, le président du Mécanisme européen de stabilité, le Fonds monétaire international – quand on traite d’un programme comme celui de Grèce –, et un staff léger qui ne joue pas de rôle direct dans la réunion. Vingt-trois personnes en charge, vingt-trois deputies. Dans cette salle, on peut décider du sort de millions de citoyens en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal, sans qu’il y ait la moindre transparence, le moindre contrôle parlementaire, et pas non plus de contrôle médiatique ou populaire, car en réalité personne ne sait ce qui se passe. C’est ça, le scandale !
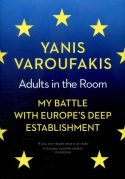
Varoufakis dans Conversations entre adultes a été l’un des seuls à donner une représentation des discussions qui ont lieu à l’Eurogroupe, qu’en aviez-vous pensé ?
Le succès de son livre s’explique précisément parce qu’il racontait pour la première fois ce qui se passait dans les coulisses. Simplement Varoufakis, qui a eu recours à une méthode de voyou en enregistrant des conversations privées, part toujours de faits exacts pour en faire une lecture erronée, mensongère et pro domo. On aurait pu tirer du même référentiel un tout autre récit, plus juste. Mais somme toute, ce n’est pas vraiment la question. Le mieux serait qu’il y ait des actes, des délibérations, un compte rendu devant le Parlement.
Une partie de la gauche pense aujourd’hui qu’à côté de cette opacité, c’est la fixité des règles européennes – dont vous avez été appelé à être le gardien en tant que Commissaire – qui a constitué un obstacle insurmontable à l’invention d’une démocratisation, alors que celle-ci impliquerait du mouvement et du changement. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette critique ?
Je ne suis pas mal à l’aise avec l’existence de règles. Il n’y a pas de société, pas de démocratie, pas d’Etat, pas de construction européenne sans règles communes. En Europe, nous avons une quasi Constitution, faite d’un ensemble de traités. Je respecte les institutions européennes qui sont maintenant en place, je les connais toutes de l’intérieur et je suis un réformiste. Je pense donc qu’on peut et qu’on doit les modifier, les améliorer, les ouvrir, parce que nous ne construirons qu’à partir de ces structures, de ces institutions ou de ces règles. Toute autre approche aboutit soit à l’implosion soit à l’hypocrisie.
Pourriez-vous expliciter le sens de cette alternative ?
Quand on dit que l’on veut une autre Europe, on fait semblant d’oublier que l’Europe existe déjà et qu’on ne peut pas en bâtir une autre à l’unanimité. Il s’agit donc d’une position qui aboutit à la désagrégation ou à l’implosion. D’un autre côté, quand on continue à prétendre que l’on change tout alors que l’on sait qu’on ne pourra pas le faire, on se retranche dans l’hypocrisie. Je ne suis pas gêné par l’existence et par la défense des règles européennes. Je ne suis même pas gêné par l’existence des règles du Pacte de stabilité et de croissance. Elles sont dictées par une logique assez robuste, qui est d’éviter que la dette augmente. Cela fait longtemps que j’appartiens à une courant méconnu dans la social-démocratie, qui est celui que j’appellerais “des socialistes ennemis de la dette”.
Il faut réinventer et revivifier la démocratie au niveau européen, en commençant par « détechnocratiser » la gestion des règles.
Il s’agit d’une position qui avait été formulée autrefois par Dominique Strauss-Kahn…
J’ai travaillé pendant des années avec lui, même si nos chemins ont divergé, avant même le scandale du Sofitel. DSK tenait en effet ce raisonnement : la dette est l’ennemie de l’économie, donc elle est aussi l’ennemie de la gauche. En effet, plus le service de la dette augmente, plus vous affaiblissez l’économie, moins la place pour les politiques et services publiques est éminente. En Italie, le service de la dette est à 65 milliards d’euros. C’est le premier budget de l’Etat à égalité avec l’Éducation. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, toute politique qui augmente la dette n’est pas une politique bonne pour le peuple, ni pour la gauche. J’ai donc toujours pensé que la réduction de la dette était un objectif de gauche.
Pour revenir à la question de la fixité des règles, comment l’avez-vous affrontée dans votre expérience de Commissaire aux Affaires économiques et financières, fiscalité et douanes ?
Les règles ne sont pas immuables. Elles peuvent être modifiées, améliorées, simplifiées, interprétées. Quand je suis arrivé à la Commission européenne, une logique mécaniste prévalait dans l’interprétation du Pacte de stabilité et de croissance. À la rigidité nous avons préféré tout de suite la notion de flexibilité. Nous utilisons depuis cinq ans toute la flexibilité qui existe dans le cadre des règles. Si ça avait été une autre Commission et un autre commissaire, nous aurions probablement sanctionné l’Espagne, le Portugal, l’Italie, peut-être même la France au cours des quatre dernières années. Mais j’ai toujours eu la conviction que quand un cas était « borderline » il fallait le traiter avec souplesse.
Le cas italien dépasse-t-il aujourd’hui le cadre de cette flexibilité ?
Oui, il y a des situations différentes, comme la situation italienne actuelle. Un arbitre sympathique peut considérer qu’un service qui touche la ligne extérieure est bon. Il peut être très, très sympathique si la balle est juste dans le couloir et s’il est terriblement myope. Mais quand elle est dans les bâches ou quand elle vise directement le public, on ne peut pas considérer que le point a été marqué ! Quand un gouvernement comme celui de la Ligue et du M5S envoie la balle dans les gradins, c’est là que l’existence de règles et d’un arbitre devient utile.
Dans le débat italien en ce moment, la plupart des media se sont emparés d’une sorte de duel politique : Moscovici contre Salvini. Or dans la version la plus répandue de cet affrontement on a toujours l’impression qu’il s’agit d’un combat de la technocratie contre la politique et la démocratie…
C’est un problème et une erreur. Car je pense que technocratie et populisme sont des doubles monstrueux, caricaturaux. Dans un cas la politique se fait au nom d’un peuple réifié, inexistant. Dans l’autre cas elle se fait au nom de la technicité et de l’administration pure, tout aussi inexistante. On doit refuser ces deux pôles. C’est la raison pour laquelle j’essaie de politiser le débat avec Matteo Salvini. Je ne me place pas en technocrate, je refuse de le faire.
De quelle manière ?
D’abord je réfute l’argument selon lequel se trouve d’un côté des technocrates, non élus, et de l’autre des hommes qui porteraient le peuple. La Commission européenne n’est pas une technocratie, mais un éxécutif politique démocratiquement contrôlé par le Parlement européen , exactement comme l’est le gouvernement d’un État membre. Certes nous sommes des hommes et des femmes politiques, et non des fonctionnaires, mais nous sommes investis et contrôlés par le Parlement, comme un ministre l’est par un parlement national. Nous sommes donc une instance politique qui s’efforce de se comporter politiquement et qui pour cela part de règles. Dans le cas italien il y avait plusieurs façon de procéder. J’aurais pu dépasser mon rôle, frapper fort : c’est précisément ce que j’ai refusé et ce que je me refuse à faire. Je n’ai fait qu’agir selon les règles, en m’efforçant de ne pas aller trop loin. Les règles, même dans ce cas de figure, sont à interpréter avec flexibilité. On aurait pu déclencher beaucoup plus tôt une procédure pour déficit excessif, je m’y suis refusé. Dans le débat avec Salvini, je fais fonctionner les deux hémisphères de mon cerveau.
En quel sens ?
L’hémisphère gauche, c’est celui d’un homme politique qui a des convictions antifascistes depuis toujours, fils d’un père venu en France en fuyant le totalitarisme, et d’une mère cachée en Lozère par des Justes. Je suis totalement allergique à tout ce qui peut rappeler cette période, très sensible à cela et je ne laisse rien passer. Avec cet hémisphère, je combats Matteo Salvini, l’homme d’extrême-droite, l’ami de Marine Le Pen, le populiste, le ministre anti-migrants. Mais dans ma capacité de Commissaire, avec mon hémisphère droit, j’essaie de garder ce que Rouletabille appelait « le petit bout de la raison » et de ne pas donner de prise à une critique de la Commission. Je respecte totalement la légitimité du gouvernement italien, je ne discute pas ses choix, mais leur impact sur la croissance, le déficit et la dette. C’est ce qui fait tout le charme de cet affrontement.
Dans La Grande transformation Karl Polanyi a une pensée politiquement intéressante quand il écrit que « l’efficacité politique du fascisme n’a pas à voir avec sa force matérielle et numérique » mais que « la caractéristique de la ‘situation fasciste’ est la désintégration psychologique et morale de toutes les forces de résistance ». Voyez-vous aujourd’hui une résistance à la mesure de la poussée néo-nationaliste européenne ?
La réponse est très clairement non. C’est bien là le grand drame de cette époque. Polanyi est tout à fait éclairant. Certes, cette citation contribue à entretenir la comparaison avec les années 1930, mais elle ne me choque pas. Il y a des facteurs de ressemblance, et je n’hésite pas à voir une montée des périls comparables à ceux de cette époque. Les acteurs ne sont pas les mêmes et je ne veux pas qualifier trop rapidement quiconque de fasciste, au risque de rejoindre trop vite le point Godwin. Pourtant, nous faisons face à une extrême droite qu’il faut nommer, qui possède certaines caractéristiques du fascisme, et contre qui pourtant l’esprit de résistance est trop faible. En Europe, ce sont les idées de l’extrême-droite qui sont en train de devenir hégémoniques, portées par une force politique très offensive, qui est la force populiste. Si l’on regarde la configuration politique contemporaine, les sociaux-démocrates restent assez bien câblés, mais ils n’ont pas de capacité propulsive dans leur discours. Ils sont devenus, et je le regrette, non pas une force motrice, mais une force d’appoint. La famille conservatrice et la famille libérale ne sont qu’apparemment unies, et chacune porte en son sein des leaders et des courants qui sont eux-mêmes dominés par la pensée populiste. Il y a des populistes – ou en tout cas des influences populistes – chez les libéraux. Mais de cela nous n’en parlons jamais.
À qui pensez-vous ?
À Christian Lindner, le président du Parti libéral-démocrate allemand (FDP), par exemple. Il est lourdement responsable de l’échec des élections allemandes et de la formation de la grande coalition qui est en train de laminer la CDU et le SPD. Il y a aussi Andrej Babiš en République tchèque, qui incarne un populisme affairiste. Quant au Parti populaire européen (PPE) il n’a pas souhaité réellement faire barrage au populisme. Sa position sur Viktor Orban est à cet égard tout à fait typique, puisqu’il ouvre un débat qu’il ne tranche pas, puisqu’il a fait adopter à la majorité l’article 7 (sur les violations de l’État de droit) tout en continuant à soutenir le Premier ministre Hongrois..
Quand on regarde de près les affaires italiennes on se rend compte que le Medef italien (Confindustria) est loin de s’être entièrement rallié à Salvini, ce qui est assez contre-intuitif étant donné sa base électorale. On peut penser qu’une partie de ce ralliement vient d’actions dont vous pouvez être considéré comme le responsable. Est-ce que ce n’est pas là la force de résistance dont nous parlions avec Polanyi ?
Cela doit faire mal à mes racines marxistes, mais oui, le patronat va jouer un rôle éminent dans l’affaire italienne, parce qu’en l’absence d’opposition crédible, la Confindustria et les entreprises en général auront une voix très importante. Et cela d’autant plus qu’elles représentent en partie l’électorat de Matteo Salvini, ou du moins les forces économiques pour lesquelles il doit travailler, avec lesquelles il doit escompter. Cela étant dit, je souhaite que le Partito Democratico (PD) se reconstitue et que renaisse une force démocratique et pro-européenne crédible en Italie. Il faudrait cependant que ce parti gagne en courage, en cohérence et en articulation.
En quel sens ?
Je peux vous citer une anecdote. Quand je suis allé à Rome à la mi-octobre, j’avais pris rendez-vous avec Maurizio Martina, qui était encore secrétaire général du PD. Un quart d’heure avant le rendez-vous, il annule, en me disant qu’il n’était pas prudent que nous nous voyions au siège du PD. Comme si le chef d’un parti de centre-gauche était incapable d’assumer de rencontrer le commissaire européen social-démocrate que je suis ! Je ne prétends certes pas incarner à moi seul le leadership européen, mais il semble je sois devenu l’ennemi public n°1 aux yeux d’un certain nombre d’Italiens qui soutiennent Matteo Salvini. Le problème avec les populistes, c’est qu’il y a toujours un dilemme. Si vous les affrontez, on dit « vous perdez parce que vous les nourrissez ». Si vous ne les affrontez pas, vous perdez parce que vous ne les combattez pas. Tant qu’à perdre, il vaut mieux perdre les armes à la main et, surtout, tout faire pour l’emporter : je pense donc qu’il faut les affronter. Un parti qui se dérobe est un parti qui n’a pas d’avenir. Heureusement d’autres personnalités m’ont reçu de manière cordiale et amicale, à commencer par les deux présidents de la République successifs Giorgio Napolitano et Sergio Matarella.
Le problème avec les populistes, c’est qu’il y a toujours un dilemme. Si vous les affrontez, on dit « vous perdez parce que vous les nourrissez ». Si vous ne les affrontez pas, vous perdez parce que vous ne les combattez pas. Tant qu’à perdre, il vaut mieux perdre les armes à la main et, surtout, tout faire pour l’emporter : je pense donc qu’il faut les affronter.
Pierre Moscovici
On peut noter qu’un non-respect des règles a été nécessaire dans le cas italien pour que la Commission en vienne à jouer un rôle politique et pour qu’émerge une figure européenne capable de lancer un débat. Pensez-vous que l’incarnation et la politisation du rôle de Commissaire représentent deux tendances souhaitables ?
Cela ne me crée pas que des amis en Italie, mais je reçois aussi un fort soutien. En tout cas, on ne peut plus tout à fait penser qu’il s’agit d’une lutte de la technocratie contre la démocratie. Ce sont bien deux conceptions politiques de ce que doit être l’Europe qui s’opposent. Dans cette perspective, j’étais favorable, et je le reste, au principe du Spitzenkandidat. Observons quand même qu’il a perdu beaucoup de sa force et de son sens, parce que ni le candidat du PPE ni le candidat du PSE ne peuvent être considérés comme les chefs incontestés de leur camp. Et puis les autres partis ne jouent pas le jeu. Il va donc falloir réinventer cette règle. Soit elle devient automatique, générale et elle perdure, soit elle n’est plus automatique, elle est partielle et elle doit disparaître. Elle doit être accompagnée par des listes transnationales, qui donnent un enjeu européen au débat des élections européennes, qu’il faut avoir maintenant.
Comment voyez-vous la séquence politique qui s’ouvrira après les résultats des élections européennes de mai 2019 ?
Ce qui va se jouer au lendemain des prochaines élections européennes sera absolument crucial. Au fond, il y a trois scénarios : la défaisance, le sursaut, et l’immobilisme.
Commençons par le premier scénario, celui de la défaisance…
Ou de l’implosion. Il présuppose une percée de l’extrême-droite qui serait telle qu’elle remettrait en question l’existence de la zone euro. Un scénario dans lequel le gouvernement populiste voudrait que l’Italie sorte de la zone euro et voudrait construire un autre système. Dans ce scénario, les partis nationalistes occupent une telle place dans les institutions européennes qu’elles sont en réalité la force autour de laquelle tout s’organise. Ce scénario est un scénario d’implosion. Il ne se joue pas non plus forcément sur les seules élections européennes, mais s’installe dans une montée des périls néonationalistes d’extrême-droite en Europe, qui peuvent devenir majoritaire. Les remparts sont faibles, la France elle-même risque de basculer dans une situation dangereuse. Nos institutions sont capables d’entretenir une illusion majoritaire, mais en vérité l’électorat est très fragmenté et la situation est en conséquence précaire.
Le deuxième scénario est un scénario de sursaut ?
Oui, les élections européennes dans ce scénario déboucheront sur un résultat décevant pour les populistes. Dans ce cas, les différentes forces politiques agissent au Parlement, à la Commission et au Conseil et reprennent à bras le corps les dossiers qui n’ont pas été complètement saisis, à commencer par celui de la zone euro – qui est beaucoup plus important qu’on ne le croit, car il porte en lui la capacité à combattre les inégalités.
Le troisième scénario est celui de l’immobilisme…
Oui, c’est la guerre de tranchées. Dans ce scénario il y a une percée populiste conséquente, insuffisante pour faire basculer l’Europe mais suffisamment forte pour que le système soit ralenti voire paralysé, avec un bloc majoritaire trop hétérogène pour faire avancer des réformes. On verrait un succès croissant des populistes et des nationalistes et le Conseil comme le Parlement seraient divisés en deux camps. La capacité d’initiative n’est pas la même dans chaque scénario. Il faut donc créer les conditions qui permettent un sursaut. C’est en cela que ces élections européennes sont les plus importantes depuis que le Parlement est élu au suffrage universel (1979). Si elles débouchent sur un scénario gris ou noir, alors l’Europe est en danger.
La politique européenne semble constamment suspendue à un rythme d’urgence et de crise qui se confronte paradoxalement à une lenteur structurelle. Se pose donc la question des occasions ou des moments favorables à saisir pour proposer des transformations concrètes. Quelles fenêtres d’action voyez-vous dans le futur proche ?
Je crains que rien de décisif ne se passera en zone euro jusqu’au lendemain de l’élection, même si j’espère quelques avancées sur l’Union bancaire, le rôle du Mécanisme Européen de Stabilité ou le principe d’un budget de la zone euro en décembre 2018. C’est pourquoi je pense que la prochaine opportunité d’action ne se situera qu’en 2020. Il y en a eu avant, qui ont coïncidé avec la présidentielle française, et les élections allemandes, mais cette fenêtre s’est refermé du fait de la formation d’un front hostile mené par les Néerlandais et les pays nordiques. Le problème est qu’en 2020 le contexte se sera encore forcément dégradé.
D’un point de vue institutionnel, comment verriez-vous la mise en œuvre de ces transformations ?
La logique voudrait qu’on les mette en oeuvre dans le cadre d’une nouvelle législature, donc d’un nouveau mandat. Par conséquent les élections européennes et leurs lendemains sont le prochain rendez-vous. Le problème est que ce rendez-vous risque de se dérouler dans des conditions difficiles.
Et du point de vue de la Commission ?
La Commission européenne s’inscrit dans un cycle politique. Quand nous sommes arrivés, nous avons lancé un certain nombre d’initiatives, j’en citerai trois : le plan Junker immédiatement en 2015, la flexibilité, très vite également en 2015, puis le cap franchit contre la fraude et l’évasion fiscale, aussi très rapidement, par des directives. Puis nous avons géré la montée en puissance et nous entrons naturellement dans la période du cycle, à la fin de cette année, où la Commission gérera petit à petit les affaires courantes. Il faut dans l’ensemble avoir une approche de législature.
La difficulté est que les institutions européennes ne sont pas tout à fait construites pour assurer pleinement une logique de législature…
Oui, le binôme Commission-Parlement ne s’est pas totalement affirmé comme étant le cœur battant de la gouvernance européenne, et le Conseil européen, lui, se reforme et se déforme constamment, ce qui vient percuter cette logique. C’est toute la difficulté d’institutions qui n’obéissent pas à un raisonnement à la Montesquieu, mais qui répondent à un ordre beaucoup plus complexe, mélangeant l’intergouvernementalisme et la supranationalité.
Avant de conclure, nous aimerions entendre votre réaction à une belle formule quelque peu tragique prononcée par Pascal Lamy lors d’une conférence internationale sur Kojève au parlement européen : « l’Europe est condamnée à la puissance » — qu’en pensez-vous ?
Nous sommes dans une phase tragique de l’histoire. Toute personne qui l’aborde naïvement, en pensant que l’on est dans le « business as usual », que nous vivons somme toute une simple phase du cycle politique précédent l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle force politique, est aveugle à ce qui se passe sous ses yeux, et chemine au bord de l’abîme.
Prenez le cas de Donald Trump à l’extérieur de nos frontières européennes. En regardant de près les résultats des midterms, Trump semble bien un président sinon condamné, du moins promis à être un one term president. Il lui sera difficile de gagner la prochaine élection présidentielle si l’électorat qui a voté pour les Démocrates le 6 novembre se consolide. N’empêche que même s’il ne l’a pas gagnée et a fortiori s’il la gagne, il aura radicalisé une moitié de l’Amérique et le Parti républicain sortira de la période Trump durablement transformé. Toute sa frange modérée, les héritiers d’Abraham Lincoln auront disparu. Et les pertes des démocrates aux sénatoriales dans les red states c’est cela au fond. C’est le territoire qui se met à parler, peu importe que vous soyez modéré ou non. Et on en arrive à un parti politique qui n’a plus de modérés qui soient capables d’être vocaux – à part peut être Romney.
Voyez-vous un phénomène similaire en Europe ?
Oui, petit à petit les populistes pourraient s’imposer comme interlocuteurs. Donc nous sommes dans une période tragique. Regardons le monde tel qu’il est la Chine, le Golfe, les États-unis et au-delà de ça, les forces politiques dans le monde. Je serai dans quelques jours au G20. Qui sont les démocrates libéraux au sein du G20 ? Le Canadien, l’Australien, l’Allemande, la Britannique, le Français, l’Union européenne et, avec ses particularités, le Japonais. A côté de ceux-là, vous avez Bolsonaro, Trump, Poutine, Xi Jinping, Erdogan, le prince héritier Mohamed Ben Salmane, le Premier ministre indien Modi. La planète est devenue majoritairement illibérale – et, à l’occasion, populiste. L’Europe a donc un devoir sur ce point, qui est de se constituer, de se former, de devenir puissante. A la fois plus unie dans les formes de gouvernance, plus vigoureuse dans les politiques qu’elle propose et capable de peser à l’échelle mondiale, parce qu’aussi faible et fragile soit elle, elle reste un modèle politique, économique, social, culturel, unique au monde.
La planète est devenue majoritairement illibérale – et, à l’occasion, populiste. L’Europe a donc un devoir sur ce point.
Pierre Moscovici
Quels sont les éléments de singularisation que vous retenez de ce modèle à défendre ?
Ils sont très nombreux. Par exemple, en Europe nous n’avons pas la peine de mort, nous voulons l’égalité entre les hommes et les femmes, nous refusons toute forme de discrimination, nous sommes conscients du réchauffement climatique, nous défendons un modèle social fondé sur la réduction des inégalités et sur la sécurité sociale, nous défendons le multilatéralisme, nous sommes contre le protectionnisme… et je pourrais continuer. Certes, cet environnement unique a pu être érodé et contesté de l’intérieur, mais il s’agit tout de même d’une entité qui a des principes à apporter au monde. Mais pour cela il faut que l’Europe se constitue. C’est peut-être ce que Pascal Lamy entendait par « condamnée à la puissance ». Soit l’Europe se constitue maintenant, et alors nous serons un acteur décisif pour nos propres peuples et dans le monde, soit nous nous décomposons, c’est le risque de la défaisance. Alors nous serons une proie offerte à tous les autres — 27 États isolés et impuissants dans l’anomie d’un monde dangereux. C’est ce contre quoi je me bats !


