La nouvelle grande transformation
En proposant une critique du dernier grand livre de l'économiste Branko Milanovic, Andrea Capussela montre comment une analyse des origines politiques et économiques de notre temps pourrait, en réalité, ouvrir une brèche vers des temps nouveaux.
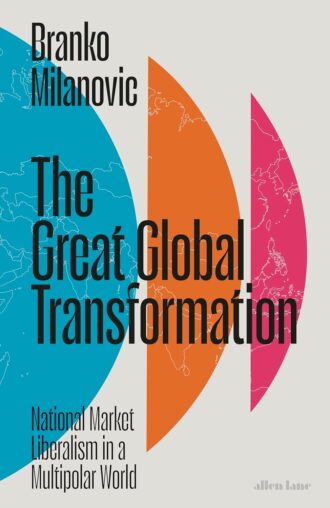
Je ne sais pas par quel miracle il a réussi à le faire poser aussi longtemps — vu les spasmes et les crises qui le secouent — mais le portrait du monde que Branko Milanović vient d’achever est remarquablement réussi. Et c’est bien là le problème : en se reconnaissant un peu trop fidèlement dans la toile, le monde pourrait bien réagir comme le pape Innocent X devant le chef-d’œuvre de Velázquez : « troppo vero ». Il faut dire qu’il ne s’y découvre pas sous son jour le plus flatteur.
Le plus difficile à accepter dans le dernier livre de Milanović est son pessimisme implicite à l’égard de la possibilité d’une réforme ou de tout changement positif. Cependant, avant de critiquer ce que l’ouvrage ne dit pas, il est préférable de dire ce qu’il dit, qui est souvent remarquable.
Il est particulièrement frappant de constater à quel point les dernières offensives de la Maison-Blanche — à l’extérieur : le Groenland, la capture de Maduro et du pétrole vénézuélien ; à l’intérieur : les assassinats de Minneapolis, la pression judiciaire sur la Réserve fédérale et la pression politique sur la Cour suprême — renforcent le cadre analytique proposée par The Great Global Transformations.
Milanović est un contributeur du Grand Continent et un ami, il faut le dire, mais les critiques faites à son livre confirment mes propos favorables ; la seule critique négative consiste à l’accuser de justifier Trump. Il est vrai qu’il ne dit jamais que l’homme orange est mauvais ou qu’il ne l’aime pas, mais fallait-il qu’il ajoute une autre accusation à celles déjà proférées ?
Même Tolstoï ne s’en prend pas à Napoléon ; il préfère le montrer sur le champ de bataille, indifférent au sang qu’il a versé. De même, Milanović explique quelles forces ont déterminé la victoire de Trump en 2017 et en 2024, les raisons de ses choix et pourquoi il est si dangereux. Je ne considère pas non plus comme élogieuse la remarque selon laquelle l’obscénité de Trump aurait permis de révéler la corruption qui restait auparavant hors de portée.
Une autre critique 1, par ailleurs favorable, soutient que Milanović confond capitalisme, mondialisation et néolibéralisme, et dévalorise ainsi la singularité du parcours de la Chine. Je n’entrerai pas dans cette discussion, qui ne concerne ni les thèses principales du livre ni les points que je vais commenter, mais je remarque que Milanović a consacré un autre livre, Capitalism, Alone 2, aux modèles occidental et chinois du capitalisme. Le dernier livre de Milanović, construit sur les bases posées par ce livre et par le précédent, Global Inequality 3, décrit plutôt les tendances qui ont façonné le dernier demi-siècle et qui jettent leur ombre sur les décennies à venir.
Milanović parle beaucoup des États-Unis et de la Chine, moins de la Russie, peu de l’Inde et du reste de l’Asie, très peu du reste de la planète. En décrivant les élites des pays retenus, il explique ainsi ce choix : les deux « géants » sont « paradigmatiques » des transformations mondiales en cours, et leur poids leur permet de les influencer 4. L’argument est donc plus général, et invite à voir dans l’évolution des États-Unis l’annonce de ce qui pourra se produire également en Europe.
La fin d’une hégémonie
La « grande transformation » qui donne son titre au livre résulte de l’essor économique et technologique de l’Asie, et en particulier de la Chine. Milanović rappelle qu’entre 1974 et 2022, la part de la Chine dans le produit mondial est passée de 2 % à 22 %, à pouvoir d’achat égal, avec une croissance annuelle moyenne par habitant de 7,7 %. Parallèlement, la part des États-Unis a chuté de 22 % à 15,5 %. En le rapportant à la durée qu’a exigée le développement d’autres pays — et à la taille de leur population — Milanović montre que ce bond en avant relève d’un tout autre ordre de grandeur que les épisodes jusqu’ici tenus pour exceptionnels (le Japon de 1952 à 1991, les États-Unis de 1865 à 1914).
Le réveil de l’Asie a largement comblé l’écart ouvert par la révolution industrielle, qui, il y a deux siècles, avait rompu un équilibre séculaire en propulsant la productivité, les revenus, la puissance militaire et l’influence politique de l’Europe occidentale — puis de l’Amérique du Nord — bien au-dessus de celles de l’Inde et de la Chine. Pour Milanović, ce rééquilibrage est un événement d’une importance comparable à cette rupture : il inaugure une nouvelle période historique.
Cette rupture relève peut-être moins de l’histoire économique — celle qui met le progrès technique au premier plan — que de l’histoire politique ; or c’est précisément sur ce terrain que Milanović s’aventure. La croissance chinoise a déplacé le centre de gravité de la production et du commerce mondial vers le Pacifique ; elle a créé les conditions d’un face-à-face géopolitique avec les États-Unis, redessiné la distribution mondiale des revenus et nourri, dans les pays occidentaux, un sentiment diffus d’insécurité économique et de mécontentement politique. À ce titre, l’écho du livre de 1944 de Karl Polanyi, 5, semble pour une fois parfaitement justifiée.
Pour Milanović, les sociétés occidentales sont désormais contraintes de choisir entre une droite d’inspiration trumpiste et les élites issues du néolibéralisme.
Andrea Capussela
L’autre phénomène qu’examine Milanović, en parallèle du réveil de l’Asie, est « la formation de nouvelles élites riches dans tous les grands pays du monde », toutes « bénéficiaires des politiques néolibérales » des quatre dernières décennies. Ces élites ont nourri, chez ceux que ces politiques ont laissés de côté, des « sentiments contre-révolutionnaires » croissants ; elles sont aujourd’hui la cible de l’« action rétrograde ou contre-révolutionnaire » menée par Trump, Xi Jinping, Vladimir Poutine et d’autres 6.
Ici, Milanović ne fait pas référence au « double mouvement 7 » de Polanyi, mais en parlant de la réaction des classes moyennes et inférieures des pays occidentaux, frappées par « la stagnation des salaires réels, la perte d’emplois et la généralisation de la précarité 8 », il écrit :
« Il fallait peut-être un Polanyi pour rappeler que la question n’était pas seulement affaire d’argent. Il s’agissait de respect de soi : avoir un travail, savoir quoi faire chaque matin, être un modèle pour ses enfants, ne pas dépendre de l’argent des autres 9. »
C’est sur ce deuxième thème que je vais me concentrer, en partant de l’association inhabituelle de ces trois hommes politiques sous l’épithète de « contre-révolutionnaires ». Mais il convient d’abord d’évoquer les liens que Milanović établit entre l’ascension de ces nouvelles élites et le réveil de l’Asie.
La fin du néolibéralisme mondial
L’ascension de nouvelles élites et le réveil de l’Asie. sont la conséquence de la mondialisation néolibérale. Tous deux ont joué contre les classes moyennes et inférieures de l’Occident, dont les revenus et le statut ont perdu du terrain tant par rapport aux élites, qui s’éloignaient de plus en plus d’elles, que par rapport à la nouvelle classe moyenne mondiale, qui les pressait par le bas ; tous deux ont également provoqué « la fin du néolibéralisme mondial 10 ».
D’une part, la croissance chinoise a bouleversé l’ordre international unipolaire qui avait structuré la mondialisation pendant quatre décennies : hiérarchique et dominé par les États-Unis, cet ordre s’est montré incapable d’intégrer une puissance d’une telle ampleur ni d’absorber la tension géopolitique qui en a résulté. D’autre part, la mondialisation, la doctrine néolibérale qui l’a portée et les nouvelles élites qu’elles ont fait naître sont devenues la cible de la révolte populiste et des poussées contre-révolutionnaires évoquées plus haut. Ébranlé de l’extérieur comme de l’intérieur, le néolibéralisme mondial a fini par céder.
En Occident, ce néolibéralisme s’est transformé en « libéralisme national marchand (national market liberalism) ». Ce modèle conserve la matrice néolibérale dans l’organisation de l’économie intérieure, mais renonce à l’internationalisme et au cosmopolitisme pour adopter le nationalisme et le mercantilisme— au prix de l’abandon de plusieurs acquis essentiels du libéralisme classique.
C’est le portrait des politiques de Trump II : à l’extérieur, des droits de douane discriminatoires, des sanctions, des menaces, voire le recours illégal à la force ; à l’intérieur, des baisses d’impôts, la déréglementation, l’usage de la violence contre les indésirables et les opposants, ainsi que des pressions exercées sur toute forme de pouvoir indépendant.
Dans ce contexte, la question est de savoir si la conjonction du repli de la mondialisation et de la régression des régimes nationaux peut être enrayée, ou si elle est appelée à se généraliser — du moins en Occident.
Mondialisation, convergence et conflit
Après avoir illustré la redistribution géographique de la production et des revenus, Milanović aborde dans le deuxième chapitre ses effets sur les relations internationales.
Milanović commence par une revue critique des théories disponibles, en commençant par celles selon lesquelles le libre-échange international favorise la coopération et la paix, comme le « doux commerce » de Montesquieu, pour qui la paix est atteinte par l’interdépendance économique, ou l’idée d’Adam Smith, pour qui le commerce favorise la convergence économique et technologique entre les nations, créant un équilibre des forces et décourageant les conflits non pas par interdépendance, mais par crainte réciproque.
L’auteur aborde ensuite les théories qui affirment, au contraire, que le commerce génère instabilité et conflit : c’est d’abord la thèse de John Hobson, Lénine et Rosa Luxembourg, avancée avant la Grande Guerre puis reprise pour l’expliquer, selon laquelle la cause profonde du conflit était la « concurrence impérialiste », alimentée par la pression d’investir à l’étranger les capitaux que la faiblesse de la consommation intérieure ne rémunérait pas suffisamment. Plus tard, Joseph Schumpeter, bien qu’ayant affirmé l’irrationalité « atavique » de l’impérialisme, a reconnu de manière similaire la potentielle agressivité externe de la forme de capitalisme qu’il jugeait la plus efficace et prévoyait dominante : le capitalisme monopolistique 11.
Dans une large mesure, conclut Milanović, ce sont les conditions contingentes qui déterminent laquelle de ces logiques prévaut. Jusqu’à la première décennie de ce siècle, la Chine et les États-Unis ont coopéré pacifiquement, par intérêt mutuel et interdépendance, mais aussi souvent par aversion commune pour Moscou. Depuis s’est ouverte une phase de « concurrence impérialiste », non pas tant pour la domination des ressources, des marchés et des territoires extérieurs, comme dans la période précédant 1914, mais pour la domination « des règles qui régissent les relations économiques internationales 12 ».
Comme le prédit la seconde catégorie de théories, le passage de la coopération au conflit s’explique moins par la disparition d’un adversaire commun que par l’enchevêtrement de déséquilibres économiques internes : aux États-Unis, la stagnation des salaires réels et la perte d’emplois, largement liées aux importations chinoises et aux délocalisations ; en Chine, la pression exportatrice résultant d’un niveau de consommation intérieure trop faible. Le tournant survient lorsque, aux États-Unis, le mécontentement des classes moyennes commence à menacer le contrôle politique des élites structurées autour du duopole des centristes démocrates et républicains. Si la crise de 2008 en accélère la cristallisation, la victoire de Trump en 2016 en marque l’explosion.
À ce stade, les élites américaines avaient deux options pour se protéger : « changer les règles de la mondialisation afin qu’elle ne touche plus les classes moyennes » ou « augmenter leurs revenus en taxant davantage les riches 13 ». Elles ont choisi la première option, faisant peser sur l’ordre international le poids de leur tentative d’apaiser la révolte électorale à laquelle elles étaient confrontées. Cela explique à la fois les mesures protectionnistes ou hostiles à la Chine des administrations Trump I et Biden, ainsi que le déluge de droits de douane de Trump II et ses autres politiques « anti-mondialisation ».
L’Amérique n’est pas dans le piège de Thucydide
Milanović écarte implicitement une lecture thucydidéenne des relations sino-américaines, selon laquelle l’hégémon ne saurait tolérer l’ascension d’un rival. Il soutient au contraire qu’au moment du basculement de la coopération au conflit, « la Chine ne menaçait pas encore la domination américaine [en Asie] » et que, sans ces facteurs internes, « la rivalité géopolitique entre les États-Unis et la Chine serait apparue beaucoup plus tard — voire jamais 14 ».
Lorsqu’il aborde la perspective du « dépassement » chinois, en revanche, le raisonnement de Milanović change d’échelle. D’ici vingt ou trente ans, non seulement l’économie chinoise devrait représenter le double de celle des États-Unis en parité de pouvoir d’achat, mais le nombre de Chinois riches — en prenant pour seuil le revenu médian américain — excédera celui des « riches » américains. C’est ce second indicateur, précise-t-il, qui est le plus révélateur. Il ajoute aussitôt que la perspective de ce dépassement redonne une « base rationnelle » aux politiques hostiles à la Chine et à la mondialisation : même au prix d’un ralentissement de la croissance américaine, leur objectif est de « provoquer un ralentissement encore plus important de la croissance chinoise et de retarder le dépassement et la remise en cause plus sérieuse de la suprématie économique américaine par la Chine 15 ». Le même raisonnement vaut pour les relations politiques internationales : si rien ne l’entrave, la Chine pourra bientôt revendiquer un statut que Washington ne sera pas disposé à lui reconnaître 16.
Une réaction s’est élevée contre les élites filles du néolibéralisme mondial : selon les mots de Milanović, le ressentiment populaire les a associées à ses « effets sociaux néfastes ».
Andrea Capussela
On retrouve là une lecture éminemment thucydidéenne qui, inversée, s’inscrit assez bien dans la logique d’Adam Smith : en cherchant à ralentir l’ascension chinoise, Washington tenterait d’empêcher l’établissement de cet équilibre des forces qui, une fois stabilisé, fait naître la paix de la crainte réciproque. Milanović ne coordonne pas explicitement ce récit thucydidéen avec celui — que je viens de résumer — centré sur les déséquilibres économiques internes ; mais les deux interprétations ne sont nullement exclusives 17.
La métamorphose des élites : l’esprit du nouveau capitalisme
La seconde moitié du livre, qui examine les élites et régimes nationaux, traite presque exclusivement des États-Unis, de la Chine et de la Russie.
En Occident, Milanović observe l’avènement de « nouvelles classes dirigeantes » et d’un « nouveau capitalisme ». Aux côtés de ceux qui sont riches grâce au capital qu’ils possèdent ou aux salaires qu’ils perçoivent, une figure presque inconnue du capitalisme classique s’est répandue : celle des personnes qui ont à la fois des revenus élevés provenant du capital et des revenus élevés provenant du travail. Ce phénomène apparaissait déjà dans Capitalism, Alone, et fait ici l’objet d’une analyse empirique approfondie : à l’issue d’une longue progression, aux États-Unis, 30 % du décile supérieur de la distribution des revenus est désormais composé de personnes qui appartiennent à la fois au décile supérieur de la distribution des revenus du capital et au décile supérieur de la distribution des revenus du travail.
Pour désigner ce phénomène, Milanović a forgé le terme homoploutia, qui renvoie à la contribution égale des deux sources de richesse. Aux États-Unis, « l’élite homoploutique » représente 3 % de la population (soit 30 % des 10 % les plus riches) ; dans un pays moins développé, le Mexique, « l’homoploutie » est beaucoup plus faible (moins de 10 % [des 10% les plus riches 18]) ». En Europe occidentale, elle atteint un niveau intermédiaire, situé entre 20 % et 25 %, en progression constante.
Milanović reconnaît deux voies vers l’homoploutie. L’une est héréditaire : le capital de la famille d’origine garantit des avantages en termes d’éducation et d’opportunités, qui se traduisent souvent par des salaires élevés. L’autre est la voie du succès individuel : « de bonnes études, de la chance, un travail acharné et un salaire élevé 19 », qui permettent de réaliser des économies substantielles et de percevoir des revenus du capital — ce qui, bien sûr, ouvrira également la voie héréditaire à la génération suivante.
La qualité de l’éducation reçue et les qualifications académiques obtenues jouent un triple rôle. Elles facilitent la reproduction de la nouvelle élite et, en même temps, elles érigent une barrière entre celle-ci et les classes inférieures, d’autant plus haute que l’éducation de qualité est coûteuse 20. L’ascension de cette nouvelle élite semble en effet avoir contribué au déclin de la mobilité sociale observé au cours des dernières décennies.
Associés à des revenus élevés et à la croyance dans le principe méritocratique, leur éducation et leurs qualifications académiques confèrent en outre une confiance en soi aux membres de l’élite homoploutique, convaincus que leur position dans la société « reflète leur grande valeur intellectuelle et morale 21 ». De manière cohérente, leur profil idéologique met en avant les valeurs de l’éducation, du dévouement au travail et de la propriété privée.
Si elle approche les 10 % de la population, conclut Milanović, cette élite sera « imprenable » : protégée des fluctuations des salaires réels et des rendements du capital, car bénéficiaire des deux, vaste, homogène, idéologiquement cuirassée, sûre d’elle-même. Dès à présent pourtant, son ascension marque une rupture, car elle révèle que la classe « professionnelle-managériale » n’a pas supplanté la classe des capitalistes — comme le prédisait la théorie de la société managériale — mais qu’elle s’est « fusionnée » avec son sommet 22. Cette fusion a créé une nouvelle forme de capitalisme, dont la singularité reflète la nature double de l’homoploutie : étant riche en facteurs de production, l’élite issue de cette fusion a « résolu » en son sein le conflit perpétuel entre le capital et le travail : « C’est peut-être la seule évolution du capitalisme moderne qui surprendrait Marx », commente Milanović 23.
En parallèle du cas occidental, la nouvelle élite chinoise, plus restreinte — elle représente environ 1,5 % de la population urbaine — présente des caractéristiques similaires. Contrairement aux élites précédentes, elle tire ses revenus pour partie du secteur privé et pour partie de la corruption, comme elle remplace les qualifications académiques de ses homologues occidentaux par l’appartenance au Parti communiste.
La contre-révolution contre les élites néolibérales
Une réaction s’est levée contre les élites issues du néolibéralisme mondial : le ressentiment populaire les a tenues pour responsables de ses « effets sociaux néfastes » et, avec la mondialisation elle-même, les a placées dans le viseur de trois expressions « contre-révolutionnaires » : Trump, Xi et Poutine.
Bien qu’ils aient fondamentalement grandi dans le même « système d’accumulation de richesse et de pouvoir » qui a produit ces élites, ces trois « contre-révolutionnaires » veulent désormais « les contenir, les repousser, les briser » et « renverser [leur] hégémonie idéologique 24 ». Le caractère défensif de leur réaction — qui mériterait d’être lue pour prolonger l’étude importante d’Arnaud Miranda sur les Lumières sombres — explique à la fois l’épithète que choisit Milanović pour les qualifier et le doute qu’il fait planer sur leurs chances de succès.
L’interprétation que Milanović propose du cas chinois tranche avec celles que l’on rencontre le plus souvent : l’objectif de Xi est d’affirmer le pouvoir du parti sur la nouvelle élite, qui menaçait d’en prendre le contrôle, tout en défendant « l’autonomie de l’État » face au secteur capitaliste de l’économie 25. Xi, lui aussi, mène une bataille « contre l’esprit du temps » : elle explique à la fois la campagne qui a été conduite contre la corruption et les brides imposées aux « nouveaux oligarques », la promotion du rôle des entreprises publiques dans les secteurs de haute technologie et la lutte contre la pauvreté rurale et les inégalités des chances 26.
Aux États-Unis, le ressentiment contre les élites issues du néolibéralisme mondial a nourri deux formes de populisme : l’une de droite, incarnée par Trump ; l’autre de gauche, portée par les principaux perdants des dernières primaires concurrentielles du Parti démocrate — Bernie Sanders en 2016 et 2020, et Elizabeth Warren en 2020.
Ces défaites répétées, l’élection de 2024 devant être comptée comme l’une d’entre elles à titre indirect, expliquent probablement pourquoi Milanović, après l’avoir mentionné, ne dit pas un mot sur le populisme de gauche : dans sa préface, il évoque brièvement 27 des coalitions « vagues » de « mécontents » qui se sont formées dans presque tous les pays occidentaux contre l’ordre néolibéral, sur la vague de la « révolte populiste » : il n’est donc pas fait uniquement référence à la droite démagogique.
Même lorsqu’elles sont parvenues au pouvoir, ces coalitions ont vu leur aspiration au changement se briser sur leur « confusion idéologique et leur incapacité à concevoir et à mettre en œuvre des politiques alternatives [à celles du néolibéralisme] ». Le cas du Mouvement 5 Étoiles italien — et des deux premiers gouvernements auxquels il a participé, l’un avec la droite xénophobe de Matteo Salvini, l’autre avec les centristes et les progressistes — en offre un exemple parlant. Pour Milanović, la pression des « mécontents » n’aura eu, pour l’essentiel, que cette portée : avoir « mis fin à l’hégémonie du néolibéralisme mondial et ébranlé le pouvoir ainsi que les bases idéologiques et culturelles des nouvelles élites ».
Leur pression a contribué à ouvrir la voie à Trump, qui a ensuite recomposé les ruines de l’ancien ordre selon le modèle du « libéralisme national marchand » — alliant dans une logique profondément impériale néolibéralisme à l’intérieur et mercantilisme à l’extérieur.
Les doutes que Milanović exprime quant à la réussite de ce modèle tiennent exclusivement à la force économique, idéologique et culturelle des élites issues du néolibéralisme 28. L’analyse implicite est la suivante : les sociétés occidentales seraient désormais sommées de choisir entre une extrême droite d’inspiration trumpiste et les élites néolibérales, entre le libéralisme national marchand et le retour au néolibéralisme. Aucune troisième voie n’est envisagée — pour reprendre la formule de Margaret Thatcher, there is no alternative.
L’ascension de nouvelles élites et le réveil de l’Asie sont la conséquence de la mondialisation néolibérale. Tous deux ont joué contre les classes moyennes et inférieures de l’Occident.
Andrea Capussela
Cette analyse sonne comme une gifle salutaire pour les progressistes occidentaux, populistes ou non, souvent prisonniers d’une sorte de confuse pureté idéologique et d’une faiblesse conceptuelle nées de leur incapacité à prendre au sérieux le phénomène trumpiste et les transformations géopolitiques en cours. À long terme, toutefois, l’exclusion de toute alternative progressiste paraît discutable : leur inconséquence peut être corrigée 29 et le libéralisme national marchand ne constitue pas un équilibre stable : même s’il résiste à la contre-réaction des élites néolibérales, les causes économiques du mécontentement persisteront, et rien ne dit que les croisades contre des boucs émissaires continueront longtemps de mobiliser l’électorat potentiel des progressistes.
L’exclusion des progressistes — absents de l’horizon analytique du livre — s’explique peut-être par le choix de Milanović, au terme d’une enquête minutieusement ancrée dans les données empiriques et entièrement centrée sur le jeu des forces structurelles, de ne pas faire place aux espoirs que pourrait porter le mouvement des idées.
Cupidité et nationalisme
Le chapitre final, bref et radical, tourne entièrement autour des passions de l’âme. Milanović développe ici un argument qui mène de la propriété à la guerre par le biais de la cupidité et du nationalisme.
L’idée de Milanović est la suivante : sous le régime du libéralisme national marchand promu par Trump, la défense de la propriété aurait pris une importance telle qu’elle a encouragé la cupidité individuelle et sa diffusion dans l’ensemble de la société. Si le passage où il avance cet argument me laisse perplexe, j’en accepte volontiers la conclusion ; il est en effet probable que la cupidité s’intensifie et se généralise lorsque, pendant deux générations, responsables politiques et intellectuels influents répètent chaque jour : « Enrichissez-vous ! »
Les passages suivants, étayés par des exemples éclairants, me semblent en revanche convaincants. Sur la cupidité, Milanović se réfère à Platon. La valeur que nous attribuons aux choses que nous désirons dépasse leur utilité intrinsèque, car elle inclut « l’image de richesse et de pouvoir » que leur possession transmet aux autres 30. Comme le désir de projeter cette image sur les autres est proprement illimité, il se traduit par une cupidité tout aussi illimitée. Dans tous les domaines de la vie, ce désir alimente « notre obsession pour la propriété » : l’acquérir est devenu « l’objectif suprême », non seulement pour le « plaisir hédoniste » que nous en tirons, mais aussi parce qu’elle « démontre la valeur de la personne 31 ». La cupidité, poursuit Milanović, est également la source du nationalisme. Celui-ci naît de la crainte que d’autres communautés aient plus que la nôtre, et du désir que notre relative abondance par rapport à elles se maintienne « pour toujours ».
Comme chez Tacite, les derniers mots du livre tombent comme une lame : « Les guerres sont notre moyen d’atteindre ce ‘pour toujours 32.’ »
Cette phrase éclaire tout ce qui précède. Si la plupart des critiques du livre de Milanović ne s’attardent pas sur ce dernier chapitre, peut-être intimidées par sa dureté calme mais inexorable, il me semble au contraire nécessaire de le commenter : non pas pour le démolir, mais pour ouvrir entre les blocs de granit qui le composent une fissure suffisamment large pour laisser passer un peu de lumière.
Faisons donc un pas en arrière.
Inverser les valeurs
χρήματα δ᾽ ἱμείρω μὲν ἔχειν, ἀδίκως δὲ πεπᾶσθαι | οὐκ ἐθέλω :
(Je désire avoir des richesses, mais je ne veux pas les posséder injustement)
(Solon, VIIe-VIe siècle av. J.-C., Élégie aux Muses, 7-8, trad. Louis Humbert 33)
Dans ses Operette morali, publiées en 1827 34, Giacomo Leopardi met en scène une conversation entre un professeur de lettres et Salluste, historien romain de l’époque de César. Devant ses étudiants, le premier critique un passage du second, qui surgit de nulle part et demande des explications. Sans sourciller, le professeur insiste sur le fait que ce passage viole la règle rhétorique selon laquelle, dans les circonstances données, celui qui invoque une série de valeurs de rang différent doit les disposer dans un ordre ascendant et non descendant.
Salluste objecte que sa série — richesse, honneur, gloire, liberté, patrie — est justement ascendante. Le professeur lui démontre que c’est le contraire qui est vrai : la richesse prime sur l’honneur et la gloire, la liberté « ne compte pas », et la patrie n’existe plus que « dans le vocabulaire ». Entre son époque et 1827, commente alors Salluste, il existe manifestement « un certain écart d’opinions et de mœurs ». Pourtant, il demande au professeur d’effacer l’ancienne série et lui dicte la nouvelle, réduite et inversée.
Le réveil de l’Asie a largement comblé l’écart creusé par la révolution industrielle qui, il y a deux cents ans, a rompu un équilibre séculaire.
Andrea Capussela
Ici, Leopardi se moque de nous ou critique la désinvolture du très riche Salluste, qui, précisément dans l’œuvre que le professeur commentait — la Conjuration de Catilina, publiée quelques années après que Salluste eut été jugé pour concussion — fustigeait la cupidité et les richesses qui avaient bouleversé l’ancienne échelle des valeurs. Il se moque de même, ou nous invite à réfléchir, lorsqu’il met dans la bouche de son professeur la thèse de Théognis, poète grec du VIe siècle avant J.-C., selon laquelle il faut rechercher la richesse à tout prix.
Théognis soutenait pourtant l’inverse. Membre de l’aristocratie foncière de Mégare, ce poète aujourd’hui méconnu assiste à l’essor de l’économie monétaire et marchande qui érode la domination de sa classe. À la différence de Solon — aristocrate comme lui — il refuse toute médiation entre anciens et nouveaux groupes sociaux : réactionnaire plutôt que simplement conservateur, nostalgique et pessimiste, Théognis déplore la diffusion de la richesse nouvelle, qui mêle déjà le sang noble à celui du peuple. Mais il a la lucidité d’ajouter que la pauvreté est pire encore — et qu’il faut la fuir à tout prix.
La condamnation de la cupidité que fait Théognis est sans appel : nécessairement illimitée, elle ruine la personne et la société. Si, sur ce point, Théognis rejoint Milanović, faut-il soutenir que les deux ont raison ?
Leopardi comme Théognis rappellent que la cupidité est un problème ancien et jamais résolu : la guerre entre les cités grecques était d’ailleurs endémique. Si cette perspective n’a rien de très rassurant, comme le suggère l’épigraphe de Solon — « Je désire avoir des richesses, mais je ne veux pas les posséder injustement » —, il n’en reste pas moins qu’il existe de meilleures et de pires manières de gouverner ce problème.
Si nous la réduisons à ses termes les plus concrets, en effet, la justice à laquelle Solon fait référence dans son vers n’est qu’un ensemble de contraintes que la société impose au citoyen pour contenir sa cupidité, que nous supposons illimitée. Ces contraintes varient au cours de l’histoire, peuvent être plus ou moins efficaces, et sont influencées par d’autres institutions — règles écrites et normes sociales — que les sociétés héritent du passé ou choisissent de se donner.
Ébranlés par des tensions sociales menaçant de tourner à la guerre civile, les Athéniens confièrent à Solon, au début du VIe siècle, la tâche de réformer leurs institutions politiques et économiques — dans un contexte où, comme aujourd’hui, l’avidité des élites comptait parmi les causes de la crise. Solon suivit une voie résolument médiane entre les exigences des puissants et celles des citoyens ordinaires, mais ses réformes n’en furent pas moins radicales : sans doute ne procéda-t-il pas à une redistribution des terres, mais il annula ou allégea les dettes, abolit la servitude pour insolvabilité et ouvrit l’assemblée à l’ensemble des citoyens.
En Occident, à l’inverse, les dix-huit années écoulées depuis la crise de 2008 n’ont produit que peu de réformes — timides et discontinues. Le contraste avec les deux premières décennies de l’ère néolibérale, marquées par des transformations profondes et systématiques, est saisissant.
Alors même que la cupidité s’est intensifiée et diffusée, nous avons manqué de réformes capables de nous doter d’institutions aptes à contenir cette passion de l’âme et à l’orienter vers des fins socialement souhaitables. Autrement dit, le problème n’est peut-être plus tant la cupidité elle-même que la confusion idéologique, la faiblesse conceptuelle des progressistes et leur incapacité à parler aux classes moyennes et défavorisées — ayant peut-être oublié le mot de Talleyrand : « Les mécontents, ce sont des pauvres qui réfléchissent ».
Le pessimisme affiché dans le dernier chapitre de Milanović prolonge ainsi son pessimisme implicite quant à la possibilité d’une alternative progressiste et en fournit la clef. Mais la charge de démontrer la vanité d’une telle alternative incombe à ceux qui la proclament — et Milanović ne s’y est pas même essayé. Dans Capitalism, Alone, pourtant, il esquissait lui-même des pistes de réforme : sceptique quant au réalisme et à l’efficacité d’un relèvement substantiel de la fiscalité, il proposait des mesures destinées à réduire la concentration du capital et les inégalités d’accès à une éducation de qualité 35.
Il faut donc voir dans cette lacune un signe encourageant : tant que cette preuve n’aura pas été apportée, il vaudra la peine de chercher une alternative qui ne soit ni le libéralisme national trumpiste ni le simple retour au néolibéralisme.
Sources
- Dominik Leusder, « How not to talk about capitalism », The New Statesman, 6 décembre 2025.
- Branko Milanović, Le capitalisme, sans rival. L’avenir du système qui domine le monde, trad. Baptiste Mylondo, Paris, La Découverte, 2020.
- Branko Milanović, Inégalités mondiales. Le destin des classes moyennes, les ultra-riches et l’égalité des chances, trad. Baptiste Mylondo, Paris, La Découverte, 2019,
- Branko Milanović The Great Global Transformation. National Market Liberalism in a Multipolar World, Londres, Penguin Allen Lane, 2025, p. 105.
- Karl Polanyi, La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, trad. Maurice Angeno et Catherine Malamoud, Paris, Gallimard, 1983.
- Branko Milanović, The Great Global Transformation, op. cit., p. 2. La traduction de ces passages et de ceux cités ci-dessous est de moi.
- Dans son livre La Grande Transformation, Polanyi désigne par « double mouvement » un processus en deux temps : l’extension du marché suscite, en retour, des efforts pour en contrer les effets par le développement de la protection sociale.
- Ibid., p. 83.
- Ibid., p. 77.
- Ibid., p. xiii.
- Cette agressivité est aussi rationnelle, car dictée par la recherche d’une rémunération plus élevée. La théorie schumpétérienne actuelle de la croissance s’écarte cependant des deux thèses évoquées.
- Branko Milanović, The Great Global Transformation, op. cit., p. 78.
- Ibid., p. 76.
- Ibid., p. 73.
- Ibid., p. 36.
- Ibid., pp. 113–118.
- Cette partie du livre se termine par une critique convaincante de la théorie des relations internationales du philosophe politique libéral le plus influent de ces dernières décennies, John Rawls, que Milanović juge inapplicable au monde qui émerge de ces transformations, lequel n’est plus unipolaire et hiérarchiquement organisé.
- Branko Milanović, The Great Global Transformation, op. cit., p. 112.
- Ibid., p. 115.
- Ici, Milanović cite l’analyse de Daniel Markovits dans The Meritocracy Trap. Voir Daniel Markovits, The Meritocracy Trap : How America’s Foundational Myth Feeds Inequality, Dismantles the Middle Class, and Devours the Elite, Londres, Penguin Press, 2019.
- Branko Milanović, The Great Global Transformation, op. cit., p. 139
- Ibid., p. 111.
- Ibid., p. 113.
- Ibid., p. 114.
- Ibid., p. 163.
- Ibid., p. 176.
- Ibid., p. xii-xiv.
- Ibid., p. 145.
- J’ai moi-même tenté de suggérer une idée, qui combine une vision plus forte et plus égalitaire de la liberté, celle républicaine, avec l’ouverture à la destruction créatrice schumpétérienne. Voir Andrea Capussela, The Republic of Innovation : A New Political Economy of Freedom, Cambridge, Polity, 2025.
- Branko Milanović, The Great Global Transformation, op. cit., p. 196.
- Ibid., p. 197.
- Ibid., p. 198.
- in Poètes moralistes de la Grèce, Paris, Garnier Frères, 1892.
- Giacomo Leopardi, Petites Oeuvres morales, trad. Joël Gayraud, Paris, Allia, 1992.
- Ces mesures bénéficieraient du soutien normatif de la théorie républicaine de la liberté ; j’y reviens dans mon livre précité, Andrea Capussela, The Republic of Innovation, op. cit.

