Comment le capitalisme façonne la nature, une conversation avec Alyssa Battistoni
Le capitalisme n'est pas contre la nature : il l'a intégrée à son système. Comment déjouer cette ruse à l'ère de l'Anthropocène ?
Dans une grande étude théorique parue chez Princeton University Press, Alyssa Battistoni explore le concept de « don gratuit » pour nous aider à repenser les biens communs et mieux les soustraire aux forces du marché.
Nous la rencontrons.
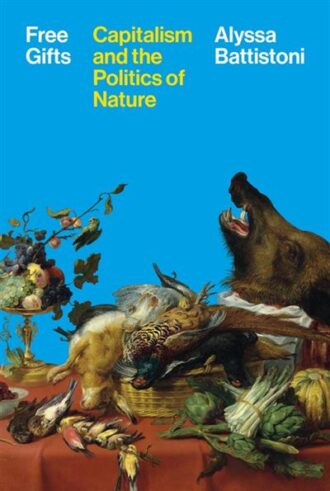
Si vous nous lisez et que vous souhaitez nous soutenir, découvrez toutes nos offres pour vous abonner au Grand Continent
Le changement climatique que nous connaissons nous a conduits à repenser la relation des sociétés à la nature. À l’ère de l’Anthropocène, certains soutiennent que cette « nature » aurait d’ores et déjà disparu, d’autres que le changement climatique ne ferait que révéler notre dépendance à cette nature bien présente et trop longtemps négligée. Comment résoudre cette opposition ?
Ces dernières années, deux grandes tendances se sont dégagées dans la façon dont les gens conçoivent la nature.
La première consiste à dire que la nature n’existe plus : les sociétés humaines auraient transformé le monde dans sa totalité. C’est une telle thèse que soutient Bill McKibben lorsqu’il affirme que le changement climatique signifie la fin de la nature, puisqu’alors il n’y a plus rien qui nous soit étranger.
L’autre position, telle qu’exprimée par Dipesh Chakrabarty, est que le changement climatique est l’instrument d’un « retour de la nature » : nous constatons que nous n’avons jamais vraiment transcendé la nature ni soumis celle-ci au contrôle humain.
Dans les deux cas, le changement climatique semble être le moment d’une révélation, où nous découvrons, soit que la nature a disparu, soit qu’elle est de retour.
Si l’on examine l’histoire de la pensée politique, on constate toutefois que la politique de la nature a toujours été étroitement liée aux sociétés humaines, d’une manière qui ne correspond peut-être ni à la position de McKibben — selon laquelle la nature est totalement séparée de nous, quelque chose que nous n’avons transformé que récemment et que nous avons presque entièrement pollué ou déformé — ni à celle de Chakrabarty — pour qui la nature est la force déterminante ou prépondérante.
La nature a toujours fait partie de notre politique. Cela dit, la théorie politique a souvent eu tendance à s’abstraire de ces conditions matérielles, comme le soulignent à juste titre les analyses de ces deux auteurs. Au lieu de tout repenser, comme on nous invite souvent à le faire, nous devons nous pencher sur les travaux de pensée politique et sur les pratiques et l’histoire politiques réelles, en essayant de voir où la nature — et plus généralement le monde matériel — est façonnée par nos formes de vie politique et d’organisation sociale, mais aussi où celle-ci en détermine en retour les conditions.
En défendant une conception moniste de la nature et de la société — la culture n’est pas séparée de la nature et encore moins supérieure à elle –, vous affirmez que le capitalisme ne fait pas seulement partie de la nature, mais que la nature fait également partie du capitalisme. Comment comprendre cette double intégration ?
Lorsque nous voulons réfléchir à la nature et au capitalisme, nous ne devons pas nous contenter de dire : « Voici quelques effets environnementaux du capitalisme », mais plutôt nous demander : où se situe la nature dans les relations sociales fondamentales du capitalisme ?
Pour la situer, il nous faut revenir à l’analyse de Marx sur la valeur et la forme sociale, en réfléchissant à la manière de répondre à l’analyse classique de la marchandise et en accordant une attention particulière à la nature non humaine qui, comme le dit Marx lui-même, est un don gratuit au capital.
Le terme « don gratuit » est étrange quand on y réfléchit, car les dons sont toujours gratuits : par définition, ils ne s’achètent ni ne se vendent, mais ils sont souvent considérés comme réciproques, comme l’ont compris des anthropologues tels que Mauss. Le don gratuit désigne donc la position d’entités utiles mais sous-évaluées au sein d’une forme d’organisation sociale organisée par la valeur, et par cette forme particulière de valeur d’échange que Marx analyse de manière très explicite et détaillée : la marchandise.
Il existe aussi bien d’autres choses qui ne prennent pas l’apparence de la marchandise, qui n’apparaissent pas dans l’échange de marchandises, mais qui restent importantes, tant dans les processus de production que dans les conditions plus générales de notre vie dans le monde et de la circulation du capital. Lorsque nous ne prêtons pas attention à celles-ci, nous passons à côté d’une grande partie de ce qui se passe dans un monde dominé par le capital, mais qui n’est pas exclusivement constitué de capital.
La position qui défend que la liberté est purement sociale néglige généralement les conditions matérielles de la liberté.
Alyssa Battistoni
Il est donc essentiel de reconnaître que le capitalisme est un humanisme : le capitalisme et l’échange de travail salarié sur lequel il repose dépendent de la spécificité du travail humain. Cependant le travail des humains est conscient : ils ne se vendent pas lorsque leur force de travail est achetée mais entrent dans une relation d’échange dont la nature est exclue. Comment donc penser le travail des êtres non-humains, puisqu’il est impossible de le caractériser de la même façon ?
Marx est souvent critiqué pour être un penseur anthropocentrique, qui se serait concentré uniquement sur le travail humain. Bien sûr, son analyse du capitalisme est très axée sur le travail humain, mais c’est parce qu’il fait une critique du capitalisme, de l’économie politique.
Ce qui crée cette distinction fondamentale entre le travail humain et les autres types de contributions — les contributions non humaines à la production en général — est que le travail humain peut être acheté et vendu contre un salaire ; une fois acheté, ce travail est dirigé par quelqu’un d’autre que le travailleur, tandis que le reste du monde non humain peut être mobilisé de diverses manières dans le processus de production, mais ne peut pas entrer dans cette relation contractuelle fondamentale de travail contre salaire.
L’éventail des activités d’un être humain par rapport à d’autres êtres est également une distinction importante. Les non-humains ont des qualités très spécifiques qui peuvent être canalisées dans certains processus de production : une abeille peut polliniser les fleurs, et c’est à peu près tout, ou du moins son champ d’activité est très limité.
Le travail humain, au contraire, est indéterminé. Il peut être déployé de nombreuses façons, et on peut donc le traiter comme une catégorie générale, mais qui doit être gérée, organisée et dirigée de manière particulière. Ce sont ces qualités qui font que les êtres humains sont soumis aux formes de domination, de contrôle interne et externe que nous observons dans les relations entre le capital et le travail.
Cette distinction établie par le capitalisme et les relations sociales capitalistes sépare le travail humain de tout le reste et fait apparaître la nature comme un don gratuit par rapport au travail humain salarié.
Peut-on imaginer une manière de penser nature et culture qui ne véhicule pas une forme de hiérarchie entre les deux termes ?
Il y a eu énormément de critiques du dualisme cartésien et de cette idée que les êtres humains sont séparés des autres types d’êtres ou supérieurs à eux. Cette supériorité est souvent justifiée par la conscience de l’être humain, par opposition à la matière inerte de la nature.
Je suis d’accord avec la position d’Andreas Malm 1 — ce qu’il appelle le monisme substantiel, le dualisme des propriétés — selon laquelle nous sommes tous faits de la même matière et devons évidemment reconnaître les continuités matérielles entre les êtres humains et le reste du monde. Mais il doit y avoir des moyens d’accepter cette position tout en reconnaissant certaines qualités distinctives des êtres humains. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire de dire que ces qualités sont bonnes et supérieures et que les autres sont mauvaises et inférieures. D’autres espèces possèdent également de nombreuses qualités, capacités et aptitudes que les êtres humains n’ont pas et aimeraient avoir. Nous ne pouvons pas voler, ou bien je ne peux pas nager longtemps sous l’eau.
Nous n’avons donc pas à affirmer que nos capacités sont simplement supérieures. Ce que nous devons faire, c’est comprendre comment ces capacités humaines distinctives sont mobilisées dans le capitalisme en tant que mode de production et, plus largement, en tant que mode d’organisation de la vie sociale, et pourquoi cela est important. Que fait le capitalisme de ces qualités proprement humaines ? Comment pourrions-nous, dans un autre système, reconnaître ces qualités sans les considérer comme un droit de dominer ou de proclamer notre supériorité sur les autres êtres ?
Cette distinction analytique est importante si nous voulons vraiment comprendre ce qui se passe dans le capitalisme. Au contraire, il me semble inutile de dire : « Il n’y a pas de différence entre ce que font les êtres humains et ce que font les autres espèces » afin de combattre le dualisme cartésien.
La nature est peut-être exclue de ce processus d’échange, mais elle est toujours très présente dans les processus du capitalisme, et tout d’abord dans le processus de production. Comment celui-ci la maîtrise-t-il ?
Si l’on considère le don gratuit comme une forme sociale capitaliste, l’une des caractéristiques clefs de cette forme sociale est son caractère dual. Pour la marchandise, cette dualité réside à la fois dans la valeur d’usage et la valeur d’échange sous leur forme physique, puis dans leur apparition dans le domaine de la valeur abstraite. C’est également vrai pour le don gratuit, mais sa valeur abstraite est nulle. Néanmoins, ce qui relève de ce don continue d’exister dans le monde matériel, d’être mobilisé dans la production et continue donc d’avoir des effets physiques dont nous devons tenir compte et rendre compte.
De nombreuses analyses marxistes affirment à propos des formes sociales capitalistes : « il y a bien ces deux aspects, l’abstrait et le concret, mais nous nous concentrons principalement sur l’abstrait et les processus d’abstraction qui sont propres au capitalisme. » Elles ont raison de dire que l’abstraction est très importante, mais nous devons également nous accrocher à la double nature des formes sociales capitalistes et prêter attention au concret : aux qualités spécifiques des différents types de nature et au rôle qu’ils jouent dans le processus de production. Car ils structurent de manière assez significative les processus de travail, et par conséquent le processus de valorisation et la production de plus-value.
À cette fin, la subsomption est un concept très important : pour Marx, il s’agit d’une manière de décrire comment le capital remodèle d’abord les relations dans lesquelles s’inscrit une forme de processus de travail ou de production — ce qu’il décrit comme la subsomption formelle — puis comment il transforme physiquement le processus de travail et réorganise les modèles concrets de travail, dans ce qu’il décrit comme la subsomption réelle.
La subsomption est également un concept important pour comprendre comment les éléments physiques et non humains de la production — les outils, les ressources, les machines, etc. — sont conçus et ordonnés pour atteindre l’objectif particulier de la valorisation. Il y a une restructuration physique du processus de production. Et lorsque nous voulons examiner cette reconstruction physique de la production, nous devons nous demander quels sont les éléments qui entrent dans ce processus, au sens littéral du terme : quels sont les éléments matériels du processus de production et dans quelle mesure le capital peut-il les réorganiser ? Car il s’avère que tous les processus de travail concrets ne se prêtent pas de la même manière à l’efficacité, à la fluidité et à la productivité maximales que le capital recherche.
Nous façonnons notre planète chaque jour, à chaque instant, d’une manière qui ne relève pas de notre choix, à travers nos actions filtrées par le marché.
Alyssa Battistoni
Le processus de subsomption est souvent décrit comme un processus progressif dans lequel le capital subsume de plus en plus la production, d’abord formellement, puis réellement, rendant le monde de plus en plus à son image et orienté vers le cycle d’accumulation de valeur. Mais lorsque nous y regardons de plus près, nous pouvons en fait voir de nombreux endroits où cela ne fonctionne pas aussi bien que le suggère l’histoire du capitalisme, où les éléments physiques de la production résistent ou se rebellent contre le fait d’être réellement subsumés — c’est-à-dire remodelés selon la tendance du capitalisme à les rattacher à un temps abstrait.
Je m’inspire de l’idée de subsomption pour décrire les choses qui dépassent la capacité du capital à remodeler la production physique : c’est ce que désigne mon concept de suprasomption. Nous voyons celle-ci de nombreuses façons, à la fois sous la forme de processus de production qui ne se sont pas conformés au mode industriel élevé, considéré comme le summum du capitalisme et de la production capitaliste — par exemple, de nombreux secteurs agricoles et autres secteurs reposant sur des processus naturels qui ne se sont jamais complètement industrialisés.
Il y a aussi beaucoup de choses générées par ces processus qui n’apparaissent pas du tout dans nos analyses : la pollution, les déchets, etc. Comment considérer tous ces excès matériels qui contredisent la rationalisation de la production visée par le capital ?
Alors que certains penseurs, comme Anna Tsing 2, ont considéré que certaines pratiques agricoles, comme la récolte de champignons, se développaient en dehors du capitalisme, vous démontrez, à l’aide des concepts d’« abdication » et de « subsomption commerciale », que loin d’être en dehors du capitalisme, ces activités y sont très bien intégrées, mais d’une manière différente de celle de l’usine. Pouvez-vous nous expliquer comment ?
Il existe en effet de nombreuses formes de production qui sont intégrées ou font partie du capitalisme et des relations sociales capitalistes au sens large, mais qui, là encore, ne prennent pas la forme du modèle industriel de production en usine.
Il existe de nombreux secteurs où le capital n’est pas en mesure de réaliser une subsomption réelle et formelle, des secteurs qui ne peuvent atteindre le summum de l’efficacité et de la productivité parce que le capital n’est pas en mesure de réorganiser le travail et les matériaux de manière à maximiser la valeur. Ces secteurs ne valent souvent pas la peine d’être investis, et c’est là que l’abdication a lieu. Dans ces cas-là, nous avons tendance à voir, plutôt qu’une organisation du travail par le capital, une forme traditionnelle de production qui n’a pas pris la forme des processus de production du capital.
Si des petits producteurs cueillent des champignons dans la forêt, c’est parce qu’il est très difficile de rationaliser la production de champignons. Il existe de même des modèles de type « cueillette » ou d’agriculture à petite échelle pour de nombreux produits agricoles difficiles à industrialiser.
L’abdication ne signifie pas que le capital est absent. Lorsque le capital entre en jeu, ce n’est pas en tant que patron, propriétaire qui organise le travail de A à Z — le propriétaire laisse quelqu’un d’autre s’occuper de toute l’organisation inefficace du travail. Le capital intervient plutôt au niveau du commerce, de l’échange, en tant que marchand et qu’intermédiaire : c’est le commerçant qui est en mesure d’interagir avec ces petits producteurs de manière dominante, en exerçant le pouvoir du capital sur les petits producteurs, mais en utilisant des moyens qui ne sont pas ceux de la relation salariale directe. Il s’agit donc plutôt d’un échange supposé entre deux producteurs indépendants, mais dont les moyens sont très différents.
Dans votre livre, vous montrez que la domination de classe et la domination du marché sont essentielles non seulement pour comprendre les processus du capitalisme, mais aussi pour comprendre comment il se crée et façonne la planète en nous privant de notre liberté. De ces deux dominations, l’une est-elle un dérivatif de l’autre ? Comment le capitalisme les articule-t-il ?
Je suis une théoricienne politique et j’essaie de démontrer que nous ne devrions pas seulement considérer le capitalisme comme un système économique, mais aussi comprendre comment il façonne la politique.
Le capitalisme est le mode de production dominant aujourd’hui, mais il est également la force structurante de la plupart des décisions que nous considérons comme étant politiques d’une manière ou d’une autre — les décisions qui ont le plus d’impact sur la façon dont nous vivons dans le monde et organisons nos vies ensemble, ce qui est généralement le rôle de la politique. En d’autres termes, ce capitalisme est une forme de domination.
Nous pensons généralement à la domination en termes de systèmes politiques et de formes de gouvernement, comme la démocratie ou l’aristocratie ; il importe alors de savoir quelles personnes règnent sur quelles autres. Dans le capitalisme, la domination fonctionne de manière différente. Il y a ce que j’appelle la domination de classe d’un côté, et la domination du marché de l’autre.
La plupart des espèces et des formes de vie existantes sont simplement ignorées par le capital, qui n’en a aucune utilité. Elles sont simplement là.
Alyssa Battistoni
Le concept de domination de classe est, à bien des égards, le plus familier, comme est familière la critique qu’il a portée : il s’agit de l’idée que dans une société de classes, les personnes qui possèdent les moyens de production ont un pouvoir exclusif sur la manière de les utiliser, et que les autres sont intégrées dans un processus qu’elles ne contrôlent pas : ces dernières ne décident pas quoi produire ni comment.
Mais il y a un autre élément à prendre en compte : comment les décisions des personnes possédant les moyens de production sont-elles prises et structurées ? Nous devons ici réfléchir à ce que je décris comme la règle du marché ou la règle par le marché. L’échange commercial est le principal moyen par lequel nous acquérons les biens et services dont nous avons besoin pour vivre, et plus encore, l’un des modes fondamentaux d’interaction sociale. Les consommateurs et les capitalistes interagissent les uns avec les autres par le biais du marché et se font concurrence sur ce dernier, qui devient ainsi le principal lieu de prise de décision. Nous devons donc comprendre comment les décisions que nous prenons concernant ce qu’il faut acheter et vendre sont canalisées par cette structure particulière.
La règle du marché est ce que Niko Kolodny 3 appelle une « règle par personne ». Personne en particulier n’est responsable : au contraire, nous prenons tous nos propres décisions individuelles qui sont agrégées par le marché. Cette force d’agrégation nous pousse ainsi à prendre collectivement des décisions qui ne sont pas de véritables décisions. Nous n’y avons pas réfléchi consciemment et nous n’avons pas débattu des objectifs que nous voulons poursuivre ; ces décisions collectives sont simplement générées par les interactions de nos décisions individuelles et atomisées.
Lorsque nous pensons au capital en particulier, ces décisions sont orientées vers la production d’une valeur toujours plus grande, qui est le seul objectif du capital. Les décisions prises par les consommateurs manquent de direction, tandis que le capital est constamment orienté vers l’accumulation de valeur. Et cela devient le moteur principal de notre société.
Selon Friedrich Hayek, le marché est le seul espace véritablement libre, dans lequel nous prenons nos propres décisions, en fonction des indications fournies par les prix. Pour cet économiste, ces choix révèlent nos véritables valeurs, celles que nous adoptons lorsque nous sommes confrontés au monde. Hayek omet pourtant de se poser la question de savoir ce qu’est le marché : s’il est un ordre spontané pour lui, il est un instrument de domination pour d’autres. Quelle est votre position dans ce débat ?
Pour Hayek, le marché est le lieu où nous pouvons prendre nos décisions sur ce qui est important pour nous dans notre vie. Personne ne nous dit quoi choisir ni n’exerce de pouvoir sur nos choix. Hayek incarne une forme de critique républicaine, soutenant que, tant que personne n’a de pouvoir direct et arbitraire sur vous, vous êtes libre.
Ce qu’Hayek exprime au sujet du choix sur le marché est à la fois assez convaincant et erroné. Je pense que nous devrions relever le défi d’affirmer que nos valeurs sont importantes, révélatrices et méritent d’être prises au sérieux, mais la façon dont Hayek considère le marché comme le lieu où les valeurs peuvent et doivent être réalisées est profondément erronée, car je pense que les marchés finissent par faire exactement le contraire. Ils limitent de manière assez significative notre capacité à prendre de véritables décisions concernant les choses auxquelles nous accordons de la valeur dans nos vies. Le raisonnement de Hayek suggère que les achats que nous effectuons reflètent véritablement la valeur des choses, ce qui n’est pas le cas des prix. Le prix du travail ou le prix de la nature ne reflète en rien leur valeur réelle.
Sur le marché, nous ne sommes pas vraiment en mesure de dire : « Ce que j’apprécie, c’est un environnement stable, et c’est ma priorité. » Si, sur un tel marché, je peux acheter des produits respectueux de l’environnement, je n’ai aucun contrôle sur la manière dont mes décisions concernant ces achats individuels sont canalisées et acheminées à travers ce système beaucoup plus vaste de prise de décision individualisée, produisant un résultat global dont personne ne voulait peut-être, comme le changement climatique. Nous n’avons aucun moyen de traduire la décision individuelle en une valeur véritablement collective.
Ainsi, si le marché est le moyen d’exprimer nos valeurs, il impose une limitation réelle et assez stricte à la liberté de mettre en œuvre nos valeurs dans le monde.
Pour étayer votre argumentation, vous développez deux concepts sartriens : la sérialité et la contre-finalité. Nous ne choisissons pas la signification des prix, ce qu’ils sont ; notre prétendu libre choix implique des conséquences que nous ne voulons pas. Comment ces deux concepts permettent-ils de critiquer les marchés ?
Sartre présente quelques similitudes intéressantes avec Hayek : lui aussi soutient que nous devrions être libres de choisir nos valeurs et, par conséquent, que nos valeurs sont ce que nous créons plutôt que ce qui nous est donné en quelque sorte. Néanmoins, sa position est différente à d’autres égards.
Sartre, par son concept de sérialité, décrit une position où tout le monde est dans la même position par rapport à un objet, un processus ou un phénomène. Cette idée est très utile pour réfléchir aux limites de nos choix conscients et de nos formes d’évaluation, de valorisation, qui sont en fin de compte imposées par la structure même du capitalisme.
Le marché est un exemple de sérialité : chacun d’entre nous est comme tous les autres agents du marché et nous agissons avec une rationalité de marché similaire, même si les gens n’agissent pas toujours de manière rationnelle sur le marché. Nous agissons selon un modèle de comportement similaire d’une personne à l’autre, mais en étant isolés les uns des autres. Nous anticipons ce que les autres feront et en particulier la manière dont ils réagiront aux prix.
Pour Sartre, les prix fonctionnent presque comme des ordres : ils vous dictent ce que vous devez faire. Vous ne décidez pas que l’air pur a beaucoup de valeur. Vous découvrez ce que le marché vous dit de la valeur de l’air pur, pour soit payer, soit ne pas payer. Si cet air n’a aucune valeur sur le marché, vous ne pouvez pas simplement dire : « Eh bien, cela a vraiment de la valeur pour moi, donc je vais payer ce montant ».
Nous devons reconnaître que les écosystèmes ne se situent pas vraiment en dehors du capitalisme, car ils continuent d’être érodés, transformés et détruits, précisément en raison de leur manque de valeur.
Alyssa Battistoni
Les prix organisent ainsi la manière dont nous prenons ces décisions et interagissons les uns avec les autres. Notre isolement — l’atomisation de ce marché — finit par produire ces formes de comportement qui sont structurées par la relation globale et qui génèrent souvent des résultats que personne ne souhaite.
Le concept de contre-finalité de Sartre est également une idée utile pour réfléchir à ce que nous décrivons souvent comme des conséquences involontaires. La contre-finalité décrit la manière dont nos actions, que nous faisons avec une intention, se propagent ensuite dans le monde et interagissent avec les actions d’autres personnes, mais aussi, de manière très conséquente, avec le monde matériel. Nos choix et nos décisions en tant qu’êtres humains, c’est-à-dire en tant qu’agents conscients de leurs choix, se déplacent dans un monde physique que nous ne contrôlons pas. En raison de cette rencontre incontrôlée, ils peuvent alors se matérialiser d’une manière que nous n’anticipons pas ou que nous ne choisissons pas activement. Les résultats de nos décisions peuvent alors revenir nous hanter d’une manière que nous n’avions pas prévue.
Nous parlons souvent de cela comme d’un principe général de conséquences imprévues — et il est évident qu’il y a des conséquences imprévues à toute forme d’organisation sociale. Mais nous devons être très attentifs à la manière dont ce cadre du marché, sous la loi capitaliste de la valeur, est la principale force qui canalise notre action comme celle des autres, comme nous devons être attentifs à la manière dont cela dirige notre initiative dans le monde d’une manière qui remodèle ensuite la nature, notre planète même, d’une manière que nous n’avons pas choisie. Cette redirection a souvent des conséquences que nous regardons avec horreur, en disant : « Comment avons-nous fait cela ? Ce n’était pas dans notre intention. »
Je pense que les deux concepts sartriens de sérialité et de contre-finalité peuvent aider à expliquer le sentiment d’impuissance que les gens expriment souvent à l’égard d’un phénomène tel que le changement climatique.
Vous critiquez également l’idée selon laquelle la pollution relève uniquement de la responsabilité individuelle. Pour vous, celle-ci découle de son statut dans le processus de production, car c’est un sous-produit qui n’a pas de prix. Ce constat étant fait, vous ne souscrivez pas à la théorie du « coût social » de Ronald Coase — qui préconise d’attribuer des droits et des prix à la pollution, pour la maîtriser par le marché 4. Quelle solution proposez-vous donc pour lutter contre celle-ci ?
La pollution rassemble certains des concepts dont nous avons discuté. D’une part, il s’agit d’une forme de matière excédentaire générée au cours du processus de production qui n’est pas vraiment sous le contrôle du capital, l’un de ceux pour qui le concept de suprasomption est pertinent. La pollution n’est pas un produit intentionnel : elle est générée comme un sous-produit de l’objectif réel, qui est de produire des marchandises afin de créer de la valeur. En produisant ces marchandises physiques, vous produisez également tout cet excédent dont personne ne veut et qui est souvent très nocif.
Ce problème a été souligné à maintes reprises par les économistes. Il fait l’objet d’un débat de longue date dans cette discipline, particulièrement en économie environnementale : comment envisager ces externalités ou ces coûts sociaux qui n’ont pas de prix mais qui ont des effets négatifs ?
Coase est particulièrement intéressant car il met le doigt sur certains aspects de la pollution. Pour lui, celle-ci est une relation réciproque entre le producteur de la matière en question (la fumée, par exemple) et les personnes touchées par cette matière. La fumée n’est un problème que parce que d’autres personnes vivent à proximité de l’usine qui la produit. Si elles ne vivaient pas là, il n’y aurait pas de problème. Ce constat peut sembler très cynique, et il l’est, car cela revient à dire : « Si vous n’aimez pas la fumée, pourquoi vivez-vous là ? Vous avez choisi de vivre là. C’est votre problème. »
Si nous interprétons cette relation réciproque de manière légèrement différente, nous pouvons pourtant la considérer comme une relation réciproque structurée par la domination de classe, où le propriétaire de l’usine se trouve dans une position différente de celle des personnes vivant à proximité et des travailleurs qui se rendent à l’usine. Il existe en effet une relation de pouvoir à laquelle Coase ne prête pas attention. En tant que marxiste, je souhaite mettre cet aspect en évidence et affirmer qu’il s’agit d’une relation de classe.
Une comparaison peut être faite avec la relation contractuelle — salaire contre travail — dont nous parlions : les deux sont des relations de pouvoir, une situation de pouvoir asymétrique avec le capital. Mais la différence est que les gens ne vendent pas leur force de travail, ou dans ce cas leur force pulmonaire : ils vivent simplement dans un endroit, et lorsque l’usine s’installe, ils sont par défaut contraints de l’accepter.
Coase a également raison lorsqu’il dit que le droit de polluer est un facteur de production : la production génère inévitablement des éléments désagréables d’une manière ou d’une autre — peut-être pas inévitablement, mais dans la plupart des cas, qu’il s’agisse d’un excès de matière, de bruit ou de lumière. La question est donc la suivante : qui décide de produire ces effets ? Je dirais que c’est généralement le capitaliste. Ensuite, qui en supporte le fardeau et dans quelles conditions ? Le fardeau est souvent imposé aux gens plus ou moins contre leur gré, car ils n’ont fondamentalement aucun moyen de résister ou de refuser.
La nature est déjà inestimable dans le capitalisme, dans le sens où celui-ci la traite par défaut comme un cadeau gratuit, dont le prix est nul.
Alyssa Battistoni
Ce partage inégal et imposé a aussi été dénoncé sous une autre forme : de nombreux travaux du marxisme féministe, comme ceux de Silvia Federici 5, ont opéré une critique du travail domestique non rémunéré pour revendiquer un salaire. Quelle place a ce travail dans le processus, plus large, du capitalisme ?
La catégorie de travail est interne au capitalisme, elle ne saurait exister au dehors. Il est intéressant de réfléchir aux formes de travail qui ne correspondent souvent pas au modèle du travail industriel, qui sont souvent non rémunérées ou effectuées de manière inhabituelle, ou d’une manière qui ne ressemble pas au travail capitaliste.
De nombreux ouvrages féministes marxistes, qui m’ont beaucoup appris et qui sont très précieux, ont cherché à répondre à la question : quel est le statut des femmes sous le capitalisme ? La question féminine, en essayant d’expliquer les relations entre les sexes en termes de formes de travail, a pourtant limité notre capacité à réfléchir à la manière dont la relation entre le genre et le travail pourrait changer. Elle l’a figée excessivement. De nombreux débats sur la question des tâches ménagères, et en particulier sur les femmes au foyer et le travail domestique, ont eu lieu à un moment historique particulier et donc assez contingent. Les ouvrages marxistes féministes s’appuient sur cette analyse historiquement spécifique — selon laquelle un certain type de personnes effectue un certain type de travail — pour formuler un argument plus général sur le travail reproductif.
Il y a beaucoup de choses auxquelles nous pourrions réfléchir pour inclure le genre et le capitalisme dans une perspective plus large. Ce que j’essaie de comprendre, c’est : pourquoi ce que nous appelons le travail reproductif est constamment sous-rémunéré ou effectué de manière inhabituelle ou plus informelle, comme beaucoup d’autres formes de travail ? Je pense que le travail reproductif est plus proche d’autres formes de travail qu’on ne le suggère parfois, mais il y a des éléments qui le rendent distinctif, qui ne concernent pas ses qualités intrinsèques, mais plutôt la manière dont ce travail de reproduction de la vie humaine s’effectue. Lorsque nous examinons ces processus de travail de manière plus concrète, nous constatons en fait de nombreux points communs avec les secteurs fondés sur des processus naturels que j’évoquais précédemment. Dans ces secteurs, comme dans le travail reproductif, il existe des formes de récalcitrance physique et de résistance qui rendent le processus de travail difficile à mécaniser, à industrialiser et à rendre efficace et productif.
Je pense que cela est très important pour comprendre comment et pourquoi le capital absorbe et organise ces processus de travail ou les abandonne, les laissant à quelqu’un d’autre, par exemple à une famille. Une fois que nous comprenons pourquoi ces types de travail sont souvent non rémunérés ou sous-payés, nous pouvons nous interroger sur qui finit par faire ce travail et pourquoi. C’est là que nous pouvons réintroduire l’analyse de genre, ainsi que d’autres éléments de l’analyse de classe et de race.
Fondamentalement, c’est sur l’organisation du processus de travail par le capital que nous devons concentrer notre critique — dans ce cas, notre critique de l’économie politique du travail reproductif. Il est alors beaucoup plus utile de comprendre la spécificité du travail reproductif au sein du capitalisme plutôt que de simplement dire que le travail reproductif est une catégorie stable et que c’est ce que font les femmes — ce qui est ce que beaucoup de débats ont dit jusqu’à présent.
Dans votre ouvrage, vous réfutez le pouvoir du capitalisme de « créer » la famille ou le genre à ses fins ; vous pouvez ainsi soutenir que le statut du travail reproductif dans le capitalisme n’est pas dû à sa nature, mais à la manière dont le capitalisme traite les activités liées à la nature. Pouvez-vous expliquer cette différence ?
Je critique le rôle que joue l’idéologie dans de nombreux débats féministes marxistes centrés sur l’idée de la naturalisation des femmes. Selon ces débats, il y a quelque chose dans notre perception des femmes et du genre qui les classe comme faisant partie de la nature ; c’est pourquoi leur travail reproductif est traité comme un cadeau gratuit plutôt que comme un véritable travail.
Je pense que cette approche attribue trop de pouvoir aux idées, par rapport à une approche marxiste ou matérialiste. Les femmes sont valorisées, elles sont naturalisées, et leur travail est donc considéré comme bon marché, mais d’autres types de travail ne sont pas mystifiés de cette façon. La question est donc la suivante : pourquoi le capital a-t-il choisi tel domaine, et non tel autre, pour en faire un domaine de mystification idéologique ? Pourquoi ne pas simplement nous mystifier tous, tout le temps ?
Il nous faudrait soit avoir une conception beaucoup plus forte de l’idéologie dans son ensemble comme moteur des mécanismes du capitalisme, soit reconnaître que l’idéologie, tout en faisant partie du capitalisme, n’en est pas le moteur. Je ne veux pas rejeter complètement le monde de l’idéologie, des idées, des visions du monde, et je n’ai pas une théorie complète de la manière dont les idées s’inscrivent dans ce processus et à quel moment elles interviennent. Je pense simplement que dans de nombreux récits, les idées ont été surestimées par rapport à d’autres facteurs plus importants.
Selon vous, critiquer la mainmise du capitalisme sur la nature est une erreur, car une telle critique signifierait que les êtres non humains ne faisaient pas déjà partie du capitalisme. Pourquoi cette intégration a-t-elle déjà eu lieu ?
Il existe tout un courant de réflexion sur les types de nature qui n’ont pas encore été intégrés dans la production capitaliste, qui n’ont pas été marchandisés, principalement les écosystèmes et les grandes étendues sauvages ou non cultivées.
La question est alors : que faisons-nous à leur sujet ? Comment les considérons-nous ? Ce problème de valeur — le fait qu’ils produisent des valeurs d’usage sous-évaluées — est reconnu depuis longtemps ; il peut être discuté, par exemple, dans les pages du Financial Times.
Dans cette perspective, le problème est que la nature n’a pas de prix : il y a un écart entre son utilité et sa valeur d’échange. Une réponse a donc été : « Nous allons simplement mettre un prix sur la nature. » Il suffit de déterminer ce qu’elle devrait valoir et de lui attribuer un prix. Divers projets ont tenté de le faire, mais la plupart ont échoué.
C’est sur l’organisation du processus de travail par le capital que nous devons concentrer notre critique.
Alyssa Battistoni
La critique de cette approche a généralement été une critique morale affirmant que la valeur de la nature dépasse son prix. C’est une position à laquelle je suis sensible, mais c’est aussi une position incohérente, car il est évident que nous transformons de nombreux types de nature en marchandises qui finissent par entrer dans la production capitaliste : matières premières, différents types de ressources. Alors pourquoi certains types de nature échappent-ils au domaine du prix et de l’économie, alors qu’il est acceptable d’en utiliser d’autres types ?
Nous pouvons construire une critique beaucoup plus forte du capitalisme dans son ensemble si nous ne commençons pas par accepter cette distinction entre deux types de nature, l’une dont le prix peut être fixé — un arbre dans une plantation forestière, par exemple — et l’autre dont le prix ne peut l’être — un arbre sacré dans une forêt tropicale. C’est la première chose que je souhaite remettre en question.
De plus, je dirais également que la nature est déjà inestimable dans le capitalisme, dans le sens où celui-ci la traite par défaut comme un cadeau gratuit, dont le prix est nul. Nous devons remettre cela en question et ne pas nous contenter d’essayer de résoudre le problème en attribuant une valeur monétaire à la nature, pour plutôt nous demander : pourquoi certains aspects particuliers de la nature sont-ils toujours inestimables ? Pourquoi le capitalisme ne les intègre-t-il pas dans son orbite ? Là encore, une fois que nous aurons fait cela, nous pourrons adopter une perspective plus politique et économique plutôt que de nous limiter à une critique morale.
Si la nature peut être représentée dans les relations de marché et les relations sociales capitalistes, où elle est détenue sous forme de propriété, où quelqu’un en perçoit un loyer — c’est une façon pour la nature d’être représentée dans le capitalisme —, pourquoi y a-t-il tant d’éléments de la nature qui ne le sont pas ? Nous pouvons réfléchir à la fois aux limites des formes de propriété, mais aussi aux raisons pour lesquelles les écosystèmes ne sont tout simplement pas susceptibles de générer de la valeur, et identifier cela comme la source de leur abandon par le capitalisme.
En fin de compte, nous devons également reconnaître qu’ils ne se situent pas vraiment en dehors du capitalisme, car ils continuent d’être érodés, transformés et détruits, précisément en raison de leur manque de valeur. Ils ne se situent pas du tout en dehors du capitalisme, ils sont simplement transformés par le capital d’une manière différente.
Vous définissez les écosystèmes non pas comme du capital naturel, mais comme des infrastructures qui sont des « biens communs ». Cela renvoie à la théorie des biens publics en économie, mais alors que les biens publics ne peuvent pas être épuisés, ces biens communs, eux, le peuvent. Quel est donc le rôle de l’État pour ces biens ?
L’argument du bien public est un argument qui s’oppose à l’économie dominante et qui peut nous indiquer où se situent certains des problèmes. Le concept de bien public décrit des choses dont il est très difficile d’empêcher d’autres personnes de se servir : l’océan et l’atmosphère en sont des exemples classiques. On ne peut pas les posséder dans le sens où on ne peut pas empêcher les autres de les utiliser. Or, cette exclusion est essentielle à la propriété.
De tels biens ont donc un statut étrange dans un monde où la valeur tirée de la nature passe par sa possession. Cela place ces entités dans une position d’abdication, où le capital, s’il n’y a pas moyen de les rendre productives et génératrices de valeur, renonce à toute responsabilité à leur égard.
Le capital cultive de nombreuses formes de nature, qui en sont venues à dominer notre planète, comme le bétail et les céréales cultivées. Les types de nature qui se sont révélés relativement faciles à intégrer dans les processus de production de valeur sont devenus la majeure partie de ce qui existe dans notre monde. Mais la plupart des espèces et des formes de vie existantes sont simplement ignorées par le capital, qui n’en a aucune utilité. Elles sont simplement là, et sont pour la plupart érodées et détruites par négligence : c’est pourquoi elles sont considérées comme des « biens communs », car elles peuvent être érodées.
L’État est la réponse classique au problème des biens publics. Si le capital ou le marché ne fournissent pas quelque chose, l’autre acteur majeur capable d’agir à une telle échelle est l’État. Dans le cas de ces biens communs, de nombreux efforts ont été déployés pour mettre au point des mécanismes de marché afin qu’ils puissent être appropriés, évalués et échangés. Si l’on souhaite vraiment les protéger, cependant, la meilleure solution serait simplement de les socialiser, de les traiter comme un véritable bien public contrôlé par la collectivité. Peut-être que « contrôlé » n’est d’ailleurs pas le mot juste, on pourrait dire détenu et géré collectivement.
Je pense que socialiser la nature nous obligerait à nous poser des questions importantes : utilisez-vous cette zone humide comme habitat et pour la filtration de l’eau, ou la transformez-vous en habitations pour du tourisme de luxe ? Une fois que vous commencez à considérer cela comme un espace politique de prise de décision, il s’agit d’un espace collectif de contrôle et de prise de décision. On commence à voir apparaître une telle approche, qui conteste le pouvoir décisionnel du capital. La question de savoir si l’on peut attendre des États qu’ils rendent des comptes à la société est tout autre chose. Mais c’est là au moins un domaine d’action potentiel pour l’État.
La règle du marché est ce que Niko Kolodny appelle une « règle par personne ». Personne en particulier n’est responsable : nous prenons tous nos propres décisions individuelles qui sont agrégées par le marché.
Alyssa Battistoni
Vous prônez donc une « création consciente de la planète ». Qu’est-ce que cela signifie et en quoi cela diffère-t-il d’une perspective de géo-ingénierie ?
Collectivement, nous façonnons notre planète chaque jour, à chaque instant, d’une manière qui ne relève pas de notre choix, à travers nos actions filtrées par le marché. Mais une autre forme de création de la planète dans le capitalisme passe par le contrôle des investissements : les décisions sont prises par un très petit groupe de personnes qui contrôlent également les moyens de production et qui, par conséquent, orientent la plupart des décisions concernant la structure fondamentale de notre monde d’une manière qui ne laisse aucune voix au chapitre à la plupart d’entre nous. Les capitalistes eux-mêmes sont poussés par la valeur, par la concurrence avec d’autres capitalistes. Il existe une force compulsive qui remodèle notre planète et à laquelle nous sommes tous soumis d’une manière ou d’une autre.
Je pense donc qu’il faut absolument mettre fin à la transformation capitaliste de la planète. Mais dans tous les cas, nous allons devoir prendre de nombreuses décisions sur la manière de continuer à vivre sur cette planète. Nous ne pouvons pas simplement revenir à un état naturel. Nous allons devoir vivre dans ce monde transformé. Nous allons devoir décider : quels écosystèmes voulons-nous préserver tels quels ? Lesquels doivent être utilisés pour produire ce dont les gens ont besoin pour vivre ? Il y a beaucoup de gens sur la planète, qui ont besoin de beaucoup de choses pour vivre : cela va inévitablement impliquer la transformation de la nature, notamment par le biais de formes de production de masse et de transformation à grande échelle. Nous allons devoir prendre des décisions sur toutes ces questions.
Ce que j’appelle la « création consciente de la planète » est une façon de la créer en gardant à l’esprit les objectifs que nous voulons atteindre pour notre vie commune. C’est aussi une façon de reconnaître que notre vie commune en tant qu’êtres sociaux implique inévitablement des décisions sur la manière dont nous organisons la nature. C’est également grâce à cette conscience que nous reconnaissons les limites de notre contrôle et de notre capacité à refaire le monde, et que nous en prenons conscience — cette prise de conscience étant absente des perspectives de géo-ingénierie.
Décider de recourir à la géo-ingénierie solaire serait par exemple une forme de création inconsciente de la planète : nous n’avons aucune idée précise de ce qui se passerait si nous le faisions. C’est une forme de non-reconnaissance des limites de notre capacité à contrôler les conséquences de nos actions. Rejeter la géo-ingénierie ne signifie pas que nous n’aurons pas non plus à prendre des décisions concernant, par exemple, la restauration d’une forêt, qui est également une forme de création de la planète.
Dans votre épilogue, vous envisagez une société post-capitaliste, et la question de la place des marchés dans une telle société se pose. Dans son livre Cannibal Capitalism, Nancy Fraser défend l’idée que nous pouvons conserver les marchés pour les « niveaux intermédiaires » : ni pour les décisions concernant la société dans son ensemble ou pour la manière dont le monde est façonné, ni pour les besoins fondamentaux, mais pour beaucoup d’autres biens et décisions entre ces deux niveaux. Considérez-vous les marchés comme un moyen d’organiser et de distribuer les biens et les décisions ?
Je n’ai pas de théorie complètement aboutie sur le rôle des marchés dans une société post-capitaliste. Je pense qu’ils ont probablement un rôle limité à jouer, qui ne concerne pas la prise de décisions sociales importantes ou l’accès aux nécessités de la vie. Les marchés peuvent être des outils pour obtenir des informations et organiser et distribuer des biens, plutôt que ce qu’ils sont actuellement, à savoir un outil décisionnel majeur et un moteur d’activité.
Je suis probablement d’accord avec une grande partie de ce que dit Nancy Fraser. Cela dit, je pense que les externalités et le capital naturel sont inévitablement très difficiles à intégrer dans les marchés. Dans un monde où nous essayons de réfléchir sérieusement à ce que les marchés peuvent et ne peuvent pas faire, il importe de réfléchir à la manière d’évaluer et d’intégrer certaines choses qui ne seront jamais intégrées de la même manière que d’autres types de biens.
Comme vous le dites, la socialisation de la nature par l’État aurait également des implications considérables pour le capital. Mais comment l’État, lui-même contraint par sa dépendance au capital — comme on peut le voir au Chili, par exemple, dans le rapport de l’État avec les grandes sociétés minières — peut-il trouver les moyens de socialiser un ensemble de ressources ?
Je travaille actuellement sur la question de l’État et de ses relations avec le climat et le capitalisme. C’est une grande question à laquelle je ne réponds pas vraiment dans mon livre. Qu’est-ce que l’État dans une société capitaliste ? Que fait-il ? Que pouvons-nous attendre de lui ? Que pouvons-nous attendre de lui ?
Je pense que même si les États sont généralement orientés vers la reproduction des conditions d’accumulation et la facilitation du capital, qu’ils ont des incitations à agir en ce sens et peuvent réaliser ce que le capital ne peut pas faire, il est parfois possible pour eux d’aller dans une direction différente.
L’État est enclin à soutenir les conditions d’accumulation. Il a besoin de recettes et de créer des emplois pour assurer sa légitimité. Il y a toutes sortes de choses que les États doivent faire qui sont alignées sur les objectifs du capital. Mais il y a aussi des domaines où ces objectifs sont plus ambigus.
L’État n’est pas orienté vers la production de valeur de la même manière que le capital ; ce n’est pas un grand espoir, mais c’est celui que nous avons. C’est au moins un point de départ pour mener certains combats et, espérons-le, élargir l’écart entre capital et État tout en accentuant la tension entre les deux.
La nature a toujours fait partie de notre politique. Cela dit, la théorie politique a souvent eu tendance à s’abstraire de ces conditions matérielles.
Alyssa Battistoni
Vous terminez votre livre en exposant votre conception de la liberté : un équilibre à sans cesse chercher entre les contraintes du monde matériel et notre capacité à agir en tant qu’êtres humains. Quelles tensions se font jour entre ces deux termes ?
Dans le chapitre de conclusion, je souhaite me montrer critique mais bienveillante envers certaines tendances existantes de la pensée marxiste. Je continue de trouver très puissante une grande partie de l’idée marxiste classique de la liberté, qui met l’accent sur la réduction du travail et certaines formes d’abondance matérielle. Mais cette idée a évolué, dans certaines versions, vers celle que la liberté n’est possible qu’une fois que l’on a entièrement vaincu la nécessité. Parfois, les gens finissent par confondre la nécessité avec la domination de la nature en soi, et suggèrent que ce n’est que lorsque l’on a dépassé, surmonté cette nécessité, que l’on peut être libre.
Si nous reconnaissons que nous vivons dans un monde soumis à des contraintes écologiques où il n’est probablement pas possible de dépasser la nécessité, et que nous sommes inévitablement des créatures dans le besoin, qui auront besoin les uns des autres et du monde non humain, cette vision est profondément pessimiste. Dans ce monde contraint, les moyens de dépasser la nécessité deviennent de plus en plus absurdes, de plus en plus fantaisistes et on préconise par exemple ceci : « Nous devons exploiter les astéroïdes pour que les habitants de la Terre soient libres. »
La position qui défend que la liberté est purement sociale, en revanche, néglige généralement les conditions matérielles de la liberté et soutient que la liberté ne concerne que les relations entre les êtres humains.
Ce que j’aime dans la « liberté ambiguë » de Simone de Beauvoir, c’est qu’elle tente de maintenir cette conscience de l’être : nous sommes des créatures incarnées, mais nous sommes aussi des êtres conscients. Nous sommes à la fois esprit et corps. L’un ne prime pas sur l’autre. Nous devons nous considérer à la fois comme des entités physiques et incarnées, mais aussi comme des êtres qui tentent de vivre leur vie d’une manière qui, selon eux, reflète ce qui est important à leurs yeux, leurs valeurs — d’une manière qui ne se limite pas à énoncer un ensemble de principes éthiques, mais qui consiste à les mettre en pratique dans le monde matériel.
Cela m’a beaucoup aidé à réfléchir à la manière de concilier notre nature nécessairement incarnée et notre capacité à prendre des décisions sur la manière dont nous interagissons les uns avec les autres, tout en structurant ces relations de manière plus ou moins libre. Le monde matériel sera toujours là, mais il est également toujours compris à travers le prisme des significations sociales, culturelles et humaines.
Nous devons toujours essayer de maintenir l’équilibre entre le naturel et le social, tout en acceptant qu’il existe une part d’ambiguïté. Il s’agit également d’accepter le caractère infini de ces décisions et le fait que la liberté est un processus continu et non un objectif à atteindre. Ce processus continu consiste à déterminer comment vivre ensemble dans le monde, et à le faire dans des circonstances changeantes, d’une manière que nous ne pouvons ni prévoir ni contrôler.
La lutte pour réaliser et mettre en œuvre la liberté ne prendra jamais fin. Et cela, pour moi, est à la fois stimulant et encourageant pour réfléchir à la manière dont nous allons avancer sur une planète de plus en plus effrayante.
Sources
- Andreas Malm, Avis de tempête. Nature et culture dans un monde qui se réchauffe, Paris, La fabrique, 2023.
- Anna Tsing, Le Champignon de la fin du monde, Paris, La Découverte, 2017.
- Niko Kolodny, « Rule over None : What Justifies Democracy ? », Philosophy and Public Affairs, Vol. 42 (3), 2014, pp. 195-229.
- Ronald Coase, « The Problem of Social Cost », Journal of Law and Economics, 3(1), 1-44.
- Silvia Federici, Point zéro : propagation de la révolution. Salaire ménager, reproduction sociale, combat féministe, Donnemarie-Dontilly, Éditions iXe, 2016.

