« Un Ecclésiaste du vingtième siècle », Einstein par Oppenheimer
Oppenheimer : écrits choisis | Épisode 7
Dix ans après la mort d’Albert Einstein, Oppenheimer lui rend hommage dans un éloge funèbre d’une grande finesse. Essayant d’embrasser toutes les facettes de ce personnage complexe, de sa carrière scientifique à son immense charisme, il esquisse aussi son autoportrait — moins de deux ans avant sa propre mort.
- Auteur
- Le Grand Continent
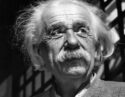
Certaines oraisons funèbres sont plus marquantes que d’autres. Celle de Madame par Bossuet témoignait du néant et de la grandeur de l’homme ; celle d’Einstein par Oppenheimer raconte la grandeur de la science lorsqu’elle trouve un interprète génial et singulier. Avant d’être publié dans la New York Review of Books, ce texte a été prononcé à l’UNESCO en décembre 1965, dix ans après la mort d’Albert Einstein. C’est un subtil portrait où l’évaluation des travaux scientifiques de ce dernier est présentée en miroir de ses qualités telles qu’Oppenheimer veut les décrire.
Leur relation a récemment été mise sous le feu des projecteurs dans le film de Christopher Nolan. Einstein y est présenté comme un interlocuteur privilégié d’Oppenheimer pendant l’élaboration de la bombe atomique : ce dernier va notamment le voir pour lui présenter certains de ses calculs les plus inquiétants. Il s’agit d’une pure licence artistique puisque c’est Arthur Compton, de l’Université de Chicago, qui avait été consulté. Du propre aveu de Christopher Nolan : « Je l’ai remplacé par Einstein. C’est la personnalité que les gens connaissent dans le public ». Du reste, la relation entre les deux hommes, qui connaissaient parfaitement leurs travaux respectifs, fut longtemps houleuse. Ils avaient vingt-cinq ans d’écart et s’opposèrent notamment sur certaines applications de la physique quantique : Einstein mena en effet un long combat contre l’introduction par la théorie quantique de la notion de hasard fondamental dans la représentation scientifique du monde, objectant, selon une phrase devenue célèbre, que « Dieu ne jou[ait] pas aux dés ». Aux yeux d’Oppenheimer, il fut aussi un vieux maître qui menait des combats d’arrière-garde : cet éloge porte la trace de ses conflits, quoique leur virulence ait été lissée par le passage du temps et la complicité tardive qui s’est nouée entre les deux savants.
À partir de 1947, en effet, ils furent collègues à l’Institut d’études avancées de Princeton, dont Oppenheimer prit la direction à la suite d’Einstein. C’est dans ce contexte qu’ils se rapprochèrent, non sans que certains de leurs désaccords ne restent vifs. L’éloge d’Oppenheimer porte aussi la trace d’une autre différence fondamentale : leur rapport à l’État et au gouvernement. Tandis qu’Einstein entretenait une méfiance profonde pour tout appareil étatique, Oppenheimer fut pendant une longue période un scientifique qui opéra au cœur de l’administration américaine. Même après la révocation de son habilitation de sécurité en 1953, il refusa par exemple de signer certains manifestes contre les armes nucléaires, y compris le manifeste Russell-Einstein en 1955. De même, invité, il choisit de ne pas participer à la première conférence du mouvement Pugwash en 1957. Faut-il voir l’évocation qu’il fait de ces activités tardives d’Einstein dans cet éloge comme l’expression d’un regret ? S’il finit par rejoindre un certain nombre des compagnons de route d’Einstein en 1960 dans la World Academy of Art and Science, Oppenheimer n’a jamais complètement renié l’arme atomique. C’est peut-être la différence principale entre lui et Einstein : d’un côté, un scientifique qui avait connu plusieurs émigrations, et qui, jusqu’au bout, resta hostile à toute autorité et à toute violence, surtout si elle émanait de l’État ; de l’autre, un chercheur qui avait tellement trouvé sa place au sein de la technocratie de guerre américaine qu’il ne sut jamais rompre avec elle — même lorsque les États-Unis le mirent au ban.
Oppenheimer insiste fortement sur cette différence, allant jusqu’à écrire que la lettre envoyée par Einstein à Roosevelt le 2 août 1939 — et préparée par le physicien hongrois Leó Szilárd —, dans laquelle il lui recommandait d’engager des recherches sur les usages civiles et militaires de l’uranium — en lui faisant remarquer que les Allemands avaient déjà commencé — n’aurait en rien pesé dans le programme nucléaire américain. De ce point de vue, ce portrait, qui souligne plus de différences que de points d’accords, dessine aussi en creux un autoportrait d’Oppenheimer.
Mais en dépit de ces profondes divergences, il porte aussi l’empreinte de la passion, commune aux deux hommes, pour la physique et la philosophie de la nature. Au moment où Oppenheimer prononce ces mots, il ne sait pas encore qu’il a un cancer de la gorge, qui l’emporta moins de deux ans plus tard, mais il se sent de plus en plus faible, épuisé qu’il est par une mauvaise toux. Se sentant vieillir, on le devine, au choix des mots, ému par la manière dont Albert Einstein a vécu sa vie d’homme et de scientifique. À plusieurs reprises, il souligne qu’en plus d’être scientifiquement révolutionnaires, les travaux d’Einstein avaient une qualité esthétique — une forme de beauté ou d’élégance — qui leur était propre : « ses premiers manuscrits étaient paralysants de beauté ». C’est peut-être le plus bel hommage que le « père de la bombe atomique » pouvait rendre à celui qu’il qualifie de « plus grand philosophe de la nature de notre temps ».
Bien que j’aie connu Einstein pendant deux ou trois décennies, ce n’est qu’au cours de la dernière décennie de sa vie que nous avons été des collègues proches et même des amis. Mais j’ai pensé que cela pourrait être utile, car je suis sûr qu’il n’est pas trop tôt — et peut-être déjà trop tard pour notre génération — pour commencer à dissiper la nuée mythologique et dévoiler le pic formidable que ces nuages cachent. Comme toujours, le mythe a son charme, mais la vérité est bien plus belle.
Einstein a toujours fait preuve d’une pureté merveilleuse, à la fois enfantine et profondément obstinée.
J. ROBERT OPPENHEIMER
Vers la fin de sa vie, alors qu’il était désespéré par les armes et les guerres, Einstein a déclaré que si tout était à refaire, il se ferait plombier. C’était un mélange de sérieux et de plaisanterie que personne ne devrait essayer de troubler aujourd’hui. Croyez-moi, il n’avait aucune idée de ce qu’était un plombier, et encore moins aux États-Unis, où l’on dit en plaisantant que le comportement typique de ce spécialiste est qu’il n’apporte jamais ses outils sur les lieux de la catastrophe. Einstein n’a cessé d’apporter ses outils sur les lieux de crise ; c’est un physicien et le plus grand philosophe de la nature de notre temps.
Ce que nous avons déjà entendu, ce que vous savez tous, ce qui constitue la partie authentique du mythe, c’était son extraordinaire originalité. La découverte des quanta serait sûrement venue d’une manière ou d’une autre, mais c’est lui qui les a découverts. La compréhension profonde de ce que signifie qu’aucun signal ne puisse voyager plus vite que la lumière serait sûrement advenue — les équations formelles étaient déjà connues — mais cette compréhension simple et brillante de la physique aurait pu être beaucoup plus lente à venir — et beaucoup plus floue — s’il ne l’avait faite pour nous. Quant à la théorie générale de la relativité qui, aujourd’hui encore, n’est pas bien prouvée expérimentalement, personne d’autre que lui ne l’aurait faite avant longtemps, très longtemps. En fait, ce n’est qu’au cours de la dernière décennie, et même de ces dernières années, que l’on a constaté comment un physicien piéton et travailleur, ou plusieurs d’entre eux, pouvaient parvenir à cette théorie et comprendre cette union singulière de la géométrie et de la gravitation ; et nous ne pouvons le faire aujourd’hui que parce que certaines des possibilités ouvertes a priori sont limitées par la confirmation de la découverte d’Einstein selon laquelle la lumière serait déviée par la gravitation.
Ce n’est qu’avec l’arrivée des nazis au pouvoir qu’il commença à comprendre avec mélancolie et sans jamais l’accepter vraiment qu’en plus de comprendre, l’homme a parfois le devoir d’agir.
J. ROBERT OPPENHEIMER
Mais il y a un autre aspect d’Einstein que l’originalité. Il a apporté au travail de l’originalité des éléments profondément issus de la tradition. Il n’est qu’en partie possible de découvrir comment il y est parvenu, en suivant ses lectures, ses amitiés, les maigres archives dont nous disposons. Mais parmi ces éléments de tradition profondément ancrés — je n’essaierai pas de tous les énumérer, car je ne les connais pas tous —, trois au moins étaient indispensables et n’ont cessé de l’accompagner.
Le premier élément provient d’un champ de la physique aussi beau qu’il est obscur, à savoir l’explication des lois de la thermodynamique en termes de physique statistique. Einstein l’a toujours pratiquée. C’est ce qui lui a permis, à partir de la découverte par Planck de la loi du rayonnement du corps noir, de conclure que la lumière n’était pas seulement constituée d’ondes mais aussi de particules, dont l’énergie est proportionnelle à leur fréquence et dont la quantité de mouvement est déterminée par leur nombre d’ondes, ces fameuses relations que Broglie devait étendre des électrons à l’ensemble de la matière.
C’est cette tradition statistique qui a conduit Einstein aux lois régissant l’émission et l’absorption de la lumière par les systèmes atomiques. C’est elle qui lui a permis de voir le lien entre les ondes de Broglie et les statistiques des quanta de lumière proposées par Bose. C’est ce qui lui a permis de rester un découvreur et un promoteur actifs des nouveaux phénomènes de la physique quantique jusqu’en 1925.
Les clefs d’un monde cassé.
Du centre du globe à ses frontières les plus lointaines, la guerre est là. L’invasion de l’Ukraine par la Russie de Poutine nous a frappés, mais comprendre cet affrontement crucial n’est pas assez.
Notre ère est traversée par un phénomène occulte et structurant, nous proposons de l’appeler : guerre étendue.
Sa seconde attache à la tradition, tout aussi profonde — et je pense que nous savons d’où elle vient — était son amour total pour l’idée de champ : c’est-à-dire la possibilité de suivre des phénomènes physiques dans des détails minutieux et infiniment subdivisibles dans l’espace et dans le temps. C’est ainsi qu’il a vécu son premier grand drame en essayant de voir comment les équations de Maxwell pouvaient être vraies. Il s’agissait des premières équations de champ de la physique ; elles sont toujours vraies aujourd’hui, avec seulement quelques modifications mineures et bien maîtrisées. C’est cette tradition qui lui a fait comprendre qu’il devait y avoir une théorie du champ de la gravitation, bien avant que les indices de cette théorie ne soient entre ses mains.
La troisième tradition relève moins de la physique que de la philosophie. Il s’agit d’une variante du principe de la raison suffisante. C’est Einstein qui a demandé ce que nous voulions dire, ce que nous pouvions mesurer, quels éléments de la physique étaient conventionnels. Il a insisté sur le fait que ces éléments conventionnels ne pouvaient jouer aucun rôle dans les véritables découvertes physiques. Cette idée a également ses racines : tout d’abord, l’ingéniosité mathématique de Riemann, qui a vu à quel point la géométrie des Grecs avait été déraisonnablement limitée. Mais surtout, elle s’inscrivait dans la longue tradition de la philosophie européenne, qui commence avec Descartes — vous pouvez, si vous le voulez, la faire commencer au treizième siècle, parce qu’elle a en réalité commencé à ce moment-là — pour se poursuivre avec les empiristes britanniques, avant d’être très clairement énoncée par Charles Pierce, sans pourtant que cela n’ait d’influence en Europe : il fallait se demander ce que l’on pouvait en faire et ce que cela signifiait. S’agissait-il simplement de quelque chose qui pouvait nous aider à calculer ? Ou, au contraire, pouvions-nous réellement l’étudier dans la nature à l’aide de moyens physiques ? Le fait est que les lois de la nature ne décrivent pas seulement les résultats des observations, mais qu’elles délimitent le champ d’application de ces observations. C’est ainsi qu’Einstein a compris le caractère limitatif de la vitesse de la lumière ; c’est également la nature de la résolution dans la théorie quantique, où le quantum d’action, la constante de Planck, a été reconnu comme limitant la finesse de la transaction entre le système étudié et la machine utilisée pour l’étudier, limitant cette finesse dans une forme d’atomicité tout à fait différente et beaucoup plus radicale que toutes celles que les Grecs avaient imaginées ou que celles qui étaient familières dans la théorie atomique de la chimie.
Il avait bien sûr un nombre incroyable de disciples, entendu comme des personnes qui, en lisant son travail ou en l’entendant enseigner, ont appris de lui et ont eu une nouvelle vision de la physique, de sa philosophie, c’est-à-dire de la nature du monde dans lequel nous vivons.
J. ROBERT OPPENHEIMER
Dans les vingt-cinq dernières années de sa vie, la tradition lui a, d’une certaine manière, fait défaut. Ce sont les années qu’il a passées à Princeton. Et bien qu’il soit une source de chagrin,cet échec ne doit pas être occulté. Il y avait droit . Il a d’abord passé ces années à essayer de prouver que la théorie quantique comportait des incohérences. Personne n’aurait pu être plus ingénieux pour trouver des exemples inattendus et astucieux ; mais il s’est avéré que ces incohérences n’existaient pas et que leur résolution pouvait souvent être trouvée dans des travaux antérieurs. Lorsque cela n’a pas fonctionné, après des efforts répétés, Einstein a simplement déclaré qu’il n’aimait pas la théorie. Il n’aimait pas ses éléments d’indétermination. Il n’aimait pas l’abandon de la continuité ou de la causalité. C’étaient des choses avec lesquelles il avait grandi, qu’il avait préservées et énormément développées ; et les voir disparaître lui était extrêmement difficile, alors même que c’était son travail qui avait armé leur assassin. Il s’est noblement et furieusement battu avec Bohr, et il a combattu la théorie qu’il avait engendrée mais qu’il détestait. Ce n’est pas la première fois que cela se produisait en science.
Il travaillait également sur un programme très ambitieux, qui visait à combiner la compréhension de l’électricité et de la gravitation de manière à expliquer ce qu’il considérait comme l’apparence — ou l’illusion — du caractère discret des particules dans la nature. Je pense qu’il était clair à l’époque, et je pense que c’est encore le cas aujourd’hui, que les éléments sur lesquels reposait cette théorie étaient trop maigres et laissaient de côté trop de choses connues des physiciens, mais qui ne l’étaient pas encore à l’époque des études d’Einstein. Elle apparaissait donc comme une approche désespérément limitée et historiquement conditionnée par accident. Bien qu’Einstein ait suscité l’affection ou, plus justement, l’amour de tous pour sa détermination à mener à bien son programme, il avait perdu la plupart de ses liens avec le monde de la physique, parce qu’il avait raté certaines découvertes, faites trop tard pour qu’il ait le temps d’en prendre connaissance.
Ses premiers manuscrits étaient paralysants de beauté.
J. ROBERT OPPENHEIMER
Einstein était aussi connu, et je pense à juste titre, comme un homme d’une grande bonne volonté et d’une grande humanité. En effet, si je devais trouver un seul mot pour décrire son attitude à l’égard des problèmes humains, je choisirais le mot sanscrit Ahimsa — qui signifie la non-violence et la bienveillance. Il avait une méfiance profonde à l’égard du pouvoir ; il ne conversait pas aisément et naturellement avec les hommes d’État et les hommes de pouvoir, comme le faisaient Rutherford et Bohr, qui sont peut-être les deux physiciens de ce siècle qui furent ses plus grands rivaux. En 1915, alors qu’il élaborait la théorie générale de la relativité, l’Europe se déchirait et perdait la moitié de son passé. Il a toujours été pacifiste. Ce n’est qu’avec l’arrivée des nazis au pouvoir qu’il eut quelques doutes à cet égard, comme le montre sa célèbre et profonde correspondance avec Freud. Il commença alors à comprendre avec mélancolie et sans jamais l’accepter vraiment qu’en plus de comprendre, l’homme a parfois le devoir d’agir.
Einstein était l’un des hommes les plus sympathiques qui soient. J’ai eu l’impression qu’il était aussi profondément seul. Beaucoup de très grands hommes sont solitaires ; pourtant, j’ai eu l’impression que même s’il était un ami profond et loyal, les affections humaines les plus fortes occupaient une place peu profonde ou peu centrale dans sa vie, prise dans sa totalité. Il avait bien sûr un nombre incroyable de disciples, entendu comme des personnes qui, en lisant son travail ou en l’entendant enseigner, ont appris de lui et ont eu une nouvelle vision de la physique, de sa philosophie, c’est-à-dire de la nature du monde dans lequel nous vivons. Mais il n’avait pas, dans le jargon technique, d’école. Il n’avait pas beaucoup d’étudiants qui étaient ses apprentis et ses disciples. Il y avait chez lui quelque chose d’un travailleur solitaire, qui tranchait fortement avec les équipes que nous voyons aujourd’hui, et avec la manière très coopérative dont d’autres secteurs de la science se sont développés. Plus tard, il s’est fait aider par des personnes qui travaillaient avec lui. On les appelait généralement des assistants et ils avaient une vie merveilleuse. Le simple fait d’être avec lui était merveilleux. Sa secrétaire avait une vie merveilleuse. Son sens de la grandeur ne l’a jamais quitté une minute, pas plus que son sens de l’humour. Les assistants faisaient une chose qui lui avait manqué dans sa jeunesse. Ses premiers manuscrits étaient paralysants de beauté, mais ils comportaient de nombreux errata. Plus tard, il n’en laissa plus. J’ai eu l’impression que, parallèlement à ses malheurs, sa célébrité lui procurait certains plaisirs, non seulement le plaisir humain de rencontrer des gens, mais aussi le plaisir extrême de la musique qu’il jouait non seulement avec Elisabeth de Belgique, mais aussi avec Adolf Busch, alors même qu’il n’était pas un très bon violoniste. Il aimait la mer, il aimait naviguer et il était toujours heureux de monter sur un bateau. Je me souviens d’avoir marché avec lui le jour de son soixante et onzième anniversaire. Il me dit : « Vous savez, lorsqu’il a été donné à un homme de faire quelque chose de sensé, la vie devient ensuite un peu étrange ».
Si je devais trouver un seul mot pour décrire l’attitude d’Einstein à l’égard des problèmes humains, je choisirais le mot sanscrit Ahimsa — qui signifie à la fois la non-violence et la bienveillance.
J. ROBERT OPPENHEIMER
Après ce que vous avez entendu, je n’ai pas besoin de redire à quel point son intelligence était lumineuse. Il n’était en rien un sophiste ou un mondain. Je pense qu’en Angleterre, on aurait dit qu’il n’avait pas beaucoup de « background », et en Amérique qu’il manquait d’« education ». Cela nous éclaire peut-être un peu sur la façon dont ces mots sont utilisés. Je pense que cette simplicité, cette rigueur et cette absence de langue de bois ont eu beaucoup à voir avec la sauvegarde, tout au long de sa vie, d’un certain monisme philosophique pur, un peu à la manière Spinoza, qu’il est bien sûr difficile de conserver si l’on a été « éduqué » ou si l’on a un « background ». Il a toujours fait preuve d’une pureté merveilleuse, à la fois enfantine et profondément obstinée.
Einstein est souvent blâmé, loué ou crédité de ces terribles bombes. À mon avis, ce n’est pas vrai. La théorie spéciale de la relativité n’aurait peut-être pas été aussi belle sans Einstein, mais elle serait devenue un outil pour les physiciens et, en 1932, les preuves expérimentales de l’interconvertibilité de la matière et de l’énergie qu’il avait prédite étaient écrasantes. La faisabilité d’une exploitation massive de ces données n’est apparue clairement que sept ans plus tard, et ce presque par accident. Ce n’est pas ce qu’Einstein recherchait vraiment. Son rôle fut de susciter une révolution intellectuelle et de découvrir, plus que tout autre scientifique de notre époque, à quel point les erreurs commises par les hommes avant lui étaient profondes. Il a écrit une lettre à Roosevelt sur l’énergie atomique. Je pense qu’il s’agissait de l’expression de son tourment face à la malfaisance des nazis, mais aussi de sa volonté de ne nuire à personne de quelque manière que ce soit. Je dois néanmoins souligner que cette lettre a eu très peu d’effet : Einstein n’est vraiment pas responsable de tout ce qui s’est passé par la suite. Je crois qu’il l’a compris lui-même.
Je pense qu’en Angleterre, on aurait dit qu’il n’avait pas beaucoup de « background », et en Amérique qu’il manquait d’« education ».
J. ROBERT OPPENHEIMER
Sa voix s’élevait avec beaucoup de force contre la violence et la cruauté partout où il les voyait et, après la guerre, il a parlé avec une profonde émotion et, je crois, avec beaucoup de force, de la violence absolue de ces armes atomiques. Il a dit tout de suite avec une grande simplicité : « Nous devons désormais créer un gouvernement mondial ». C’était très direct, c’était très abrupt, c’était sans doute « sans éducation » et sans « background » ; mais nous devons tous, dans une certaine mesure, reconnaître qu’il avait raison.
Sans pouvoir, sans calcul, sans l’humour profondément politique qui caractérisait Gandhi, il a néanmoins fait bouger le monde politique. Dans le dernier acte de sa vie, il s’est joint à Lord Russell pour défendre l’idée que les hommes de science s’unissent pour se comprendre et éviter le désastre qu’il pressentait dans la course aux armements. Le mouvement dit de Pugwash, qui porte aujourd’hui un nom plus long, est le résultat direct de cet appel. Je sais qu’il a joué un rôle essentiel dans le traité de Moscou, le traité d’interdiction limitée des essais, qui est une déclaration provisoire, mais très précieuse à mes yeux, selon laquelle la raison pourrait encore l’emporter.
Lorsque je l’ai connu, pendant ses dernières années, Einstein était un Ecclésiaste du vingtième siècle, disant avec une implacable et indomptable gaieté : « Vanité des vanités, tout est vanité ».


