Le capitalisme déchaîné
La période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale a vu le capitalisme se transformer en profondeur. Mais ces évolutions n’étaient pas structurellement déterminées : si la trajectoire du capitalisme a pu s’ancrer dans certaines démocraties jusqu’à finir par écarter tous les modèles rivaux, c’est à travers une série de raisons contingentes que Krishnan Nayar explore dans son dernier livre. Un compte-rendu signé Branko Milanovic.
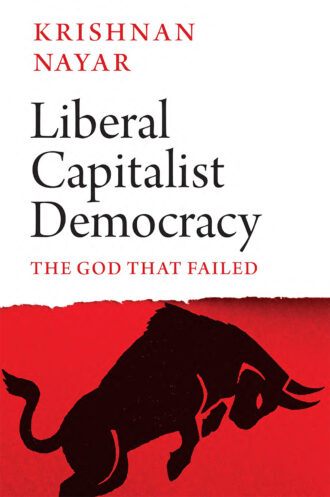
Krishnan Nayar soulève trois points essentiels dans l’ouvrage qu’il vient de publier, Liberal Capitalist Democracy : The God that Failed. Premièrement, il affirme que les révolutions bourgeoises ont souvent échoué à conduire à la démocratie, un point de vue fortement ancré dans l’interprétation whig de l’histoire et dans le marxisme simplifié. Les révolutions bourgeoises auraient plutôt provoqué une réaction aristocratique et des développements économiques autoritaires qui, à bien des égards, ont été plus fructueux que ceux de la démocratie bourgeoise. En d’autres termes, la démocratie ne vient pas avec le capitalisme — comme nous le verrons, le capitalisme la détruit même souvent. Les modernisateurs autoritaires — Nayar en étudie quatre : l’Allemagne après 1848, la France de Louis-Napoléon, l’Allemagne de Bismarck et la Russie de Stolypine — ont bénéficié d’un large soutien de la part de la bourgeoisie qui, craignant pour ses biens, a préféré se ranger du côté de l’aristocratie réformatrice plutôt que de jeter son dévolu sur le prolétariat. C’est d’ailleurs l’une des déceptions qui ont surpris Marx et Engels en 1848-51, lorsqu’ils ont constaté que les classes possédantes se rangeaient du côté de Louis-Napoléon Bonaparte plutôt que de celui des ouvriers parisiens.
Deuxièmement, Nayar affirme que le capitalisme darwinien débridé conduit toujours à l’instabilité et à l’anomie sociales, et que l’instabilité sociale renforce les partis de droite. Il affirme ainsi que la montée au pouvoir d’Hitler a été rendue possible, voire causée, par la dépression de 1928-1932, et non, comme le pensent certains historiens, par la peur du communisme ou les mauvaises tactiques du parti communiste qui, au lieu de s’allier aux sociaux-démocrates, les a combattus.
Troisièmement, et c’est peut-être le point le plus intéressant, Nayar affirme que le succès du capitalisme occidental au cours de la période 1945-1980 ne peut s’expliquer sans tenir compte de la pression exercée sur le capitalisme à la fois par l’existence de l’Union soviétique en tant que modèle alternatif de société, et par des partis de gauche forts liés aux syndicats dans les principaux pays d’Europe. En ce sens, la période des Trente glorieuses, qui est aujourd’hui considérée comme la période la plus fructueuse du capitalisme, se serait produite à l’encontre des tendances capitalistes normales. C’était une anomalie. Elle ne se serait pas produite sans la pression socialiste et la peur des émeutes, des nationalisations et – même – des défenestrations. Mais avec la montée de l’économie néolibérale après 1980, le capitalisme est volontiers revenu à ses versions originales du XIXe et du début du XXe siècle, qui produisent régulièrement de l’instabilité sociale et des conflits.
Avec la montée de l’économie néolibérale après 1980, le capitalisme est volontiers revenu à ses versions originales du XIXe et du début du XXe siècle, qui produisent régulièrement de l’instabilité sociale et des conflits.
Branko Milanovic
La leçon à tirer de Nayar est, d’une certaine manière, assez simple.
Le capitalisme, s’il n’est pas ancré dans la société et s’il n’accepte pas de limites à ce qui peut être marchandisé, doit passer par des périodes récurrentes d’effondrement et de prospérité. Mais ces deux phénomènes ne peuvent pas être considérés comme un plus et un moins qui s’annulent l’un l’autre. Leurs effets politiques sont très différents. Et c’est là que Nayar prend à partie de nombreux économistes, qui considéraient la dépression des années 1920 comme une période de purification du capitalisme devant déboucher sur un boom. Le fait est qu’il s’agit ici de personnes réelles et non de simples chiffres : beaucoup ne veulent pas attendre que le boom se produise ; il se peut même qu’ils ne soient pas là lorsqu’il se produira. C’est pourquoi ils votent pour des solutions radicales ou descendent dans la rue. C’est un aspect souvent oublié par les économistes qui traitent les revenus des individus sur le long terme comme une somme mathématique, sans se rendre compte que les effets politiques des phases d’effondrement sont très différents de ceux des phases de prospérité.
Si nous examinons les trois thèses principales du livre de Nayar, aucune d’entre elles n’est nouvelle. Mais elles le sont lorsqu’elles sont mises bout à bout et replacées dans leur contexte historique. Les modernisations autoritaires ont bien sûr fait l’objet de nombreux ouvrages, dont certains, comme le classique de Barrington Moore, sont ici cités. La montée du fascisme a été – et est toujours – liée aux politiques d’austérité, comme les ouvrages récents de Mark Blyth (Austerity : History of a Dangerous Idea) et Clara Mattei (The Capital Order : How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism) le rappellent. Nayar exagère peut-être en affirmant que de nombreux historiens, tels que Ian Kershaw et Joachim Fest, ont tendance à ignorer les causes économiques de la montée du nazisme parce qu’ils considèrent l’économie capitaliste comme acquise. C’est peut-être vrai pour certains observateurs contemporains comme Churchill ou Keynes, qui semble avoir été inconscient des effets politiques de la crise jusqu’à une date relativement tardive, mais les historiens les plus sérieux reconnaissent l’impact considérable de la dépression. Il est en effet difficile de ne pas le faire lorsque le PIB de l’Allemagne a diminué d’un cinquième et que plus d’un quart de sa population active était au chômage.
Les économistes traitent les revenus des individus sur le long terme comme une somme mathématique, sans se rendre compte que les effets politiques des phases d’effondrement sont très différents de ceux des phases de prospérité.
Branko Milanovic
Cependant, Nayar présente un argument plus subtil qui concerne la position des partis communiste et social-démocrate en Allemagne. Contrairement à de nombreux historiens qui reprochent à Staline d’avoir décidé de diriger l’animosité du KPD non pas vers les fascistes, mais vers ceux que Staline appelait les « sociaux-fascistes », c’est-à-dire le SPD, Nayar pense que la collaboration entre les deux partis était impossible en raison de la différence de leurs circonscriptions et de leurs positions au sein du système de Weimar. Le SPD était fortement ancré dans le système de Weimar. Il a participé aux politiques d’austérité, soutenu les réductions de dépenses et l’équilibre budgétaire, et a été impliqué dans la décision de ne pas prolonger les allocations de chômage ; ce qui a déclenché une nouvelle chute du gouvernement et les élections qui ont finalement porté les nazis au pouvoir — grâce aussi, bien sûr, aux machinations en coulisses de von Papen et du fils d’Hindenburg. Le KPD, quant à lui, a vu ses rangs grossir par les chômeurs, c’est-à-dire par les mêmes personnes que les sociaux-démocrates poussaient dans la rue. Il était impossible pour les deux partis de collaborer, que Staline le veuille ou non. Certes, l’absence de coopération a ouvert la voie à Hitler, mais en l’état des lignes politiques des deux partis à l’époque — qui, comme tout acteur politique, ne pouvaient connaître l’avenir — il était tout simplement impossible qu’ils s’accordent à unir leurs forces.
Le troisième point soulevé par Nayar est également de plus en plus reconnu : il concerne le soutien indirect que les régimes communistes et les partis de gauche ont apporté au capitalisme et aux capitalistes, en les poussant à réformer le système et à se rendre compte qu’en l’absence de politiques sociales plus fortes, ils risquaient d’être submergés par les partis communistes. Dans un article empirique très important1, André Albaquerque Sant’Anna a montré que les politiques sociales ont été plus fortement développées dans les pays où les partis socialistes ou communistes étaient plus forts ou où la menace de l’Union soviétique était plus grande. Nayar cite un certain nombre d’hommes politiques et d’intellectuels britanniques qui font le même constat, même s’ils n’en sont pas toujours conscients. Il critique à juste titre Tony Judt qui, bizarrement, a refusé de l’accepter.
L’expérience soviétique et son importance internationale n’ont pas joué un rôle uniquement en Italie où, à un moment donné, un tiers de la population votante soutenait le parti communiste, ou en France où la part des communistes oscillait autour de 20 % ; elle intervint aussi dans les débuts de la planification néerlandaise ou les plans quinquennaux indiens. Je pense donc qu’il n’y a pas de contestation sérieuse à ce sujet. Nayar peut s’en prendre à certains historiens qui sont singulièrement aveugles à la réalité, mais le point de vue raisonnable est que l’expérience soviétique — très embellie — a eu un impact important, promouvant indirectement des politiques qui n’auraient jamais vu le jour autrement et qui auraient été rejetées d’emblée par la classe capitaliste.
Le point de vue raisonnable est que l’expérience soviétique — très embellie — a eu un impact important, promouvant indirectement des politiques qui n’auraient jamais vu le jour autrement et qui auraient été rejetées d’emblée par la classe capitaliste.
Branko Milanovic
Dans cette partie du livre, Nayar est cinglant quant à la déconnexion des soi-disant intellectuels marxistes avec la réalité de leur propre pays et du monde. Il attribue à juste titre cette déconnexion à l’incapacité d’accepter que le capitalisme a été, même à contrecœur, accepté par la majorité de la population, y compris par la majorité des travailleurs ; que les revenus réels ont augmenté et que le rôle typique du parti communiste, qui se considérait comme le leader de la classe ouvrière dans une relation antagoniste avec la bourgeoisie, était tout simplement obsolète.
En conséquence, les intellectuels marxistes sont devenus ce que Nayar appelle des « playboys intellectuels » sans aucun impact perceptible sur la politique. Ils nous paraissent aujourd’hui risibles — et ils l’étaient probablement à l’époque. S’ils s’étaient réellement intéressés au marxisme, et non à philosopher pour quelques heureux élus ; s’ils s’étaient intéressés aux sujets qui préoccupaient Marx, Engels, Lénine, Trotsky, ou Kautsky et qui avaient trait au développement du capitalisme et à la vie des gens normaux, ils auraient remarqué les changements qui se sont produits entre 1945 et 1980 : la taille de la classe ouvrière avait diminué, les revenus réels avaient augmenté, le pouvoir des syndicats disparaissait, les grandes entreprises n’exerçaient plus le rôle qu’elles avaient dans le passé et, ce qui est peut-être le plus important, le changement technologique était devenu très différent du progrès technologique connu au XIXe et au début du XXe siècle. Tous ces développements ont tout simplement échappé à l’attention des (quasi) marxistes mentionnés par Nayar : Sartre, Althusser et Marcuse. Pour être tout à fait juste, la sélection de Nayar est elle-même étroite, peut-être trop influencée par les salons londoniens et parisiens. En effet, de nombreux membres de la gauche ont perçu ces développements, mais il est vrai qu’ils étaient moins populaires, parmi la jeunesse rebelle des années 1960 et 1970, que les personnes mentionnées ici.
Ces penseurs ont donc manqué le changement à l’œuvre à l’intérieur du capitalisme, mais les capitalistes ne leur ont de toute façon pas prêté beaucoup d’attention. Le néolibéralisme s’est senti enhardi par la dynamique interne qui marginalisait la classe ouvrière, puis par la chute précipitée de l’Union soviétique et du communisme. Une fois que le capitalisme s’est retrouvé sans rival, il est rapidement revenu à ses politiques passées, manifestant bon nombre de ses pires caractéristiques oubliées pendant les trente glorieuses. Marx, avec sa critique du capitalisme, est devenu beaucoup plus notre contemporain que la myriade d’autres philosophes — Garton Ash, Ignatieff, Fukuyama et autres — qui, oublieux des leçons de l’histoire, avaient célébré le triomphe du capitalisme dans une prose non moins irréaliste que celle par laquelle Sartre et Marcuse l’avaient vilipendé quarante ans auparavant.
Marx, avec sa critique du capitalisme, est devenu beaucoup plus notre contemporain que la myriade d’autres philosophes — Garton Ash, Ignatieff, Fukuyama et autres — qui, oublieux des leçons de l’histoire, avaient célébré le triomphe du capitalisme dans une prose non moins irréaliste que celle par laquelle Sartre et Marcuse l’avaient vilipendé quarante ans auparavant.
Branko Milanovic
La question que tout le monde se pose après avoir lu le livre de Nayar est la suivante : « Et après ? » Car si le capitalisme continue sur la trajectoire actuelle que Nayar estime presque prédestinée, il doit à nouveau produire de l’instabilité et du rejet. Et cela ferait — une fois de plus — le jeu des mouvements de droite. Nous pourrions rejouer un siècle plus tard la même histoire que celle qui s’est déroulée dans l’Europe des années 1920. L’histoire se répète rarement mot pour mot : nous ne verrons probablement pas débarquer les chemises noires ou les mouvements d’uniformes de couleurs différentes qui ont inondé l’Europe dans les années 1920, mais nous pourrions voir, comme c’est déjà le cas, des partis issus de mouvements nationalistes ou quasi fascistes revenir au pouvoir et défaire la mondialisation, combattre les immigrants, célébrer le nationalisme, couper l’accès aux prestations sociales à ceux qui ne sont pas assez « indigènes ». Est-ce du fascisme ? Une légère variante ? C’est la conclusion mélancolique que l’on peut tirer de cette vaste étude des développements politiques et économiques de l’Occident au cours des deux derniers siècles.
Au total, c’est un livre impressionnant par la quantité de détails qu’il rassemble, par l’érudition de Nayar et son sens de l’insolite et de l’absurde, ainsi que par son style sans complaisance. Cependant, l’ouvrage a aussi certaines limites : le livre ne traite que des pays d’Europe occidentale, et encore seulement quelques-uns d’entre eux — le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne — avec de surcroît une partie consacrée aux développements pré-révolutionnaires russes. Il est également vrai que la sélection des intellectuels visés par les commentaires souvent acerbes de Nayar — et dans certains cas sauvages ou drôles — se limite à un groupe relativement restreint d’intellectuels français et britanniques, saupoudrés, pour faire bonne mesure, de quelques Américains. Or la scène intellectuelle européenne était bien plus large que les personnes mentionnées dans le livre. Le livre ne traite pas non plus du reste du monde : l’Afrique et la lutte anticoloniale ne sont pas du tout présentes ; l’Amérique latine est totalement absente ; l’Inde est mentionnée en quelques phrases ; et la Chine est inexistante, à l’exception de la guerre de Corée. Il s’agit donc d’un livre limité dans sa portée géographique et idéologique, ainsi que dans le choix des personnes que Nayar dénonce. Néanmoins, malgré ces limites, il traite de manière très convaincante d’une période cruciale de l’histoire politique occidentale — nous faisant envisager l’avenir avec une certaine crainte.
Sources
- https://mpra.ub.uni-muenchen.de/64756/ MPRA Paper No. 64756

