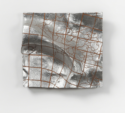La guerre en Ukraine constitue un tournant politique majeur dans l’histoire de l’Europe depuis 1957. Elle la confronte à la réalité d’une guerre interétatique de haute intensité jamais connue sur le continent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ; elle l’expose à une Russie qui, en agressant l’Ukraine, a détruit l’architecture de sécurité européenne mise en place depuis 1991. Certes, ce conflit n’oppose pas directement la Russie à un État membre de l’Union européenne ; mais il l’affecte directement, au regard de la place de l’Ukraine dans l’équilibre géopolitique européen. De surcroît, une invasion réussie de l’Ukraine aurait menacé directement la sécurité de l’Union en décuplant l’agressivité politique et militaire de Moscou. La Russie aurait pu considérer l’invasion de la Moldavie après celle de l’Ukraine, et accentuer son travail de déstabilisation des autres États.
Depuis de nombreuses années, l’Union européenne s’efforçait de construire une politique commune vis-à-vis de la Russie. Force est d’admettre qu’elle n’y parvenait pas, tant la perception européenne de l’enjeu russe était hétérogène. Il y avait des États pour qui la menace russe était une menace existentielle ; d’autres qui, sans être totalement naïfs, pensaient ou espéraient que le maintien d’un dialogue politique ou d’une interdépendance économique forte avec la Russie atténuerait ses desseins révisionnistes ou hégémoniques ; enfin, il fallait compter avec les États pour qui la question russe constituait un enjeu relativement secondaire, soit parce qu’ils ne percevaient pas la réalité de sa menace sur leur propre sécurité, soit parce qu’ils s’accommodaient de la Russie, avec laquelle ils entretenaient des relations cordiales, parfois alimentées par des relations interpersonnelles aussi fortes que troublantes.
Par la brutalité de son action, la Russie est parvenue à réunir contre elle l’ensemble des États de l’Union. Non seulement son agressivité s’est révélée au grand jour ; mais sa parole politique, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, s’en est trouvée dévaluée.
Zaki Laïdi
Le 24 février 2022 a balayé d’un seul coup cette perception éclatée au profit d’une représentation désormais largement partagée : celle d’une Russie révisionniste et hégémonique remettant en cause la sécurité de l’Europe. Moscou a brutalement envahi un État souverain après avoir officiellement déclaré qu’il ne nourrissait aucune intention de cet ordre. Par la brutalité de son action, la Russie est parvenue à réunir contre elle l’ensemble des États de l’Union. Non seulement son agressivité s’est révélée au grand jour ; mais sa parole politique, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, s’en est trouvée dévaluée. Comment, après cela, croire à la véracité d’un engagement politique russe ?
Cette unanimité européenne a donc été rendue possible par la brutalité de l’opération, par l’argumentaire fallacieux sur lequel la Russie s’appuyait pour la justifier, mais également par les piètres performances de son armée. En effet, une guerre éclair gagnée en quelques jours aurait rendu la riposte européenne plus difficile, non pas sur le plan des principes, mais sur le plan opérationnel. Le fait que le gouvernement légal et légitime d’Ukraine soit resté en place, que la résistance du peuple ukrainien se soit exprimée, que dès les premiers jours les plans russes aient été déjoués, ont modifié la donne. La deuxième armée du monde s’est révélée une caricature d’elle-même, tandis que l’armée ukrainienne symbolisait la résistance d’un peuple.
Ce texte n’est pas destiné à refaire l’historique du conflit ou à en relater les différentes étapes. Il cherche plutôt à comprendre en quoi cette guerre a changé le visage de l’Europe ; en quoi elle l’a fait passer du statut de simple puissance normative à celui d’une puissance géopolitique. À cette fin, il nous paraît utile de dégager dans la dynamique politique de l’Europe actuelle trois dimensions : l’acquis, le requis et l’indécis.
L’acquis, c’est ce que l’Union est parvenue à réaliser à la faveur de ce conflit ; le requis est ce qui lui reste à accomplir sur le chemin de la puissance ; enfin, l’indécis est l’ensemble des sujets qui n’ont pas encore été tranchés, soit parce que nous manquons de recul pour le faire, soit parce que les enseignements de cette guerre sont loin d’être tous connus.
Cette guerre a changé le visage de l’Europe. Elle l’a fait passer du statut de simple puissance normative à celui d’une puissance géopolitique.
Zaki Laïdi
L’acquis
L’acquis est le contraire de l’inné ; or l’inné de l’Europe, c’est le refus de la puissance au sens classique du terme. En effet, le projet européen était d’abord et avant tout destiné à prévenir un nouveau conflit entre la France et l’Allemagne. Il visait à pacifier les relations intra-européennes par l’échange et la complémentarité économique. L’épure était donc kantienne : elle reposait sur le principe de la paix par l’échange. La politique extérieure était laissée de côté ; soit parce qu’aucun État européen ne souhaitait à cette époque aliéner sa souveraineté dans ce domaine sensible, surtout après l’échec retentissant de la CED ; soit parce que ceux qui étaient à disposés à le faire n’envisageaient cette action que dans le cadre exclusif de l’OTAN. N’oublions pas le préambule du traité franco-allemand de 1962 voté par le Bundestag, le subordonnant clairement à l’alliance atlantique garante de la sécurité de l’Allemagne.

La guerre en Ukraine a-t-elle modifié ce rapport à la puissance ? Il semblerait, dans la mesure où la condition essentielle de la puissance repose sur deux facteurs : le sentiment d’être confronté à un danger existentiel et la volonté de prendre des risques pour le réduire ; or c’est bien cette double démarche qui a animé l’Europe depuis le début de la guerre. Le sens du danger a conduit l’Europe à voter une succession de dix paquets de sanctions en l’espace d’un an, et cela dès le début de l’invasion. Ces sanctions visaient non seulement à cibler les élites russes, mais à affaiblir l’effort de guerre, ce qui est tout à fait inédit dans la politique européenne ; ce fut un changement qualitatif peu commenté, mais déterminant. Jusque-là, les sanctions européennes visaient à ostraciser des individus ou des entités, et non un régime. Là, il s’agissait de contraindre le régime russe pour infléchir sa politique ou la rendre plus difficile. Le contraste est frappant avec les réactions extrêmement limitées de l’Europe après l’occupation de la Crimée en 2014, où il fallut attendre qu’un appareil de la Malaysian Airlines soit abattu par les séparatistes du Donbass pour que l’Europe s’engage timidement sur la voie des sanctions.
En sanctionnant durement et rapidement la Russie, l’Europe a basculé vers le hard power. En effet, et contrairement à une idée reçue, le hard power n’a jamais signifié le seul recours à la force militaire, mais aussi le recours à la coercition – c’est ce seul point qui le sépare du soft power. Si donc la force militaire s’exerce dans le cadre d’une opération de maintien de la paix, elle ne relève nullement du hard power. En revanche, le vote de sanctions significatives destinées à affaiblir ou à contraindre la conduite d’un État relève pleinement du hard power. Si on ajoute à cela le financement militaire d’un État en guerre et le gel des avoirs russes détenus à l’étranger, il n’est pas déraisonnable d’affirmer que l’Europe a passé la première étape de qualification du hard power, une étape attendue depuis longtemps, mais jamais concrétisée à ce jour, probablement faute d’unité dans les rangs de l’Union.
En sanctionnant durement et rapidement la Russie, l’Europe a basculé vers le hard power.
Zaki Laïdi
En venant en aide à l’Ukraine et en décrétant des sanctions destinées à contraindre l’effort de guerre de la Russie, l’Europe a réussi à rendre crédible son ambition de puissance géopolitique ; mais son expression politique la plus forte dans cette guerre n’aura été ni le vote de sanctions massives contre la Russie, ni l’octroi d’une aide militaire européenne à l’Ukraine, mais la décision de mettre en l’espace d’un an un terme à notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. En effet, avant l’invasion de l’Ukraine, l’Europe importait 45 % de son gaz de Russie, un chiffre très élevé, qui s’était même accru après l’invasion de la Crimée — ce qui pouvait logiquement inciter Poutine à penser qu’en aucun cas l’Europe ne prendrait le risque de se couper de l’approvisionnement russe. La Russie fournissait de surcroît 200 millions de tonnes de pétrole et de produits pétroliers, sans parler du charbon, qui représentait la moitié des importations européennes. En l’espace d’un an, cette dépendance a été pratiquement éliminée pour le gaz, le charbon, le pétrole et les produits pétroliers.
Malgré cela, l’Europe est parvenue à compenser cette rupture par des sources d’approvisionnement alternatives que ses moyens financiers lui permettaient de trouver (parfois au détriment de pays plus pauvres) ; elle est aussi parvenue à réduire sa consommation de gaz de 20 % sans ralentissement de son économie. La Russie estimait que la dépendance de l’Europe vis-à-vis d’elle était tellement forte (75 % de son gaz et 55 % de son pétrole allaient vers l’Europe) qu’elle ne prendrait jamais le risque de s’opposer frontalement à elle ; or en assumant ce risque majeur, l’Europe a privé la Russie d’une source de revenus essentiels. Ainsi, elle a fait perdre à la Russie la bataille de l’énergie ; elle l’a non seulement privée de ressources, qui ont baissé de 40 % en un an, mais elle l’a contraint à gérer l’explosion de ses dépenses militaires.
Il en découle une logique de ciseaux où les revenus de la Russie s’effondrent tandis que ses dépenses explosent. Tendanciellement, le problème de la Russie est plus grave encore, car le coût d’extraction de ses hydrocarbures est devenu sous l’effet des sanctions deux fois plus élevé que la moyenne mondiale, réduisant ainsi sa marge de financement de la guerre. Certes, la Russie dispose de débouchés alternatifs en Chine, en Inde et en Turquie. Mais cette substitution n’est nullement contrariante pour l’Europe, dont l’objectif n’est pas d’exclure la Russie du marché mondial, mais bien de réduire les bénéfices de ses exportations pour limiter ses ressources pour la guerre. Là encore, les objectifs politiques de l’Europe sont atteints, d’autant que la mise en place d’un plafond sur les prix contraint la Russie à chercher des moyens alternatifs (shadow fleet) et à pratiquer des rabais sur ses prix.
L’Union a fait perdre à la Russie la bataille de l’énergie ; elle l’a non seulement privée de ressources, qui ont baissé de 40 % en un an, mais elle l’a contraint à gérer l’explosion de ses dépenses militaires.
Zaki Laïdi
La mise en place d’un plafond montre là encore la réalité et l’effectivité du hard power européen, puisque ce sont pour l’essentiel des compagnies installées en Europe qui disposent d’un quasi-monopole sur les assurances de fret maritime. Aujourd’hui, le pouvoir de marché de la Russie s’en trouve atténué, et l’Europe y a largement contribué. Cette dernière devra pourtant méditer les deux graves erreurs politiques qu’elle a commises : dépendre à l’excès du marché russe, et croire que l’interdépendance économique rendrait la Russie plus raisonnable et donc moins agressive. Il paraît difficile d’imaginer que l’Europe puisse revenir sur sa libération énergétique ; d’autant qu’en rompant avec sa dépendance russe, l’Europe parvient à atteindre deux objectifs politiques concomitants : sa politique russe ne sera plus dépendante de sa vulnérabilité énergétique, et sa libération du marché russe accélèrera sa transition énergétique. C’est ce que Pierre Charbonnier a appelé dans ces colonnes l’écologie de guerre.
L’accélération du recours aux énergies renouvelables et les mesures d’économie d’énergie ont permis à l’Europe d’aligner ses intérêts géopolitiques sur ses ambitions climatiques. Avant le 24 février, c’était une gageure, après le 24 février, c’est une réalité. Ainsi, malgré une dépendance énergétique très forte vis-à-vis de la Russie, malgré des regards divergents sur la réalité russe, malgré une politique étrangère soumise au carcan de l’unanimité, l’Union européenne est passée à l’âge de la puissance politique.
Par-delà les mesures qu’elle a prises et dont nous venons de parler, l’Europe a consenti à un effort économique et militaire considérable vis-à-vis de l’Ukraine. Son aide, incluant celle de l’Union et des États membres, atteint en termes de sommes promises 67 milliards d’euros, dont 12 milliards d’aide militaire, lesquels passeront à plus de 18 milliards d’ici la fin de l’année. Si on ajoute à cela les 22 milliards d’euros destinés à permettre l’exportation des produits agricoles ukrainiens, on arrive au chiffre de 90 milliards d’euros. En comparaison, l’aide américaine, très importante, atteint les 51 milliards.

Certes, l’aide militaire américaine est supérieure à celle de l’Europe ; mais l’écart n’est pas flagrant. Le soutien militaire européen représente 40 % de l’effort militaire américain — mais rapporté au PNB par habitant des États-Unis, les chiffres sont comparables. Par ailleurs l’addition de l’aide économique et militaire place l’Europe en tête. Au demeurant, les aides de l’Europe et des États-Unis sont complémentaires, et non concurrentes. Le soutien américain est crucial pour tout ce qui touche aux missiles de moyenne portée et au renseignement, sans parler du soutien politique sans lequel l’engagement de l’Europe n’aurait pas pu prendre cette importance ; mais cela ne doit cependant pas nous inciter à négliger encore une fois la qualité de l’équipement militaire européen.
L’Europe a consenti à un effort économique et militaire considérable vis-à-vis de l’Ukraine.
Zaki Laïdi
De surcroît, la gestion politique de l’Ukraine montre que ce sont les États européens, ou en tout cas certains d’entre eux, qui ont constamment l’initiative pour intensifier cette aide — par exemple la Pologne et la Slovaquie, qui ont ouvert le bal de la livraison de chasseurs à l’Ukraine. C’est du reste l’Estonie qui a mis sur la table un plan ambitieux de 4 milliards d’euros, destinés à permettre la fourniture d’un million de munitions à l’Ukraine.
Certes, il serait possible d’arguer que, dans ce conflit, l’Europe n’a pu agir que parce que prévaut un consensus entre ses États membres ; et que la force de ce consensus face à la Russie ne préjuge pas de son extension à d’autres sujets. L’objection est recevable, à condition d’introduire deux nuances. La première est que même un État membre comme la Hongrie, qui s’est depuis le début du conflit montré très réservé, voire peu solidaire des choix collectifs de l’Europe, n’a jamais utilisé son droit de veto pour s’opposer aux choix collectifs ; un tel État participe même au financement de la Facilité pour la paix. La seconde est qu’un événement d’une telle magnitude conduit forcément à tirer certains enseignements. Certes, rien n’est garanti. Mais cette guerre a créé une nouvelle dynamique politique, car elle a modifié le regard que l’Europe porte sur elle-même, et que peut-être le monde porte sur l’Europe. La puissance est un apprentissage ; elle n’exclut pas les aléas ou les revers — jusqu’à présent, ils semblent limités.
Le requis
En politique, rien n’est simple, surtout face à l’ampleur systémique de la crise ukrainienne. S’il ne fait guère de doute que la guerre en Ukraine a fait franchir à l’Europe les premiers pas vers ce que l’on appelle l’Europe géopolitique, cela ne signifie pas pour autant que tout est acquis ou que tout est réglé. Tout cela ne se vérifiera que dans la durée. En politique, la linéarité n’est pas la règle, surtout lorsque l’on a affaire à une fédération d’États.
Le premier requis concerne d’abord la capacité à maintenir le rythme et la vigueur de l’effort consenti. À quel rythme, et jusqu’à quand ? Personne ne le sait, car tout dépend des conditions dans lesquelles s’achèvera ce conflit ; pour le moment il est loin d’être terminé ; et s’il ne fait guère de doutes que la Russie ne peut plus gagner cette guerre, rien n’indique que l’Ukraine l’ait déjà remportée.
Au demeurant, les paramètres de la défaite comme ceux de la victoire ne sont pas totalement clairs. Naturellement, le recouvrement plein et entier de la souveraineté de l’Ukraine sur son territoire demeure l’objectif, mais ses conditions concrètes restent encore à définir ; d’autant que, indépendamment du recouvrement de la souveraineté territoriale, il conviendra de régler le problème des crimes de guerre, des réparations et des garanties de sécurité à offrir à l’Ukraine. Par ailleurs, malgré son échec politique majeur et ses revers militaires impressionnants, la Russie continue à bénéficier d’un pouvoir de nuisance considérable, fondé sur le sacrifice infini de ses hommes et le recours ininterrompu aux tirs d’artillerie. La Russie ne peut rien construire ou consolider, mais elle peut encore beaucoup détruire. Il est très probable que d’ici l’été, nous disposerons d’une évaluation beaucoup plus précise de la situation, car d’ici là, l’Ukraine aura déclenché une contre-offensive. Les points de vulnérabilité russes sont nombreux, particulièrement en Crimée. Il s’agit en effet d’une péninsule, reliée au sud de l’Ukraine et à la Russie par un nombre limité de voies ; couper ces voies revient à asphyxier la Crimée, ce qui constituerait, avant le Donbass, un basculement stratégique au regard de l’investissement politique et symbolique de Poutine en Crimée.
Les paramètres de la défaite comme ceux de la victoire ne sont pas totalement clairs.
Zaki Laïdi
Dans cette perspective, quatre facteurs jouent en faveur de l’Ukraine : la mobilisation pleine et entière du peuple ukrainien pour gagner la guerre, le soutien politique et militaire des États-Unis et de l’Europe, le maintien d’un fort soutien de l’opinion publique et la capacité de l’Europe à limiter les effets du choc énergétique. Les prix du gaz et du pétrole sont revenus à leur niveau d’avant-guerre, de même que celui des céréales : la tentative par la Russie d’instrumentaliser le conflit en provoquant une flambée des prix des denrées alimentaires et en suscitant un rejet politique de l’Occident dans les pays du Sud a largement échoué ; les prix restent certes élevés mais cette hausse tient moins à la guerre qu’à d’autres facteurs comme la sécheresse. Grâce au EU Solidarity Lines et au BSGI (Black Sea Grain Initiative) mis en place par la Turquie et les Nations unies, 51 millions de tonnes de céréales ukrainiennes et russes ont réussi à être exportées, ce qui a contribué à faire baisser les prix.
Il faut cependant admettre que l’édifice reste fragile. C’est la raison pour laquelle l’Europe a effectué un véritable travail politique, notamment en Afrique, pour expliquer que les sanctions contre la Russie ne concernaient pas les céréales. Le Haut-Représentant a ainsi écrit à 52 ministres africains pour leur préciser que les céréales n’étaient nullement concernées par les sanctions, et qu’il était parfaitement possible de s’approvisionner en céréales russes ou ukrainiennes.
L’édifice reste fragile. C’est la raison pour laquelle l’Europe a effectué un véritable travail politique, notamment en Afrique, pour expliquer que les sanctions contre la Russie ne concernaient pas les céréales.
Zaki Laïdi
C’est une réalité que le récit russe cherchait bien évidemment à contredire, mais cet exemple montre d’ailleurs qu’à la faveur de cette guerre, l’Europe a découvert la nécessité de se comporter comme un acteur transactionnel et plus simplement comme un acteur politique statique déclamant des principes abstraits ou dispensant automatiquement une aide au développement sans se préoccuper du comportement de ses partenaires. Les délégations européennes disposent désormais d’argumentaires précis pour déconstruire la propagande russe.
Ce travail politique s’est prolongé aux Nations Unies où, à la faveur de plusieurs résolutions, 140 États ont condamné l’invasion de l’Ukraine. Pour autant, il ne faut pas être dupe. Beaucoup d’États ne ressentent pas le conflit ukrainien dans des termes similaires aux nôtres. Ils ne nient pas l’agression russe ; mais ils veulent éviter que cette question domine l’agenda mondial, au point d’occulter d’autres problèmes plus pressants pour eux, comme le financement de la transition énergétique, l’endettement et le financement du développement. Leur conflit avec l’Europe n’est pas forcément un conflit de valeurs, mais de priorités.

Comment les en blâmer ? L’Europe n’a de surcroît aucune objection à ce que le reste du monde continue à commercer avec la Russie, à condition que les États tiers ne servent pas de base logistique à la réexportation vers la Russie de produits européens — ce qui est à l’évidence le cas. C’est la raison pour laquelle l’Union européenne a désigné un représentant spécial chargé d’assurer la veille sur ce sujet extrêmement sensible.
Beaucoup d’États ne ressentent pas le conflit ukrainien dans des termes similaires aux nôtres. Leur conflit avec l’Europe n’est pas forcément un conflit de valeurs, mais de priorités.
Zaki Laïdi
L’édifice est ainsi fragile, et l’Europe ne sera jamais totalement immunisée contre les risques d’une usure ukrainienne si le conflit venait à se poursuivre, voire à s’éterniser. La réalité multipolaire du monde nous force à la fois à maintenir notre cohésion, à accepter la perspective d’un engagement durable aux côtés de l’Ukraine, à prendre en compte la fatigue éventuelle des opinions, à empêcher la mise en place d’une coalition indirectement favorable à la Russie et à prévenir un soutien plus ouvert de la Chine à la Russie. Tous ces paramètres d’incertitude demeurent conditionnés par notre capacité à assurer le plus vite possible une victoire militaire de l’Ukraine.
L’indécis
Reste enfin ce que j’appelle l’indécis, c’est-à-dire l’ensemble des questions politiques et stratégiques ouvertes par cette guerre, et pour lesquelles il est encore très difficile de formuler des hypothèses et encore moins engager des pronostics.
La question la plus fondamentale concerne bien évidemment la place de la Russie dans l’architecture de sécurité européenne. Répondre à cette question est difficile, car cela dépendra beaucoup des conditions dans lesquelles ce conflit prendra fin, que nous ne connaissons pas encore. Pour l’heure, on voit mal comment la Russie pourrait être intégrée à une architecture de sécurité européenne qu’elle a détruite, même si elle restera notre voisin ; ce sera encore plus difficile si elle ne renonce pas à ses visées impériales et n’accepte pas que ses frontières se limitent à celles de la fédération de Russie, lesquelles sont ses frontières internationalement reconnues.
Que vaut en la matière la parole russe ? La question mérite d’être posée au regard de sa violation flagrante des engagements qu’elle avait pris vis-à-vis de l’Ukraine dans le mémorandum de Budapest de 1994. C’est la raison pour laquelle toute intégration de la Russie dans une nouvelle architecture de sécurité paraît extrêmement difficile sans rupture politique majeure. Or nous savons que si cette guerre a été déclenchée par Poutine, le problème de l’Ukraine est un problème russe, dont au fond Poutine n’a fait qu’aggraver les termes.
Si cette guerre a été déclenchée par Poutine, le problème de l’Ukraine est un problème russe, dont au fond Poutine n’a fait qu’aggraver les termes.
Zaki Laïdi
De surcroît, la guerre en Ukraine, qui était au départ une guerre territoriale, a généré sa propre dynamique. Jusqu’à la découverte du charnier de Boutcha, on aurait pu imaginer qu’un retrait russe d’Ukraine pouvait être la solution — même provisoire — au problème. Depuis, l’ampleur des crimes de guerre, des déportations d’enfants et des destructions d’infrastructures civiles ont alourdi le passif, comme si la Russie voulait rendre ce conflit interminable, inextricable et insoluble. Les conflits gelés sont la marque de fabrique de la politique russe, assez forte pour détruire, mais incapable de construire. Poutine ne veut probablement pas de solution à ce conflit. Il cherche donc à l’amplifier, à pousser à une implication directe de l’OTAN qui forcerait l’Occident à un compromis, compte tenu des risques d’embrasement généralisé. Les références à la menace nucléaire participent de cette stratégie d’intimidation, qui pour le moment n’a guère réussi.
On comprendra donc dans un tel contexte que toute discussion sur l’architecture européenne est prématurée. La première condition d’une pacification ou d’une normalisation des rapports d’avec la Russie passe par le retrait de ses forces armées, le transfert à l’Ukraine des avoirs russes gelés afin de permettre la reconstruction du pays, la mise en place d’un mécanisme juridique jugeant des responsabilités de la guerre et l’octroi de garanties juridiques susceptibles de prévenir une réédition du scénario du 24 février. Pour le moment, la conséquence la plus tangible de la guerre est et demeure l’entrée potentielle de l’Ukraine dans l’Union européenne. Ce n’est bien évidemment pour le moment qu’une perspective, compte tenu des énormes défis à surmonter. Mais cela reste une perspective crédible, concrète et surtout actée par les États membres de l’Union. La question de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN se posera à terme, puisqu’à l’évidence les garanties juridiques offertes à ce pays en 1994 se sont révélées insuffisantes.
Certes, cette éventualité est de nature à nourrir une nouvelle fois un esprit de revanche russe ; mais la guerre de 2022 montre en réalité que le fond du problème n’a jamais été l’OTAN en soi ; il vient davantage du processus de distanciation politique, économique et culturelle de l’Ukraine par rapport à la Russie. Tant que Moscou pensait pouvoir contrôler le pays, il tolérait son indépendance ; le jour où le Kremlin prit conscience que cette distanciation était probablement irréversible, il choisit la voie de la déstabilisation ; et quand la déstabilisation se révéla infructueuse, il choisit l’invasion. Il faut rappeler que la révolution de Maïdan n’est pas née de la perspective d’adhésion à l’OTAN, mais d’un projet de traité de libre-échange entre l’Ukraine et l’Union européenne — ce qui revient à dire que le fond du problème réside dans l’incapacité historique de la Russie à sortir du schéma colonial dans lequel son histoire s’est construite depuis plusieurs siècles.
La guerre de 2022 montre en réalité que le fond du problème n’a jamais été l’OTAN ; il vient davantage du processus de distanciation politique, économique et culturelle de l’Ukraine par rapport à la Russie.
Zaki Laïdi
On a cru que ce processus avait été engagé avec l’effondrement de l’URSS ; mais Poutine nous a rappelé qu’il n’en était rien, et que la Russie continuait à se penser comme un empire colonial. C’est le cœur du problème et c’est donc à la Russie d’y répondre. Historiquement, les fins d’empire ne sont pas faciles à gérer. Les Européens sont bien placés pour le savoir. Ce fut le cas pour l’Espagne avec Cuba, ou pour la France avec l’Algérie. En attendant cette éventualité, il appartient à l’Europe de contenir la Russie, y compris hors du continent où elle combat méthodiquement nos positions. Cette situation peut durer des années, et probablement des décennies ; même la perspective d’un conflit de haute intensité entre la Russie et l’Europe n’est pas à exclure. La question russe est donc encore devant nous.
Est-ce que l’Ukraine modifie notre rapport à la responsabilité stratégique de L’Europe ? Le terme de « responsabilité stratégique » est mieux adapté que celui d’autonomie stratégique, politiquement connoté. Ce qui est sûr, c’est que l’Ukraine a incontestablement relevé le niveau de conscience du danger et montré la nécessité de consentir un effort militaire soutenu sur le moyen ou long terme. L’accroissement des dépenses de défense sera dans les années à venir substantiel, pour des pays aussi importants que la France, l’Allemagne et la Pologne — cette dernière verra ses dépenses militaires monter jusqu’à 4 % de son PIB.
Certes, sans le soutien américain, la réponse militaire européenne à l’Ukraine aurait été insuffisante ; mais il serait inexact de penser que la réaction européenne à l’agression russe contre l’Ukraine ait été initiée par les seuls États-Unis. Il y a bien eu une forme de co-construction euro-américaine de la riposte, rendue possible par la très forte convergence des perceptions et des intérêts communs dans cette guerre.
Le terme de « responsabilité stratégique » est mieux adapté que celui d’autonomie stratégique, politiquement connoté.
Zaki Laïdi
Outre l’accroissement très probable des dépenses militaires, on peut noter d’ores et déjà un certain nombre d’initiatives, dont celles que viennent de prendre les quatre pays nordiques pour créer une défense aérienne commune intégrée. Naturellement, il ne s’agit là que de premiers pas, qui n’auront de sens que s’ils sont soutenus et démultipliés. Ces étapes ne modifient pas substantiellement le rapport de l’Union européenne à l’OTAN, dans la mesure où la défense territoriale de l’Europe relève plus que jamais de l’Alliance ; la guerre en Ukraine a clairement montré que les Européens n’étaient pas militairement prêts à relever seuls le défi d’une guerre de haute intensité.

Dans le même temps, cette guerre a encore une fois montré à l’Europe qu’elle devait consentir un effort particulier pour crédibiliser davantage le soutien américain. Et il est indéniable que les États-Unis sont et seront plus que jamais incités à intensifier l’effort de défense européen. Naturellement, cette complémentarité fonctionne lorsque, des deux côtés de l’Atlantique, la perception des problèmes et des réponses est identique.
Cette convergence forte pendant la guerre en Ukraine est-elle immuable ? Probablement pas — car rien n’est immuable en politique. Force est de constater que le lien transatlantique a été revitalisé par la guerre en Ukraine mais la solidité de ce lien impose l’accroissement de la responsabilité stratégique de l’Europe en matière de défense et de sécurité. Cela suppose que l’Europe revienne à une trajectoire haute de ses dépenses militaires, en ciblant l’effort quantitatif et qualitatif, c’est-à-dire la mutualisation de l’effort et l’autonomie d’action dans tous les champs extérieurs à la défense territoriale de l’Europe. Il y a du chemin à parcourir dans ce domaine. Car si la guerre a unifié les positions européennes autour du danger russe elle n’a nullement fait disparaître les sensibilités et disparités nationales très fortes au regard de leur façon de penser leur sécurité. Mais l’expérience ukrainienne montre que les choix stratégiques en Europe ne s’effectuent jamais à froid ou de façon abstraite mais à chaud et de manière concrète. Autrement dit ce seront toujours les crises qui feront l’Europe et rien d’autre.
En s’inspirant du modèle japonais, l’Europe doit jouer la carte de l’OTAN sans renoncer à son propre effort. C’est tout l’enjeu de sa responsabilité stratégique, telle qu’elle est posée par la Boussole stratégique. Dans cette perspective, la mutualisation des efforts européens sera essentielle, y compris à travers le développement d’une base militaire industrielle européenne. Il existe désormais plusieurs initiatives allant dans ce sens ; mais il reste encore beaucoup d’obstacles avant d’y parvenir. Par-delà la Russie et l’Ukraine , d’autres théâtres vont mettre l’Europe à l’épreuve de la pratique de la puissance. Le premier concerne la Chine ; le second, le Sud global — même si cette dernière expression mérite toujours d’être développée.
En s’inspirant du modèle japonais, l’Europe doit jouer la carte de l’OTAN sans renoncer à son propre effort.
Zaki Laïdi
La Chine ne doit pas être ostracisée ou combattue comme la Russie, parce que Pékin ne menace pas pour le moment notre sécurité. Certes, la Chine est un acteur avec lequel nous avons de profondes divergences, . Mais nous devons nous en tenir au triptyque « partenaire, concurrent et rival », avec une pondération entre ces trois facteurs qui variera en fonction des situations et des dynamiques politiques. La coopération est effective dans les domaines de la biodiversité ou même de l’endettement des pays pauvres. Elle devrait être plus grande dans le domaine du changement climatique. En revanche, nos positions restent très éloignées sur les questions d’universalité des droits humains que la Chine comme la Russie et bien d’autres veulent dissoudre ou subordonner au droit au développement. Nous devons garder ouverts sur tous sujets nos propres canaux de communication, d’information et de discussion avec Pékin — qu’il s’agisse de l’ouverture des marchés, des droits humains, de l’endettement des pays, du changement climatique ou de la biodiversité, sans compter les questions stratégiques et diplomatiques, comme l’Ukraine ou le Moyen-Orient. La Chine qu’on disait non préparée aux médiations a réussi à favoriser directement le rétablissement des relations diplomatiques entre Téhéran et Ryad ce qui n’est pas rien.
Nous n’avons intérêt ni à la création d’un axe Moscou/Pékin, ni à une subordination de la Russie à la Chine dont il faut néanmoins admettre qu’elle est bien engagée.. Nous devons juger le comportement de Pékin sur ses actes, tout en restant fidèles à la politique « d’une seule Chine » — qui, après tout, a fait la preuve de son utilité dans le maintien de la paix. Mais nous ne saurions accepter la moindre altération du statu quo par la force. Taïwan est un élément structurel de nôtre sécurité compte tenu de l’importance du détroit dans le transit des échanges mondiaux et de l’hyper concentration de la technologie des semi-conducteurs à Taïwan. Il importe donc que toutes les marines européennes — et pas seulement la française — poursuivent leurs missions de libre navigation dans le détroit de Taiwan — les fameuses FONOP (Freedom of Navigation Operations), au lieu de contourner l’île. La dernière mission navale française est d’ailleurs intervenue en avril 2023, lors de la visite du président Macron à Pékin.
L’autre contentieux majeur avec la Chine concerne les relations économiques de plus en plus déséquilibrées qui tiennent moins à la faible compétitivité européenne qu’aux entraves au marché mises par les autorités chinoises dans le cadre des programmes Made in China et Buy in China. Le déficit avec la Chine atteint près de 400 milliards et ne cesse de s’amplifier. Et la dynamique des investissements en Chine s’essouffle car le marché chinois devient de plus en plus difficile d’accès sauf dans les niches où les Chinois n’aspirent pas à avoir de champions nationaux — comme le luxe par exemple.
Nous nous devons de rester fermes sur les principes et de maintenir notre propre marge d’appréciation face aux problèmes qui se posent ou qui viendraient à se poser — et ce sans être dupes des tentatives de division.
L’Europe accepte l’émergence d’un monde multipolaire.
Zaki Laïdi
Le second axe concerne notre engagement avec les pays du Sud. C’est un sujet qui dépasse le cadre de ce propos, mais la guerre en Ukraine a mis en évidence une nouvelle permanence : beaucoup d’États cherchent à profiter de la multipolarité naissante du système mondial pour récuser toute forme d’alignement. Les craintes s’expriment face à un possible conflit sino-américain, ou à un conflit entre l’Ouest et la Russie.
Certes, certains États sont déterminés à tirer avantage de ces contradictions pour accroître leur propre marge de manœuvre ; d’autres craignent d’être pris en étau. Il nous revient à nous, Européens, d’agir dans ces contextes pour apaiser ces craintes ou proposer des alternatives. L’Europe accepte l’émergence d’un monde multipolaire — d’ailleurs, quand bien même elle ne le souhaiterait pas, cela ne changerait rien. L’important n’est pas tant que d’autres points de vue que le nôtre s’expriment, mais que nous parvenions à répondre aux besoins et aux craintes de ceux qui nous sollicitent ou dont nous recherchons l’amitié, tout en combattant les récits et les conduites de ceux qui cherchent à nous évincer ou à nous rabaisser. La pratique de la puissance est un sport de combat qui ne se limite pas à une seule épreuve. C’est un parcours que nous avons à peine entamé. Rien ne prouve que l’Europe le terminera ; mais tout indique depuis l’Ukraine qu’elle a échappé à son élimination — en se qualifiant pour le tour suivant.