Nova
Jusqu'à samedi, nous publions chaque jour en avant-première des extraits des cinq romans finalistes du Prix Grand Continent, qui sera remis le dimanche 18 décembre à 3466, au cœur du massif du Mont Blanc. Aujourd'hui, pour la première fois en français, nous vous offrons des extraits du roman de Fabio Bacá, Nova, une intrigue moderne où les certitudes cérébrales d'un neurochirurgien de Lucca s'ébranlent une à une — jusqu'à la catastrophe.
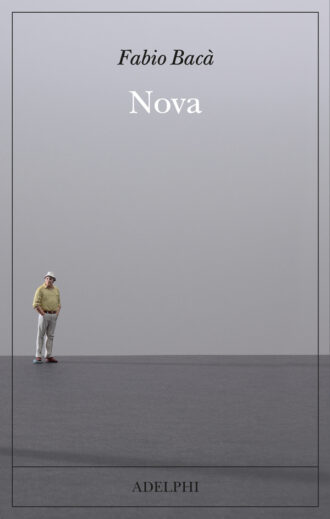
Prologue
« … Kabobo par exemple. Tu te rappelles Kabobo ? C’était à Milan, il y a trois ou quatre ans. Voilà. Le fou avec la pioche. Le Ghanéen qui a tué trois malheureux croisés par hasard à Niguarda. Oui. Lui. Le clandestin qui affirmait avoir entendu des voix dans sa tête avant de sortir casser celle des autres, et qui a fini par écoper d’une peine relativement légère grâce aux circonstances atténuantes controversées invoquées par un expert psychiatre face au tribunal. Mais moi, ce qui me paraît le plus significatif, c’est ce qui s’est passé quelques heures plus tôt. Tu te rappelles ? Ça m’étonnerait. Presque tout le monde a oublié, à présent. Un détail certes négligeable face à l’énormité des faits, mais d’une certaine manière tout aussi emblématique de cette affaire, un homme de trente-et-un ans qui trouve une pioche dans un chantier sans surveillance et s’en sert pour museler les suggestions mortifères d’une voix dans son esprit. Ce jour-là, à trois heures du matin, Kabobo agresse à mains nues deux personnes : à proximité de piazza Belloveso, une fille lui échappe seulement parce qu’elle habite tout près et parvient à ouvrir la porte de son immeuble à toute vitesse ; une demi-heure plus tard, un malheureux moins chanceux reçoit une gifle en plein visage. Le plus étrange, c’est qu’aucun signalement ne parvient aux autorités. N’est-ce pas surprenant ? Deux paisibles citoyens échappent aux coups potentiellement fatals d’un déséquilibré manifeste, mais aucun d’eux ne prend une minute pour téléphoner à la police. Entre cinq et six heures, Kabobo se procure une barre de fer et blesse gravement deux passants. Il en poursuit un troisième sorti promener son chien, mais celui-ci se met à courir et notre homme renonce à le poursuivre au bout de quelques pas. Et devine quoi ? Là non plus, personne ne songe à dénoncer les faits aux autorités. L’une des deux victimes de la barre de fer va carrément se faire soigner le bras aux urgences, mais il donne des explications vagues aux médecins : je ne comprends pas non plus pourquoi ces derniers ont omis d’alerter les autorités comme le leur imposait la loi et le code de déontologie. À ce moment-là, Kabobo a déjà trouvé l’outil qui apportera une contribution exponentielle à la brutalité de ses actes ultérieurs. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer le bruit qu’a fait la presse pendant les vingt-quatre heures qui ont suivi. Cinq agressions, zéro signalement : cinq personnes potentiellement étranglées ou tuées à coup de barre de fer, et pas un seul appel reçu par la centrale de la police ni des carabiniers. Le sempiternel peloton de sociologues, psychanalystes, philosophes et provocateurs professionnels est venu asséner au public ses interprétations éclairées : égoïsme épidémique, autisme émotionnel, effondrement des valeurs de civisme, d’empathie et de solidarité. Autant d’opinions sensées, certes. Mais moi, je te dis qu’il y a autre chose. Quelque chose qui n’a rien à voir avec la logique élémentaire ni l’érosion du sens de la miséricorde humaine. Ce que je crois, c’est que la plupart des gens n’est pas préparée à un événement aussi psychologiquement traumatique qu’une agression violente. Étant donnée la société dans laquelle nous vivons, il est tout à fait probable qu’un Occidental lambda soit prédisposé à la possibilité de subir un type de violence quelconque : mais je t’assure qu’entre la prise en compte d’un événement désagréable et sa métabolisation émotive, il y a un gouffre. Je suis prêt à parier qu’aucune des personnes qui ont échappé à la furie de Kabobo ne possédait une expérience suffisante de l’agressivité pour l’identifier et la gérer rationnellement à un niveau plus profond. Je ne suis pas en train de dire que la sensibilité du citoyen moyen est devenue imperméable aux conséquences intérieures d’une agression à coups pioche ; formulé ainsi, on pourrait croire que le problème, c’est l’indifférence. Non. Ce que j’affirme est bien différent, à savoir que pour la quasi-totalité d’entre nous, la violence est une réalité émotionnellement étrangère. Ça ne veut pas dire que le citoyen moyen soit immunisé face aux contrecoups psychiques d’une attaque : il ne parvient tout simplement pas à établir un lien productif entre l’impact rationnel et les inférences émotives qu’amorce cet impact. Ici, le mot-clé est « productif ». Le problème, c’est que nous avons perdu le contact avec quelque chose d’essentiel en nous. Réfléchis un instant. Comment une fille qui vient d’échapper à un fou en bas de chez-elle ne peut-elle pas deviner que son agresseur pourrait choisir sa prochaine victime parmi les personnes qu’elle connaît dans cette même rue ? Comment peut-elle ne pas troquer le dérangement d’un appel à la police contre le soulagement d’avoir éloigné un danger mortel du quartier où elle vit ? Qui est peut-être celui où vivent ses parents, ses amis, le garçon qui lui plaît ? Comment fait-elle pour ignorer que le lendemain matin, en ouvrant sa fenêtre, elle pourrait trouver sous son nez un tas de sciure sur le trottoir, imbibé des restes de sang et de fluides cérébraux d’une personne innocente ?
« Comment crois-tu qu’elle réagirait, si ça lui arrivait ?
— Et toi ?
— Pose-toi la question, docteur.
— Toi, comment tu réagirais ? »
1
À quoi pense un homme au réveil ? Que lui apporte la collision entre inconscient et réalité ? Quel est l’objet de ses premières méditations confuses tandis qu’il tente de reconquérir la maîtrise du vrai ? Quelles sont les images, les sons, les murmures, les tumultes dans sa tête ?
Il pense probablement à lui-même, ou à la femme qui dort à côté de lui.
Peut-être pense-t-il à ses enfants. Ou bien à ses parents, à son amante, au petit-déjeuner, à un ami en difficulté, à sa déclaration d’impôts, au dîner entre amis de samedi prochain, à son mal de dos, à la politique, aux contrariétés professionnelles, à la nouvelle voiture en leasing que lui a proposée son concessionnaire, à Dieu, aux buts de la veille au soir, à sa maison de campagne, à ses vieilles ambitions qui se sont échouées Dieu sait où, aux chevilles d’une collègue, aux films de Christopher Nolan, à la motion de coït déposée par la fugace luxure de son érection matinale.
Davide, non.
Davide pense à la mort.
Ça arrive peu après six heures. Il ouvre les yeux, recouvre le minimum de netteté intellectuelle nécessaire pour affronter la perspective du néant éternel, puis il se met à fixer le plafond.
Non, il n’est pas fou.
Ni gravement malade.
Pas même déprimé.
Bon, certes. Il rencontre quelques difficultés avec son supérieur direct, le docteur Martinelli, grand ponte de la médecine en Toscane, virtuose de la neurochirurgie qui depuis quelque temps semble l’avoir dans le collimateur.
Et oui, il a quelques soucis avec son voisin, Massimo Lenci, propriétaire de la boîte de nuit qui pendant plus d’un an a perturbé la tranquillité du quartier paisible où il vit, dans la banlieue sud de Lucques, avant qu’une injonction municipale salvatrice ne vienne rétablir le calme.
Rien d’irrémédiable, cependant. Rien qui ne le place dans le camp des perpétuels affligés, des thanatophiles ou des candidats au suicide.
Pourtant, Davide pense à la mort.
Il considère cela comme une sorte de rituel, un antidote aux périodes difficiles qu’il affronte régulièrement depuis plus de quinze ans. Il ouvre les yeux, fixe le lambris du plafond et réfléchit aux implications de la fin de la vie.
Pas nécessairement la sienne, en réalité. Et souvent, il ne pense même plus à la mort comme terme des expériences terrestres d’un être vivant. Étendu aux côtés de sa femme, il ouvre les yeux, prend conscience de lui-même, du craquement diffus des poutres sous la chaleur du soleil, de la respiration vaguement adénoïde qui provient de l’autre côté du lit : puis il commence à méditer sur la cessation des fonctions primaires et accessoires d’organismes vivants, sociaux, mécaniques ou virtuels de toutes sortes.
Il a commencé peu après la naissance de Tommaso. Pendant les années suivantes, il en était arrivé à la conclusion que réfléchir à la mort constituait le contrepoint logique à l’incroyable surplus de vie que le soin d’un petit être humain gémissant aux besoins incommensurables avait imposé à la routine tranquille d’un couple de travailleurs. Un chien, deux chats et un bébé : voilà qui justifiait amplement un premier réveil consacré à la perspective rassurante du repos éternel.
Le chien, soit dit en passant, était un Jack Russell nommé Fred Pierrafeu. Les chats, Épaminondas et Cochise, deux frères tigrés et ombrageux, ne partageaient guère l’enthousiaste hyperactivité de Fred : ils l’observaient, circonspects, depuis un recoin élevé du salon, et de temps à autre le coinçaient dans la cuisine ou dans le couloir pour lui extorquer l’humiliant tribut qu’exige le sadisme naturel de leur espèce.
Si les animaux constituaient un remède intermittent et réversible à l’excès de placidité domestique – il restait toujours possible de les enfermer dans le jardin quand les escarmouches, couinements, miaulements et incursions sur le canapé dépassaient les limites – un nouveau-né était omniprésent. Il insufflait dans la maison une sensation d’attente messianique : de ses réveils, de ses humeurs, de sa faim, de sa digestion, de la quantité ou de la qualité de ses déjections, de ses signes de satisfaction ou de mal-être. Confiné dans le bureau au premier étage de la maison, Davide tentait de boucler un semestre de perfectionnement au Guy’s Hospital de Londres. Il était rentré juste à temps pour assister à l’accouchement, mais il soupçonnait que l’accumulation de nuits blanches et autres joies de la paternité compromettrait sa capacité à tirer le moindre profit de son expérience londonienne.
La nuit, il ne dormait pratiquement pas ; le jour, il posait la tête sur ses livres, somnolait dans les fauteuils de la faculté ou errait dans les couloirs, en proie à un engourdissement perpétuel. À la fin de l’été, il devait entrer au département de neurochirurgie de l’hôpital Campo di Marte, mais il doutait de sortir vivant des dix premières semaines de sa vie de parent.
Ses seules minutes de paix correspondaient à ce premier réveil. Il en profitait pour commencer à réfléchir aux avantages insoupçonnés de la mortalité. Aux promesses alléchantes de l’extinction, terme miséricordieux de toutes les fatigues. À la pesanteur enchantée de l’expression « sommeil éternel » (en particulier au merveilleux pouvoir évocateur du substantif). À l’apologie de la fugue, du renoncement, de l’abandon. Il n’était pas croyant, mais il s’était parfois surpris à fantasmer sur la sereine ascension post-mortem vers le flux des âmes qui veillent, avec quelque perplexité bien compréhensible, sur l’évolution du monde.
Le soulagement que lui procurèrent ces quelques minutes de réflexion le convainquit de poursuivre, même après avoir retrouvé un rythme de vie acceptable. Il découvrit qu’après tout, il ne détestait pas tant que ça cet enfant, qui lui avait au moins permis d’accéder à une vision consolatrice de l’apparent dualisme vie/mort.
Des réflexions sur sa propre fin, il passa à celle de ses proches – bébé compris. Puis de ses parents plus éloignés. Puis de ses amis. Puis de ses animaux. Puis de ses collègues. Puis de ses patients à l’hôpital et des inconnus qu’il rencontrait par hasard. Enfin, il se consacra aux stars du cinéma, de la musique et du sport.
Rien de particulièrement macabre : il imaginait habituellement une sortie de piste lente et sereine, entourée par l’affection des siens.
Par la suite, il se consacra à la fin des institutions politiques (l’interminable dissolution de l’empire romain d’occident, la brutale interruption de l’histoire des Romanov ou des Bourbon-Orléans), à celle des voitures, des modes, des clichés lexicaux.
Il ne suivait aucune stratégie particulière, aucun programme. Il se réveillait et travaillait à la première chose qui lui venait à l’esprit. Au bout de quelque temps, il s’était persuadé qu’il projetait une sorte de flux bienveillant, apotropaïque sur le mourant auquel il se consacrait.
Le jeu avait duré un peu plus de six mois, après quoi ses pensées matinales avaient été occupées par des considérations plus urgentes. Mais au cours des années suivantes, au cœur d’une inévitable tempête, il avait à nouveau trouvé le réconfort dans cet étrange vice, dans ces quelques minutes passées sous la couette, à méditer sur la paix éternelle.
La fin de tout problème.
Barbara dormait sur le côté, lui tournant le dos. Comme d’habitude, elle avait posé sa jambe gauche sur la sienne, ancrant sa cheville au matelas comme pour l’empêcher de léviter pendant la nuit.
Épaminondas somnolait sur la commode. Confirmation de la vertu propitiatoire de ses réflexions, les animaux de la maison avaient triomphalement dépassé l’âge de seize ans.
Ce matin-là, Davide devait retirer un gliome du cerveau d’une jeune fille, et il consacra donc quelques minutes à méditer sur la mort des cellules de Schwann.
Soudain, quelque chose attira son attention. Un gros insecte noir, une sorte de scarabée maladroit et luisant, était sorti de sous l’armoire. Il le fixa, sans grande surprise : la porte-fenêtre de la chambre, qui donnait sur le jardin, était une source inépuisable d’incursions animales.
Il posa le regard sur Épaminondas. Le chat avait déjà ouvert les yeux, alerté par son ouïe, son odorat et l’instinct félin.
L’animal dressa la tête et fixa l’intrus qui arpentait avec une émouvante détermination sur le parquet. L’homme se prépara à un épilogue imprévu de ses réflexions : de la fin digne d’une cellule à la mort cruelle d’un gros insecte.
Mais Épaminondas s’était rendormi. D’ici dix minutes, son maître se lèverait pour remplir sa gamelle : à quoi bon se fatiguer pour quelque chose de visiblement moins appétissant ?
Pendant au moins une décennie, Épaminondas avait été le chat le plus féroce et le plus téméraire du quartier. Yeux couleur topaze, démarche patibulaire, réflexes prodigieux. Il grimpait aux rideaux, se pendait aux lustres, prenait le soleil en équilibre précaire sur la véranda, sautait d’un toit à l’autre pour des missions de reconnaissance aérienne de son territoire, engageait des bagarres mémorables avec les chats du voisin pour de vaines questions de suprématie sexuelle – ses adversaires étaient tous stérilisés. À la belle saison, il améliorait son régime par des suppléments entomologiques variés : grillons, abeilles, papillons, mouches, scarabées, cigales. C’était un exterminateur en série, un génocidaire à quatre pattes, un instrument de contrôle démographique de la faune du quartier.
Mais aujourd’hui ? Il se préparait à présent à passer la dernière partie de son existence à l’ombre du plus paresseux laissez-vivre : il avait atteint la sagesse de la sénilité, l’économie de mouvement qui se mesure à l’aune de la plus grande pondération.
Tant mieux pour lui, songeait Davide.
Plus tard, Barbara le rejoignit à la cuisine, pieds nus.
« Ce n’était pas mon tour de faire le café ? demanda-t-elle.
— Ça fait un moment que je suis réveillé. »
Elle se mit à examiner quelque chose au plafond en se grattant un sein, puis alla s’asseoir sur le tabouret de l’îlot central. Là, elle mit en œuvre un complexe jeu de chevilles et de talons pour éloigner Épaminondas, qui tentait de se frotter contre ses mollets.
« Tommaso est réveillé ? demanda-t-elle.
— Je crois que oui. J’entends remuer depuis un moment.
— Avant que j’oublie, chéri, hier matin on a reçu une lettre d’avocat.
— L’avocat de qui ?
— Devine. »
Davide posa la cafetière sur la plaque à induction.
Elle passa les mains le long de sa tête pour ramener ses cheveux en arrière, et noua sa queue avec un élastique rose apparu entre ses doigts. Fred Pierrafeu, accroupi sur le tapis de la cuisine, la fixait attentivement. Dans un pourcentage non négligeable de cas, sa maîtresse s’attachait les cheveux quand elle devait s’occuper de lui d’une manière moins ordinaire que la nourriture ou les câlins. Par exemple pour lui donner le bain ou l’emmener chez le vétérinaire.
« Pourquoi tu fais cette tête ? demanda Barbara. Il a dit qu’on aurait de ses nouvelles, et il a tenu parole. Apprécions au moins sa cohérence, faute d’autre chose.
— Et qu’est-ce qu’il dit, cet avocat ?
— Rien d’inquiétant. En gros, il met en demeure le nôtre d’arrêter de mettre en demeure son client. »
Davide s’approcha du frigo, l’ouvrit et en étudia le contenu. Il saisit une brique de lait d’avoine et un pot de confiture. Il posa ce dernier sur l’îlot central. Il remplit de lait un bol en céramique, et le renifla avant de le poser à côté de la confiture. Puis il se retourna, ouvrit la porte de gauche du buffet et en tira un paquet de biscottes.
« J’ai déjà tout envoyé à Paolo, dit Barbara.
— Tu as bien fait. »
À ce moment, Tommaso apparut de l’escalier, suivi en silence par Cochise. Le chat ne le quittait jamais d’un pas, aussi discret et zélé que l’intendant d’un grand général sud-américain.
« Salut, lança Tommaso.
— Bonjour mon chéri, répondit Barbara.
— Je t’ai servi un peu de lait d’avoine », dit Davide.
Tommaso ouvrit la poche supérieure de son sac à dos, y trouva son portable, effleura l’écran et se mit à analyser les conséquences de ce contact en exhibant le répertoire de micro-expressions insatisfaites qu’il arborait depuis quelque temps. Puis il s’approcha de l’îlot, s’assit, posa son téléphone à côté de son bol et glissa les doigts dans le paquet de biscottes ouvert.
« Tu ne te laves pas les mains ? demanda Barbara.
— Je viens de le faire là-haut », répondit Tommaso.
Puis il tendit un bras, prit le pot de confiture, inspecta l’étiquette et le remit en place.
« Où tu vas, aujourd’hui ? lui demanda Davide.
— Chez Marco, répondit-il en trempant une biscotte dans le lait. En bus, précisa-t-il pour anticiper une probable requête paternelle d’éclaircissements.
— Il y aura qui avec toi ? demanda Barbara.
— Matteo. Anna. Claudio. Peut-être Penna. Francesca. Giorgio. Peut-être Lenny. »
Barbara décocha un coup d’œil à son mari. Lenny ? demanda-t-elle sans émettre un son. Il haussa les épaules, comme pour dire qu’il avait renoncé depuis un moment à s’enquérir des bizarreries onomastiques du cercle de Tommaso.
« Je peux t’accompagner, dit-il. La villa des Callipo n’est pas loin de l’hôpital.
— Si tu veux.
— Je prends un café, je m’habille et je suis prêt.
— Je suis pas pressé.
— Moi, si. »
Cochise attendait à ses pieds, assis sur ses pattes arrière, l’air docile et légèrement renfrogné. Il avait un caractère tellement opposé à celui d’Épaminondas que leur consanguinité paraissait presque impossible. Soudain, il bondit comme un éclair, atterrit avec un bruit sourd sur les genoux de son maître et s’accroupit sur son jean.
La cafetière se mit à gargouiller.
« Qu’est-ce que tu fais pour le déjeuner ? demanda Davide à Barbara.
— Je ne sais pas. Pourquoi ?
— J’aimerais bien essayer ce petit restau viale Puccini dont tout le monde dit du bien. Tu veux me rejoindre là-bas ? On trouvera bien quelque chose qui te plaît.
— Pourquoi pas ? »
Puis il se tourna vers Tommaso.
« Tu viens aussi, chéri ?
— Je sais pas, répondit-il. C’est à quelle heure ?
— Ça dépend de ta mère. Pour moi, à partir d’une heure c’est bon.
— Je dois passer chez mes parents dans l’après-midi, répondit Barbara. J’ai dit trois heures et demie à maman. J’ai le temps pour un déjeuner de noces.
— Va pour la noce. »
Une demi-heure plus tard, Davide et Tommaso montèrent à bord de la BMW. Le portail électrique coulissa sur les rails dans un murmure un peu moins léger que d’habitude. Davide jeta un regard à la façade de la maison : Barbara avait pronostiqué qu’avant la fin de l’année, il faudrait procéder à une légère manutention, mais le grincement du portail semblait prophétiser l’imminence d’une intervention réparatrice plus généralisée et plus coûteuse. À la connaissance de Davide, cette maison de deux étages avait été la première de tout Lucques entièrement bâtie en bois. En effet, moins d’une semaine après avoir découvert qu’elle était enceinte, Barbara avait traîné son mari dans une agence immobilière alternative. Ils avaient consulté des catalogues de maisons préfabriquées : luxueuses, durables, dotées de toutes les commodités, mais sans le fardeau de la culpabilité pour excès de caprices exaucés aux dépens de la planète. Sur les plaquettes en papier couché brillant se découpait nettement l’acronyme NZEB, Nearly Zero Emission Building. Loquace et confiante, Barbara mémorisait le moindre détail. Davide battait des paupières, les bras croisés, dans la posture sceptique de l’homme de science face au renversement de concepts éprouvés. L’idée d’aller vivre dans une maison en bois tel un rescapé d’une catastrophe naturelle le laissait pantois.
Dès leur mariage, ils s’étaient installés chez ses parents à lui, au premier étage d’une sombre demeure sur les collines au nord-est de la ville. Puis ils avaient conçu Tommaso, et Barbara avait exigé avec une douce fermeté de s’affranchir de la tutelle de ses beaux-parents pour s’installer dans un appartement en centre-ville. Ce n’était pas seulement l’architecture sombre qui la perturbait : depuis quelque temps, l’harmonie familiale était ébranlée par l’opposition idéologique entre Davide et son père – lui aussi neurochirurgien –, qui avait eu pour prétexte œdipien la querelle historique entre locationiste et plasticistes.
Barbara commençait tout juste à étudier l’orthophonie, matière où l’intérêt pour la compréhension approfondie des mécanismes cérébraux était plus qu’accessoire : nul besoin d’une théorie unifiée de la neurologie pour apprendre à un enfant comment éliminer un défaut de prononciation. Mais elle avait lu Sacks, un peu de Kandel, et elle voulait comprendre si l’abîme doctrinal qui séparait son mari et son beau-père était réellement infranchissable.
Un soir, Davide regardait distraitement la télé. Elle s’approcha de lui et lui demanda de lui exposer le problème.
« Eh bien les premiers chercheurs croyaient que chaque fonction était localisée dans une zone précise du cerveau, fixe et immuable, expliqua-t-il en s’étirant. Jusqu’à ce qu’on découvre que, si nécessaire, chacune de ces zones peut suppléer le travail des régions voisines : le cerveau est donc plastique, muable, adaptif. Dommage que mon père hausse encore les épaules quand il entend certaines théories.
— Et ça te paraît être une raison valable pour lui faire la tête ?
— C’est lui qui me la fait. »
Peu après, ils avaient loué un appartement au deuxième étage sur trois dans un immeuble via Sant’Andrea. Au-dessus vivait une famille avec quatre enfants, en-dessous deux adorables petits vieux : tous s’affairaient pour saturer de bruit des portions de la journée si rigoureusement réparties qu’elles semblaient avoir été assignées lors de réunions de copropriété dédiées. Le matin, les programmes les plus désolants du paysage télévisuel national, que les petits vieux suivaient religieusement. L’après-midi était envahi par les cris des enfants d’au-dessus, passionnément soutenus par le chiot sautillant de la famille : un gros cocker couleur miel, stupide et surexcité, qui dérogeait au planning de la copropriété en aboyant et en couinant à toute heure de la journée.
Davide et Barbara avaient tenu jusqu’à l’automne de la deuxième année. En été, Barbara avait hérité de ses grands-parents un petit terrain via Tofanelli, au sud des murs de la ville. Après quelques visites sur place, c’était elle qui avait proposé à Davide d’y construire une maison en bois.
Un ami architecte, affilié à une mystérieuse congrégation d’utopistes des travaux publics durables, avait déjà une ébauche de projet : deux étages, un portique orné de glycines, un jacuzzi pour quatre sur le solarium. Et les voisins ? Tenus à distance par un jardin planté de saules et d’oliviers, parsemé de pierres noires et de trèfles, au point de vider de son sens le concept même de « voisinage ».
Adieu cocker, enfants turbulents et quizz télévisés.
Davide avait fini par accepter, à contrecœur. À quoi bon gagner cent mille euros par an s’il devait vivre dans une cabane sur pilotis comme un indigène des archipels polynésiens ?
Tommaso sortit un polycopié du sac à dos entre ses jambes.
« Qu’est-ce que c’est ? demanda Davide.
— Des notes, répondit-il. Pour une recherche qu’on a rendue samedi.
— Je croyais que l’école était finie.
— Ça termine après-demain.
— Juste à temps pour le grand événement. Tu es excité ?
— Je sais pas. Je devrais ? »
Ils étaient arrêtés à un feu rouge. Davide lui jeta un regard. Son fils était occupé à gratter quelque chose sur le cuir couleur champagne de la portion de siège sous sa cuisse : un garçon timide, brillant à l’école, passionné d’astronomie, qui sortait lentement d’une période compliquée après un insignifiant épisode de pseudorévolte juvénile – l’une des nombreuses menues épreuves qui rythment le développement d’un adolescent occidental.
« À ton âge, je n’en aurais pas dormi la nuit. Aerosmith. Tu te rends compte ?
— Je dors déjà assez mal, merci.
— Rolling Stone les classe à la cinquante-neuvième place des cent meilleurs artistes de tous les temps.
— Seulement cinquante-neuvièmes ?
— D’accord. Mais Steven Tyler a été élu plus grande icône musicale de tous les temps. De tous les temps. Plus grand qu’Elvis. Que Freddy Mercury. Que Bono Vox. Que John Lennon.
— C’est qui, Elvis ? »
Davide le fixa, vaguement perplexe. Tommaso se trouvait dans cette période de la vie où la seule stratégie pour contenir l’augmentation des attentes dont les adultes devenaient les goulus émissaires, dès qu’ils estimaient l’enfance terminée, consiste à manifester du désintérêt pour toute question ouvertement secondaire. Phase que Davide n’avait pas expérimentée : durant toute sa jeunesse, il avait accueilli avec gratitude la moindre stimulation. Il se rappelait encore son émoi quand, en première année, il avait appris l’une de ces informations invérifiables qui pendant plusieurs jours sont source d’une répulsion émerveillée parmi les jeunes étudiants : le monde que nous percevons est une illusion, avait dit le professeur d’embryologie. Les fleurs, les arbres, le ciel, les nuages, les océans, les maisons, les voitures, les livres, les animaux, le visage de nos parents ou de la femme qu’on aime ne sont pas réels, ou du moins pas sous la forme que nous appelons telle. Le monde est une architecture cendrée et silencieuse de molécules sans couleur, sans odeur, sans saveur ni température, à partir desquelles chaque cerveau humain reconstitue sa réalité à partir de signaux électriques dédiés à créer des sensations complètement différentes de la pâle et concrète substance des faits.
La BMW gravissait une courte montée. Au milieu d’un long mur de briques, ils trouvèrent une grille.
« On se retrouve au restaurant, lança Davide tandis que Tommaso ouvrait la portière. Viale Puccini, numéro 1524.
— Numéro 1524, c’est le nom du restau ?
— Non, c’est le numéro.
— Et le nom ?
— Je ne me rappelle pas. »
Tommaso hissa son sac à dos sur son épaule gauche. Davide l’observa avancer vers la grille, légèrement bossu, comme s’il était encore engourdi par les récentes mutations de son corps. Un léger décalage dans son synchronisme hormonal avait retardé d’un an le début de la maturité sexuelle, avec son embarrassant cortège de duvet, douleurs articulaires, ptose du timbre vocal, élancements aux testicules et fortes exhalaisons androgènes de toutes les jonctions de membres. Depuis la fin de cette expérience, Tommaso entretenait une relation extrêmement prudente et formelle avec lui-même, comme s’il redoutait de nouvelles surprises désagréables.
Cinq minutes plus tard, Davide arriva dans le parking réservé au personnel de l’hôpital.
La voiture de Martinelli n’était pas là.
Tant mieux, songea-t-il. Il éteignit le moteur et leva le regard sur la façade.
Au sommet des escaliers, une porte à tambour tournait paresseusement sur elle-même : depuis qu’il travaillait à Campo di Marte, Davide ne l’avait jamais vue interrompre sa lente révolution.
Il prit sa mallette et descendit de voiture.
Dans un certain état d’esprit, songea-t-il, le moindre symbole résonne comme un glas lugubre dans les replis de notre esprit.
Remis au cœur du massif du Mont Blanc, à 3466 mètres d’altitude, le Prix Grand Continent est le premier prix littéraire qui reconnaît chaque année un grand récit européen.
———————————-
31
Il trouva une vieille chemise de rechange dans son casier du vestiaire. Il retira avec précaution son t-shirt et inspecta son bandage. Puis il se rhabilla, se peigna et sortit pour rejoindre son bureau.
Il contourna la table et se laissa tomber dans le fauteuil.
Il plia les bras à angle droit, les posa sur le bureau et appuya le front sur son poignet gauche. Il ferma les yeux pendant quelques minutes. Sa tête continuait à lui envoyer de faibles signaux de protestation. Il ignorait où se trouvait son portable, et il ne se sentait pas assez lucide pour trouver un autre moyen de récupérer le numéro de Diego.
À cet instant, le téléphone sonna.
« J’ai appelé les urgences, la chirurgie et les soins intensifs, annonça Lucio. Aucune trace de ton ami. Il a peut-être été admis à San Luca ou à Cisanello. »
Davide appela le standard et se fit mettre en ligne avec le premier hôpital. Il demanda à parler au service de chirurgie, et une voix féminine transféra son appel. À la quinzième sonnerie, personne n’avait encore répondu. L’appel revint au standard. La fille lui expliqua laconiquement qu’ils devaient être très occupés.
« J’imagine », commenta-t-il.
Il répéta la procédure avec l’hôpital Cisanello de Pise, et cette fois-ci le service de chirurgie répondit. Le médecin lui apprit que le seul patient avec des plaies de taille arrivé pendant les dernières vingt-quatre heures était un barman qui s’était coupé deux phalanges la veille au soir : presque tous les blessés de piazza Napoleone, lui expliqua-t-il, légèrement pédant, souffraient des conséquences typiques des événements traumatiques de masse – hématomes, fractures, écrasements, et quelques infarctus. Mais aucun coup de couteau.
Davide raccrocha. Il entrecroisa ses doigts devant son front, ferma à nouveau les yeux et se mit à réfléchir. Puis il souleva à nouveau le combiné et se surprit à se rappeler par cœur le numéro d’une compagnie de taxis qu’il n’utilisait presque jamais.
Le soleil était levé depuis peu. Il inspecta l’esplanade depuis le palier de l’escalier de service.
La foule était impressionnante. Devant l’entrée, un groupe de caméramen, appareil à l’épaule, discutaient en attendant le contact matinal avec leurs médias respectifs. Non loin, un agent écrivait, penché sur le coffre d’une voiture aux gyrophares allumés. Davide descendit lentement jusqu’à une entrée réservée aux fournisseurs.
Avant même de sortir, il aperçut Massimo Lenci. Il était assis sur le muret du jardin, un mégot éteint entre les doigts, le regard fixé sur une portion de mur sans intérêt apparent.
Davide s’immobilisa sur le seuil.
Massimo se tourna et le remarqua. Ses traits semblèrent se déformer sous le coup de sentiments réprimés – bouche entrouverte, yeux mi-clos, double menton frémissant – mais ce n’était que l’ébauche d’un bâillement qui avorta à l’instant où il comprit qui se trouvait face à lui.
Ils se fixèrent sans hostilité. Dans les yeux de son voisin, Davide sentit la même chose qu’exprimaient les siens : fatigue, souffrance, l’effort insoutenable de rassembler le petit troupeau de ses certitudes éparpillé dans la brume de cette nuit-là.
Massimo reposa le regard sur le coin de mur.
« Carlos a tout vu, articula-t-il. Il m’a dit que c’est mon fils qui a déclenché tout ce bazar. »
Davide ne put se retenir d’acquiescer.
Massimo resta un instant en silence.
« Il a commencé à se comporter bizarrement quand il avait huit ou neuf ans », dit-il enfin.
Il jeta sa cigarette devant lui.
« Des petites auto-mutilations, surtout. Il volait mes lames de rasoir et s’entaillait les mains, ou bien il se brûlait le bout des doigts avec des allumettes. Ensuite il s’est mis à frapper ses camarades de classe, et par frapper je veux dire faire mal, pas pousser ou tirer les cheveux. Il mordait les doigts et les oreilles, il donnait des gifles, il étranglait. Sa mère me donnait la faute : elle disait que mon comportement excitait son instinct de violence typiquement masculine. Mais pour moi, le comportement de mon fils n’avait rien de typique. Ses colères étaient intenses, irrationnelles. C’était comme si pour lui, le temps n’existait pas : à douze ans, il souffrait encore pour des brimades qu’il avait subies en primaire. J’ai fini par convaincre ma femme de l’emmener chez un psychologue. Il nous a dit que Giovanni souffrait d’une forme inhabituellement grave de… trouble oppositionnel avec provocation. Je crois que ça s’appelle comme ça. »
Il se regarda les mains.
« Vu que son principal problème était son incapacité à gérer la colère, il a donné des médicaments à notre garçon, et à nous des conseils pour apaiser l’ambiance à la maison. Pendant un moment, les choses ont été mieux : plus de lames ni d’allumettes, et surtout plus de coups à l’école. Même si le prix à payer était de voir mon fils sans arrêt abruti par les cachets. À la fin de l’année, sa mère est partie en Australie pour suivre un éleveur de taureaux. Giovanni s’est attaché à moi de manière malsaine. J’ai commencé à l’emmener partout avec moi. Un soir d’été, je me suis mis à jouer aux cartes avec un voyou que je connaissais de vue. Giovanni était sous la véranda, à moitié endormi dans la balancelle. Le type et moi, on s’est mis à se disputer. Je ne sais plus pourquoi. On a commencé à s’insulter, à se pousser, jusqu’à ce que ce salaud prenne la bouteille et me la casse sur la tête. J’avais du sang sur le visage. Je n’ai pas vu arriver mon fils. Et je n’ai pas vu qu’il tenait un tire-bouchon à la main. »
Il posa les mains sur sa tête.
« Il a frappé l’homme à la gorge. Je l’ai regardé tomber à terre. J’ai vu le sang gicler de son cou. Je n’oublierai jamais son expression pendant que Giovanni lui montait sur la poitrine et continuait à le frapper. Sur les bras, dans le dos. Il n’allait pas s’arrêter. Il allait continuer jusqu’à le tuer. On s’est jetés à trois sur lui. Avant de réussir à l’arrêter, je me suis pris quelques entailles à la main. »
Il ferma les yeux.
« Pour dédommager cet homme, j’ai perdu presque tout ce que j’avais. J’ai envoyé Giovanni dans une communauté psychiatrique. Je suis allé le voir chaque mardi et chaque vendredi ces quatre dernières années. Sa mère n’a jamais cessé de lui écrire. Elle lui envoyait des livres sur l’Australie, des vêtements, des petits cadeaux. La dernière fois, elle lui a envoyé ce boomerang. »
Il rouvrit les yeux et redressa le torse.
« Les médecins de la communauté m’avaient assuré que son trouble était devenu gérable. Ils utilisaient les mêmes mots que le psychologue. »
Il leva le regard vers Davide.
« C’est pas dommage que ce soit toujours quelqu’un d’autre qui finisse par payer le prix de ces prédictions foireuses ? »
Son visage exprimait une peine sincère.
« Maintenant, dis-moi, docteur. Que va devenir mon fils quand il sortira du coma ? Je ne peux pas m’enfuir pour toujours. Comment est-ce qu’on réussira à contenir sa colère ? Comment est-ce qu’on fera pour le sauver de lui-même ? À le sauver de ce qu’on a réveillé en lui ? »
Le taxi l’attendait au coin de via Borgognoni.
Dans un tiroir de son bureau, il avait récupéré les quatre billets de vingt qu’il gardait en réserve au cas où il oublierait son argent et sa carte de crédit à la maison. Il se demanda s’il était sorti sans portefeuille la veille au soir, ou bien s’il devait le considérer perdu au même titre que son portable : portefeuille dont, d’ailleurs, il ne se rappelait ni la forme, ni la matière, ni les dimensions, de sorte qu’il passa au moins cinq minutes dans le taxi à en reconstituer l’histoire par induction. Il décida d’attendre quarante-huit heures avant de s’inquiéter de la persistance de ces trous de mémoire.
Le taxi le déposa via di Moriano.
Il tourna dans la ruelle anonyme et aperçut la Golf de Diego à cinquante mètres du monastère.
La portière grande ouverte amplifia alors son angoisse. Il pressa le pas, réprimant l’envie de se mettre à courir uniquement parce qu’il était trop faible. Des remords hétéroclites ballottaient en lui à chaque pas.
Il se jeta presque dans l’habitacle. Il s’attendait à trouver Diego affalé sur le siège : blessé, ou plus probablement mort, le couteau encore dans le ventre.
Mais il n’y avait personne dans la voiture.
Le siège était imbibé de sang. Il aperçut d’autres taches de liquide sombre sur le bitume, sous ses pieds. Diego devait être resté là quelques secondes pour reprendre des forces, à réfléchir à quelque question obscure.
Pourquoi ne s’était-il pas précipité à l’hôpital ? Peut-être n’avait-il pas estimé que sa blessure était assez grave pour nécessiter l’intervention d’un médecin ? Cette hypothèse lui parut bancale à l’instant même où il la formula. Qui penserait une chose aussi absurde avec un couteau planté dans l’abdomen ?
Il quitta la voiture et se dirigea vers le monastère en boitant, les yeux fixés sur le goutte à goutte macabre qui souillait la route. À la moitié de la palissade, il trouva un autre assemblage de gouttes, comme si Diego s’était arrêté une deuxième fois.
Davide continua jusqu’au sentier qui menait de la rue à l’entrée.
Là, il s’arrêta.
Le gravier était immaculé.
Pas une seule trace de sang jusqu’au portail.
Comment était-ce possible ? L’hémorragie avait visiblement diminué, mais il lui paraissait improbable qu’elle ait cessé d’un coup.
Il leva les yeux vers le bois.
Et si Diego avait continué par là ?
Ça n’avait aucun sens, mais vérifier ne lui coûtait rien.
Il parcourut quelques mètres et remarqua une goutte solitaire. Il s’agenouilla pour l’inspecter, tel un éclaireur indien.
C’était du sang.
Il se releva et continua jusqu’à la limite entre la rue et l’herbe.
Il fixa la clairière. La pente lui donnait une vue avantageuse, mais l’herbe était trop haute pour déceler une présence.
Pour peu qu’il y ait quelqu’un.
Il ne comprenait toujours pas les actions de Diego. Rentrer chez soi n’était pas totalement irrationnel : bien que tortueuse et résiduaire, c’était la logique élémentaire d’un animal blessé. Mais se traîner dans un bois dépassait ses capacités d’identification.
Il s’avança dans la clairière.
À certains endroits, l’herbe atteignait au moins cinquante centimètres, voire davantage. De minuscules gouttes de rosée brillaient au soleil, qui bientôt les appellerait à lui. Davide continua avec un calme étrange, regardant autour de lui. L’odeur de terre et de divers types de fleurs lui remplissait les narines.
Il avait l’impression que l’herbe recelait les traces du passage de quelqu’un, un sillon à peine esquissé, la violation des proportions délicates de l’espace et de l’équilibre entre un brin et l’autre.
Soudain, il tomba sur une vaste zone de végétation qui semblait avoir été comprimée par quelque chose des dimensions approximatives d’un corps humain. Au milieu de la silhouette, se trouvait une grosse tache de liquide absorbé par la terre.
Cette fois-ci, il ne se pencha pas pour l’examiner.
Elle grouillait de fourmis.
Il se remit en marche, essayant d’ignorer le clapotis de la marée de présages qu’il sentait monter en lui.
Il franchit les premiers arbres et s’enfonça dans le bois. Le bruit de la rivière résonnait sous le feuillage des peupliers en un délicat crépitement. Privée de l’abondance du soleil, l‘herbe était plus basse et clairsemée.
Moins d’une minute plus tard, il atteignit la berge. Il s’accorda quelques secondes de contemplation silencieuse de ce recoin paradisiaque. Six mètres au moins séparaient les deux rives. Il songea que Diego n’aurait eu ni la force, ni aucune raison vraisemblable de gagner la rive opposée : il se mit donc à examiner attentivement le sol, à la recherche de traces. Au bout d’un moment, il remarqua deux minuscules taches de sang à côté d’un petit creux dans l’herbe.
Son ami devait s’être assis ou agenouillé là.
Et ensuite ?
Il s’agenouilla lui aussi, tel un médecin légiste sur la scène d’un crime. Il se pencha sur le côté pour avoir une meilleure perspective de la berge à droite, puis il répéta l’opération pour le côté gauche.
Rien.
Il se releva et poursuivit son inspection sur une vingtaine de mètres dans les deux directions.
Toujours rien. Il n’y avait pas d’autre trace.
Il se mit donc à vérifier qu’il n’y ait pas d’herbe dérangée par des pas humains dans un rayon encore plus vaste, espérant que ses facultés d’enquêteur suffiraient à identifier un indice aussi incertain. Il passa les dix minutes suivantes à explorer une bonne partie de la berge, mais il ne trouva rien d’inhabituel : le seul détail insolite fut la curieuse sensation d’être observé – une sorte de frémissement dans sa nuque qui le poussait parfois à se retourner.
Un instant, il envisagea la possibilité de s’éloigner de la rivière pour quadriller au moins une partie de l’extrémité sud du bois, mais il se soupçonnait d’être trop faible pour ce genre d’entreprise.
Que pouvait-il faire ?
Son mal de tête s’était réduit à une série de lentes pulsations régulières, qui lui permettaient de réfléchir avec une certaine lucidité.
La seule solution était de retourner au monastère pour demander de l’aide.
Il se dirigea donc jusqu’à l’endroit où il supposait que Diego s’était assis. De là, il regarda la rivière.
Il se demanda si elle était profonde à cet endroit.
Assez, se répondit-il.
Il se retourna et se mit en marche le plus vite possible, tentant d’ignorer les implications les plus indicibles et douloureuses de ce mot.
Un jeune moine lui ouvrit la porte. Il avait les cheveux rasés, les pieds nus, le même habillement paramilitaire et la même sérénité profuse que l’homme qui l’avait accueilli la veille. Lequel – si le niveau d’ascèse était proportionnel à l’inexpressivité – devait être le roshi, le maître. Le jeune homme écouta en silence son histoire, le scrutant de la tête aux pieds comme pour trouver la confirmation des absurdités qui venaient d’être proférées. Puis, quand il comprit que les mots et l’aspect halluciné de l’homme lui conféraient une effrayante crédibilité, il courut auprès de ses confrères.
Qui une minute plus tard se précipitèrent à l’extérieur.
Ils étaient huit. Deux d’entre eux s’approchèrent de la voiture de Diego et observèrent l’intérieur avec de petits hochements de tête consternés. Quelques secondes plus tard, le roshi sortit du monastère. Il salua Davide en joignant les mains et en approchant le nez de la pointe de ses doigts : il dit seulement qu’il avait veillé à alerter la police, puis se dirigea d’un air décidé vers le bois. Ses disciples le suivirent en éventail sur une bonne part de la largeur du pré.
Davide se dit qu’il aurait dû les aider. Mais il n’avait pas le courage de contempler le cadavre de l’homme qui avait sauvé la vie de Tommaso au prix de la sienne.
Il se mit en marche vers via di Moriano. Voici ce qu’il allait faire : rejoindre à pied le premier bar et appeler un taxi pour qu’il vienne le chercher le plus vite possible.

32
Il arriva à l’hôpital une heure plus tard.
Il entra par la même porte qu’à sa sortie peu avant l’aube de ce matin-là. Il regarda par la fenêtre du premier étage. La foule avait augmenté.
Il repensa aux fourmis qui tiraient des nutriments du sang au sol.
Il monta jusqu’au service de neurologie. Dans le vestiaire, il se dirigea vers son casier. Il retira sa chemise et inspecta à nouveau le bandage. Sur son bras gauche étaient apparues des égratignures qu’il n’avait pas remarqué auparavant.
La trace des ongles de sa femme.
Il retira ses chaussures et enfila ses Crocs de service, prit un t-shirt propre et la petite trousse de toilette sur l’étagère supérieure. Dans la salle de bains, il se rasa avec soin, essayant d’ignorer l’homme victime de traumas multiformes qui le fixait depuis la surface réfléchissante. Il se lava les aisselles avec quelque difficulté – il ne parvenait pas à lever le bras droit sans éprouver un élancement à l’épaule –, enfila son t-shirt et se peigna. Puis il s’accorda une deuxième inspection au miroir.
Le problème, c’étaient ses yeux : il avait dormi avec ses lentilles de contact, qui avaient provoqué une inflammation.
Il les retira et les jeta dans les toilettes.
Il retourna à son casier et enfila sa blouse. Il quitta le vestiaire. Il ne voyait presque rien. Au bout de vingt pas, il croisa une infirmière qui lui demanda comment il allait. Il ne reconnut pas sa voix et répondit en levant un pouce, sans s’arrêter, puis pressa le pas pour éviter d’autres absences d’identification embarrassantes. Il entra dans son bureau et se mit à fouiller dans son tiroir. Il trouva une vieille paire de lunettes de vue photochromiques, les sortit de leur étui et se redressa. Il s’approcha de la fenêtre et les exposa à la lumière jusqu’à ce que les verres se teintent suffisamment pour masquer l’état piteux de ses yeux.
Il les chaussa et sortit.
Il croisa un collègue qui s’arrêta au milieu du couloir, son visage exprimant le soulagement et la surprise. Davide lui indiqua d’un hochement de tête qu’il ne pouvait pas s’arrêter.
Il prit l’ascenseur et descendit en soins intensifs. Il traversa le service et arriva à l’avant-dernière chambre.
La 52.
Pieri avait parlé d’un garçon dans le coma après un choc à la tête.
S’il était dans le coma, c’était sans doute la bonne chambre.
Il ouvrit la porte.
Giovanni était étendu sur le lit, inconscient et intubé, la tête posée sur un coussin de décharge occipitale. Un petit hématome sombre et enflé marquait sa tempe gauche.
Sur ses poignets apparaissaient les ecchymoses d’une torsion vigoureuse et prolongée. La canule dépassait de ses lèvres, reliée au ventilateur mécanique qui soupirait avec insistance à sa gauche.
Davide prit place sur le tabouret proche du lit. Il fixa le visage du garçon qui avait essayé de le tuer.
Qui avait envoyé son fils en réanimation.
Qui avait tué son ami.
Le visage d’un être humain fou, irrémédiablement fou, et donc vraisemblablement incapable de contenir l’immense Pouvoir en lui.
Allait-il survivre ? Probable. Le trauma lui laisserait-il des séquelles irréversibles ? Il n’en savait rien.
Quoi qu’il en soit, il ne pouvait pas faire grand-chose pour lui, qu’il le veuille ou non. Avant la fin de la matinée, les autorités recouperaient les faits et les témoignages, et l’empêcheraient de voir le garçon qui avait attenté à sa vie. À partir de ce moment-là, la seule manière de contribuer à son salut serait d’imaginer sa mort.
Mais Davide n’était pas certain que sa bonté aille jusque là.
Le détestait-il ?
Il reformula : le détestait-il au point de souhaiter sa mort ?
Et s’il ne se limitait pas à la désirer ?
Non, pensa-t-il.
Je ne suis pas un assassin.
Je ne veux pas lui faire de mal.
Je n’ai jamais voulu faire de mal à personne dans ma vie.
Il inclina la tête et la prit entre ses mains.
(Je ne provoquerai jamais la mort délibérément…)
Mais…
… et s’il sortait du coma ? Si un jury le reconnaissait à nouveau irresponsable pour maladie mentale ?
Bientôt, il reviendrait. Il reviendrait pour se venger de lui et de son fils.
Ou bien il l’oublierait. Jusqu’au jour inévitable où le résidu à demi-enseveli de sa colère éclaterait sur la tête de quelqu’un d’autre. Aucun doute quant à l’intensité de cette déflagration : la seule incertitude était liée au nombre et à l’identité des victimes.
Mais lui-même ne subirait jamais les conséquences de ses actes.
Il se rappela quelque chose que lui avait raconté Tommaso : parfois, dans l’univers, une naine blanche explosait en un fulgurant éclair d’énergie électromagnétique, annihilant tout autre corps céleste dans un rayon de plusieurs milliards de kilomètres, mais survivait à sa propre furie.
Giovanni était quelque chose de similaire.
C’était cela, la vie qui l’attendait ? Vivre dans la crainte de le voir reparaître ? Ou dans le remords de ne pas l’avoir arrêté ?
Davide se leva.
Non, se dit-il. Je ne peux pas permettre ça.
Le supprimer serait d’une désarmante simplicité. Il pourrait lui injecter un peu de morphine, ou bien manipuler le ventilateur mécanique jusqu’à diminuer le pourcentage de saturation, lui administrant la lente euthanasie de la carbonarcose.
L’alternative consistait à sortir de la pièce et s’illusionner que tout irait pour le mieux.
(Inadmissibles. Les deux options étaient tout simplement inadmissibles.)
Dans quel dilemme invraisemblable s’était-il coincé ? Il regarda le profil que dessinait la cime des arbres par la fenêtre, ondes de sismographe vacillantes dans le ciel. Aucun doute que l’épicentre du tremblement de terre se trouvait dans cette pièce.
Il regarda la canule qui dépassait de la bouche de Giovanni, tel l’hameçon d’une grotesque ligne de pêche. Il ignorait combien de temps s’écoulerait avant l’entrée d’un médecin ou d’un infirmier.
Il recula de deux pas et s’assit au pied du lit.
Il l’ignorait, et au fond cela ne l’intéressait pas.
Le temps n’existait plus.
Au loin, par-delà la cime des arbres, la fenêtre encadrait l’habituel paysage urbain des remparts médiévaux et des toits couleur d’argile, les tours au centre du tableau.
Davide avait presque l’impression d’entendre les voix des blessés dans les étages inférieurs, le tumulte de l’urgence se répercuter sur le contrefort des sons de l’esplanade. Il ne parvenait pas à envisager un moment plus inopportun que celui-ci pour interrompre les communications avec le monde.
Et puis non, songea-t-il. C’est bien ainsi.
Son esprit projeta une succession incohérente d’images sur le fond rosé de ses paupières. La pinède de Camaiore. Le corps de Tommaso sur les pavés de piazza Napoleone. Épaminondas qui tuait un serpent dans le jardin. Le visage impassible de Neil Tennant. Les pieds nus de Barbara. Une pyramide aztèque au milieu des arbres. La triste assemblée de gouttes sur le bitume de la rue sans nom, qui s’effleuraient sans se superposer.
Il inspira à fond et chassa toute pensée, se laissant bercer par le soupir du monde. Il n’y avait rien d’autre à faire.
La vie est une question de justes proportions.
À un moment donné, il faut que cela arrive. Soit tu es illuminé, soit tu ne l’es pas. Soit tu es amoureux, soit tu ne l’es pas. Soit tu es prêt, soit tu ne l’es pas.
Il se pencha sur le garçon et lui posa une main sur la poitrine. Couper ou mourir : il n’avait pas d’autre alternative. Il éprouva à nouveau le frisson qui lui avait caressé la nuque au bord de la rivière.
Quelqu’un me regarde, se dit-il. Quelqu’un témoignera que je m’apprête à renier ce en quoi j’ai toujours cru.
À présent, je sais que l’univers est infini car il contient toute la haine générée par la race humaine depuis le début des temps. Voilà ce que nous sommes. Telle est la substance dont nous sommes faits : sang, fureur et débris de rêves aux confins entre la veille et le sommeil. Dominer la violence ou être dominé par elle. Retirez-moi l’épithélium de la civilisation pour exposer le visage écorché de mon véritable moi. Je ne suis plus seulement un médecin assis au chevet d’un garçon. Je suis le fils bien-aimé de la forêt et de la rivière. Je suis le noyau bouillonnant de Pouvoir tapi dans les ténèbres qui attend d’en émerger. Je suis l’homme aux yeux fermés, et je médite sur le terrible koan au-delà duquel je saurai si je suis capable de tuer pour me sauver moi-même.

