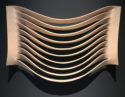Abonnez-vous à nos Lettres Restez informés des actualités du Grand Continent
Le débat européen actuel présente à la fois des appels vigoureux à de nouveaux projets ambitieux, par exemple dans les propos d’Emmanuel Macron et de Mario Draghi, mais aussi des appels à la prudence de la part de nombreux gouvernements. L’Union européenne se retrouve confrontée à un trilemme. Les circonstances voudraient que des progrès décisifs soient réalisés en matière d’intégration. Cependant, il est de plus en plus difficile de réaliser des progrès majeurs avec le consensus de tous les membres. Mais dans le même temps, l’unité des 27 est, plus encore que par le passé, un atout précieux à protéger. Comme toujours, la faisabilité des projets – ou plutôt l’articulation entre le nécessaire et le faisable – dépendra de la manière dont les événements se dérouleront.
Au cours des quinze années qui ont suivi la crise financière, l’Union européenne a connu l’une de ses plus intenses périodes de mutation. La décennie précédente avait été le théâtre de deux décisions qui ont fait date : l’introduction de l’euro et le passage de 15 à 28 États membres. Aussi importantes soient-elles, elles avaient été annoncées depuis un certain temps et constituaient la réalisation de projets et d’engagements pris antérieurement, après la chute du mur de Berlin et la dissolution de l’URSS. Rien de ce qui s’est passé plus récemment n’avait été prévu. Nous avons dû réagir aux événements et nous l’avons souvent fait dans une situation de vide juridique important et avec des institutions mal équipées pour faire face à des crises de cette ampleur. Dire que tout cela se serait passé sous la direction de facto d’Angela Merkel, chancelière du pays le plus important de l’Union, n’est qu’une simplification partielle. La voie suivie reflète son style, mais plus généralement la prudence avec laquelle l’Allemagne n’agit qu’après avoir obtenu un haut degré de consensus interne, puis européen. C’est une ligne de conduite qui peut susciter l’exaspération et suggérer une analogie avec ce que Churchill disait à propos des États-Unis : « ils ne font la bonne chose qu’après avoir épuisé toutes les alternatives ». D’autre part, le consensus (national et européen) acquis de cette manière s’est avéré durable, contrairement à la politique européenne pour le moins oscillante d’autres grands pays comme la France et l’Italie. L’Allemagne a également introduit dans le débat européen un concept de sacralisation des règles qui fait partie intégrante de son consensus interne et reflète une volonté d’exorciser un passé dramatique. L’autre caractéristique de la voie empruntée est que l’Union a été programmée depuis sa création pour faire face aux crises lorsqu’elles se produisent, mais pas pour s’attaquer aux nœuds systémiques qui lui permettraient de prévoir et de prévenir les crises ultérieures.
L’Union a été programmée depuis sa création pour faire face aux crises lorsqu’elles se produisent, mais pas pour s’attaquer aux nœuds systémiques qui lui permettraient de prévoir et de prévenir les crises ultérieures.
Riccardo Perissich
Les événements auxquels je fais référence sont bien connus. Le Brexit a ainsi pu générer deux types de récits. Selon le premier, l’Europe en sort affaiblie économiquement, politiquement et militairement ; et le tabou de la perpétuité est brisé. Selon le second, le Brexit a des effets positifs car l’un des pays qui s’était le plus fortement opposé à une plus grande intégration par le passé n’est plus là. Les deux interprétations sont vraies, mais doivent aussi être relativisées. L’opposition britannique a souvent servi d’alibi à la résistance des autres, mais elle n’a jamais empêché des avancées fortement souhaitées par une majorité de pays – par exemple sur Schengen et l’euro. En outre, le Brexit a renforcé l’unité des 27 et augmenté le sentiment d’appartenance également de ceux qui étaient traditionnellement proches des positions britanniques. D’autre part, l’affirmation de ces pays (les Scandinaves et les Pays-Bas, par exemple) a été renforcée par l’absence du défenseur le plus influent du libéralisme en économie et de l’atlantisme en politique étrangère, ce qui leur a donné presque une « nouvelle mission » au sein de l’Union. Le Brexit a d’ailleurs encouragé la thèse d’un clivage inévitable, politique, culturel et même fondé sur des valeurs, entre le continent européen et un mythique « monde anglo-saxon ». Cette thèse, cependant, n’a pas de fondement réel et sous-estime à la fois le caractère « européen » de la Grande-Bretagne et la proximité historique, politique et culturelle d’une partie importante de l’Europe, surtout au nord mais aussi à l’est, avec le monde anglo-saxon. Cela dit, le Brexit reste un chantier inachevé, mal négocié par le gouvernement britannique et encore mal digéré. Cela n’enlève rien au fait que l’Union et la Grande-Bretagne ont toujours besoin l’une de l’autre.
La deuxième série d’événements concerne la réponse aux crises économiques récurrentes : d’abord la crise financière, puis la crise pandémique, et enfin la guerre en Ukraine. Il est bien connu que le chemin a été semé d’embûches. Cela a commencé avec l’illusion que l’on pouvait se fier entièrement au caractère sacré et automatique des règles, puis s’est poursuivi avec les graves erreurs de la « marche de Deauville » entre Merkel et Sarkozy, dans la réponse chaotique et parfois dramatique à la crise grecque, au Whatever it takes de Mario Draghi, à la création du mécanisme européen de stabilité (MES), à l’admission par la Commission Juncker que les règles devaient être interprétées et appliquées avec souplesse, à la suspension des règles elles-mêmes pendant la pandémie, au tabou brisé de l’endettement commun avec le plan de relance Next Generation EU. Aucune personne saine d’esprit ne pourrait contester que la réponse de l’Union a été opportune. Cependant, cette épreuve a peut-être été la plus difficile à affronter pour l’Union et la zone euro depuis le début de la construction européenne. À cela s’ajoute la décision de faire de la transition climatique le projet qui définira la stratégie économique de l’Union pour les années à venir.
Le troisième événement est la pandémie. Dès le départ, l’Union manquait de compétences et d’un mandat clair en matière de santé. La réponse de l’Europe a d’abord été confuse et fragmentée, avec des manifestations d’égoïsme national qui ont fait craindre le pire. Puis, avec une rapidité étonnante, la situation s’est redressée et un programme commun de développement et de fourniture de vaccins a été lancé. Relativement, la réponse de l’Europe à la pandémie n’a pas été pire et, à bien des égards, meilleure que celle des États-Unis et de nombreux pays asiatiques, dont la Chine.
Puis, peut-être la crise la plus importante de toutes, l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Là encore, la rapidité avec laquelle l’unité de l’Europe et de l’OTAN a été atteinte est étonnante, tant par la dureté des sanctions que par l’envoi d’armes de plus en plus lourdes.
Enfin, la crise à laquelle la réponse la plus inadéquate a été apportée : celle de la pression migratoire sans précédent en provenance d’Afrique et du Moyen-Orient. Pour une organisation qui, selon son créateur Jean Monnet, est destinée à « avancer dans les crises », le moins que l’on puisse dire est que nous avons été servis.
Pour une organisation qui, selon son créateur Jean Monnet, est destinée à « avancer dans les crises », le moins que l’on puisse dire est que nous avons été servis.
Riccardo Perissich
L’évolution de l’Union n’a pas seulement été motivée par les événements décrits de manière aussi sommaire, mais aussi par un contexte international profondément modifié. L’intégration européenne est le produit le plus abouti de la conception des relations internationales développée par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale : celle d’un monde non pas dominé par des rapports de force, mais par un système de règles acceptées et partagées. Un monde « kantien », ou, si l’on veut, « post-westphalien ». Cette vision du monde coïncidait avec celle que l’Europe avait d’elle-même : une « puissance douce » (soft power), née d’un désir de paix, qui n’avait pas besoin d’une grande force militaire et qui pouvait étendre son influence grâce à l’élaboration habile de règles. Des règles qui allaient s’imposer pour leur sagesse et leur efficacité, mais aussi parce qu’elles étaient la porte d’entrée du plus grand marché du monde. Peu importe que cette conception ait été largement démentie, puisque la défense de l’Europe a en fait été confiée aux États-Unis. L’Union était ainsi devenue le principal champion d’un multilatéralisme qu’elle n’avait pas inventé, mais qu’elle avait fortement contribué à construire. L’effondrement du communisme a été suivi d’une brève période d’hégémonie américaine, puis occidentale, incontestée, qui a donné l’illusion que cet ordre allait bientôt devenir mondial. Nous savions que ce n’était pas le cas. Certaines erreurs stratégiques commises au Moyen-Orient par les États-Unis, la menace du terrorisme islamique et surtout la montée en puissance de la Chine ont profondément changé la donne. Cette instabilité généralisée a permis à certaines puissances intermédiaires (Iran, Brésil, Turquie et autres) de tenter de s’affirmer comme des acteurs autonomes. Une évolution qui a également eu d’importantes répercussions économiques, conduisant à une remise en question des avantages de la mondialisation, ou du moins montrant ses limites et sa fragilité. Aujourd’hui, ceux qui veulent promouvoir le multilatéralisme sont sur la défensive. L’Europe, créature kantienne, s’est ainsi trouvée confrontée à un monde de plus en plus hobbesien ; un défi qui, pour l’Union, avant d’être politique, est presque de nature ontologique.
L’Europe est maintenant obligée de tirer deux conclusions difficiles de ce contexte international. La première est que l’émergence d’une puissance comme la Chine, peu respectueuse des règles internationales et championne d’un capitalisme largement soumis au politique, ne permet plus de séparer les questions économiques et commerciales des questions géopolitiques. D’autant que même les États-Unis n’hésitent pas à utiliser leur puissance économique à des fins politiques. La seconde est que l’Europe est restée loin derrière les États-Unis et la Chine dans la révolution numérique.
Ce double réveil a introduit de nouveaux concepts dans le récit européen : celui de la dimension géopolitique de l’action de l’Union et celui de l' »autonomie stratégique ». La seconde en particulier, lancée dans le débat par Emmanuel Macron, a suscité à la fois un grand intérêt mais aussi de nombreuses questions. Parler d' »autonomie » européenne ou, comme on l’a fait, de « souveraineté », contient une forte dose d’ambiguïté. La physique quantique moderne nous apprend que l’état d’une particule ne peut être déterminé a priori, mais dépend du moment, de la manière et de la personne qui l’observe. Ainsi, le concept d’autonomie européenne change selon qu’on le regarde de l’intérieur ou de l’extérieur. Dans le premier cas, cela peut signifier que les membres de l’Union doivent être en mesure d’exercer leur souveraineté en commun. Dans le second, nous devons être autonomes par rapport à quelque chose d’autre que nous-mêmes. Cette deuxième discussion s’est immédiatement concentrée sur les conséquences pour les relations avec les États-Unis et l’OTAN. Il s’agit de l’une des questions les plus controversées du débat européen, qui a le potentiel de paralyser tout le reste.
Sur la base de ce qui précède, il est maintenant intéressant de voir non pas tant le bien et le mal de ce qui a été fait, mais plutôt à quel point cela a changé l’équilibre des pouvoirs au sein de l’Union, son mode de fonctionnement, ses intérêts stratégiques et son identité. Ces récents événements dramatiques ont notamment permis de dépasser, voire de réfuter, un certain nombre d’analyses sur lesquelles reposaient à la fois des consensus considérés comme acquis et des désaccords parfois difficiles à surmonter.
La première question concerne les valeurs fondatrices. L’Union européenne est une organisation composée de pays qui, bien que dotés de structures constitutionnelles différentes, partagent les mêmes valeurs démocratiques, libérales et de respect de l’état de droit. Toutefois, n’étant pas une union politique à part entière, elle ne dispose pas des instruments nécessaires pour les faire respecter par ses membres. Jusqu’à récemment, cela était considéré comme implicite, dans la mesure où le principe de la suprématie du droit européen sur le droit national reposait sur l’hypothèse que la Cour de justice européenne respecterait « par définition » dans ses arrêts les droits fondamentaux qui sous-tendent les constitutions des États membres. L’expérience avec les nouveaux membres de l’Est a ébranlé cet équilibre. Pour certains d’entre eux (Pologne et Hongrie, mais pas seulement), le chemin vers une démocratie libérale complète s’est avéré plus cahoteux que prévu. Il en résulte de graves anomalies dans le respect des principes de l’État de droit qui sont mal perçues par l’opinion publique des autres pays, laquelle ne comprend pas pourquoi des manquements beaucoup moins graves et non de véritables atteintes à la démocratie peuvent être sanctionnés. Le problème est que les instruments dont dispose l’Union pour combattre les déviations sont très faibles, essentiellement de nature financière, et difficiles à utiliser lorsque les pays « déviants » sont de plus en plus nombreux.
L’Union européenne est une organisation composée de pays qui, bien que dotés de structures constitutionnelles différentes, partagent les mêmes valeurs démocratiques, libérales et de respect de l’état de droit. Toutefois, n’étant pas une union politique à part entière, elle ne dispose pas des instruments nécessaires pour les faire respecter par ses membres.
Riccardo Perissich
La deuxième question concerne l’idée d’une Union irrémédiablement divisée par un désaccord entre les libéraux (ou ordolibéraux) d’un côté et les keynésiens et interventionnistes de l’autre ; ou, comme on l’a dit aussi, entre les cigales et les fourmis. Ce prétendu clivage a pris le caractère d’un clivage Nord-Sud. Outre le fait qu’il existe des différences colossales entre le « libéralisme » et l’ordo-libéralisme qui prévaut en Allemagne et dans une grande partie de l’Europe, et que les ordonnateurs de Francfort ne sont guère à l’aise à Chicago, la gestion concrète de la crise a permis de désidéologiser le débat. Plus personne ne semble penser que les règles ne sont par définition ni sacrées (comme le voudraient certains) ni « stupides » (comme les appelait Romano Prodi, alors président de la Commission). En outre, la création d’instruments de solidarité tels que le mécanisme de sauvegarde de l’environnement et l’Union européenne de nouvelle génération, même si elle ne représente pas le « moment hamiltonien » revendiqué par certains, constitue une innovation dont personne ne peut sous-estimer l’importance. De même, faire face au retard de la révolution numérique et au défi simultané d’un monde dans lequel les règles multilatérales sont de plus en plus remises en question exige que l’intervention publique joue un rôle plus important que ce qui était considéré comme souhaitable jusqu’à récemment. Les attitudes à l’égard de la mondialisation, notamment en raison de la fragilité des chaînes de production, sont en cours de révision. Sur ces questions, qui ont traditionnellement été âprement disputées, il existe une convergence considérable, même entre deux pays traditionnellement opposés, comme la France et l’Allemagne. D’autre part, il existe également une perception claire que parmi les grandes zones économiques, l’Union est celle qui dépend le plus du commerce international et ne peut donc pas s’isoler du reste du monde. Malgré sa taille et l’attrait de son marché, elle ne peut même pas se donner l’illusion qu’elle pourrait réglementer librement des technologies qu’elle ne possède pas. Personne ne pense donc que cela puisse signifier un retour à des formes de politiques industrielles semblables à celles pratiquées en France, en Italie et ailleurs jusqu’aux années 1980.
Les questions qui suivent concernent le dépassement de la distinction entre les dimensions économique et stratégique de l’intégration, d’où le concept d’Europe « géopolitique » ou d’autonomie stratégique. La politique étrangère, grande absente du projet initial de Jean Monnet, a fait une entrée remarquée dans le débat européen. Le cas le plus important, celui qui nous oblige à repenser le plus, est la relation avec la Russie à la lumière de l’agression contre l’Ukraine. Après l’effondrement de l’URSS, l’espoir avait prévalu à l’Ouest que la Russie pourrait elle aussi, sinon devenir pleinement démocratique et occidentale, du moins connaître une évolution compatible avec un ordre européen stable et consensuel. Surtout après l’arrivée de Poutine au pouvoir, les signes d’involution, trop connus pour les énumérer tous, se sont multipliés. Cependant, de nombreux pays européens, notamment l’Allemagne, la France et l’Italie, ont préféré décider que le dialogue avec Moscou restait une priorité ; ils ont ainsi épousé la théorie allemande du Wandel durch Handel, le changement par le commerce. En d’autres termes, nous lier la Russie sur le plan économique aurait facilité une évolution dans le sens souhaité. Il s’ensuit une dépendance massive aux importations d’hydrocarbures en provenance de Russie. Dans cette optique, une invasion de l’Ukraine était considérée comme peu probable, voire impossible.
Ce récit a été contré par un autre, porté principalement par les pays baltes, la Pologne et d’autres pays de l’Est. Selon cette analyse, les partisans de l’ouverture, obnubilés par leurs lumières, se sont lourdement trompés. Au contraire, la dérive adoptée par Poutine avait des racines profondes. L’objectif était de rétablir une identité russe exempte des corruptions occidentales et fondée sur un nationalisme à la fois ethnique, territorial et religieux, qui renvoie aux racines autocratiques, orthodoxes et impériales de l’histoire russe. L’hostilité aux valeurs occidentales, comprise comme la principale menace au retour de la Russie à ses racines, était donc irréductible. Dans cette optique, la Russie n’était pas seulement un partenaire difficile, mais une véritable menace. Rétablir le contrôle sur les anciennes républiques de Géorgie, de Moldavie et surtout d’Ukraine n’était pas seulement un moyen de rétablir une sphère impériale, mais aussi de se défendre contre la contamination par toute évolution démocratique et occidentale de ces peuples. C’est d’ailleurs le véritable sens de l’opposition obsessionnelle, presque paranoïaque, à l’élargissement de l’OTAN.
Rétablir le contrôle sur les anciennes républiques de Géorgie, de Moldavie et surtout d’Ukraine n’était pas seulement un moyen de rétablir une sphère impériale, mais aussi de se défendre contre la contamination par toute évolution démocratique et occidentale de ces peuples. C’est d’ailleurs le véritable sens de l’opposition obsessionnelle, presque paranoïaque, à l’élargissement de l’OTAN.
Riccardo Perissich
La réponse des autres Européens a été de comprendre les craintes historiques de la Pologne et des autres, mais aussi de les considérer avec une certaine condescendance comme excessivement extrémistes. Pour apaiser leurs craintes, l’adhésion à l’OTAN et à l’Union européenne a été favorisée, mais pour le reste, l’attitude de déni de la menace s’est poursuivie. Même Angela Merkel, qui avait une vision très lucide de Poutine, a choisi de ne pas modifier substantiellement la politique allemande et européenne. Même l’expansion de la Russie au Moyen-Orient, en Méditerranée et en Afrique n’a pas conduit à une remise en question substantielle. Cette réponse insuffisante, concrétisée par la réaction irréaliste et ambiguë à la demande d’adhésion à l’OTAN de l’Ukraine et de la Géorgie, a consolidé la croyance de Poutine en la décadence et la division de l’Occident. D’autre part, cela lui a permis d’exciter davantage les sentiments nationalistes dans son pays avec la thèse de l’encerclement dû à l’élargissement de l’OTAN et de l’humiliation infligée à la Russie par les vainqueurs de la guerre froide.
Aujourd’hui, il faut admettre que la Pologne et ses amis avaient raison et que la plupart des autres pays avaient tort. Le résultat est la guerre à laquelle nous assistons. Ce n’est pas le lieu pour analyser son développement. Il suffit de noter que la combinaison des insuffisances militaires de l’armée russe, des terribles atrocités commises, de la résilience inattendue des Ukrainiens et de la réponse unie tout aussi surprenante de l’Occident et de l’Europe rend les négociations de paix hautement improbables dans un avenir proche. Il reste la possibilité d’une trêve temporaire et précaire, inévitablement suivie d’une longue période de tension qui, à bien des égards, ne sera pas sans rappeler la guerre froide. La perspective d’un nouveau système de sécurité européen partagé est condamnée de manière réaliste. Cela nécessitera un changement dans ce qui est devenu l’équivalent russe du Sonderweg allemand, la recherche obsessionnelle d’une identité spéciale distincte de l’Occident et en opposition avec lui. Il reste cependant, comme à l’époque de la guerre froide, la nécessité d’un système de règles du jeu partagées pour éviter qu’un conflit latent ne se transforme en conflit ouvert.
Un certain nombre de conséquences en découlent. Poutine a été arrêté non seulement par l’héroïsme des Ukrainiens et ses propres erreurs, mais aussi par l’unité de l’Occident. La relation entre l’OTAN et l’autonomie européenne s’en est trouvée profondément modifiée. En effet, il a été démontré au-delà de tout doute possible qu’il n’existe pas de réponse militaire européenne efficace en dehors de l’OTAN, ni aujourd’hui, ni dans un avenir proche. Une évolution confirmée et renforcée par la décision historique de la Finlande et de la Suède de rejoindre l’alliance. La fable d’une Amérique tournant le dos à l’Europe pour ne penser qu’au Pacifique a été démentie de façon retentissante. D’un autre côté, cependant, il est également apparu que l’unité de l’Europe était indispensable pour renforcer l’efficacité de la réponse occidentale. Le maintien de l’engagement américain en Europe aujourd’hui dépend également d’un renforcement concret de l’engagement européen. Sans l’Union des sanctions de cette ampleur n’auraient pas été possibles.
La fable d’une Amérique tournant le dos à l’Europe pour ne penser qu’au Pacifique a été démentie de façon retentissante.
Riccardo Perissich
Si l’unité de l’Occident est donc cruciale, la question se pose de savoir si le temps joue en notre faveur ou en faveur de Poutine. À moyen terme, cela joue certainement en notre faveur. En effet, les sanctions ont de lourdes conséquences sur l’économie russe et donc aussi sur sa capacité militaire. À court terme, la réponse est moins certaine, notamment parce que les sanctions ont besoin de temps pour fonctionner et qu’une défaite militaire de la Russie sur le terrain n’est pas concevable. Le consensus autour de la stratégie adoptée par l’Occident est solide pour le moment, notamment parce qu’en l’absence de perspectives sérieuses de trêve, il n’y a guère d’alternative. Toutefois, la situation dans certains pays importants comme l’Italie et la France est fragile en raison d’une forte polarisation politique interne. Même la position allemande présente encore des éléments d’incertitude. Nous assistons donc au paradoxe de pays qui, bien que fondamentalement sur la même ligne, adoptent une rhétorique publique parfois divergente et en tout cas ambiguë. Ce phénomène est particulièrement visible en Italie et en France, mais aussi en Allemagne. L’adaptation du discours aux conditions politiques locales fait partie du réalisme politique. Dans ce cas, cependant, l’opinion publique peut être amenée à douter de l’unité de l’Occident, voire à se convaincre que l’obstacle à la trêve se trouve chez nous et non à Moscou. Une rupture du consensus interne dans certaines nations européennes importantes aurait des effets potentiellement dévastateurs non seulement pour l’unité de l’Europe, mais aussi pour les perspectives de sécurité et de paix. L’unité de l’Occident est donc aujourd’hui un bien suprême à préserver, tant pour convaincre Poutine de l’inanité de ses menaces que pour consolider le consensus de nos opinions publiques. Il s’agit d’un effort qui exige la coopération de tous en matière de langage et de comportement.
Le principal danger pour le maintien de l’unité de l’Occident et de l’Europe, le facteur qui peut miner le consensus interne plus que d’autres, est économique et social. En même temps, le conflit nous impose d’accélérer le désengagement de la dépendance aux hydrocarbures russes et la transition climatique, mais sans mettre en péril les fragiles possibilités de reprise économique entrevues avant la crise. Il s’agit d’un défi, exacerbé par de fortes tensions inflationnistes, qui exige un engagement national et collectif exceptionnel de la part des pays européens. L’architecture même de la gouvernance monétaire et économique sera affectée.
Le conflit nous impose d’accélérer le désengagement de la dépendance aux hydrocarbures russes et la transition climatique, mais sans mettre en péril les fragiles possibilités de reprise économique entrevues avant la crise. Il s’agit d’un défi, exacerbé par de fortes tensions inflationnistes, qui exige un engagement national et collectif exceptionnel de la part des pays européens. L’architecture même de la gouvernance monétaire et économique sera affectée.
Riccardo Perissich
Une autre conséquence du conflit est d’avoir posé en termes nouveaux le problème de l’effort spécifiquement européen pour la défense commune. Dans ce cas, le principal acteur du changement est l’Allemagne, qui a annoncé une Zeitenwende, un tournant décisif dans son attitude vis-à-vis des dépenses militaires. Ce tournant, bien qu’accompagné d’hésitations et d’ambiguïtés typiques du fonctionnement du système politique allemand, permet pour la première fois de donner un sens concret et urgent à la perspective d’une défense européenne. Cette perspective est d’autant plus concrète que le tournant allemand cherche explicitement à concilier les engagements européens et atlantiques. Là encore, la technologie a modifié les termes de la question. Pour les Européens, il ne s’agit pas tant ou seulement de construire en commun quelques avions ou sous-marins, mais de se préparer à des conflits hybrides qui font mentir l’ancien dicton de Cicéron : inter pacem et bellum nihil medium, il n’y a rien entre la paix et la guerre. Les conflits peuvent donc représenter un continuum entre la désinformation, les provocations de toutes sortes, les sanctions économiques, le piratage informatique, l’utilisation militaire des technologies spatiales et de l’intelligence artificielle, jusqu’à l’utilisation des technologies militaires classiques et de l’arme nucléaire. Une perspective qui modifie aussi profondément le concept de dissuasion.
On a beaucoup écrit sur le fait que l’OTAN a rassemblé des alliés importants en dehors de ses frontières (Japon, Australie et autres), mais qu’un grand nombre de pays émergents ont déclaré leur neutralité. Ce phénomène est en fait naturel et compréhensible. Même pendant la guerre froide, une grande partie de l’humanité était neutre. Être neutre dans ce cas ne signifie pas se ranger du côté de la Russie, et encore moins de la Chine ; il s’agit simplement d’une « guerre qui n’est pas la leur ». D’ailleurs, les motivations de cette position sont très différentes, par exemple chez les Asiatiques, les Africains ou les Latino-Américains. Cela n’enlève rien au fait qu’il s’agit de motivations dont nous devons tenir compte, par exemple en faisant tout notre possible pour faire face aux pénuries alimentaires que le conflit ukrainien menace de provoquer dans certaines régions d’Afrique.
Être neutre dans ce cas ne signifie pas se ranger du côté de la Russie, et encore moins de la Chine ; il s’agit simplement d’une « guerre qui n’est pas la leur ».
Riccardo Perissich
Les motivations des pays asiatiques comme l’Inde, qui sont naturellement plus déterminées par le rôle de la Chine que par le conflit lui-même, revêtent une importance particulière. Pour de nombreux pays de la région et pour les États-Unis, le conflit en Ukraine est également une métaphore du problème de Taïwan. L’alliance entre la Russie et la Chine n’a pas été provoquée par nous. Elle est le produit de la convergence naturelle entre deux grands pays dont la politique est nourrie par un nationalisme fort, un rejet des valeurs occidentales et une volonté de renverser l’ordre et les règles que l’Occident a établis au cours des dernières décennies. La convergence est donc fondée sur des raisons objectives. La « question chinoise » représente l’échec de l’autre grande illusion d’un monde qui, grâce au commerce libre et ouvert, s’unirait facilement autour du multilatéralisme et des valeurs occidentales. Cependant, les intérêts de deux acteurs comme la Russie et la Chine, qui entretiennent par ailleurs des relations très déséquilibrées entre elles, ne coïncident que partiellement. Il apparaît que le soutien chinois à l’agression russe n’a guère été que verbal jusqu’à présent. Et certains espèrent que la Chine jouera un rôle actif dans la recherche d’une trêve. La réalité est que, pour de nombreux acteurs asiatiques et pour les Américains, la confrontation avec la Chine reste le défi qui caractérisera le cours du siècle plus que tout autre. En ce qui concerne l’Europe, une conséquence importante est que nous ne pouvons plus considérer les théâtres européen et asiatique comme complètement séparés. Nous ne pouvons pas non plus continuer à considérer la « question chinoise » sous un angle purement économique et commercial. Cela s’ajoute à la liste des dénis européens qui doivent être surmontés – et cette remarque vaut en particulier pour l’Allemagne, mais pas seulement. Tout aussi irréaliste serait la tentation de vouloir s’ériger en médiateur entre la Chine et les États-Unis. Mettre en œuvre une politique unifiée à l’égard de la Chine sera encore plus difficile que cela ne l’a été pour la Russie.
Une autre conséquence du conflit en Ukraine est l’afflux de quelques millions de réfugiés, principalement des femmes et des enfants, en Europe. Ces chiffres sont sans précédent, tout comme la réaction ouverte et accueillante de nombreux membres de l’Union. Il reste à voir si ce grand élan de solidarité, qui contraste avec l’attitude de fermeture permanente à l’égard de l’immigration en provenance d’Afrique et du Moyen-Orient, facilitera l’obtention d’un plus grand consensus européen sur la politique migratoire.
Mettre en œuvre une politique unifiée à l’égard de la Chine sera encore plus difficile que cela ne l’a été pour la Russie.
Riccardo Perissich
Toutes ces questions ont en commun la caractéristique de poser en termes nouveaux des problèmes qui existaient déjà et de mettre fortement l’accent sur la nécessité d’une relation étroite avec les États-Unis, à la fois sur le plan stratégique et économique. Entre les deux côtés de l’Atlantique, il existe d’inévitables divergences de perception et d’intérêts contingents, mais celles-ci se manifestent dans le cadre d’une convergence stratégique substantielle sur les valeurs et les intérêts. Les conditions actuelles de la relation transatlantique sont dans le meilleur état possible depuis très longtemps. L’effort de dialogue de l’administration Biden est indéniable. La politique française – qui est peut-être le partenaire européen le plus difficile à cet égard – a également considérablement évolué. Il d’ailleurs est intéressant d’examiner l’évolution de la rhétorique macronienne sur le constat de la » mort cérébrale » de l’OTAN à une gestion de la crise ukrainienne en coordination substantielle avec les alliés. Cependant, une forte méfiance à l’égard de la fiabilité des États-Unis demeure en Europe, alimentée par l’expérience traumatisante de la présidence Trump, mais aussi par des incertitudes ou des erreurs dans la politique américaine qui datent de bien avant Trump. La crainte d’un second Trump est parfois agitée par les ennemis européens de l’unité occidentale comme une prophétie dont on espère finalement l’accomplissement libérateur. En miroir, on constate une méfiance généralisée des Américains à l’égard de la fiabilité des alliés européens. Il s’agit donc de convaincre les Américains qu’ils ne pourront pas faire face au monde turbulent qui se prépare sans l’apport européen. Pour les Européens, en revanche, il s’agit de comprendre que l’autonomie ne signifie pas le détachement, mais plutôt l’émancipation d’un partenaire devenu adulte. Sur le plan économique, les deux partenaires doivent prendre conscience que, si la tendance à la mondialisation reste forte, un certain degré de déconnexion technologique avec la Chine est inéluctable et se produit déjà. Ni les États-Unis, ni l’Europe, ni nos alliés en Asie ne sont en mesure de parvenir seuls à la réglementation dont Internet a besoin ou à la réorganisation des chaînes de production et d’approvisionnement pour certains composants critiques. La véritable convergence stratégique ne sera ni facile ni automatique. Pour l’atteindre et la maintenir, il faudra un effort constant de dialogue et de volonté politique. Elle nécessitera également le développement d’instruments de coordination permanents qui sont en cours de création, comme le Conseil du commerce et de la technologie, mais qui n’existent que partiellement pour le moment.
Chacun des défis mentionnés ci-dessus poserait en soi des problèmes redoutables pour un système fragile et imparfait tel que l’Union. Tous ensemble, ils peuvent sembler insurmontables. Cependant, ils sont largement interconnectés : s’attaquer à l’un d’entre eux permettra de s’attaquer aux autres. Si l’évolution des événements a profondément modifié les termes de nombreux problèmes et rendu possible des convergences auparavant considérées comme impossibles, il faut maintenant voir dans quelle mesure l’Union sera prête à répondre concrètement à tous ces défis. La première réponse spontanée est négative. La structure institutionnelle reste baroque et mal comprise par le public, et trop de décisions importantes nécessitent le consentement unanime des États membres. Dans ces conditions, il est souvent extrêmement difficile de parvenir à un consensus à 27.
Une difficulté souvent sous-estimée est l’absence d’un véritable débat politique européen. Jamais auparavant il n’a été aussi nécessaire non seulement que les autorités expliquent la vérité au public sans complaisance, mais aussi qu’elles le fassent de manière cohérente avec leurs partenaires européens. La « Convention » récemment conclue, qui a organisé le débat entre quelques centaines de citoyens européens, est une tentative généreuse et utile, mais elle montre aussi les limites de l’exercice. Il a été dit que les États-Unis n’ont commencé à exister en tant qu’entité politique que dans les premières décennies du XIXe siècle, lorsque la technologie a permis d’imprimer des journaux à grand tirage. Aujourd’hui, la technologie n’est guère un problème. Le principal obstacle au débat transnational est la barrière linguistique qui renforce le caractère national de la politique.
Le débat transnational qui existe est par définition limité à une élite. Par exemple, il faudra expliquer de manière cohérente au public les raisons et les limites de notre politique de lutte contre l’agression russe, mais aussi que l’accélération du désengagement de la dépendance aux hydrocarbures russes nécessite des arbitrages difficiles avec la stratégie de transition climatique. C’est d’autant plus crucial que la guerre actuelle se déroule aussi en partie sur le terrain de l’information et de la désinformation. La manière dont la confrontation politique se développe en Europe est également très différente. Dans certains pays, notamment dans le sud et dans ceux où la politique est plus polarisée, les questions tendent à être discutées en termes d’alternatives radicales ou de changements de paradigme. Dans d’autres, notamment dans le Nord, les choix sont discutés en termes de changements progressifs. Nous avons assisté à une campagne électorale française qui a opposé des choix de société radicaux, précédée d’une campagne électorale allemande dans laquelle Scholz, le candidat de l’opposition, s’est présenté comme la continuation… d’Angela Merkel avec laquelle il gouvernait d’ailleurs jusqu’avant l’élection.
Tout cela conduit à la réouverture d’un débat sur les institutions européennes qui était en sommeil après l’échec des référendums français et néerlandais sur le projet de « constitution ». Les questions à débattre sont nombreuses, mais la plus importante est certainement le besoin d’unanimité qui existe encore pour des questions importantes telles que la politique étrangère, la défense et la fiscalité. Des dirigeants importants tels que Macron et Draghi ont officiellement appelé à son abandon. La plus grande difficulté en Europe reste celle de réunir une majorité, mais il est indéniable que le droit de veto peut paralyser ou en tout cas retarder des décisions importantes. Il suffit de penser aux problèmes que pose maintenant la Hongrie. Dans une organisation telle que l’Union, qui réunit des États souverains, le réflexe de recherche du consensus prévaudra toujours, mais la possibilité concrète de voter change complètement la stratégie de négociation de tous les acteurs car elle les pousse à anticiper la recherche de compromis qui leur permettent de faire partie d’une éventuelle majorité. Cette réforme serait donc hautement souhaitable et il est bon que la discussion ait commencé. Toutefois, il faut être conscient que les perspectives de progrès à court terme sont modestes. Non seulement la question est par définition controversée, mais la réticence à se lancer dans une nouvelle opération de réforme des traités est encore largement répandue. Il ne s’agit pas seulement de mauvaise volonté. Certaines des questions qui devraient faire l’objet d’un vote sont au cœur de la souveraineté de nos pays. Bien qu’ils ne soient pas optimaux et parfois compliqués à mettre en œuvre, les moyens de contourner les vétos existent et nous en connaissons plusieurs exemples. Jusqu’à ce que l’Union ait atteint une forme stable d’union politique accomplie, cela restera l’une des principales voies pour faire progresser l’intégration : l’action des avant-gardes montrant la voie, prêtes ensuite à accueillir les retardataires. Cependant, l’expérience du Brexit devrait nous avoir appris que la pratique de la géométrie variable est par définition précaire, difficile à gérer et ne peut durer éternellement. Tôt ou tard, le choix entre la recomposition et la rupture ne peut être évité.
Dans une organisation telle que l’Union, qui réunit des États souverains, le réflexe de recherche du consensus prévaudra toujours, mais la possibilité concrète de voter change complètement la stratégie de négociation de tous les acteurs car elle les pousse à anticiper la recherche de compromis qui leur permettent de faire partie d’une éventuelle majorité.
Riccardo Perissich
Les choses se compliquent lorsque l’on veut faire passer cette façon de procéder du pragmatique au structurel. Il s’agit de la théorie dite des « cercles concentriques », selon laquelle les États membres de l’Union se regrouperaient en cercles caractérisés, de l’extérieur vers l’intérieur, par des degrés d’intégration plus élevés, chacun ayant sa propre structure institutionnelle ouverte mais distincte. Nous le mentionnons ici car certains ont voulu en voir des traces dans le discours de Macron à Strasbourg. Il s’agit d’une idée intellectuellement séduisante, mais qui comporte de nombreux dangers pouvant entraîner de graves fractures. Tout d’abord, l’idée de cercles concentriques ne correspond pas à la réalité des choses. Si nous prenons les plus importants – Schengen, l’Euro, la coopération renforcée en matière de défense – définir un noyau sur la base de l’un d’entre eux serait impossible car, si les cercles sont ce qu’ils sont, ils se croisent plutôt qu’ils ne se chevauchent. De plus, le marché unique, qui par définition devrait englober tout le cercle extérieur des 27, n’est pas une zone de libre-échange fonctionnant seule, mais un ensemble intégré qui doit être gouverné politiquement, juridiquement et financièrement. Sa gestion ne peut être facilement séparée, par exemple, de celle de la monnaie ou de la décision d’appliquer des sanctions économiques à des pays hostiles. Pour que l’Union ne se fracture pas irrémédiablement, la différenciation doit donc être gérée par une structure institutionnelle unitaire.
Il existe toutefois des raisons plus profondes d’être prudent. L’Union a besoin d’un moteur. Pendant longtemps, on a pensé que ce serait le couple franco-allemand. Il reste essentiel mais est désormais loin d’être suffisant. L’ensemble du système est devenu politiquement beaucoup plus complexe et il serait dangereux de sous-estimer les entraînements centrifuges. Nous savons tous que pendant la crise de l’euro, il y a eu une forte tension nord-sud. Nous savons également que de nombreuses personnes au nord des Alpes pensent depuis longtemps qu’un euro libéré du poids des cycles du sud serait plus stable et plus sûr. Le tournant s’est produit lorsque, confrontés à un véritable dilemme, ils ont décidé de résister à la tentation qui existait d’exclure la Grèce de l’euro. Aujourd’hui, l’un des rares points de consensus concernant la gouvernance de l’économie est que les solutions et les compromis doivent tenir compte des intérêts et des besoins, non seulement de tous les membres de l’euro, mais aussi de ceux qui n’en font pas encore partie. Le sens politique de la récente présentation d’un document hispano-néerlandais n’a échappé à personne. Cela ne sera pas facile, mais certains développements suggèrent qu’une nouvelle initiative visant à financer conjointement la réponse aux nouveaux défis, tels que la transition énergétique et l’effort renouvelé pour renforcer la défense européenne, pourrait mûrir en un rien de temps.
De nombreuses personnes au nord des Alpes pensent depuis longtemps qu’un euro libéré du poids des cycles du sud serait plus stable et plus sûr. Le tournant s’est produit lorsque, confrontés à un véritable dilemme, ils ont décidé de résister à la tentation qui existait d’exclure la Grèce de la monnaie commune.
Riccardo Perissich
La dimension Est/Ouest est plus compliquée. À l’époque, tout le monde voyait dans l’élargissement à l’Est le complément naturel de la fin de la guerre froide et de la réunification au nom de la démocratie de deux parties de l’Europe artificiellement séparées. Si, sur le plan économique, l’opération peut être considérée comme un succès, sur le plan politique, le chemin a été beaucoup plus chaotique. La manière traditionnelle et quelque peu bureaucratique dont le processus d’élargissement a été abordé a sous-estimé les difficultés politiques de l’intégration pour des peuples dont la tradition démocratique est plus fragile et récente que celle de la partie occidentale du continent. Des peuples, en outre, pour lesquels le nationalisme n’était pas tant perçu comme un mal à vaincre, mais souvent comme une valeur à préserver parce qu’elle était le symbole d’une liberté retrouvée. Nous avions oublié que cet arc de peuples qui s’étend de la Baltique à l’Adriatique était le lieu où sont nées deux guerres mondiales et où se sont produites certaines des horreurs les plus atroces de notre histoire. Une histoire conditionnée par un conflit constant entre les mondes germanique, ottoman et russe.
Lorsque nous avons découvert que l’intégration était beaucoup plus compliquée que prévu, nous avons écouté les explications de certains intellectuels comme Ivan Krastev qui ont essayé de nous instruire sur la complexité et les contradictions des événements de ces peuples et les dangers qu’ils représentaient pour nous aussi, les Occidentaux, mais avec condescendance et un peu d’agacement. Après tout, nous nous sommes dit que ces personnes devaient simplement s’adapter. Nous nous sommes comportés comme ces Piémontais et Lombards d’Italie qui, après 1860, ont cru que l’exploit de Garibaldi signifierait seulement une nation plus grande et non une nation profondément différente. L’agression russe contre l’Ukraine sonne comme un signal d’alarme. Il n’est plus possible de concevoir une politique à l’égard de la Russie, aujourd’hui notre principal test de politique étrangère, sans tenir pleinement compte de ce que pensent les Baltes, la Pologne, les autres pays de l’Est et même les Scandinaves.
Une difficulté similaire se pose lorsqu’il s’agit de traiter la longue liste des pays des Balkans occidentaux, auxquels s’ajoutent désormais l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, qui sont candidats à l’adhésion. Il ne fait aucun doute que les leçons des erreurs commises lors du dernier élargissement doivent être soigneusement examinées. Les délais objectifs exigés par la complexité des problèmes concrets se heurtent à des attentes émotionnelles toujours plus grandes qui risquent de produire des engrenages infernaux rendant impossible la résolution des problèmes les plus importants, qui sont les problèmes politiques.
Il y a quelques années, à l’initiative de la France, il a été décidé d’adopter une méthode différente, plus souple et progressive, qui mettrait au premier plan la gestion politique de l’adhésion et permettrait de « graduer » les formes d’adhésion à l’Union en fonction du degré de maturité politique et économique. Un processus à la fois incitatif et réversible. C’était certainement le bon chemin.
Après l’élargissement, nous nous sommes comportés comme ces Piémontais et Lombards d’Italie qui, après 1860, ont cru que l’exploit de Garibaldi signifierait seulement une nation plus grande et non une nation profondément différente. L’agression russe contre l’Ukraine sonne comme un signal d’alarme.
Riccardo Perissich
Dans son discours de Strasbourg, Emmanuel Macron a proposé de donner à cette démarche une forme institutionnelle en créant une « communauté politique », sorte de cercle extérieur de l’Union. La valeur symbolique de cette proposition, qui en Italie est également formulée par Enrico Letta, est indéniable. Mais avant de s’engager dans cette voie, il convient de se demander quels sont les avantages réels de la superposition d’une structure institutionnelle commune à un processus politique nécessairement différencié. Dans la pratique, elle risque d’être typique de la « mauvaise bonne idée » et de comporter plus d’inconvénients que d’avantages. Une institution nécessite une longue discussion sur ses structures et risque rapidement de devenir une machine lourde et bureaucratique. L’expérience de l’Union pour la Méditerranée aurait dû nous apprendre quelque chose. Les risques politiques sont plus graves. Les pays candidats sont presque tous dans des situations très différentes, avec des aspirations et des problèmes très différents. Une institution commune contient implicitement l’exigence de les gérer de manière unifiée et coordonnée. Deux exemples suffisent à illustrer les dangers. Que faire avec la Turquie, un pays très important mais dont on sait combien il constitue une question épineuse pour l’Europe ? Sa candidature est peut-être la plus ancienne, mais tout le monde, d’Ankara à Stockholm, sait qu’elle n’a désormais aucune chance de se concrétiser. Comment est-il possible de mettre l’Ukraine et la Serbie – historiquement alliée et toujours très proche de la Russie – dans la même institution, que l’on veut » politique » par définition ?
Nous avons dit que le couple franco-allemand reste essentiel pour faire avancer l’Europe. Après une longue période d’un processus conduit par la prudence allemande, un peu de décisionnisme français ne fait pas de mal. Cependant, le leadership exige non seulement d’énoncer des objectifs, mais aussi et surtout d’obtenir le consensus nécessaire pour les atteindre. Il faut reconnaître que la difficulté de concilier la valeur suprême de l’unité des 27 avec la possibilité de permettre à quelques avant-gardes d’aller de l’avant est plus grande que par le passé. La crise de l’euro nous a fait redécouvrir la nécessité de donner de l’espace à d’autres grands pays comme l’Italie et l’Espagne ; mais même cela ne suffit pas. Comme nous l’avons dit, la crise ukrainienne rend impossible une politique étrangère dans laquelle la Pologne et les pays baltes ne jouent pas un rôle central. Cette nouvelle centralité de la Pologne, qui n’est objectivement pas facile à gérer, a cependant l’avantage d’introduire un coin important entre la Pologne et la Hongrie, les deux principaux problèmes pour la question de l’état de droit.
Après une longue période d’un processus conduit par la prudence allemande, un peu de décisionnisme français ne fait pas de mal. Cependant, le leadership exige non seulement d’énoncer des objectifs, mais aussi et surtout d’obtenir le consensus nécessaire pour les atteindre.
Riccardo Perissich
Il n’est même plus possible de penser uniquement en termes de « grands pays ». Des agrégations telles que le groupe des soi-disant « frugaux » allant des Pays-Bas aux Scandinaves en passant par l’Autriche ne sont pas seulement, comme certains le pensent avec agacement et mépris, une excroissance du rigorisme allemand, mais la manifestation d’une volonté d’exister. Face à cette complexité, on lit plutôt dans les médias des analyses d’une arrogance suprême qui, pour se référer à l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne, parlent de « l’Europe qui compte ».
La prudence allemande de l’ère Angela Merkel était parfois excessive, mais elle était aussi inspirée par la conscience – imposée par l’histoire et la géographie – de la nécessité de prendre en compte toutes les variables du jeu européen. Il serait bon qu’une partie de ce sentiment de complexité traverse le Rhin et les Alpes et arrive aussi à Paris et à Rome. En Europe, le leadership est comme un chasse-neige. En cas de fortes chutes, si le chasse-neige n’est pas là ou avance trop lentement, la neige s’accumule et la route est bloquée. Cependant, si la vitesse à laquelle le chasse-neige se déplace est supérieure à la puissance avec laquelle il peut dégager le sol, il sera lui-même piégé.