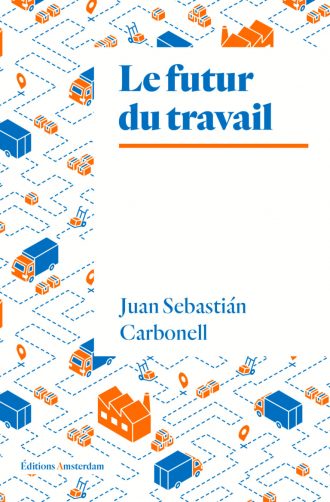Permanence du travail
Ulysse Lojkine examine deux thèses de l'ouvrage Le futur du travail, la permanence du travail vivant et celle du salariat stable.
Le futur du travail peut être lu de deux manières 1. D’une part, comme un manuel de haut niveau sur le travail contemporain en France et dans les pays riches, apportant sur ce thème toujours débattu et fantasmé le regard objectif du sociologue, mobilisant pour l’occasion aussi bien ses propres enquêtes dans l’industrie automobile qu’une impressionnante bibliographie en économie et en sociologie, citant aussi bien des chercheurs établis que des thèses inconnues du public. Mais aussi, d’autre part, comme un essai personnel, n’hésitant pas à prendre position de manière stimulante et souvent provocatrice dans ces mêmes débats. Plus précisément, face aux futurologues qui annoncent le remplacement du travail par les robots, du salariat par la précarité, et de la production par les flux logistiques, le livre apporte une même réponse : la permanence du travail salarié, par son volume et par bon nombre de ses caractéristiques. Les vraies questions seraient donc ailleurs, et notamment dans les rapports de classe qui déterminent l’intensité du travail, son contenu et sa durée.
Cette thèse s’applique d’abord aux débats sur l’automatisation. Le premier chapitre montre bien qu’elle ne peut pas être réduite à un processus qui remplace les travailleurs par des machines. Selon les cas, elle peut aussi créer des emplois, et comme il le montre par d’intéressants exemples issus de l’industrie automobile et des entrepôts logistiques, ses effets se déploient aussi selon d’autres dimensions comme la qualification et l’intensité du travail. Les chapitres 3 et 4 montrent concrètement à quoi ressemblent les nouveaux emplois engendrés par le changement technologique. Le chapitre 3 rappelle ainsi le rôle des « nouveaux prolétaires du numérique », ces travailleurs qui entraînent, contrôlent ou complètent les intelligences artificielles de reconnaissance d’images, des moteurs de recherche, de traduction ou de modération de contenu. Le chapitre 4 pour sa part rappelle la centralité du travail dans les nouvelles infrastructures logistiques de la mondialisation et de la production « juste-à-temps ». Ce qui devrait nous interpeller ne serait donc pas tant le risque de disparition du travail vivant que les conditions et l’intensité du travail dans l’entraînement des intelligences artificielles ou dans les entrepôts logistiques 2.
Le deuxième versant de la thèse de permanence du travail concerne la précarité, qui est l’objet du deuxième chapitre. Selon l’auteur, le salariat stable reste la norme dans les pays riches. C’est peut-être la thèse la plus provocatrice, car contrairement à la disparition du travail, l’idée d’une précarisation généralisée, qui constituerait une des caractéristiques de l’ère néolibérale par opposition à l’ère fordiste, n’est pas seulement le fait de futurologues en quête de notoriété, mais est relativement répandue dans les sciences sociales critiques, et le livre rappelle que Bourdieu lui-même proclamait en 1997 que « la précarité est aujourd’hui partout ». Pourtant, Carbonell a des chiffres à l’appui : en France, les salariés, dont près de neuf sur dix sont en contrat à durée indéterminée (CDI), restent en moyenne 11 ans dans une entreprise, soit un peu plus longtemps qu’en 1980 ; et la situation est sensiblement la même au Royaume-Uni ou aux États-Unis (p. 70-72). L’ampleur de l’ubérisation, pour sa part, est difficile à mesurer mais selon les calculs de l’OCDE, elle reste elle aussi une marge du marché du travail (p. 109). Par conséquent, les nouveaux statuts précaires ne doivent pas nous faire perdre de vue les évolutions dans le salariat stable lui-même, à commencer, en France, par les réformes successives du droit de travail dont l’auteur a lui-même étudié les effets.
Ce qui devrait nous interpeller ne serait donc pas tant le risque de disparition du travail vivant que les conditions et l’intensité du travail dans l’entraînement des intelligences artificielles ou dans les entrepôts logistiques.
ULYSSE LOJKINE
Bien que les grandes lignes de l’argumentation soient convaincantes et stimulantes 3, je voudrais revenir sur ces deux grandes affirmations, la permanence du travail vivant et celle du salariat stable. Carbonell montre bien que si le travail n’est pas prêt de disparaître, toute la question est celle de sa réallocation entre emplois, entre entreprises, entre secteurs. Pourtant, il ne commente pas directement une des transformations les plus massives et les plus profondes du marché du travail des pays riches ces dernières décennies : la raréfaction des emplois ouvriers. La désindustrialisation a été massive dans tous les pays riches, y compris d’ailleurs en Allemagne entre les années 1970 et les années 1990. Carbonell prétend que le discours sur la société postindustrielle relève d’une « vision eurocentrée » (p. 89) ; l’économiste Dani Rodrik a pourtant montré que les pays en développement étaient eux aussi touchés par un phénomène de « désindustrialisation prématurée » 4.
D’autres emplois apparaissaient à la même période, mais le plus souvent dans les services. Pour les travailleurs peu qualifiés, ce sont surtout les emplois dans le soin, réputés féminins, qui se sont démultipliés. Loin des discours futuristes sur la disparition du travail, il y a donc peut-être bien eu, pour les hommes de classes populaires, une raréfaction de l’emploi socialement reconnu comme digne, et il est possible que nous soyons aujourd’hui en train d’en affronter les conséquences politiques.
Cela nous mène à la seconde thèse de l’ouvrage, concernant la stabilité des emplois. Je dois répéter que j’ai beaucoup appris en lisant le chapitre 2. Pourtant, indépendamment du débat sur le poids respectif des CDD et des CDI, je crois que la montée du chômage représente un phénomène massif et profond de précarisation qui est bien attesté. L’auteur cherche à parer à cette objection et s’appuie sur une récente thèse de sociologie quantitative 5 pour affirmer que « le plein-emploi des Trente Glorieuses apparaît avant tout comme un mythe masculino-centré » (p. 69). Certes, l’expression de plein-emploi peut être trompeuse, car les femmes étaient largement à l’époque maintenues hors de l’emploi, dans la sphère du travail domestique. Pour autant, la non participation au marché du travail et le chômage, qui suppose une disposition à prendre un emploi, ne doivent pas être confondus, même si leur frontière peut être discutée. De plus en plus souvent à partir du milieu des années 1970, en France mais aussi, à des degrés divers, dans la plupart des pays riches, les personnes qui cherchaient un emploi ont passé des mois voire des années à en trouver un, surtout lorsqu’elles étaient peu qualifiées. On peut bien parler, en ce sens, de précarisation des trajectoires professionnelles.
Ces nuances ne diminuent en rien le mérite de ce petit livre qui pose en quelque sorte le cadre du débat : permanence du travail, permanence du salariat.
Sources
- Je dois préciser d’emblée que Juan Sebastian Carbonell est un ami, et qu’il m’a donné la chance d’apporter mes commentaires sur des versions antérieures du manuscrit.
- On peut d’ailleurs remarquer que les travailleurs de ces deux secteurs sont souvent employés par une même entreprise, Amazon, par sa plateforme Amazon mechanical Turk ou par ses activités de distribution.
- Même si l’auteur tord peut-être parfois un peu trop le bâton, comme lorsqu’il affirme que dans la grande distribution, « le développement des caisses automatiques n’a pas entraîné la suppression d’emplois » (p. 37), sans chiffres, ni inférence causale à l’appui, ou lorsqu’il se laisse prendre au jeu de la prédiction pour déduire des pertes actuelles d’Uber que son modèle économique serait intrinsèquement non viable (p. 110-111).
- Dani Rodrik, « Premature deindustrialization », National bureau of Economic research, document de travail n° 20935, février 2015 – https://www.nber.org/system/files/working_papers/w20935/w20935.pdf.
- Marion Plault, Métamorphoses et permanences des parcours professionnels en France (1968-2018). Pour une approche cohortale et sexuée des évolutions de l’emploi, thèse de doctorat, avril 2019 – https://hal.inria.fr/tel-02162326/