« Le massacre par en bas », une conversation avec Jérémie Foa
Faire l’histoire des humbles, de la banalité, des vies minuscules qui entourent un événement aussi colossal que la Saint-Barthélémy : c’est le pari de l’historien Jérémie Foa, auteur de Tous ceux qui tombent. Visages du massacre de la Saint-Barthélémy (La Découverte, 2021).Nous l’avons rencontré pour discuter de sa méthode, des échos de son travail avec l’histoire de la Shoah ou du génocide des Tutsis du Rwanda, et de la mémoire de la Saint-Barthélémy dans l’inconscient français.
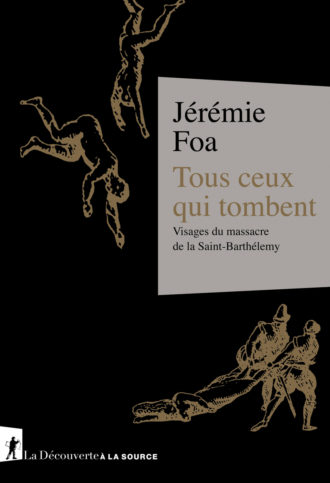
Vous avez d’abord travaillé sur les négociations de paix entre les années 1560 et 1570. Après des années passées sur la question de la concorde civile, vous avez résolu de travailler sur l’un des massacres les plus marquants de l’histoire de France. Comment en vient-on à travailler sur la Saint-Barthélémy ?
Il est vrai que ce n’était pas ma recherche initiale : j’ai commencé ma thèse avec Olivier Christin, à travailler sur des acteurs, qui étaient des commissaires envoyés par le roi pour faire la paix, deux par deux, dans les provinces. Et j’avais laissé complètement de côté, dans mes recherches initiales, la Saint-Barthélemy. La raison principale est qu’il s’agit d’un événement qui avait déjà été très travaillé, notamment par Denis Crouzet, qui a produit une immense thèse sur le sujet, à la fois merveilleuse et terrifiante pour un jeune historien. Commencer quand on a 25 ans, et se dire que l’on va faire une thèse sur la Saint-Barthélemy, alors que Denis Crouzet vient de révolutionner le champ, c’est ambitieux, voire téméraire. Si vous voulez, c’est une raison qui est assez prosaïque, mais qui est, je pense, relative à l’organisation du champ académique. Voilà pourquoi je n’ai pas commencé par la Saint-Barthélémy.
Quels sont les liens avec mon ancien travail ? Eh bien c’est toujours cette volonté d’étudier les problèmes par le bas. De la même manière que j’ai étudié la paix par ses acteurs, au ras du sol, c’est-à-dire les commissaires, non pas les grands livres, les grands théoriciens, le roi, les parlements, mais les acteurs qui, localement, se sont déplacés pour tenter de trouver une solution aux guerres de religion, de cette même manière j’ai interrogé le massacre de la Saint-Barthélemy par en bas. C’est-à-dire que dans la continuité de ma thèse, qui était « Comment fait-on la paix par en bas ? », ce livre s’interroge sur comment on commet un massacre par en bas et de quelle manière il est vu d’en bas.
Quelle est la singularité de ce massacre, ou au contraire sa normalité, sa banalité dans la période ?
Oui, on peut effectivement l’aborder de cette manière, c’est intéressant : à la fois sa singularité et sa banalité. Son côté exceptionnel, c’est le nombre de victimes : on est à 10 000 morts, alors que pour les autres massacres on est plutôt dans des registres d’une centaine de morts. Évidemment, du fait de cette ampleur, du nombre des victimes, il y a un travail de mémoire et un traumatisme mémoriel français qui est très important autour de cela : le massacre de la Saint-Barthélemy est vraiment un lieu de mémoire, entouré par une production documentaire incomparable. Beaucoup plus d’auteurs ont écrit sur la Saint-Barthélemy que sur les massacres de 1562 à Tours, par exemple. Il y a des dizaines d’auteurs, notamment protestants, qui ont écrit sur cette Saint-Barthélemy, et puis il y a surtout la production d’archives, notamment chez les notaires, qui est beaucoup plus importante que dans d’autres cas.
Voilà donc ce qui singularise, si vous voulez, la Saint-Barthélemy : le nombre de victimes, et le lieu de mémoire, qui fait que depuis cinq siècles, on n’a jamais cessé de travailler sur la Saint-Barthélemy. Si vous interrogez un Français dans la rue, même quelqu’un qui n’a pas fait des études d’histoire poussées a entendu parler du massacre de la Saint-Barthélemy, et cette dimension mémorielle m’intéressait.
D’un autre côté, quel est son lien avec les autres massacres ? En quoi est-il aussi, finalement, une continuité ? C’est une question intéressante. J’essaie de montrer dans mon livre que la Saint-Barthélemy ne surgit pas du jour au lendemain comme une invention pure dans laquelle des hommes se découvriraient tueurs sur un coup de tête, mais au contraire que ces tueurs, leurs techniques et leurs savoir-faire s’enracinent dans une décennie de persécutions et de violences à l’encontre des protestants.
On ne peut comprendre la Saint-Barthélemy qu’en tenant ces deux éléments. C’est exceptionnel, c’est une surprise, c’est non-prémédité, mais de l’autre côté ç’a été préparé de longue date, notamment depuis 1562 : d’abord car les massacres antérieurs ont permis de se faire la main ; ensuite par toutes les persécutions légales qui se sont abattues sur les protestants, notamment les arrestations arbitraires, les confiscations de biens, les bannissements. Ce qui fait que la Saint-Barthélemy ne se comprend que parce qu’elle est l’aboutissement d’une décennie de violence.
Si vous interrogez un Français dans la rue, même quelqu’un qui n’a pas fait des études d’histoires poussées a entendu parler du massacre de la Saint-Barthélémy, et cette dimension mémorielle m’intéressait
Jérémie foa
Enfin, on peut souligner que c’est le dernier massacre. Ce n’est pas le premier, mais c’est le dernier massacre des guerres de Religion : à partir de 1572 – Denis Crouzet l’a très bien montré –, la violence des catholiques devient différente. Une extrême violence a été déployée, mais du côté catholique, on se rend compte que c’est un échec. Du côté des catholiques zélés, des catholiques radicaux, on a tué tous les protestants possibles et imaginables, et on se rend compte qu’en réalité ils sont toujours là ; leurs enfants sont toujours là ! Il y en a toujours autant.
Et à partir de ce constat, les catholiques se disent : « si malgré tous nos efforts, malgré toute notre violence, les protestants sont encore là, c’est que Dieu le veut. Et peut-être avons-nous mal compris le message que Dieu nous adresse en envoyant sur Terre les hérétiques. Peut-être le message était-il non pas de commettre une violence à leur encontre, mais de nous purifier nous-mêmes ». Donc après 1572, la violence va s’inverser : avant 1572, elle est tournée à l’encontre des autres, à l’encontre des protestants, à l’encontre des hérétiques ; après 1572, la violence des catholiques radicaux est tournée contre le fidèle lui-même, dans une spiritualité qui est une spiritualité de type pénitentielle ; on va se fouetter, on va se punir, on va se lacérer.
Vous le voyez, la Saint-Barthélemy s’inscrit dans la continuité de longs massacres, mais elle est d’un autre côté un événement inouï, qui clôt un cycle de violence de 10 ans.
Qui sont vos prédécesseurs dans l’histoire des humbles ? La micro-histoire à la suite de Carlo Ginzburg, ou plutôt des gestes para-historiens comme ceux de Michel Foucault (notamment La Vie des hommes infâmes), que vous citez à plusieurs reprises ?
S’il faut se choisir des grands prédécesseurs, ces deux auteurs m’ont marqué, donc ce n’est pas l’un ou l’autre, mais l’un et l’autre. Évidemment, quand on lit La Vie des hommes infâmes de Michel Foucault, et qu’on est historien, on est saisi à la fois par la beauté de la langue, et puis par l’originalité du projet ; on a envie de faire la même chose. On veut partager cette émotion que ressent Michel Foucault à croiser des petites vies. Petites vies, dit-il, qui ne sont arrivées jusqu’à nous que parce qu’elles ont été prises dans les filets de l’archive, donc du pouvoir, ce qui parle évidemment à l’historien. Et puis bien sûr toute la microstoria m’influence grandement dans cette volonté qui est mienne de lire le monde par en bas.
On peut également citer une autre influence qui est grande sur moi : celle d’Arlette Farge, qui a aussi travaillé avec Michel Foucault. Arlette Farge, depuis toujours, s’intéresse aux petits, aux humbles, à ceux dont on ne parle pas, et milite pour prendre en compte l’émotion de l’historien, sa sensibilité face aux archives, ses envies, ses désirs. J’ai aussi accepté, contre tout une tradition académique, de me mettre en scène, ou en tout cas de parler de moi écrivant, de moi cherchant, de moi ressentant des émotions face à ces archives, alors que toute ma formation, toute la vôtre aussi sans doute, nous invite à cacher cela derrière une pseudo-objectivité. Donc voilà, Arlette Farge est aussi une grande source d’inspiration.
Vous citez régulièrement Michel Foucault, Michel de Certeau ou Georges Didi-Huberman, vous maniez des concepts hérités du structuralisme tout en les intégrant avec une grande maîtrise au travail d’enquête historienne. Comment intégrer la théorie critique au travail de l’historien, et quels bienfaits peut-elle avoir dans ce champ ? À quoi vous sert une science sociale moderne comme la sociologie (je pense à Erving Goffman, Pierre Bourdieu, Luc Boltanski, dont vous citez souvent les travaux) pour aborder la pragmatique du massacre ?
Merci beaucoup d’avoir remarqué cela, parce que c’est aussi quelque chose qui est très important, et c’est parfois aussi quelque chose que les historiens ont tendance à glisser sous le tapis : toutes les lectures qu’ils font et qui les aident à problématiser leurs recherches. Pour vous répondre largement, je crois à l’unité fondamentale des sciences sociales : je ne crois pas qu’il y ait de distinction épistémologique entre l’histoire, la sociologie, et l’anthropologie ; pour moi, il s’agit d’un même savoir qui s’applique à des objets différents. Donc je vais me servir des outils et des concepts des sciences sociales pour tenter de penser des problèmes, qui sont les problèmes rencontrés par les hommes du XVIe siècle.
Par exemple, vous avez cité Erving Goffman, qui a énormément étudié les intéractions quotidiennes entre les personnes, et il étudie évidemment les interactions notamment dans l’Amérique du XXe siècle : comment on se croise, comment on se regarde dans la rue. Pour ne pas faire peur aux passants, il faut ne pas trop scruter les gens : on regarde les passants et puis on baisse les yeux, c’est comme ça qu’on se comporte dans une grande ville. Et c’est ce qu’a établi Goffman, qu’il appelle l’inattention civile ; pour être poli, il ne faut pas prêter trop d’attention aux passants qu’on croise.
Je crois à l’unité des sciences sociales : je ne crois pas qu’il y ait de distinction épistémologique entre l’histoire, la sociologie, et l’anthropologie.
Jérémie Foa
Je me suis posé la question : qu’est ce que la vie dans une guerre civile, qu’est-ce-que la vie au XVIe siècle nous permet de comprendre du problème posé par Goffman ? Est-ce qu’on se comporte différemment, est-ce qu’on a le droit de s’arrêter plus longuement sur un passant dans une guerre civile que dans une grande métropole contemporaine ? Donc, si vous voulez, je me sers des concepts des sciences sociales contemporaines, pensées dans la grande ville via l’école de Chicago, pour éclairer le XVIe siècle et en retour j’espère, avec les problèmes croisés au XVIe siècle, éclairer peut-être et proposer peut-être des concepts que peuvent croiser les sciences sociales. Je pense donc que les sciences sociales sont fondamentalement unies et qu’on peut tout à fait utiliser – avec précaution , bien sûr – les concepts qui ont été forgés pour le XXe siècle, ou le XXIe siècle, et tenter de les faire tourner au XVIe siècle pour voir en quoi cela coince ou cela fonctionne.
Quelle méthode doit guider l’historien pour opérer ces rapprochements tout en gardant sa spécificité à chaque événement ? Ne risque-t-on pas de tomber dans un piège qui consisterait à ne chercher que des invariants anthropologiques, à écraser en quelque sorte les hommes du XXIe siècle, ou du XXe siècle sur les hommes du XVIe siècle ?
C’est une grande question que vous soulevez là, et c’est effectivement un grand risque, mais cela peut devenir une heuristique. C’est un pari que nous amenait à soutenir Nicole Loraux : l’audace de l’anachronisme. Parce que finalement, là se trouve la question : vous savez que l’on a cette injonction terrifiante de Lucien Febvre, qui nous invite, nous, historiens, à éviter à tout prix le péché entre tous, irrémissible, qui est le péché d’anachronisme, qui voudrait dire que des pensées qui sont celles des hommes du XXe siècle ne peuvent pas être des pensées des hommes du XVIe siècle et que mettre dans la tête d’hommes du XVIe s des pensées d’hommes et de femmes du XXe siècle c’est commettre l’anachronisme.
Nicole Loraux a elle, au contraire, invité à se saisir des rapprochements que notre position d’historiens dans une certaine société nous permet d’opérer. Cela nous permet de poser des questions nouvelles sur notre société. Pour ma part, je pense qu’être un historien qui a vécu les attentats terroristes du Bataclan – qui a vécu comme spectateur, bien sûr –, qui a vécu les phénomènes de radicalisation religieuse, qui vit dans une société hantée par l’angoisse des lendemains, tout cela me conduit à poser des questions nouvelles, à regarder de manière nouvelle le XVIe siècle. Donc voilà, premier élément de réponse : ne pas avoir peur de l’anachronisme.
De l’autre côté évidemment, le risque demeure, et on ne peut pas céder à la croyance que de tout temps les hommes ont pensé, senti de la même manière. Il faut donc toujours tenter d’articuler ces deux obligations, qui sont d’un côté celle de poser de nouvelles questions au passé à partir de nos problèmes contemporains, de l’autre d’accepter qu’il y ait des différences culturelles fortes entre les périodes, ces différences culturelles fortes, qui sont que dans la France du XVIe siècle, on est intensément croyant, on est intensément religieux, et que les pensées séculières ou laïques qui sont les nôtres, celles d’hommes du XXe siècle ne sont pas celles du XVIe siècle. Donc on ne peut pas mobiliser complètement les façons d’être, de croire et de sentir parce qu’elles sont différentes.
Et il y a une histoire des sensibilités, une histoire des émotions, une histoire du sensible qui doit tenir compte de la différence radicale qui sépare des hommes du XVIe des hommes du XXe. On doit tenter d’articuler les deux. Il y a des problèmes que les hommes du XXe et les hommes du XVIe croisent de manière commune : comment vivre avec des gens d’une religion différente ? Comment accepter que notre voisin ne croie pas de la même manière que nous ? Comment survivre dans un environnement radicalement hostile ? Qu’est-ce que mentir ? Qu’est-ce que transmettre ? Ce sont des problèmes, appelez-les invariants ou anthropologiques si vous voulez, mais des problèmes que l’humanité se pose à différentes époques de son histoire.
Il y a une histoire des sensibilités, une histoire des émotions, une histoire du sensible qui doit tenir compte de la différence radicale qui sépare des hommes du XVIe des hommes du XXe.
Jérémie foa
J’essaie d’articuler ces deux dimensions de mon travail. Un, en lisant les sciences sociales. Et les sciences sociales, vous le savez, sont des sciences sociales forcément contemporaines, pensées à partir du XXe siècle. Deux, en apportant une masse d’archives, donc en articulant le concept et l’empirisme. Et ces deux dimensions, l’empirisme et le concept, sont ce qui me permet, je pense, d’articuler l’audace de l’anachronisme et le respect de la singularité des époques.
Histoire des victimes, histoire des bourreaux, histoire des survivants… Comment vous êtes-vous nourri de travaux récents sur les exterminations de masse, particulièrement sur la Shoah et le génocide des Tutsi ? À quel point êtes-vous conscient des échos qui s’installent dans votre travail entre histoire moderne et contemporaine ?
Je pense que le terme d’écho est assez intéressant, parce qu’on peut lui donner deux dimensions. Il y a d’abord des échos conscients, et ils proviennent des lectures que je fais d’historiens et de périodes contemporaines tragiques. C’est par exemple le cas d’Hélène Dumas, qui est une spécialiste du génocide des Tutsis au Rwanda, dans le travail de qui je découvre le concept de « massacre de proximité ». En lisant dans ses pages que seuls les voisins Hutus ont le savoir-faire nécessaire pour reconnaitre, désigner et traquer un Tutsi ; que le génocide s’opère par en bas avec un savoir autochtone, parce que seuls les voisins sont en possession des ressources nécessaires à l’identification de leurs prochaines victimes… je me suis dit que c’était exactement la même chose dans la France du XVIe siècle.
Pendant des siècles, on s’est demandé si Catherine de Médicis ou Charles IX avaient commandité le massacre… Évidemment, j’ai un peu abandonné cette quête parce que c’est une quête impossible, que les sources existantes ne nous permettront pas de vraiment trancher. Et ce que l’on peut dire, en lisant Hélène Dumas, est que de la même manière que seuls les voisins au Rwanda étaient en possession du savoir sur l’identité de leurs voisins, au XVIe siècle seuls les voisins à Paris ou à Lyon ou à Rouen savent qui est protestant et qui ne l’est pas. Ian Grossman a montré des processus similaires qui impliquent les voisins dans la mise à mort des juifs pendant la Shoah. Catherine de Médicis, Charles IX, les Guises ne sont pas en possession de ces informations. Quand bien même ils auraient commandité le massacre d’en haut, il manque toujours un chaînon entre un ordre et sa mise en œuvre.
Pour mettre en œuvre un massacre de protestants, il faut encore savoir qui est protestant, qui ne l’est pas, et où ils vivent dans Paris. Seuls des voisins, des gens qui entretiennent des liens anciens de socialisation, maîtrisent ce savoir : « celui-là n’était pas à la messe dimanche ; j’ai vu cette fille sortir pour aller au prêche dimanche dernier ; cet homme n’a pas amené ses enfants au baptême, etc. ». Catherine de Médicis et Charles IX ignorent tous ces détails-là.
Il faut bien imaginer qu’au XVIe siècle — c’est radicalement le contraire aujourd’hui —, on est à l’opposé d’un État bureaucratique, où le pouvoir est nourri du savoir sur ses sujets. Il n’y a pas d’état-civil, ou du moins il est balbutiant, et il n’est de toute façon pas en possession du roi. Il n’y a pas, bien sûr, de savoir informatique qui permette à un roi de dire que tel ou tel de ses sujets est protestant. Donc il y a une ignorance presque complète du pouvoir sur la vie des humbles. Or Foucault a bien démontré que le savoir était intimement lié au pouvoir et que l’absence de savoir du côté de l’État indique que l’État seul n’a pas pu commettre ce massacre. Les liens entre savoir et pouvoir de tuer, on ne le retrouve qu’au niveau du sol, c’est-à-dire au niveau des voisins.
Quand bien même ils auraient commandité le massacre d’en haut, il manque toujours un chaînon entre un ordre et sa mise en œuvre.
Jérémie foa
Mais il y a aussi un ensemble d’échos souterrains, qui s’opèrent inconsciemment lorsque l’historien travaille sur un sujet. Je sais que pour des raisons familiales ou pour des raisons personnelles, il m’est impossible d’éviter d’associer la persécution des protestants et celle des juifs. Et, en un sens, si je désire travailler sur la persécution des protestants, c’est une façon de ne pas travailler sur la persécution des juifs, ou de mettre celle-ci à distance.
Dans les titres de mes chapitres, je fais des allusions à l’histoire et à la mémoire de la Shoah. J’ai par exemple intitulé « Au revoir les enfants » la partie où je reviens sur la façon dont on a caché les enfants protestants pendant le massacre de la Saint-Barthélémy. Il y a donc, si vous voulez, des associations qui sont inconscientes, qui sont liées à nos traumatismes, à notre propre histoire familiale. C’est ce qui nous pousse à travailler : je commence mon livre par un rapprochement assez étrange entre la mort d’une femme dénoncée par son mari pendant la Saint-Barthélémy — la femme du commissaire — et un traumatisme de ma propre enfance, qui est la mise à mort d’une femme, une amie de ma mère, dont l’assassinat a été commandité par son mari, dans l’Auvergne de mon enfance, dans les années 1990. Quand j’ai lu un texte évoquant « la femme du commissaire Aubert dénoncée par son mari », j’ai immédiatement fait une association inconsciente, involontaire et lancinante entre le visage de cette femme de 1572 dont le mari a commandité l’assassinat et l’assassinat de cette amie de ma mère dans l’Auvergne d’il y a trente ans. Et c’est pour cela que je m’attache à cette figure et que je m’attèle à cette enquête.
Donc vous voyez que quand on parle d’échos, ils seront à la fois volontaires, conceptuels, conscients, travaillés, mais aussi involontaires : il y a des figures attachantes du passé, il y a des figures dont on se souvient quand on lit une archive, et d’autres que l’on oublie. Il se trouve qu’ici je me suis souvenu de cette femme, qui dans le livre de Goulart était connue seulement sous le nom de la femme du commissaire Aubert. Et l’un de mes désirs était de lui redonner un nom, ce que je suis parvenu à faire — elle s’appelait Marie Robert —, et je pense que c’est l’un de mes succès personnels dans ce chapitre.
Bien sûr, c’est un triomphe minuscule, qui ne bouleverse pas la science ou la connaissance que nous avons du passé. Mais voilà, j’ai cette volonté de rendre cette petite justice aux victimes, de tenter de les nommer, et de dire quelque chose de leur mort, mais aussi de leur vie. Dans le cas de Marie Robert, je ne me suis pas seulement intéressé à sa mort, mais aussi à sa vie : ses enfants, ses robes, ses désirs, ses pensées, ses amis.
Revenons sur ce que vous disiez sur le roi qui ne connaissait pas les habitants protestants ; il en connaît tout de même quelques-uns, comme la noblesse protestante massacrée au Louvre et dans ses environs. Peut-on dire qu’il y a eu deux Saint-Barthélémy, d’un côté le coup de majesté contre la noblesse protestante, et de l’autre le massacre parisien ? Peut-on dire que vous vous êtes concentré sur l’une des deux, celle d’en bas ?
Il est impossible de dissocier ces deux massacres dans le temps car le signal de l’un entraîne l’autre. En revanche, ce que j’ai fait, vous avez raison, est que je me suis complètement désintéressé du premier pour diverses raisons. D’une part, le massacre du Louvre a été massivement travaillé depuis quatre siècles. D’autre part, je m’intéresse aux humbles et pas aux grands.
On travaille toujours sur Coligny, Téligny, et les autres seigneurs protestants qui, en effet, avaient quelque chose de spécifique par rapport aux autres victimes : ils étaient connus du roi. Il est ainsi tout à fait possible, et même plausible que leur mise à mort ait été commanditée par le roi : c’est la fameuse liste qui sort du Louvre avec une vingtaine, une trentaine de noms biens ciblés. Ce sont les grands protestants qui auraient peut-être repris les armes s’ils n’avaient pas été exécutés, que le roi ou l’entourage du roi — cette question est difficile à trancher — décide d’éliminer.
J’ai cette volonté de rendre cette petite justice aux victimes, de tenter de les nommer, et de dire quelque chose de leur mort, mais aussi de leur vie.
Jérémie FOA
Évidemment c’est un processus de mise à mort nobiliaire par des nobles qui est bien spécifique et très différent du massacre qui va s’ensuivre. Ceci étant, on ne peut pas les distinguer totalement parce qu’il est probable — et c’est mon hypothèse — que les bourgeois de Paris, et notamment la milice parisienne, voyant des soldats sortir du Louvre, sur ordre du roi pour tuer Coligny, ont pris ceci comme une invitation à aller plus loin et qu’ils se sont servis de leurs savoir-faire, savoir-faire que n’avait pas le roi, pour passer par les armes leurs voisins. Il y a donc eu là une dimension imitative.
Une autre hypothèse avance que les bourgeois et les miliciens ont très bien compris que le roi ne souhaitait pas la mise à mort des petits protestants parisiens, et qu’ils ont désobéi. C’est l’hypothèse de Jean-Louis Bourgeon, qui dit que la Saint-Barthélémy est une révolte parisienne contre le roi : les Parisiens, notamment les miliciens, ayant très bien compris que le roi n’avait souhaité que la mise à mort d’une vingtaine de personnes, se révoltent.
On a donc ces deux massacres, dont il faut distinguer les techniques, les acteurs, les savoir-faire. Pourtant on ne peut pas les séparer radicalement puisque l’un entraîne l’autre, selon des conditions qui sont toujours discutées controversées entre révolte ou obéissance, imitation ou sédition.
Alors même que vous faites souvent référence à d’autres périodes, vous n’évoquez pas l’historiographie des massacres de Septembre (1792) à propos des massacres à Lyon et Toulouse, alors que le modus operandi paraît similaire, c’est-à-dire que les protestants sont d’abords emprisonnés, avant d’être exécutés par des groupes plus réduits et extrêmement organisés dans les cours des prisons. Est-ce un choix délibéré ?
Il est vrai que si j’assume très volontiers les échos contemporains, même très contemporains, j’assume moins ce genre d’écho. Non pas que je pense qu’ils soient illégitimes, au contraire, j’ai lu Côme Simien ou Jean-Clément Martin, et je vois beaucoup de rapprochements, et j’ai l’idée même de travailler avec Côme Simien sur des rapprochements et des connexions qu’on peut faire entre les massacres de Septembre et les massacre de la Saint-Barthélémy. Du reste, le massacre de 1572 est une référence pendant la Révolution française, la peur d’une « Saint Barthélémy » des patriotes souvent l’une des causes des journées révolutionnaires. Mais il est vrai que, pour l’instant, c’est un point aveugle et je pense qu’un article qui comparerait les deux, sans dire que c’est la même chose, serait très pertinent. Il y aurait matière à des comparaisons tout à fait heuristiques et pertinentes.
La rigueur de vos enquêtes vous oblige fréquemment à vous arrêter sur le seuil d’hypothèses qu’il serait tentant de prolonger, mais que les sources manquent pour étayer : avez-vous déjà été tenté par le recours à la fiction ? Qu’est-ce qui différencie l’historien du romancier ?
Il y a beaucoup d’éléments de réponse à votre question : oui j’ai déjà été tenté par la fiction, par exemple dans une bande dessinée, avec le dessinateur Pochep, intitulée Sacrées guerres. De Catherine de Médicis à Henri IV que j’ai publiée l’an dernier, dans la collection « L’histoire dessinée de la France »(La Découverte/La Revue Dessinée). Mais je pense qu’il faut être très vigilant à ne pas mélanger les genres. Et dans mon livre, justement, quand vous dites que j’insiste sur les silences des sources, c’est qu’il me semble qu’il est essentiel de maintenir cette frontière entre le réel et la fiction — pour le dire avec des gros sabots quand on fait des sciences sociales. Il faut dire que, passé un certain seuil de certitudes, si l’on va plus loin, on commence à imaginer.
J’assume parfois d’imaginer, c’est-à-dire que j’écris très clairement « on pourrait imaginer… ». C’est un peu lourd de le formuler ainsi, mais je pense que cela met le lecteur dans un état de vigilance nécessaire.
jérémie foa
J’assume parfois d’imaginer, c’est-à-dire que j’écris très clairement « on pourrait imaginer… ». C’est un peu lourd de le formuler ainsi, mais je pense que cela met le lecteur dans un état de vigilance nécessaire. Selon moi, les historiens devraient recourir à ce procédé plus souvent, parce qu’en réalité nos sources sont très limitées : elles balisent le réel, mais très souvent entre ces deux balises de réel, c’est l’imagination qui prend le dessus. On imagine qu’entre tel acte qui a lieu à 13h et tel acte qui a lieu à 15h, l’acteur fait ceci. Mais là c’est l’imagination qui comble les vides de la documentation. Bien sûr, notre imagination est en partie nourrie par nos lectures scientifiques. En somme, je crois que la frontière doit rester étanche entre le réel et la fiction dans une œuvre, ce qui n’empêche pas de faire des œuvres de fiction quand on est historien ; mais alors on doit savoir qu’on ne fait plus de l’histoire, mais de la fiction !
La Saint-Barthélémy est devenue un topos du roman historique français. Pourriez-vous revenir sur les différentes représentations de cet événement ? Comment s’en affranchir ?
Malheureusement la littérature et le roman historique sur le sujet, en France comme à l’étranger, ont très peu évolué : on est toujours prisonnier de la lecture d’Alexandre Dumas dans La Reine Margot, qui a figé le récit qu’on en donne. Il a encore été repris récemment par Jean Teulé qui a publié un Charly 9. La caricature est éternelle : Catherine de Médicis passe pour une matrone abusive et son fils est dépeint comme un dégénéré sanguinaire. Dumas, que j’adore, a figé les derniers Valois dans un portrait à charge qui les présente comme des débiles sanguinaires et incestueux.
Le film de Chéreau, magnifique d’un point de vue esthétique, reste lui aussi prisonnier de la lecture d’Alexandre Dumas. Et d’un point de vue historique, il reste focalisé sur les grands de ce monde, à savoir l’inverse de ce que j’ai essayé de faire. Il faudrait, je pense, qu’un grand romancier, comme Pierre Michon a pu le faire pour d’autres époques, se saisisse des vies minuscules de la Saint-Barthélémy, pour écrire une Saint-Barthélémy que l’on ne verrait pas seulement du Louvre ou du point de vue de Catherine de Médicis.
On attend encore le grand romancier sur la Saint-Barthélémy.
Vous construisez une constellation de traces autour de l’événement « Saint-Barthélémy », un peu à la manière de Walter Benjamin dans son enquête sur Paris, capitale du XIXe siècle, dans votre cas avec une attention aux sources policières et administratives. Est-ce un type d’approche que vous appelez de vos vœux face à d’autres épisodes de l’histoire moderne ? Selon vous, y a-t-il des événements de l’histoire qui manquent particulièrement, dans leur transmission scolaire ou universitaire, de cette approche par le bas et par les marges ?
Je suis content que vous fassiez cette référence à Walter Benjamin car elle est pour moi tout à fait décisive. C’est vrai que j’avais parlé des grands ancêtres en citant Michel Foucault, mais Walter Benjamin est très important dans cette injonction, d’une part, à faire l’histoire des humbles, et de l’autre, à citer des noms. Cette dimension de mon travail vient directement de Walter Benjamin. J’appelle de mes vœux ce type d’approche et de relecture – donc, on va dire, effectivement, benjaminienne –, par les petites traces, et par les humbles.
Là par exemple, je suis en train d’écrire un livre avec une collègue, Diane Roussel, sur le siège de Paris en 1590 : Henri IV a mis le siège devant Paris au printemps 1590, et quatre mois plus tard on compte déjà près de 30 000 morts. C’est un événement très important du point de vue du peuple catholique. Donc ici je tente aussi cette même approche à partir des archives notariales, par le bas, par la constellation des traces restantes de ces vies minuscules.
Je pense qu’on pourrait le conduire exactement de la même manière sur la Fronde qui est un événement trop peu interrogé par les modernistes, ou trop peu interrogé sous cette optique-là, bien qu’elle ait été beaucoup et magnifiquement travaillé du côté de l’imprimé, notamment par Christian Jouhaud. Certains historiens de la Révolution ou de la Commune — je pense par exemple à Quentin Deluermoz — font des choses qui se rapprochent beaucoup de ce que j’essaie de faire.
On attend encore le grand romancier sur la Saint-Barthélémy.
Jérémie foa
Après l’histoire des victimes et des bourreaux, vous dites, en note de votre ouvrage, vouloir entamer une histoire des survivants de la Saint-Barthélémy. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet ?
J’ai commencé à le faire, j’ai écrit un article dessus et j’aimerais bien aller plus loin parce qu’effectivement, alors qu’on dispose d’archives sur les victimes, les témoignages protestants sont, par définition, des témoignages de survivants. Et j’aimerais utiliser ces témoignages pour comprendre et composer une sorte de manuel de survie dans le massacre. C’est-à-dire essayer de comprendre les compétences et les savoir-faire qu’ont mobilisés les survivants pour survivre. Comment survit-on dans un massacre comme celui de la Saint-Barthélémy ? Comment se déguise-t-on ? Comment ment-on sur son identité ? Comment se cache-t-on ? Comment trouve-t-on des alliés ? Quels sont les véhicules que l’on emprunte ? Les chemins qu’on parcourt ?
C’est un travail qui est nourri aussi de la lecture de Michael Pollak, qui a écrit un ouvrage magnifique sur le monde concentrationnaire, et qui met en avant les compétences, les ressources singulières aux survivants de la Shoah. Alors, évidemment, la Saint-Barthélémy n’est pas du tout une expérience concentrationnaire, et je ne rapproche pas la Shoah de la Saint-Barthélémy, mais j’essaie de m’intéresser à ces ressources singulières des survivants. Dans le cas des protestants, c’est un travail d’autant plus difficile que les rescapés ont une tendance très forte dans leur récit à dire que c’est Dieu qui les a sauvés.
Quand on est protestant, et qu’on a survécu au massacre, on est profondément croyant, on a une lecture providentialiste du massacre, et donc on dit « J’étais dans ma maison, les soldats sont arrivés, et j’ai survécu grâce à Dieu ». Pour un historien, c’est un peu frustrant, même s’il faut déplacer le problème en considérant que Dieu est un acteur du massacre dans la mesure où les protestants sont persuadés que Dieu est un acteur du massacre. Dieu devient une ressource puisqu’Il aide ceux qui sont persuadés qu’ils sont aidés.
D’un autre côté c’est un peu frustrant parce que j’aimerais qu’ils me disent très concrètement ce qu’ils ont fait. À défaut, j’ai essayé de faire une topographie des cachettes : « Je me suis caché dans un puits, dans des toilettes ; j’ai fui par les toits ; j’ai fui par le ruisseau ; je me suis déguisé en domestique ; je me suis déguisé en bonne soeur ; je me suis déguisé grâce à telle ou telle personne ». En écrivant ce manuel de la survie en guerre civile, j’essaie aussi de laisser sa place au hasard. Dire que certains ont survécu grâce à des compétences significatives ne veut pas dire que les autres qui sont morts étaient incompétents. Il faut aussi rappeler qu’il y a une immense dimension stochastique, c’est-à-dire liée au hasard, à l’arbitraire dans la survie : être au mauvais moment au mauvais endroit, être derrière la porte quand les soldats entrent, ou devant la porte… On le sait avec l’histoire des survivants du génocide des juifs.
Il y a une immense dimension de chance ou de malchance — d’arbitraire en somme — dans ces histoires-là.
Les vingt dernières pages de votre livre pointent vers une forte responsabilité du duc d’Anjou, frère du roi et futur Henri III, et de sa clientèle. Dans la mesure où vous cherchez à redonner des noms aux victimes tout en identifiant les coupables, ne vouliez-vous pas être plus explicite ?
Vous avez raison dans le fond, ce qui me retient est mon choix épistémologique d’emblée de faire une histoire d’en bas, et d’étudier des acteurs « populaires » : les miliciens qui ont tué, qui ont du sang sur les mains. Mais le duc d’Anjou, futur Henri III, apparaît à chaque ligne. C’est pour cela qu’à la fin je finis par faire une entorse à mes méthodes en disant que le duc d’Anjou avait du sang sur les mains : tous ses fidèles, tous ses clients et lui-même apparaissent à chaque ligne de ce massacre. Il n’y a pas grand chose qui me retient d’aller plus loin, si ce n’est l’envie de ne pas faire trop de concessions à une histoire des grands, à une histoire vue d’en haut.
En réalité, on le sait bien, on choisit un angle d’approche de l’histoire et cet angle d’approche est heuristique, c’est-à-dire qu’il nous permet de voir des choses que d’autres angles d’approches ne nous auraient pas permis de voir mais que l’histoire totale doit s’écrire par l’articulation de ces différents niveaux. Quand on fait de l’histoire par en bas, on ne prétend pas que l’histoire par en haut est illégitime : c’est un choix, c’est une optique, et comme toutes les optiques, on a des angles morts qui sont énormes, de tous les côtés. Mais on ne peut pas tout faire quand on est historien, on ne peut pas écrire tous les niveaux, mais j’espère bien qu’à partir de ces conclusions que je fais dans ces dernières pages, un historien ou une historienne se saisira de cela et l’articulera par une histoire du rôle très singulier — Nicolas Le Roux l’a déjà bien établi — du duc d’Anjou et de sa clientèle dans le massacre.

