La Fille qu’on appelle, livre révolté
Le dernier roman de Tanguy Viel chez Minuit s’impose comme l’une des œuvres phares de cette rentrée littéraire.
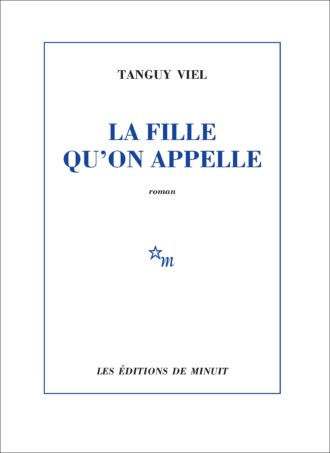
Max Le Corre, ancien champion de boxe sur le retour, est devenu le chauffeur de Quentin Le Bars, maire d’une ville moyenne de la côte bretonne. Il a une fille, Laura, qui fut jadis mannequin et posa nue pour des magazines et qui, revenue en Bretagne, cherche un travail et un logement. Quentin Le Bars promet de les lui procurer et la fait engager comme serveuse par un notable local, gérant d’un casino, aux activités louches. Faisant jouer le rapport de force et de pouvoir qui existe en sa faveur, mettant en œuvre un mécanisme d’emprise psychologique qui ne va jamais (vraiment) jusqu’au viol, le maire obtient de Laura des faveurs sexuelles répétées. La mise en place de cette situation, puis la manière dont les personnages – en particulier Laura et son père – s’y débattent, fournissent le sujet du dernier roman de Tanguy Viel, La Fille qu’on appelle (Éditions de Minuit), qui s’impose comme l’une des œuvres phares de cette rentrée littéraire.
On retrouve dans ce dernier livre de Tanguy Viel les ingrédients qui ont fait la qualité des précédents, et en particulier du remarqué Article 353 du code pénal (2017). Le récit tire sa puissance et son intensité de sa relative économie de moyens : assez peu de pages (cent soixante-seize), peu de personnages, une intrigue simple au mécanisme implacable, bref, quelque chose qui fait penser – l’auteur le disait lui-même à propos d’autres de ses romans – à une structure tragique. La dimension rétrospective du récit – puisque l’on découvre, dans les premières pages, Laura racontant sa propre histoire à la police – et l’usage du passé composé comme temps principal de la narration, avec une valeur d’accompli du présent toujours activée, participent d’un sentiment d’enfermement, de clôture, qui en rajoute sur le climat poisseux et oppressant. Mais comme si, d’une certaine manière, le texte gagnait en profondeur ce qu’il perd en ampleur, ce resserrement du cadre et de l’intrigue va de pair avec un creusement vertigineux de chaque interaction, de chaque instant, par la langue-scalpel de Tanguy Viel – l’héritage « Nouveau Roman » est sensible ; il ne publie pas chez Minuit pour rien. Quelques gestes anodins peuvent durer deux pages éblouissantes, le temps de décrire tous les mouvements d’âme, les hésitations, les désirs, les peurs, les réticences qui l’habitent et le traversent. À chaque geste, à chaque mot, à chaque silence, le temps se dilate et s’épaissit, comme aussi pour rendre ce récit, par moment si dur, plus difficile encore à traverser. Et cela est toujours pertinent et nécessaire, cela ne tourne jamais à l’exercice de style gratuit ; aucune affectation non plus dans les métaphores puissamment suggestives mais jamais tape-à-l’œil qui servent à dire toutes ces choses infimes qui ne peuvent se dire autrement, et qui souvent ont aussi pour effet, sinon pour but, de rehausser à une étonnante dignité des personnages laminés par le destin.
Car là, tout de même, Viel se sépare peut-être d’une tradition littéraire (sarrautienne, par exemple), à laquelle on pourrait être tenté de le rattacher : ses personnages à lui existent, sans l’ombre d’un vacillement, sans que leur identité sociale ou psychologique soit jamais menacée de dissolution ; ils sont au contraire efficacement offerts à la sympathie ou à la détestation, tout aussi franche l’une que l’autre, du lecteur. Mais en même temps, ce n’est pas le moindre tour de force de Tanguy Viel que d’avoir su construire ses personnages à la fois de telle sorte qu’ils existent puissamment – ils sont épais, bien campés, incarnés –, et de telle sorte qu’ils renvoient de manière ferme, univoque, transparente, à ces rôles actanciels qui semblent habiter de toute éternité notre imaginaire littéraire et moral : celui de la victime (Laura), celui du coupable – et du salaud (le maire). Le roman réaliste côtoie parfois presque la fable, sans jamais se laisser déborder – ou affadir ? – par elle.
La Fille qu’on appelle, qui raconte une histoire révoltante, est un livre révolté. Prenant sans ambages le parti des dominés contre celui des puissants, explorant par petites touches et par brefs coups d’œil les arcanes du pouvoir politique et médiatique dans ce qu’ils ont de plus sombre, il dénonce brillamment et implacablement, parce que cliniquement, la double domination de genre et de classe qui s’exerce sur Laura, et interroge aussi les manquements du système policier et judiciaire d’une manière plus pessimiste, pour le coup, que ce n’était le cas dans Article 353. Mais de même que, dans le prologue de ce roman-là, le promoteur immobilier se faisait jeter à l’eau, de même ici il fallait que dans les dernières pages le méchant fût puni – on ne révèlera pas comment, ni pourquoi, ni par qui ; cette ultime séquence, qui semble assumer sa fonction libératrice et compensatoire, prévient le roman d’être aussi noir qu’il aurait pu l’être, d’être tout à fait désespérant. Cela ne change pas grand-chose au message du livre, mais en dessinant la vengeance – ou, pour le dire en termes en peu plus positifs et vaguement plus politiques, la revanche – comme horizon, cela donne à la lecture, celle-ci achevée, un arrière-goût légèrement moins amer ; et ce dosage subtil des affects, lui aussi, est remarquable.

