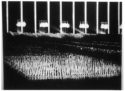« Un monde dans lequel des personnages idéalisés prennent la mesure de la réalité, et souvent la trouvent, a besoin d’être corrigé. »
Anne Heller, Ayn Rand and the World She Made.
Un homme est en train de skier. Il chute. Il est architecte. C’est le personnage du tableau de Luc Tuymans, Der Architekt, une peinture de 1998. C’est également Howard Roark, le protagoniste de The Fountainhead d’Ayn Rand. Et c’est aussi le nazi Albert Speer.

L’homme qui a chuté dans Der Architekt n’est pas en train de se reposer : c’est ce que suggère la position de ses skis, croisés sous ses genoux, mais aussi sa façon de regarder derrière lui. Pas d’équilibre dans sa posture. Il n’est pas en train de reprendre ses esprits après une marche éprouvante. Sa position exprimerait plutôt une fragilité, une faille ou même une forme de tristesse. L’expressivité de ce corps aux contours flous est rehaussée par l’absence de visage, qui pourrait aussi bien avoir été effacé par l’artiste que caché derrière un masque. En l’absence de toute indication psychologique dans son expression faciale, tous les autres signaux se retrouvent amplifiés, comme des craquements dans l’obscurité.
La même retenue s’observe dans les contours flous et dans la palette de couleurs, comprimée entre le blanc cassé de la neige et les nuances de bleu et de gris de la figure et du fond. Comme le visage effacé, ces choix sont révélateurs de la réticence de l’artiste : ils demandent au spectateur d’y regarder à deux fois. Cette réticence est essentielle au charme mélancolique du tableau, à son expressivité magnétique qui ne permet pas de savoir exactement ce qui est exprimé. La réticence est la marque de celui qui garde un secret. Quel est-il ?
Tuymans a déclaré à plusieurs reprises que Der Architekt représentait Albert Speer, l’architecte nazi. Comme beaucoup de ses œuvres antérieures, la peinture se fonde sur une image préexistante, en l’occurrence un arrêt sur image tiré d’un des films personnels de Speer. Cette identification est délibérément absente de la peinture elle-même ; la seule source d’information possible, le visage du personnage, a été effacé. La bobine privée dont il est tiré a été rendue publique pour la première fois en 2005 à la télévision allemande. Lorsque Tuymans peignit Der Architekt, l’identification était alors impossible à établir. Aux yeux de tout spectateur, cela aurait aussi bien pu être un mensonge.
Tuymans déclarait aussi que « le petit écart entre l’explication d’un tableau du tableau lui-même offre la seule perspective possible sur la peinture ».
Le petit écart dont il parle n’a rien à voir avec les médiocres éclairages souvent apportés, dans l’art contemporain, par des légendes sensées révéler sous un jour unique ce qui est normalement un simple objet du quotidien. Cette paire de clés ouvre la voiture que le fiancé de l’artiste lui a laissé après leur séparation, une voiture qu’il n’a pas pu utiliser depuis. Ce tas de déchets provient du pays de naissance de l’artiste que celui-ci a été contraint de quitter par une guerre civile. Dans de telles situations — toutes deux attestées — la légende n’ajoute pas quelque chose à la valeur de l’œuvre, mais la crée plutôt. La question qu’ils soulèvent ne provient pas des objets eux-mêmes — une paire de clés, un tas de déchets — mais du fait que ces objets aient été mis en scène comme des objets d’art. Dans cette perspective, c’est finalement une question d’aura, et la réponse, de façon intéressante, la réoriente vers quelque chose d’aussi immatériel et singulier que l’histoire personnelle. Sans légende, ces objets seraient restés muets. Croisés hors de leur cube blanc, il ne seraient chargés d’aucun mystère.
Cependant, il y a un mystère dans la peinture de Tuymans. L’écart entre le tableau et son explication a été délibérément agrandi par l’artiste. Il aurait pu produire une explication redondante, ou bien ne pas en donner du tout. Si Tuymans n’avait pas masqué le visage de Speer (ou s’il était parti d’un instantané où sa tête était visible, ce qui revient au même), l’œuvre aurait été un portrait ordinaire. Si au contraire il avait décidé de ne pas donner l’origine de l’image, cette peinture aurait seulement été la représentation subtilement étrange d’un homme capturé dans un instant de fragilité, un homme dont la personnalité semble minée à la fois par sa pose et par la technique qui la dépeint. Sans nom à poser sur cette silhouette, la suppression du visage et le floutage des contours seraient pris pour des procédés d’universalisation : des moyens de séparer la peinture de son contexte anecdotique et d’encourager les spectateurs à s’y projeter, à y voir n’importe qui. Dans ce second cas, le tableau aurait été l’exact opposé d’un portrait.
Sans nom à poser sur cette silhouette, la suppression du visage et le floutage des contours seraient pris pour des procédés d’universalisation : des moyens de séparer la peinture de son contexte anecdotique et d’encourager les spectateurs à s’y projeter, à y voir n’importe qui. Dans ce second cas, le tableau aurait été l’exact opposé d’un portrait.
Vincenzo Latronico
La singularité et la puissance de Der Architekt, le geste qu’il propose indissociables de la tension entre ces deux choix à la fois proches et opposés. Pourquoi effacer le visage d’Albert Speer ? Ou, à l’inverse, pourquoi nous dire que l’homme au visage effacé est Albert Speer ? Toute tentative de réponse doit commencer par établir si, oui ou non, ces deux questions n’en font qu’une.
Speer fut l’architecte d’Adolf Hitler. Il construisit sa Nouvelle Chancellerie et conçut la scénographie tristement célèbre des meetings de Nuremberg. À une époque où des architectes allemands comme Walter Gropius et Ludwig Mies van der Rohe faisaient rayonner le Modernisme dans le monde entier, ses immeubles tendaient à un classicisme platement stylisé. Il avait une prédilection pour les matériaux traditionnels. Il conçut le plan d’ensemble du Welthaupstadt Germania, le quartier monumental de Berlin qu’Hitler avait imaginé pour le jour où Berlin serait devenue la capitale du monde ; mais il cessa d’exercer son métier d’architecte pour devenu ministre de l’armement pendant la guerre. C’était un bel homme, introverti, cultivé, amoureux de la nature et des sports d’extérieur. Il fut jugé à Nuremberg pour crime contre l’humanité.

Il plaida coupable, déclarant que, bien qu’il n’eût pas entendu parler du génocide des juifs et des roms avant le procès, son rôle de leader national-socialiste le rendait personnellement responsable pour les actions de son gouvernement. Il évita la potence et fut condamné à vingt ans de prison, qu’il passa à Spandau, un château en lisière de Berlin-Ouest sous la surveillance de plusieurs douzaines de gardes des forces alliées, de même que six autres nazis qui avaient échappé à la mort ou au suicide à Nuremberg. Avant que le dernier d’entre eux soit libéré, le château fut rasé, afin qu’il ne devienne pas un lieu de pèlerinage.
Tels étaient les informations les plus importantes qu’on pouvait connaître sur Albert Speer à la fin des années 1990, quand Tuymans peignit Der Architekt. On peut raisonnablement penser qu’elles comptèrent dans sa décision de représenter Speer, et de le représenter de cette manière.
Ces faits se trouvent principalement dans deux ouvrages écrits par Speer pendant son emprisonnement, sur des bouts de papier cachés qu’un gardien complaisant a aidé à faire sortir, et publiés avec un grand succès international en 1969, trois ans après sa libération. Bien qu’ils aient été édités par le très érudit Joachim Fest, l’exactitude historique des souvenirs de Speer a immédiatement été remise en question. Les doutes portaient en particulier sur l’affirmation de Speer selon laquelle il n’était pas au courant des camps d’extermination. Ce doute sur l’honnêteté de Speer s’est ensuite transformé en certitude. Il existe des preuves matérielles qu’il savait, qu’il était à Poznan en 1943 lorsque Heinrich Himmler a atrocement plaidé pour le gazage des enfants aux côtés des adultes, de peur qu’ils ne survivent et reviennent pour se venger. Mais, alors qu’au fil des ans, les historiens ont de plus en plus soupçonné, puis supposé, que Speer était au courant de ces faits, la preuve matérielle n’en a été apportée qu’en 2007, plusieurs années après la réalisation du tableau.
Ces faits sont essentiels pour comprendre Albert Speer. Sont-ils également essentiels pour comprendre Der Architekt ? On pourrait naturellement supposer que c’est le secret auquel le tableau fait allusion : la conscience de la culpabilité de Speer, son rôle dans les atrocités. Dans ce cas, Der Architekt serait une répétition. Car Tuymans a déjà consacré deux tableaux à Speer, et à ce même secret.

Celui-ci était déjà présent dans une peinture de 1990, qui est un portrait au sens traditionnel du terme — les traits de Speer sont clairement reconnaissables par quiconque est familier des photographies de lui. Il est presque en noir et blanc. Speer apparaît comme un beau jeune homme, qui commence tout juste sa carrière d’architecte en chef du NSDAP. Le regard sur son visage est serein et déterminé, presque contemplatif. Ses yeux sont fermés. L’œuvre s’intitule Secrets.
Les passages des mémoires de Speer où il réfléchit à sa culpabilité, qui sont remarquablement rares, sont pleins de références à la vision. Dans l’un des cas les plus explicites, il écrit que, en tant que ministre de l’armement, il a visité une usine dont les travailleurs asservis avaient été récemment transférés d’un camp de concentration. Il rapporte que, lorsqu’on leur a demandé s’ils préféraient retourner dans un camp qui ne les obligeait pas à travailler, les prisonniers ont étonnamment répondu non. Même vingt ans plus tard, Speer se souvient de la terreur dans leurs yeux alors qu’ils envisageaient d’y retourner. Et pourtant, écrit-il, il n’a pas posé d’autres questions sur l’origine de cette terreur. Il ne l’a pas vue. Ce qui me hante aujourd’hui, écrit Speer, c’est que je n’ai pas su lire la physionomie du régime qui se reflétait dans les visages de ces prisonniers. Et parfois, je me demande qui était vraiment ce jeune homme, ce jeune homme qui m’est devenu si étranger.
Ce jeune homme est le sujet dépeint dans Secrets.
Secrets est une œuvre littérale : non seulement parce qu’elle remplit la fonction traditionnelle d’un portrait — illustrer son sujet — mais aussi parce qu’elle illustre son propre titre, c’est-à-dire la proposition de l’artiste. La proposition de Tuymans est qu’Albert Speer a vécu les yeux fermés.

Le secret, sous une forme différente, était également présent dans The Walk, daté de 1993. Il s’agit d’un tableau inspiré d’une célèbre photographie de Speer et d’Hitler faisant une randonnée dans la neige à Obersalzberg, la station alpine où Hitler se retirait souvent pour méditer et divertir ses larbins avec des monologues décousus sur la mission du Reich millénaire. Les deux hommes, représentés de dos, sont des silhouettes noires sur fond de paysage bavarois dramatique. La technique picturale est plus chargée que dans Secrets, avec une position d’auteur plus interprétative : les couleurs sont saturées, les traits presque impressionnistes.
La figure de Speer, ici, est plus cachée que dans le portrait précédent, mais pas complètement. Si, trois ans plus tôt, le seul élément invisible du visage de Speer était ses yeux — c’est-à-dire le plus expressif —, cette fois, le visage entier est hors de vue. D’autre part, les sujets du tableau, Speer et Hitler, sont intrinsèquement reconnaissables, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter un légende. Il suffit de connaître la célèbre photographie dont elle s’inspire, ou même d’avoir une certaine familiarité avec la posture dégingandée de l’architecte. En représentant Speer de dos, Tuymans semble inviter les spectateurs à imaginer son visage, à se demander comment il aurait pu aborder ce que Hitler lui disait, à se demander si quelqu’un qui était si proche du dictateur pouvait vraiment prétendre ne pas savoir.
En représentant Speer de dos, Tuymans semble inviter les spectateurs à imaginer son visage, à se demander comment il aurait pu aborder ce que Hitler lui disait, à se demander si quelqu’un qui était si proche du dictateur pouvait vraiment prétendre ne pas savoir.
Vincenzo Latronico
Dans ses mémoires, Speer nie à plusieurs reprises avoir réellement connu Hitler. Il se demande pourquoi, après avoir passé tant d’années à travailler étroitement ensemble, il n’en est jamais venu à le considérer comme un ami. Il le désigne comme « inconsistant, sans vie, vide ».
Un seul passage, dans les deux mille pages de souvenirs, semble compliquer ce tableau. Il se situe dans la nuit du 25 juin 1940. La France vient de signer l’armistice. Le haut commandement de l’Allemagne nazie attendait le cessez-le-feu depuis la ferme de la campagne française où il était cantonné. Hitler avait ordonné d’éteindre toutes les lumières. Soudain, après quelques minutes, les coups de feu rageurs au loin ont cessé d’un seul coup, comme par magie. Le silence qui suivit fut brisé par la voix d’Hitler, « douce et sans empathie », qui marmonnait, dans l’obscurité : « Cette responsabilité… »
Speer fait cette remarque : Pour moi, [cela] est resté un événement rare. Je pensais avoir vu pour une fois Hitler comme un être humain. Le rare moment où Speer a vu Hitler comme un être humain eut lieu dans l’obscurité.
À ce moment-là, le visage d’Hitler était invisible, comme celui de Speer dans The Walk. De ce point de vue, le sujet du tableau semble être le même que dans Secrets : le secret qui semble être central pour une compréhension historique d’Albert Speer. Mais la comparaison avec Secrets révèle des changements significatifs dans la façon dont le sujet est présenté, et donc dans la façon dont le tableau formule sa proposition. Secrets est un portrait : son sujet est un homme précis, Speer, et l’œuvre ne peut que se référer logiquement à lui. Dans The Walk, cette identification est un peu moins rigide : l’homme représenté de dos, se promenant avec Hitler, est Albert Speer — on peut l’établir à partir de documents historiques — mais rien dans le tableau lui-même ne permet de le savoir. Le secret spécifique d’Albert Speer — connaissait-il les camps d’extermination ? — se présente sous un jour légèrement différent, non pas comme une question historique précise, mais comme renvoyant à quelque chose de plus vaste. Quoi que le tableau amène à penser de l’intégrité morale de Speer finit par glisser au-delà de Speer lui-même. Le sujet de la peinture pourrait être quelqu’un d’autre. Cela pourrait être vous.
De ce point de vue, le passage de Secrets à The Walk semble être la première étape d’un acte de disparition qui culminera dans Der Architekt, où cet évidement du sujet se réalise pleinement. Les informations sur l’identité du sujet s’estompent au loin — passant d’abord du tableau à la mémoire collective, puis de la mémoire à la légende. Le secret — qui concerne le personnage historique de Speer — disparaît du tableau tout comme le visage de Speer, d’abord montré les yeux fermés, puis de dos, et finalement effacé par la tache blanche.
Ce qui reste, c’est la silhouette d’un homme qui est tombé. En déclarant que cet homme est Albert Speer, Tuymans nous invite à réfléchir sur lui. En effaçant son visage, Tuymans nous invite à détourner notre attention de ce qui rend Speer unique, son secret, et à considérer plutôt son image dans son ensemble.
L’image publique de Speer doit étonnamment peu à ce qu’il a construit. Il ne reste pas grand-chose de Speer en tant qu’architecte, et même cela semble appartenir à une branche morte de la discipline. Son style tentait de sauver un vestige de classicisme au milieu de ce qu’il percevait comme la pression conformiste de la modernité. Ses structures combinent des géométries du XXe siècle avec une abondance de colonnes doriques, de pignons, de marbre polychrome. D’une certaine manière, Speer y voit une bataille idéalisée contre l’Amérique (contre les gratte-ciels, contre Mies van der Rohe et Gropius), en accord avec l’idéal nazi d’une voie allemande vers la modernité qui pourrait fusionner les nouvelles technologies avec le culte d’une tradition largement inventée et un désir romantique de la nature. Le fait que, rétrospectivement, cette bataille ait été perdue ne fait que souligner davantage son aspect sentimental.
D’une certaine manière, Speer y voit une bataille idéalisée contre l’Amérique (contre les gratte-ciels, contre Mies van der Rohe et Gropius), en accord avec l’idéal nazi d’une voie allemande vers la modernité qui pourrait fusionner les nouvelles technologies avec le culte d’une tradition largement inventée et un désir romantique de la nature.
Vincenzo Latronico
Le projet dont Speer était le plus fier était le plan directeur de Welthaupstadt Germania, son projet de reconstruction de Berlin. Dans ses mémoires, il écrit que ce projet devait servir à la fois de justification artistique et, en partie, d’alibi moral : Adolf Hitler lui avait offert, à lui, jeune artiste, la possibilité de concevoir des bâtiments « tels que le monde n’en avait jamais vus ». La Germania était disposée en grille autour de deux axes principaux inspirés de l’urbanisme romain, chacun long de plusieurs kilomètres, avec un damier de parcelles monumentales attribuées aux institutions et aux industries. Le projet était centré sur la Volkshalle, un hall de rassemblement aux proportions immenses — la voûte devait mesurer 300 mètres de large et 50 de haut — pouvant accueillir près de 200 000 spectateurs, soit dix fois le Madison Square Garden et quatre fois le Colisée romain. Son plan ressemble beaucoup au cénotaphe d’Étienne-Louis Boullée pour Sir Isaac Newton.
Ce n’est pas une coïncidence. Tout comme celui de Boullée, les plans de Speer n’ont jamais été construits. Dans les premières années de sa détention, Speer raconte qu’il a travaillé à une histoire de l’architecture de papier, des projets non construits, qui devait commencer par le cénotaphe. Ce n’est qu’après plusieurs mois de recherches et de prises de notes qu’il s’est rendu compte qu’entre ce qui avait été détruit par les bombardements alliés et ce qui allait être rasé dans le cadre du processus d’Entnazifizierung, de « dénazification », une telle histoire devait aussi s’appliquer à lui-même. Cette pensée, écrit-il, l’a laissé « étrangement ému ».

Plus que de ses projets, l’image de Speer dépend de sa contribution à la philosophie de l’architecture — la théorie de la Ruinenwert, la soi-disant « valeur de la ruine ». L’idée qui, selon certains rapports, aurait convaincu Hitler de confier ses projets les plus chers à un si jeune praticien, était que les bâtiments dignes d’un empire devaient être conçus à rebours de l’histoire, en partant de la nécessité qu’ils s’effondrent en ruines majestueuses plusieurs millénaires plus tard. L’histoire n’a pas offert la possibilité de tester la théorie de Speer dans la pratique — le Reich millénaire a duré douze ans et demi, ses bâtiments ont été détruits bien avant qu’ils n’aient eu le temps de se décomposer élégamment — mais une fois la poussière de démolition retombée, il restait parmi les décombres l’image d’un architecte joignant à son offre pour un appel d’offres public une aquarelle du XIXe siècle représentant des arbres noueux luttant pour le ciel au milieu des ruines d’un gratte-ciel. Cette image a, elle aussi, quelque chose de sentimental.
Mais le facteur le plus déterminant de l’image publique de Speer est probablement la fameuse promenade autour du monde qu’il entreprit en 1954, presque à mi-chemin de sa peine. Un jour, lassé par la solitude et la répétition de l’heure en plein air, Speer décida de l’animer avec fantaisie. Il mesure le périmètre de la cour et calcule combien de tours lui permettront de faire la route entre sa cellule et Heidelberg, sa ville natale. Il commence alors à marcher en rond, en gardant la trace de chaque kilomètre tout en évoquant mentalement le paysage qu’il traverse. Après avoir atteint sa destination, après avoir parcouru six cents kilomètres en cinq mois, il a décidé de continuer, étayant ses visualisations avec des carnets de voyage et des guides touristiques qu’il a commandés à la bibliothèque de la prison. Il part vers le sud-est de l’Asie en passant par la Turquie. Ses notes mentionnent l’architecture kazakhe, l’accueil chaleureux que lui ont réservé les villageois en Mongolie et l’ennui des semaines de trekking dans les forêts enneigées de Sibérie. Après avoir traversé l’Amérique du Nord, il s’est dirigé vers le sud. Au cours de ses douze années de prison, il a parcouru trente-deux mille kilomètres. Ils sont tous relatés dans son journal. Alors que sa peine est sur le point de prendre fin, il écrit à l’ami à qui il adresse ses notes de contrebande : Viens me chercher à 35 km au sud de Guadalajara, au Mexique.
L’histoire de la marche de Speer a fait l’objet d’un livre et d’une pièce de théâtre ; elle est mentionnée dans ses biographies et dans les entrées des encyclopédies. Elle a quelque chose de poétique, on pourrait dire d’inspirant : c’est l’histoire d’un homme dont l’imagination pouvait surmonter tous les obstacles, un prisonnier dans son corps qui est intimement libre grâce à son esprit. La force de cette histoire est telle qu’elle parvient à éclipser, au moins temporairement, les raisons pour lesquelles ce corps était en prison au départ. L’image latente qui subsiste après le flash est l’idée de la primauté de l’esprit sur la matière.
C’est le fil rouge — ou plutôt le squelette d’acier qui maintient ensemble le béton de l’image de Speer : l’idée que la volonté et l’esprit sont plus pertinents, et finalement plus puissants, que la réalité matérielle. La liberté mentale surmontant l’emprisonnement physique ; des projets non construits jugés dignes, non pas en dépit mais à cause de leur caractère non construit ; un monument dont l’importance ne réside pas dans la réalité matérielle mais dans le fantôme qu’il deviendra dans des milliers d’années.
C’est le fil rouge — ou plutôt le squelette d’acier qui maintient ensemble le béton de l’image de Speer : l’idée que la volonté et l’esprit sont plus pertinents, et finalement plus puissants, que la réalité matérielle.
Vincenzo Latronico
L’idée du triomphe de l’esprit sur la matière est un principe du modernisme : en architecture et dans la politique technocratique. De différentes manières, Speer a épousé les deux. Vers la fin de ses mémoires, il se rappelle avoir lu — et discuté avec Hitler, qui était livide d’envie — un profil de lui-même publié par The Observer en 1944 (c’est-à-dire par la presse d’un pays contre lequel il menait une guerre). Ce profil est étonnamment positif à certains égards. Citations de Speer :
« Speer est, en un sens, plus important pour l’Allemagne d’aujourd’hui que Hitler, Himmler, Göring ou Goebbels. […] Il est l’incarnation même de la « révolution managériale ». […] Il est tout à fait l’homme moyen qui a réussi, bien habillé, civil, non corrompu, très bourgeois dans son style de vie, avec une femme et six enfants. […] Il symbolise plutôt un type qui prend de plus en plus d’importance : le technicien pur, le jeune homme brillant sans classe et sans arrière-plan, sans autre but originel que de faire son chemin dans le monde et sans autre moyen que sa capacité technique et de gestion. [Les gens de ce type] vont très loin aujourd’hui. C’est leur époque ; nous pouvons nous débarrasser des Hitler et des Himmler, mais les Speer, quoi qu’il arrive à cet homme particulier, resteront longtemps avec nous. »
Dans cette optique, Der Architekt montre quelque chose de bien plus large que la figure historique de Speer. Il montre un homme, un architecte, qui a structuré sa vie autour de la primauté de l’esprit sur la matière. Il le montre comme n’ayant pas de visage, ce qui pourrait signifier qu’il pourrait en représenter beaucoup d’autres. C’est un homme particulier, l’incarnation d’un changement social profond, un homme d’avenir. Il le montre déchu.
Pourquoi a-t-il chuté ?