« Weimar est la tragédie de l’Europe », une conversation avec le philosophe José Luis Villacañas
Figure majeure de la pensée politique espagnole, José Luis Villacañas est revenu avec nous sur la signification de l'épisode de la République de Weimar. Pour tenter de cerner le politique en Europe aujourd'hui, il croise les pensées de Weber, Schmitt, Blumenberg, Polanyi ou encore Kojève. Un riche entretien pour découvrir l'auteur d'Imperiofilia.
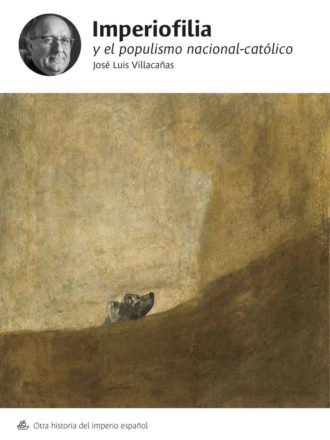
Nous voudrions profiter de cet échange pour vous poser quelques questions sur la crise actuelle en Europe 1. Il y a un siècle exactement, en 1919, Max Weber a donné une conférence fondamentale, « La politique comme vocation », dans l’antichambre de la débâcle allemande. Comme vous êtes l’un des lecteurs espagnols les plus qualifiés sur cet ouvrage, nous aimerions commencer par là : que dirait Weber de notre présent, compte tenu de la thèse sur le charisme développée dans « La politique comme vocation » ?
Je ne pense pas que Weber aurait pu parler du charisme aujourd’hui dans les mêmes termes que ceux de 1919. Déjà en son temps, il cherchait à distinguer différentes formes de charisme et à trouver son sens spécifique à l’époque des masses. Face à l’honoratiore et à l’homme charismatique à l’âge du génie, il invente le concept de charisme anti-autoritaire, qui convient à l’âge des masses. J’ai l’impression que Weber, comme l’a très bien vu Gramsci, est le théoricien qui a dégagé l’appareil conceptuel dont on a besoin pour saisir l’époque du fordisme et des masses industrielles. Il s’est ainsi laissé inspirer par l’américanisme en comprenant que c’était là que se déroulaient tous ces phénomènes de manière exemplaire. Le charisme démocratique et anti-autoritaire était celui du président des États-Unis. Or, ce charisme avait des formes de communication très précises : discours direct devant les masses, rhétorique parlementaire, écriture dans la presse périodique.
Mais les formes de communication contemporaines neutralisent presque toujours la présence. Les personnages qui apparaissent dans les messages et les discours sont simplement des figurants. Ils incarnent une réalité : la communication s’adresse aux hommes, et ces figurants ne sont en aucun cas des êtres humains. Il est impossible de conserver le charisme dans ces conditions. La formation de l’entourage, qui caractérise finalement le charisme, est aujourd’hui donnée aux robots qui reproduisent des messages sur le net, par conséquent, à des forces anonymes et invisibles, des puissances anti-charismatiques. Nous ne devons pas oublier que le charisme est lié à la dimension personnelle, indépassable pour l’autorité et de la politique. Aujourd’hui, tout cela est désactivé. Cette désactivation s’est faite au service de la manière tout aussi cachée et anonyme dont les affaires politiques sont gérées. Cela fait de la forme démocratique actuelle une farce qui maintient un vieux théâtre dans la dramaturgie duquel plus personne n’arrive à croire. C’est comme la messe aujourd’hui dont on pourrait dire qu’elle conserve un rituel vide sans parvenir à produire une quelconque forme d’émotion dans les âmes.
Je ne pense pas que Weber aurait parlé aujourd’hui du charisme comme d’une imposture. L’énorme médiation de la technique, que l’on retrouve déjà dans la propagande nazie, une quinzaine d’années après la conférence de Weber, entrave en fait ce concept. Je pense qu’il vaudrait mieux le réduire à des éléments de sincérité, de persuasion, de distinction, d’humilité, tout ce qui a trait à la sincérité. Mais même dans ce cas, il est très difficile pour ce genre de qualités de faire son chemin à l’ère de Twitter.
« Les formes de communication contemporaines neutralisent presque toujours la présence. Les personnages qui apparaissent dans les messages et les discours sont simplement des figurants. Ils incarnent une réalité : la communication s’adresse aux hommes, et ces figurants ne sont en aucun cas des êtres humains. Il est impossible de conserver le charisme dans ces conditions. »
José Luis Villacañas
Vous avez dit que le présent, comme Weimar, était dominé par l’indigestion du passé et qu’il était donc nécessaire d’avoir une généalogie qui résoudrait les contradictions de la vie historique. En reprenant les termes d’Alexandre Kojève, pourrait-on affirmer que nous vivons dans des villages post-historiques, ce qui justifierait cette analogie avec la période de Weimar ?
Oui, il s’agit du problème des époques et des seuils d’époque. Cette question a été abordée par Blumenberg 2 et elle fonctionne bien lorsque le seuil de l’époque est la Révolution copernicienne. Mais quand nous voulons être plus fins et plus concrets dans l’analyse, quand nous voulons marquer les époques de la modernité, nous réalisons que le critère de Blumenberg, l’irréversibilité, ne fonctionne pas du tout. C’est ce qui ressort clairement de l’analyse du Sattelzeit de Koselleck 3, par exemple. Nous réalisons, comme l’ont vu les savants de l’Ancien Régime, que beaucoup de choses ont survécu et ont été introduites dans la Sattelzeit. C’est pourquoi je pense que l’analyse géologique que Koselleck a adoptée dans Les Strates du temps (2000) est plus productive. Bien sûr, la succession de ces strates géologiques est irréversible, mais toutes les strates peuvent fonctionner et interagir entre elles pour construire le terrain sur lequel nous nous déplaçons.
Je ne crois pas à ce propos aux diagnostics post-historiques. C’est typique d’une époque qui jouit d’une certaine stabilité inertielle. Dans notre cas, comme vous l’avez mentionné, cette stabilité découle du sentiment profond de réussite historique qui a accompagné l’Europe de l’après-guerre, et dont Kojève croyait qu’elle était l’esprit objectif. Maintenant, dès que cette stabilité est diluée et que les illusions sont dissoutes, nous retournons à l’histoire. Weimar est pertinent parce qu’il montre à quel point la crise peut éclater et entraîner toutes les images de stabilité. C’est donc une assurance pour nous rappeler la condition historique insurmontable de nos sociétés. C’est dû au caractère imprévu de la révolution moderne qui demeure son fondement d’origine et son destin. Il est en effet certain que nous vivons à l’ère des effets imprévus. Et nous ne l’abandonnerons pas facilement parce que l’effet imprévu, qui ne peut cesser de l’être, est le capitalisme. Tant qu’il y aura du capitalisme, nous vivrons dans l’époque historique moderne. Et dans cette époque, s’accumulent les strates du fordisme, de la social-démocratie, de l’époque de l’État et finalement du néolibéralisme, qui est en tension profonde avec l’époque précédente.
« Tant qu’il y aura du capitalisme, nous vivrons dans l’époque historique moderne. Et dans cette époque, s’accumulent les strates du fordisme, de la social-démocratie, de l’époque de l’État et finalement du néolibéralisme, qui est en tension profonde avec l’époque précédente. »
José Luis VillacañAs
Weimar est important parce qu’il a montré les effets incroyables du capitalisme et de sa destruction créatrice sur la sphère politique et l’énorme capacité d’impact du passage de la politique à la sphère absolue, conséquence de l’incapacité à prévoir les effets sociaux du capitalisme. Cette structure, qui est la structure moderne, n’a pas changé et c’est pourquoi nous continuons dans l’époque historique, bien que celle-ci soit de plus en plus complexe à mesure que s’accumule les héritages politiques et que ceux-ci pèsent sur les appareils psychiques. Comme nos grands-parents de Weimar. C’est pourquoi cette époque est si importante.
Elle l’est aussi parce que Weimar montre (et c’est pourquoi Weber est vraiment décisif) que nous pouvons diminuer les tragédies si nous maintenons la social-démocratie comme base d’un État de droit engagé. Inversement, nous ne pouvons pas rêver de maintenir cet État sans social-démocratie, c’est-à-dire sans socialiser les bienfaits du capitalisme. Weimar est un avertissement jeté à la bourgeoisie capitaliste. S’ils ne veulent pas socialiser les profits, ils devront chercher des protecteurs. Et Weimar nous avertit et nous démontre que ces protecteurs (comme Hitler) coûtent beaucoup plus chers que la socialisation des profits. C’est pourquoi Weimar est une assurance de conscience historique qui nous évite de tomber dans les illusions de la post-histoire. Cela en fait une expérience inoubliable.
« Weimar est une assurance de conscience historique qui nous évite de tomber dans les illusions de la post-histoire. Cela en fait une expérience inoubliable. »
José Luis VillacañAs
Après ces deux premières questions, nous voulions nous attarder sur une question fondamentale que vous avez abordée tout au long de votre carrière académique, en particulier dans L’intelligence hispanique (2017), l’idée de crise anthropologique des élites : les élites européennes ont-elles abdiqué leur destin historique ?
Avec cette question, nous continuons à nous déplacer dans l’orbite de Weber. En fait, la question est très complexe et difficile. Au tout début du premier volume de L’intelligence hispanique, je mentionne la citation de Schmitt selon laquelle l’élite est ce groupe social qui empêche généralement l’écriture de sa biographie. Les élites hispaniques, qui, à quelques exceptions près, n’ont pas d’histoire propre et n’ont pas permis qu’elle soit écrite, l’ont mise au premier plan. C’est le résultat d’un rétrécissement des élites qui est très caractéristique de l’Espagne. Ici, il n’y a eu que des dirigeants politiques qui ont utilisé le pouvoir de l’État pour améliorer leurs possibilités économiques, car nous avons toujours eu des difficultés à construire une économie productive sans que les pouvoirs politiques se soient comportés comme des vautours. Ces élites politiques, plutôt violentes, ont donc pris sur elles d’empêcher l’émergence d’élites opérationnelles dans d’autres domaines avec lesquels elles auraient dû être d’accord et se répartir une richesse très maigre. Pour cette raison, elles n’ont pas permis qu’existent des élites économiques autonomes ou des élites juridiques indépendantes. Seule l’Église a engendré une élite alternative avec une indépendance relative, consciente de sa fragilité. Dans le reste de l’Europe, la situation est un peu plus complexe car, à tout le moins, il y a eu trois élites : les élites économiques, les élites politiques et les élites juridiques, qui furent d’abord religieuses avant que ne se mette en place un processus de sécularisation. La manière dont ces élites ont été ordonnées dépend des institutions qui les ont accueillies. Le pacte ou le débat entre ces élites est le propre des Parlements et, là où ils ont existé, ces élites diverses ont été respectées dans leur leadership, comme le montre l’exemple caractéristique de la Grande-Bretagne.
Nous pouvons ainsi dire que la modernité est la tension convenue des élites économiques, politiques et intellectuelles. Lorsqu’un nouvel accord a été conclu, une révolution interne à la modernité était inévitable, comme ce fut le cas en France.
Aujourd’hui, après le processus du fordisme et certainement à l’ère de l’économie financière virtuelle, la tension entre les élites économiques et politiques, ainsi que les élites culturelles, a connu des formes inhabituelles car, si le fordisme a besoin de l’État, il n’est vraiment pas certain que ce soit le cas de l’économie financière virtuelle. Bien évidemment, le passage continu des élites culturelles à l’industrie du divertissement soutient le retrait des élites culturelles classiques de l’ère de la responsabilité webérienne. La conséquence en est que la lutte de l’élite prend maintenant la forme politique qui correspond à ce que Marx appelait la véritable subsomption. Cela implique l’aspiration de la sphère économique à devenir la sphère absolue et donc la réduction de la sphère politique à une spectralité. La sphère de la virtualité est fermée comme un système absolu, avec des monnaies virtuelles, la délocalisation des processus industriels, la numérisation de la culture et de la mémoire et la gestion des grandes données d’information produites par le monde virtuel lui-même. Mais la strate du fordisme, de la matérialité, de l’industrie, continue à fonctionner, parce que, dans la modernité, les strates restent actives. Et cela génère des demandes populaires qui exigent que la sphère politique surmonte sa fictionnalité. Dans la lutte entre matérialité et virtualité, nous avons le terrain de la lutte des élites du futur, la lutte des couches et des époques.
« La sphère de la virtualité est fermée comme un système absolu, avec des monnaies virtuelles, la délocalisation des processus industriels, la numérisation de la culture et de la mémoire et la gestion des grandes données d’information produites par le monde virtuel lui-même. Mais la strate du fordisme, de la matérialité, de l’industrie, continue à fonctionner, parce que dans la modernité les strates restent actives. »
José Luis Villacañas
Comme toujours, il s’agira de voir si ces élites sont capables de faire un quelconque pacte. Weimar, encore une fois : si la modernité ne parvient pas à ordonner ses strates, cela engendrera des mouvements sismiques terribles. Pensez aux millions de corps qui seront affectés dans leur chair par le changement climatique. Face à eux, des millions de spectateurs numériques contempleront la catastrophe. C’est un scénario qui rappelle le plaisir des sauvés regardant les condamnés en enfer dans les peintures de l’Apocalypse. Cependant, personne ne sait où finiront les damnés de demain et personne ne croit vraiment en ce que ces représentations présentaient : la culpabilité des condamnés. La culture néolibérale n’est pas assez forte pour se substituer à l’Église dans cette tâche.
« Pensez aux millions de corps qui seront affectés dans leur chair par le changement climatique. Face à eux, des millions de spectateurs numériques contempleront la catastrophe. C’est un scénario qui rappelle le plaisir des sauvés regardant les condamnés en enfer dans les peintures de l’Apocalypse. »
José Luis Villacañas
Sans vouloir entrer dans les arguments spécifiques de votre nouveau livre Imperiofilia (2019), on pourrait dire que l’un des moyens de comprendre la crise des élites espagnoles passe par leur imaginaire impérial catholique en fonction d’un patrimonialisme d’État. Un imaginaire impérial qui a empêché la consolidation d’un pouvoir constituant moderne, développant des formes d’endiguement très efficaces contre toute forme de réformisme politique : l’Espagne, vis-à-vis de ses élites, est-elle une exception dans le contexte européen ?
L’imaginaire hispanique impérial est une élaboration théorique très réduite et dépend du contenu spécifique de la mentalité de la maison d’Autriche. La seule véritable trace matérielle de cet imaginaire est la salle ellipsoïdale du Musée du Prado où sont exposées les principales peintures de Velázquez sur les différents personnages de cette maison. Il reste un vestige de sacralité, d’austérité et de rois sacrifiés, comme ce portrait de Philippe IV où la golille semble avoir coupé la tête du roi et l’avoir offert sur un plateau (voir ci-dessous). Cette idéologie précise que la maison d’Autriche accompagnera l’Église catholique jusqu’à la fin des temps, représentant alors les deux institutions fondamentales de l’Église visible, toutes deux capables de se connecter avec la Jérusalem céleste. C’est le fondement de leur providentialisme. Toutefois, il s’agit d’un providentialisme sur le choix de l’Assemblée, qui n’implique pas de choix des personnes, parce que les Habsbourg sont des puissances déracinées et sans terre propre. Par conséquent, leur capacité d’adaptation au changement et à la nouveauté historique est très limitée. Une communauté nationale ne peut pas être construite sur cet imaginaire, puisqu’elle n’a pas été effectivement construite. Pour le reste, sa structure institutionnelle est très simple et limitée, empruntée à la couronne d’Aragon, le système des vice-rois, fonctionnel, avec une administration fébrile. Cependant, ce système laisse libre cours à un certain nombre de réalités qu’ils doivent équilibrer afin de maintenir leur capacité d’arbitrage. Cela a permis l’identification coloniale à la Couronne, parce que c’était une assurance de stabilité dans la hiérarchie sociale. Par conséquent, nous pouvons dire que, pendant que la modernité se dirigeait vers le prestige du changement, la construction du pouvoir hispanique a été redressée vers la formation de la stabilité, la manière dont l’éternité se reflète dans le temps.

Bien sûr, les élites qui peuvent émerger d’ici sont réactives à tout changement, et c’est pourquoi elles doivent rester liées, consciemment ou inconsciemment, à cet imaginaire. Cela ne veut pas dire qu’elles n’ont pas la capacité de changer. Cependant, ce changement doit être introduit d’une manière imperceptible sans remettre en cause les grands programmes de stabilité. En réalité, les deux dispositifs de sélection des changements historiques, toujours contrôlés, sont la loi historique et l’orthodoxie catholique. De cette façon, nous avons toujours une adaptation aux changements historiques régis par cette forme spécifique de révolution passive. L’exemple le plus criant est celui où la bourgeoisie conteste le droit historique des propriétés par les ordres religieux et les élimine de la possession terrienne. Cette violation de la loi historique doit se faire dans le cadre de l’orthodoxie catholique et pour cette raison elle doit être compensée en donnant éduquant les Espagnols aux mêmes ordres religieux. Ces deux éléments, le droit historique et l’orthodoxie catholique sont méta-constitutionnels et aucun pouvoir constituant du peuple ne peut les modifier. Ainsi, le monde historique tout entier se glisse au cœur de tout essai constitutionnel.
« Ces deux éléments, le droit historique et l’orthodoxie catholique sont méta-constitutionnels et aucun pouvoir constituant du peuple ne peut les modifier. Ainsi, le monde historique tout entier se glisse au cœur de tout essai constitutionnel. »
JOsé Luis Villacañas
Pendant longtemps, la royauté, l’aristocratie, l’Église et les ordres ont été considérés comme le véritable Verfassung que le peuple ne pouvait pas modifier. Cette stratégie de domination a été très efficace et va jusqu’à Franco, la révolution passive capable d’établir le fordisme en Espagne. Aujourd’hui, ces élites veulent réaffirmer qu’il y a quelque chose que les Espagnols ne peuvent décider : leur catholicité traditionnelle. Comme toujours, ils doivent adapter les changements de l’ère néolibérale à l’orthodoxie catholique et c’est la mission des partis conservateurs et de leurs intellectuels. L’école de Salamanque 4, véritable fondatrice du libéralisme économique, de la mondialisation, de la valeur de la monnaie et de la nécessité de lutter contre l’inflation, est fondamentale à cet égard. La lutte actuelle des élites – qui oppose Vox 5 et le PP à Ciudadanos – doit être situé dans ce champ. Bien sûr, tous les trois partagent un imaginaire espagnol, et c’est pourquoi leurs électeurs sont transférables. Mais les Ciudadanos sont des libéraux et non pas des défenseurs des valeurs catholiques. Et c’est là que réside le point de divergence. Cela se voit dans l’hostilité envers Ciudadanos d’un journal numérique comme Hispanidad. De sorte que les gens modestes d’Espagne préfèrent le PP à Ciudadanos, parce que le néolibéralisme du PP sera toujours un peu plus tempéré par leur catholicisme, comme on l’a vu avec Rajoy. Cela n’a rien d’exceptionnel.
Quand vous regardez profondément dans d’autres pays, vous voyez aussi leurs singularités. La modernité n’est pas une voie normative réglementée, mais un processus d’affirmation de soi. Et chacun s’affirme avec ce qu’il a sous la main. Le problème des élites hispaniques, c’est qu’elles se sont affirmées dès le début avec des outils archaïques, parce que ce n’est qu’ainsi qu’elles se sentent en sécurité pour contrôler politiquement le processus du changement.
Revenons à Weimar : nation tardive, fracture entre État et peuple, entre ouvrier et soldat. Vu du présent, vaut-il la peine de préserver l’idée de l’Europe en tant que force politique pour réorganiser la situation ? Nous avons vu qu’il y a quelques semaines, Massimo Cacciari a proposé « Dante » comme référence pour articuler un mythe vagabond, quelque chose de similaire à ce que Monica Ferrando a récemment proposé dans son livre Il regno errante (2019) : l’Espagne peut-elle offrir un autre mythe pour l’Europe ?
Weimar est la tragédie de l’Europe. Sa chute a entraîné la chute de la démocratie dans toute l’Europe. Nous, les Espagnols, nous le savons très bien. Avec la république de Weimar vivante, la république espagnole aurait survécu et la république française aurait sans doute agi différemment. Bien sûr, cette conversation sur le mythe de l’Europe m’a emporté. Mais je m’inscris ici dans le sillage de Blumenberg. Le mythe ne peut être discipliné par le dogme, et la prolifération des mythes ne peut être évitée. Même d’un point de vue existentiel, nous ne pouvons pas parler d’un mythe humaniste. La pluralité du mythe est inévitable, aussi irréductible que les sphères d’action, et nous ne pouvons pas nous laisser emporter par le mythe unitaire de Dionysos. Depuis Nietzsche, la philosophie européenne du XXe siècle s’est nourrie de ce mythe. La généalogie de ce mythe est très curieuse et bien sûr elle est liée à la fin du mythe chrétien, bien que d’une certaine manière elle en vienne à remplir la même fonction, la réserve contre l’affirmation de soi du singulier, refusant la possibilité freudienne de s’affirmer de manière mesurée. Quand on voit que ce mythe de la dissolution de la vie et de sa régression vers des formes archaïques, ne peut plus tenir parce qu’on en voit les effets de trop près, on cherche d’autres mythes, mais ils ne peuvent être que partiels. Je ne crois pas à un mythe utopique comme celui de Monica Ferrando, ni à un mythe qui ne peut être évité par téléologie, le grand mythe chrétien de la Divine Comédie. En ce qui concerne tous les idéaux et leur puissance dévastatrice, j’ai proposé le mythe d’Épiméthée, car il convient à la nature tragique, prométhéenne et destructive de l’Europe. En réalité, je crois que Cervantès a déjà projeté une ambiance éphémère sur son Don Quichotte et cela nous dit qu’on ne peut configurer aucun sur-moi sans humour. Freud ici est décisif et il est surprenant que son analyse de Don Quichotte ne soit pas aussi célèbre que celle d’Œdipe. Bien sûr, son herméneutique des deux mythes vise à éviter la tragédie et je crois profondément que l’Europe ne peut assumer une expérience tragique de plus.
Elle a déjà causé trop de douleur dans le monde pour le faire.
« En ce qui concerne tous les idéaux et leur puissance dévastatrice, j’ai proposé le mythe d’Épiméthée, car il convient à la nature tragique, prométhéenne et destructive de l’Europe. »
José Luis Villacañas
Poursuivons sur cette voie de la géopolitique européenne. Dans un récent entretien 6 avec Wolf Lepenies, il a déclaré que, compte tenu des nouvelles configurations du sentiment anti-européen, dominant de la Russie à la Hongrie, en passant par l’Italie et même la Chine, la tentative de forger un empire méditerranéen est impossible. Il devient donc un peu anachronique de parler d’un empire latin sous la tutelle d’une Rome pulcherrima : s’agit-il vraiment de prétentions impériales en Europe ou d’un simple geste théâtral ?
Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un geste entièrement théâtral, car il a une substance historique. Toutefois, je crois qu’il s’agit d’un geste tout simplement erroné parce qu’il ne reflète pas de manière adéquate cette même substance historique. Les grandes fractures européennes sont apparues lorsque l’on n’a pas été capable de trouver une manière adéquate de tisser des liens entre le Nord et le Sud. C’est ce que l’Empire carolingien et le Saint Empire germanique romain ont accompli. L’administration de cet héritage par l’Espagne a été un désastre parce que les puissances hispaniques n’étaient pas préparées à quelque chose d’aussi complexe. C’est pourquoi les Habsbourg ont dû se diviser entre les maisons de Vienne et de Madrid et c’est pourquoi ils n’ont pas pu maintenir le tissu des villes et des terres qui reliaient Naples aux embouchures du Rhin, en passant par Milan, l’épine de l’Europe.
Si cela n’est pas bien tissé, il ne sera pas possible d’ajouter au projet européen ni le catholicisme slave, ni le monde orthodoxe non russe, de la Grèce à l’Ukraine, la frontière habituelle de l’Empire. C’est ce que les empereurs espagnols ne comprirent pas : qu’avec les catégories impériales hispaniques, ce monde ne peut être pensé. L’échec historique de Charles Quint, qui est la clé de l’échec historique de la monarchie autrichienne, vient de là. Mais les problèmes structurels sont les mêmes, aggravés par le passage de l’histoire. Dans le Sud de l’Europe, la tension entre la dimension germanique et la dimension romaine de l’Empire n’a jamais cessé. Quand Goldene Bulle trace la route que l’empereur doit prendre pour être couronné à Rome, les villes gibelines et anti-papistes sont très bien choisies, mais malgré tout il est recommandé à l’empereur d’amener son propre cuisinier pour éviter le poison.
« Rome a donc toujours été une puissance anti-impériale, ce que les empereurs espagnols n’ont pas compris non plus. »
José Luis Villacañas
Bien sûr, le Pape, sauf à l’époque des Francs et des Ottons, résista autant qu’il le put aux couronnements, et bien sûr il poussa dès qu’il le put le dispositif politique et institutionnel des royaumes pour détruire la concurrence de l’Empire. Rome a donc toujours été une puissance anti-impériale, ce que les empereurs espagnols n’ont pas compris non plus. Mais au Moyen-Âge, Rome pouvait se présenter comme une puissance universelle alternative à l’Empire. Aujourd’hui, avec la fracture de la Réforme, une telle tâche ne peut plus être proposée. De sorte qu’un empire latin serait un empire catholique. Les Hispaniques et les Latinos auraient beaucoup de poids dans ce projet. Cela dit, pour nous, ce serait un moyen de soutenir les élites qui nous gouvernent depuis des siècles et je ne vois aucune raison de les renforcer. Je préfère le monde allemand pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que matériellement, nous ne pouvons pas comprendre le tissu industriel du Sud sans l’Allemagne ; deuxièmement, parce qu’ils ont impulsé un processus de sécularisation qui a fermement établi l’œcuménisme en surmontant la division entre réformés et catholiques, ce à quoi l’Église du Sud de l’Europe résiste encore avec des privilèges considérables ; enfin, parce que l’Allemagne a une politique engagée pour surmonter l’antisémitisme, ce qui l’incitera à combattre l’islamophobie, et je doute que cela sera le cas dans les pays du Sud de l’Europe. Je pense donc que le programme de l’empire latin, qui était un événement anti-allemand de Kojève, est une mauvaise idée pour le moment. Au moins pour le sud. Je pense, au contraire, qu’il obéit à une résistance historique et substantielle et qu’il doit être considéré comme un symptôme de la part du nord. Cela devrait l’inciter à générer des politiques de reconnaissance et de respect du Sud afin d’éviter que ces symptômes ne s’aggravent. Une chose ne fait aucun doute : ces différences existent, et un effort de compréhension mutuelle est nécessaire sans humiliation inutile. Il y en a eu assez.
« Je pense que le programme de l’empire latin, qui était un événement anti-allemand de Kojève, est une mauvaise idée pour le moment. »
José Luis Villacañas
Un autre grand interprète de la crise constitutionnelle de Weimar était Carl Schmitt : faut-il récupérer Weber comme antidote contre Schmitt pour déplacer la centralité de la prise de décision politique vers les mécanismes de légitimité ? Peut-on continuer à parler du concept de « légitimité » à un moment qui semble être tombé dans la production infinie de la valeur ?
Comme on le sait, les auteurs qui ont réfléchi sur Weber dans les années 1960 y ont vu l’origine du nationalisme allemand et l’ont placé à l’origine des pathologies allemandes qui ont ensuite eu lieu. Aujourd’hui, nous commençons à voir que ces positions étaient un excès produit par la pression de la culpabilité qui est tombée sur la culture allemande. Je pense à Mommsen et à Löwith, par exemple. Mais si nous nous adressons à des analystes qui étaient proches des faits, nous découvrons qu’ils pensaient le contraire. Par exemple, Helmuth Plessner a considéré dans ce qu’il a appelé plus tard La Nación tardía (1959) que la généalogie la plus précise du nazisme était la peur de la bourgeoisie qui cherchait sans condition un protecteur contre la révolution marxiste. Habermas lui-même a utilisé l’argument dans sa critique de ce livre mémorable. Mais c’était exactement le diagnostic de Weber sur l’évolution probable de l’Allemagne vers la dictature autoritaire des cercles proches du Kaiser et la clé de sa confrontation avec Ludendorff. La continuité entre Weber et Carl Schmitt doit donc être clairement niée. C’est une légende que Schmitt lui-même a parfois utilisée, bien qu’à d’autres moments il ait eu la décence de reconnaître qu’il avait choisi une autre voie très éloignée de ce qu’il appelait « l’ascèse scientifique » de Heidelberg, en référence directe à Max Weber. On peut le voir dans sa note autobiographique écrite pendant les années de Nuremberg, dans laquelle il recrée l’Université de Berlin de 1907. Il faut ici opposer l’« ascèse scientifique » à l’« aventurier intellectuel » qu’était Schmitt. Löwith lui-même, dans son premier article sur l’opportunisme de Carl Schmitt, a du mal à mettre Weber en continuité avec Schmitt. On peut dire n’importe quoi sur Weber, mais pas qu’il était opportuniste ou qu’il a maintenu la flexibilité de Schmitt.
En ce qui concerne Weimar, Weber s’est toujours fixé un objectif : la socialisation, qui impliquait une rationalisation de l’économie par l’État, guidée par un pacte clair entre la bourgeoisie progressiste et les socialistes. Cela n’a rien à voir avec les objectifs recherchés par Schmitt, une neutralisation de la sphère économique libérale protégée par un État autoritaire. Weber a parié sur le strict respect de l’État de droit, tandis que Schmitt a parié sur une violation de la loi menant à un changement constitutionnel. Bien sûr, Weber venait d’une culture où le nationalisme était la référence centrale. Cependant, il était bien conscient des mutations que l’État-nation allemand devait adopter à l’ère de l’industrialisation, du fordisme et de l’économie mondiale. Il s’en préoccupait évidemment, mais il était bien conscient qu’il s’agissait d’une nouvelle voie. En y regardant de plus près, on se rend compte que Weber aspirait à organiser une constitution très semblable à celle des États-Unis, à celle qui a permis le New Deal, quelque chose de très semblable à ce que Weber pensait avec le programme de socialisation. Bien sûr, pour lui, un président de plébiscite soumis à la loi, en tension avec un pouvoir législatif puissant qui le soumettrait au contrôle, mais avec la capacité de faire évoluer le droit dans un sens matériel (et pas seulement formel), offrait le schéma d’une légitimité démocratique, qui, selon Stefan Breuer, était la formule que Weber cherchait pour dépasser la simple notion de légitimité formelle-rationnelle.
« Weber a parié sur le strict respect de l’État de droit, tandis que Schmitt a parié sur une violation de la loi menant à un changement constitutionnel. »
José Luis Villacañas
Nous sommes certains que c’est la voie que Weber cherchait dans les jours difficiles entre l’écriture de Parlement et Gouvernement et La Nouvelle Allemagne, ou Le président du Reich. La légitimité est un concept qui, à mon avis, est toujours opérationnel, mais il doit être compris dans toute son ampleur. La légitimité a besoin d’un contexte de validité des ordres de l’État et ce cadre de validité est quelque chose qui se comprend mieux à partir de la notion d’hégémonie. Si on lit bien Gramsci, l’hégémonie a peu à voir avec le pouvoir concret, la formation des majorités ou un système particulier de domination. Il s’agit plutôt des principes civilisateurs qui donnent de la validité à certaines orientations des institutions en général. La socialisation en tant que programme assumé par les institutions étatiques aurait été le fondement de l’hégémonie. Malheureusement, la race ou la classe ont été imposées, ce qui, si l’on y regarde bien, ne peuvent pas être de véritables aspirants à l’hégémonie parce qu’ils ne peuvent offrir un principe civilisateur général. D’où leur violence extrême. Ne pas voir l’hégémonie dans le contexte de la validité historique d’une proposition et l’interpréter comme une façon d’exercer la domination est l’une des plus graves confusions dans lesquelles sont tombées certaines positions qui prétendent être post-hégémoniques. Le faire précisément à un moment où la lutte se situe entre l’option néolibérale, qui est la pure domination, et une forme de validité générale pour nos sociétés, c’est se désarmer d’un outil central dans la construction de l’avenir et de la compréhension de l’historicité à laquelle nous sommes encore soumis. Toutes les formes dérivées de la pensée post-hégémonique impliquent un désancrage radical de l’historicité radicale dans laquelle nous sommes et un engagement à l’absolutisme du présent. De ce pari naît la production infinie de valeur, dernière forme de modernité comme affirmation existentielle immédiate de soi. Mais les groupes humains ont survécu grâce à un regard capable de transcender cette immédiateté. Les groupes qui adoptent ce regard sauront distinguer entre la production infinie de valeur et la conquête d’une validité historiquement conditionnée et donc capable de contempler l’avenir. Et cela produira une légitimité.
Hégémonie ou souveraineté ? Dans son dernier livre, Sovranità (2019) Carlo Galli corrige la nouvelle souveraineté de droite en Europe en pariant sur une souveraineté construite à partir d’un nouveau « moment Polanyi » comme volonté générale contre les faiblesses de la domination économique. D’autre part, à d’autres occasions, vous avez traité un problème convergent, le fédéralisme : peut-il aujourd’hui être constitué comme une solution nationale ou post-nationale aux problèmes que connaît l’Europe ?
Je sympathise avec les positions de Galli, un penseur que j’ai suivi de près et que j’ai eu l’occasion d’écouter à plusieurs reprises. Et bien sûr, je partage la pertinence de Karl Polanyi, l’un des vrais adeptes du renseignement armé, avec les plans et les façons de voir de Weber. Son pari doit en quelque sorte de reconnaître une dépendance vis-à-vis du dernier Schmitt, et peut-être de la contribution la plus précieuse, celle du Nomos de la Terre. Bien sûr, Polanyi doit être mis à jour. Ses critiques de l’utopie du marché sont décisives, mais elles ne tiennent pas compte de la situation actuelle, dominée par l’économie financière. De la même manière qu’en son temps se libérer de l’utopie du marché était émancipatoire, se libérer aujourd’hui de l’économie financière de l’ère numérique est un objectif émancipateur sur lequel il devrait y avoir un consensus hégémonique. C’est sur elle que nous devons reposer les dimensions de validité et de légitimité. Nous ne pouvons pas dépendre dans notre vie des décisions de fonds d’investissement anonymes, réalisées par des êtres humains non représentatifs. Cependant, il semble que l’État n’ait plus la force (peut-être ne l’a-t-il jamais eue) de se libérer de ces flux de capitaux, qui affluent dans les paradis fiscaux. Il n’y a pas d’émancipation humaine, de liberté, de dignité, d’égalité minimale, si nous ne sommes pas capables de nous en libérer. D’où la validité de la notion de grand espace de Schmitt et la nécessaire pluralité de ces grands espaces. Cela nous conduit à un ordre mondial qui commence à se dessiner nettement. La dimension mythique du Nomos est liée à ce que nous pouvons appeler les piliers de la Terre : la Russie, l’Inde et la Chine. Face à ces piliers, les États-Unis ressentent encore l’anxiété de l’avenir, car ils ne savent pas ce que deviendra l’Amérique. C’est ce qui se révèle de Trump et de la haine des Hispaniques. Tout le reste est fragile, et craque aux interstices.
« L’Europe du Nord doit comprendre que soit l’Europe s’engage dans un processus de fédéralisation, soit il n’y a aucune issue. »
José Luis Villacañas
C’est là que nous intervenons sur la question du fédéralisme. À l’exception de ces grands espaces, le reste devra être ordonné par le gouvernement fédéral parce qu’il est conditionné par une trop longue histoire de pouvoirs étatiques en difficulté. Il n’y a pas d’autre moyen de créer de grands espaces dans le reste du monde que la dynamique fédérale. Cela signifie que les choix impériaux deviendront de plus en plus difficiles. Pour revenir à la question précédente : l’Europe du Nord doit comprendre que soit l’Europe s’engage dans un processus de fédéralisation, soit il n’y a aucune issue. Bien sûr, Carl Schmitt ne le comprenait pas, car il continuait à s’accrocher au concept du Reich avec une forte domination interne. Mais il est évident que cela ne peut se faire de manière démocratique. Nous ne pouvons donc plus revenir au monde dans lequel le Sud était déprimé par le sens de la mort du baroque alors que le Nord saxon se livrait à l’activisme enthousiaste des puritains. Une fédération implique une sorte de construction d’une société civile européenne commune, ce qui implique de les changer tous un peu. J’invoquerais ici les diagnostics de mon livre La Nation et la Guerre, et la mise à jour de la proposition kantienne. C’est aussi le défi pour l’Amérique latine, indépendamment des pressions exercées par les États-Unis, qui ne cesseront de croître à l’avenir. Nous connaissons les réflexes des empires en décomposition. Là-bas, le dilemme est la subalternité radicale des États-Unis ou un processus de fédération avec ouverture à d’autres grands espaces. Mais l’Amérique latine ne gagnera rien contre cette subalternité plurielle si elle n’a pas un concept propre et une manière fédéralisante de la faire avancer. L’expression, que j’utilise souvent, d’Euroamerica – dont je connais les limites – serait le moyen d’équilibrer de manière non impériale les trois grands espaces qui ont émergé de l’empreinte des Lumières : Amérique du Nord, Amérique latine et Europe. Quoi qu’il en soit, ce monde pluriel – ce que Schmitt n’a pas vu non plus – aura des moyens non impériaux de promouvoir l’unité du monde, des relations très complexes dans plusieurs directions, des associations transversales accrues. Cependant, je pense que nous devrions exclure les associations opportunistes qui ne génèrent que des impasses – par exemple, les relations russo-cubaines ou russo-vénézuéliennes. Et, bien sûr, il reste la question qui ébranle les piliers mêmes de la terre, l’ordre du monde musulman, dont les possibilités fédératives sont très éloignées en raison de l’absence réelle de traditions capables d’unir le chiisme et le sunnisme. En bref, si quelqu’un voulait parier sur une post-histoire, il a de bonnes chances de perdre.
« Si quelqu’un voulait parier sur une post-histoire, il a de bonnes chances de perdre. »
José Luis Villacañas
Une dernière question. Nous voudrions terminer en commentant certains aspects de la situation politique espagnole. Maintenant que le cycle électoral est terminé, quelle saveur le rôle d’un parti comme Podemos vous laisse-t-il ? Bien qu’ayant émergé pour réformer le système hérité du pacte de 1978, il ne semble pas pouvoir offrir une solution mature à moyen terme, peut-on continuer à parler d’un « apprentissage lent » ou est-il terminé ? Ne découvrons-nous pas ici des limites à la notion d’hégémonie comme transformateur pivot de nos sociétés ?
En ce qui concerne l’Espagne, je pense que les mois qui ont suivi les élections régionales de mai montrent clairement que le cycle électoral n’est pas terminé. Ceci pour deux raisons : premièrement, parce que la loyauté de l’électorat est vraiment fragile, comme en témoignent les fortes variations dans les pourcentages des partis ; et deuxièmement, parce que les grands partis encouragent un sentiment de temporalité dans la définition de la représentation, car ils aspirent essentiellement à reconstruire le système bipartisan. Ainsi, les erreurs des nouveaux partis, avec peu de racines dans un arrière-plan marécageux, sont exploitées par le PP et le PSOE pour une pédagogie populaire forcée qui tente de démontrer qu’avec le bipartisanat, nous avons mieux vécu. Tout sauf faire des pactes avec de nouvelles élites politiques qui imposeraient de nouvelles conditions. Face à ce scénario, ce n’est pas seulement que les possibilités de réforme de la Constitution de 1978 au sens fédéral – également économique – ont été éclipsées, mais aussi que des possibilités d’involution se sont ouvertes.
En ce sens, il est très important d’analyser la position de Vox au sein du paysage politique espagnol, car elle montre clairement que sa propre représentation des élites est liée à une compréhension nationale-catholique et impériale de l’Espagne. Bien sûr, à court terme, cette position retire les votes de Ciudadanos, car elle n’est plus le point de convergence de tous ceux qui défendent une idée forte de l’Espagne, forgée comme une réponse au problème catalan. Bien sûr, cette opération bénéficie au PP, car elle empêche le parti de Rivera d’être le premier à droite. En outre, bien sûr, il crée l’espace dans lequel les votes peuvent être échangés avec une ligne rouge : vous pouvez voter pour Vox, Ciudadanos ou PP parce qu’ils ont en commun de défendre l’idée d’une Espagne unie, contre le PSOE (sans même parler de Podemos) qui est accusé de flirt avec les indépendantistes. En effet, cette conception commune de la droite ne peut permettre les conséquences économiques qui découleraient d’une Espagne fédérale et qui réduiraient d’une certaine manière le rôle de Madrid. C’est pourquoi la bataille pour Madrid est si intense (ainsi que la lutte contre la corruption). Ce dénominateur commun n’exclut cependant pas la bataille interne, destinée à donner une place centrale au PP. En fait, bien que Vox mette l’idée de l’Espagne et de l’idéologie catholique au premier plan, ce qui lui permet de se différencier de Ciudadanos, tous ont le néolibéralisme en commun. Cela fait du PP le complexio oppositorum : il est catholique et néolibéral et tout tend à retrouver la priorité dans la droite, le véritable point de confluence. Le PSOE aidera cette opération parce qu’il forcera la gauche à converger sous sa direction si elle veut avoir une chance de gouverner un jour. Le système bipartite serait alors reconstruit et la situation de crise serait réglée.
Bien sûr, dans ce scénario, le facteur de stabilisation le plus important a été Unidas Podemos. En refusant d’occuper l’espace de l’intégration et de la transversalité, en se réfugiant dans la position de la Gauche Unie, qui était une partie structurelle du système bipartite, le Unidas Podemos a profilé un retour à la situation politique anti-crise avant tout autre parti. Cela est dû au choix d’Iglesias de garder une main de fer sur l’organisation. Cela peut être vu dans ces mêmes jours quand Iglesias 7 convoque le référendum pour soutenir sa gestion avec le PSOE pour réaliser un pacte de gouvernement. Bien sûr, la valeur politique de cette consultation est nulle, sauf pour garantir le contrôle interne de l’organisation. Cela signifie que si je devais refaire la chronique de l’évolution politique de Podemos de Vistalegre II à nos jours, je me verrais obliger d’abandonner l’idée présente dans le titre original qu’il y avait un processus d’apprentissage : Iglesias a trop à apprendre. La négociation du pacte gouvernemental avec le PSOE l’a bien montré. Il n’a pas compris que les gens ordinaires ne s’intéressent pas à savoir qui siège au conseil des ministres, et il a continué d’insister pour que tout passe par sa nomination comme vice-président. Il n’a pas déployé une négociation politique claire et transparente de mesures transformatrices, mais plutôt une négociation ad hominem. Et après un processus qui n’a en rien été transparent, il demande aux bases de se prononcer avec deux questions qui ne sont pas vraiment des alternatives. Cela signifie exclusivement l’exigence d’un acte de foi dans ce qu’elle a réalisé, ce qui a pour effet de contrôler l’appareil interne. Donc non, il n’y a plus d’apprentissage de Podemos parce qu’il a définitivement penché en faveur des anciennes pratiques d’Izquierda Unida. Et cela signifie concentrer tout le capital politique sur la personnalité du secrétaire général du parti. Mais en politique, on ne peut pas apprendre seul. Aujourd’hui, Pablo Iglesias incarne Podemos tout seul, et c’est pour cela que Podemos est condamné à produire erreur après erreur sans être jamais capable d’apprendre de celles-ci.
« En refusant d’occuper l’espace de l’intégration et de la transversalité, en se réfugiant dans la position de la Gauche Unie, qui était une partie structurelle du système bipartite, le Unidas Podemos a profilé un retour à la situation politique anti-crise avant tout autre parti. »
José Luis Villacañas
En réalité, tous les acteurs politiques agissent de la même manière. Ils savent qu’en contrôlant l’organisation politique, ils peuvent aussi définir l’agenda politique. Ainsi, ils oublient les grandes exigences de la population qui conduisent à l’ennui et au découragement, et forcent les gens à choisir toujours sous le syndrome du moindre mal. C’est le sentiment de la grande majorité des citoyens qui considèrent le système politique comme une tragédie. C’est là le vrai problème politique et non celui de la recherche de l’hégémonie. Bien sûr, presque personne n’a compris ce qu’est vraiment l’hégémonie, dans le sens où on l’a déjà dit. L’hégémonie a été confondue avec une majorité irréversible. Ou comme l’inversion d’une domination antérieure. Rien de tout cela n’est de l’hégémonie, comme je l’ai dit. L’hégémonie, c’est promouvoir un principe civilisateur avec des aspirations de validité générale, c’est-à-dire avec la capacité d’intégrer divers secteurs sociaux qui, au départ, ne seraient pas prédisposés à coopérer entre eux, mais qui comprennent qu’ils doivent coopérer dans les nouveaux objectifs.
L’hégémonie, c’est en somme le long processus de construction d’un mode de vie capable de se stabiliser provisoirement.
Sources
- José Luis Villacañas est professeur au département de Philosophie et Société de l’Université Complutense de Madrid. Réalisant son travail avec un dévouement sans précédent en Espagne, sa facette publique en tant qu’écrivain et fin analyste a fait de lui l’un des intellectuels de référence. Auteur de plus d’une douzaine d’ouvrages qui couvrent l’histoire du pouvoir politique espagnol et de la théologie politique, de la philosophie allemande et de la théorie du républicanisme, la pensée de Villacañas pourrait se résumer à la défense de la genèse éclairée de la modernité et à la mise en garde de ses difficultés. Ces dernières années, il a publié de nombreux textes incisifs qui ont joué un rôle notable dans le débat public espagnol, tels que Populismo (2016), El lento aprendizaje de Podemos (2017) et, plus récemment, Imperiofilia y el populismo nacional-católico (2019). Profitant du centenaire de la République de Weimar (1919-2019) et de la publication du livre sur la raison impériale espagnole, nous avons parlé avec le professeur Villacañas de l’Histoire contemporaine qui permet de mieux comprendre l’Espagne et le moment politique européen.
- Hans Blumenberg (1920-1996) était un philosophe et historien des idées allemands. Ces premiers travaux ont porté sur le basculement du Moyen-Âge vers la modernité, à travers notamment la thématique de la Révolution copernicienne.
- Reinhart Koselleck (1923-2006) est un historien allemand qui s’est notamment intéressé à la Sattelzeit (c’est-à-dire la période charnière) entre le XVIIIe et le XIXe siècles.
- Nom donné par des économistes du XXe siècle, notamment Joseph Schumpeter, à un groupe de théologiens et de juristes de la péninsule ibérique qui cherchèrent à réinterpréter la pensée de Saint Thomas d’Aquin.
- Parti d’extrême droite espagnol apparu en 2013 et composé au départ de membres sécessionnaires du Parti populaire.
- L’entretien est disponible ici : https://ctxt.es/es/20190123/Politica/24066/Wolf-Lepenies-El-poder-del-mediterraneo-imperio-latino-Gerardo-Mu%C3%B1oz.htm
- Le secrétaire général de Podemos depuis 2014.

