À la recherche de la bonne gouvernance
Pourquoi la social-démocratie nordique nous renvoie-t-elle l'image d'une gouvernance saine et efficace ? Le dernier livre de Fabrizio Tassinari, The Pursuit of Governance, a inspiré au diplomate britannique Robert Cooper une réflexion sur le bon gouvernement.
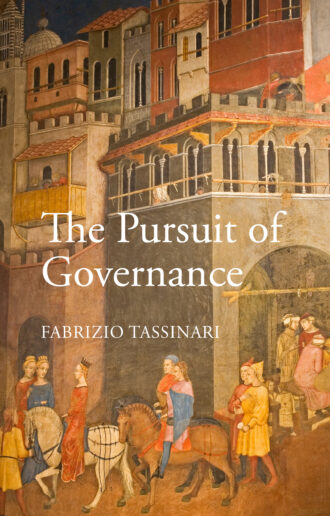
Si la démocratie produit Trump et le Brexit, qu’a-t-elle de si bien ? Sans aucun doute, en tant que Secrétaire général du Parti communiste chinois, Xi Jinping a son propre agenda lorsqu’il pose cette question. Mais d’un autre côté, il n’a pas tort non plus : pour juger un système politique, il faut se fier à ses résultats. Ceux-ci comptent plus que les noms que nous leur donnons ou que les théories qui les sous-tendent. En théorie, la démocratie est un gouvernement « par le peuple, pour le peuple ». Cela sonne bien. Mais cela fonctionne-t-il ? La façon dont nous sommes gouvernés fait une différence dans notre façon de vivre. Est-il sûr de marcher dans la rue, de boire de l’eau ? Combien d’impôts payons-nous ? Quelle est la qualité de l’éducation de nos enfants et des soins apportés aux malades et aux personnes âgées ? Toutes ces choses, et bien plus encore, comptent pour le citoyen dans la rue.
Il ne s’agit pas seulement de savoir si l’État est démocratique ou autoritaire — même si la nature du régime importe également. Dans le premier chapitre de son livre, The Pursuit of Governance, Fabrizio Tassinari compare deux démocraties : Singapour et la Californie. La première est adossé à un État très réglementé. Depuis son indépendance, Singapour organise régulièrement des élections qui, également depuis l’indépendance, ont tout aussi régulièrement porté le People’s Action Party (le PAP) au pouvoir. Personne ne peut dire que Singapour n’est pas une démocratie. À certains égards, c’est même un modèle. Transparency International classe régulièrement Singapour à égalité avec le Danemark et la Nouvelle-Zélande comme l’un des gouvernements les moins corrompus au monde.
Le premier Premier ministre de Singapour, Lee Kwan Yew, a surmonté de nombreux obstacles pour faire de Singapour un acteur important de la région. À sa naissance, personne ne s’attendait à ce qu’elle survive. L’État était et reste minuscule ; sa population est encore largement chinoise, bien qu’elle soit située en Asie du Sud-Est. Contre toute attente, Lee a établi un État sûr, ordonné et prospère — il figure parmi les leaders emblématiques du dernier livre d’Henry Kissinger. Le PAP a utilisé son quasi-monopole du pouvoir pour modifier la loi électorale à son avantage mais il reste respecté pour ses résultats au gouvernement. Après tant de succès, ce parti verrait sa victoire pratiquement toujours assurée — quel que soit le système.
Singapour dispose d’un excellent système éducatif. Les meilleurs diplômés sont recrutés pour la fonction publique, où ils sont aussi bien payés que les cadres supérieurs du secteur privé en pleine expansion. Grâce à sa réputation de bonne gouvernance, Singapour est devenu le centre régional du commerce et de la finance. La société aussi y est très réglementée. Lors de ma visite il y a quelques années, le gouvernement venait d’introduire une loi imposant une amende à tout usager des toilettes publiques qui les quittait sans tirer la chasse d’eau et sans se laver les mains — la plupart des Singapouriens font cela de toute façon. Il ne fait aucun doute que Singapour est bien gouvernée. Mais les amis occidentaux que j’y ai rencontrés m’ont dit que, de temps en temps, ils allaient passer un week-end en Indonésie — à l’époque sous régime militaire — pour profiter de la sensation de liberté.
En contraste avec la technocratie de Singapour, Fabrizio Tassinari évoque le cas de la démocratie directe en Californie. La Proposition 13, un référendum organisé en Californie en 1978, proposait de fortes réductions des impôts fonciers et des revenus des collectivités locales. Sans surprise, elle avait remporté une large majorité. Mais au fil du temps, le manque de revenus a menacé de détruire le système éducatif de pointe de la Californie. Finalement, quelque trente ans plus tard, Jerry Brown, qui était gouverneur de l’État en 1978, a conclu que le résultat du référendum avait été de mettre l’avenir de la Californie en danger. Il s’est à nouveau présenté et a été réélu au poste de gouverneur de l’État en 2011. L’année suivante, en déclarant que « le rêve californien avait été construit sur les écoles, les collèges et les universités publics », il a proposé un autre référendum — la Proposition 30 — pour augmenter les impôts sur le revenu et les ventes. Il a fait campagne pour cela et a réussi. Le résultat a été de fournir les revenus nécessaires pour redonner au système éducatif californien sa gloire d’antan.
Singapour et la Californie ont donc toutes deux des gouvernements démocratiques. Mais tandis que l’un est un régime technocratique, l’autre, poussé par un spasme populiste, a d’abord viré sauvagement dans une direction avant de, trente ans plus tard, faire un virage à 180 degrés. La conclusion à tirer est que les généralisations sur la démocratie ne fonctionnent pas : l’étude de la gouvernance doit se pencher sur des cas particuliers.
On trouve de mauvais gouvernements partout dans le monde, et ils ont des fondements très divers. Le cas le plus rare, et le plus intéressant, est celui du bon gouvernement. Peut-être que, comme Tolstoï le dit des familles heureuses, les pays bien gouvernés le sont tous de la même manière ; il vaut donc la peine d’essayer de comprendre à quoi ils doivent ce succès. Mais la comparaison entre Singapour et la Californie suggère que le monde est trop diversifié pour qu’il existe une formule unique.
Le cas que Fabrizio Tassinari a choisi d’étudier est celui des pays nordiques.
Pourquoi ? Parce qu’ils ont la prétention de figurer parmi les pays les mieux gouvernés du monde ; et peut-être parce qu’ils se situent quelque part entre les extrêmes de Singapour et de la Californie. En outre, ils constituent un groupe, plutôt qu’un cas unique.
La démocratie est difficile. Les tentatives pour l’établir à l’étranger sont incertaines, comme les pays occidentaux l’ont découvert à leurs dépens. Et il existe également de bonnes raisons de s’inquiéter de son avenir dans les endroits que nous considérons comme des foyers démocratiques. Il est donc logique de commencer par examiner les endroits où la démocratie fonctionne mieux qu’aujourd’hui en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Les pays d’Europe du Nord ont développé un modèle de démocratie qui semble à la fois plus durable et moins menacé par le populisme. La tâche que l’auteur se fixe dans son livre, The Pursuit of Governance, est de comprendre comment cela se fait. L’histoire qu’il raconte remplira probablement d’envie la plupart des lecteurs. C’est du moins ce que sa lecture a produit sur moi, citoyen britannique.
Il n’est pas difficile de trouver des exemples d’échecs en matière de gouvernement et de démocratie. Généralement, ils commencent par l’ambition, progressent par des promesses irréalistes et, lorsque la réalité s’impose, passent aux mensonges et au rejet de la faute sur les autres. L’un des problèmes de la démocratie est que les compétences requises pour faire campagne lors des élections sont différentes de celles qui sont nécessaires pour gouverner un pays. Par contraste, les compétences nécessaires pour devenir secrétaire général d’un parti communiste — la capacité à former des alliances solides avec ses amis et à traiter impitoyablement ses ennemis — peuvent très bien ne pas être très différentes de celles qui seront utiles au pouvoir.
Toutes les carrières politiques se terminent par un échec, disait Enoch Powell, un conservateur de droite radicale — qui a lui-même fini par illustrer son propre point. Mais il y a aussi ceux qui laissent derrière eux un bel héritage et dont, après un certain temps, les gens se souviennent avec nostalgie et regret. Qu’est-ce qu’un dirigeant politique pourrait souhaiter de mieux que de se voir attribuer une bonne note par les dieux de l’histoire ?
The Pursuit of Governance commence par se concentrer sur le succès du modèle nordique de gouvernement. Tassinari a passé la moitié de sa vie professionnelle au Danemark et il a le regard acéré de l’étranger envieux. Il n’est pas le premier à s’intéresser au modèle nordique : son livre commence par citer l’ouvrage de Marquis Child, Sweden : The Middle Way. Cet ouvrage a été publié en 1936, alors que le monde semblait se diviser en États capitalistes et communistes, le fascisme tapi dans l’ombre. Le livre de Child a attiré l’attention, entre autres, de Roosevelt, qui cherchait des remèdes à la Grande Dépression — apparemment la crise du capitalisme que Marx avait prédite — mais dans le cadre d’une économie de marché libre. À cette époque, la social-démocratie était une idée nouvelle : elle acceptait, dans une certaine mesure, l’analyse marxiste du problème mais pas sa solution. Elle offrait une version du socialisme sans révolution. L’idée de combiner le capitalisme de libre marché avec des politiques visant à protéger le bien-être de la classe ouvrière était en soi révolutionnaire. Le parti travailliste britannique, en revanche, a conservé l’objectif de « la nationalisation des moyens de production, de distribution et d’échange » jusqu’en 1997.
Le système nordique a changé depuis les années 1930 — comme tous les systèmes doivent le faire s’ils veulent survivre — mais son cœur reste intact. Aujourd’hui, il continue à fonctionner avec une sérénité que, en cette ère de populisme, les autres pays européens devraient envier.
En tant que personne qui partage l’admiration de Tassinari pour la gouvernance nordique, mais sans sa profondeur d’expérience, deux images me viennent à l’esprit lorsque j’y pense : l’une est contemporaine, l’autre plus ancienne. L’image récente provient d’une émission de télévision dans laquelle l’intervieweur interrogeait une experte finlandaise sur la punition des délinquants en Finlande. Elle marque une pause avant sa réponse et dit, lentement, comme parlent souvent les Finlandais : « Eh bien, vous devez comprendre qu’ici, en Finlande, nous avons beaucoup de peine pour les criminels ». C’est une remarque sensée et humaine : la plupart des criminels mènent une vie misérable. Pourtant, personne en Grande-Bretagne ou en Amérique ne songerait à dire une telle chose.
La deuxième image est une scène de l’histoire de l’après-guerre. Pour sa dernière visite à l’étranger, après la crise des missiles cubains mais avant que le coup d’État de Brejnev ne le dépose, Khrouchtchev était au Danemark. Sur son chemin à travers la campagne vers la modeste maison de campagne du Premier ministre danois, sa voiture traverse un petit village. À la demande de Khrouchtchev, ils s’arrêtent et vont voir le magasin du village. Sur place, il s’émerveille de la qualité des produits agricoles en vente. Pendant des années, Khrouchtchev s’était efforcé de relever les normes de l’agriculture russe, sans aucun succès. Ici, il y avait tout ce dont il avait rêvé : des légumes propres et frais, bien présentés et en grande variété ! La scène est mémorable pour son ironie. Le magasin du village était une coopérative, détenue conjointement par les agriculteurs : un pur produit du mouvement coopératif. Ce que Khrouchtchev n’avait pas compris, c’est qu’il s’agissait d’une sorte de communisme, mais sans la révolution, le parti ou la bureaucratie. Des efforts locaux comme ceux-ci, aidés par l’église au début, puis par l’État, notamment par le biais du système éducatif, ont permis d’améliorer le niveau de vie dans les zones rurales du Danemark. La social-démocratie faisait partie de l’histoire et de la vie des Danois avant même de faire partie de leur politique ; elle est née de la pratique et de la vie quotidienne, et non de théories.
Aujourd’hui, nous dit Tassinari dans ce livre, la tension n’est plus entre le capitalisme et le communisme mais entre le gouvernement technocratique à grande échelle et le populisme. Mais le défi est le même : donner au gouvernement un visage humain, et un visage honnête. Tassinari cite le Premier ministre suédois des années 1930, Per Albin Hannson. Sa métaphore pour le type d’État que les sociaux-démocrates suédois voulaient créer était le « Folkhemmet », autrement dit : la maison du peuple. Celle-ci, comme le bon foyer, « ne connaît ni privilège, ni négligence, ni favori, ni beau-fils. Là, règnent l’égalité, la prévenance, la coopération et la serviabilité ». Au Danemark, le grand leader social-démocrate des années 1930, Thorvald Stauning, suivant la même voie, a conclu un accord avec le Parti agraire, par nature conservateur. Les sociaux-démocrates représentaient les ouvriers d’usine, et le Parti agraire les petits agriculteurs, qui avaient en commun d’être tous deux pauvres. L’accord portait sur les droits des travailleurs et les subventions aux agriculteurs. Ils représentaient des communautés différentes mais ont pu se mettre d’accord sur un concept commun de l’État. À quoi sert l’État, si ce n’est à protéger le peuple ?
Il convient de s’arrêter un instant sur l’expression de Per Albin Hannson : « le bon foyer ». Cette formulation était politiquement brillante : une phrase simple, que tout le monde comprendrait. Elle se rapporte à la vie personnelle, mais elle rappelle aussi les contes populaires que tout le monde connaît — y compris les aristocrates. C’était une idée qui pouvait rassembler les gens — et pendant les cent prochaines années, c’est plus ou moins ce qu’elle fit. Elle avait également une signification pratique, qui serait élaborée au fil du temps. Aujourd’hui, elle est considérée comme une bonne politique. Mais l’idée elle-même a servi à rassembler les gens. C’est le début : c’est ce que fait la bonne politique, et les bonnes politiques publiques. La mauvaise politique divise : le fascisme en races, le communisme en classes sociales.
De loin, la social-démocratie nordique semble peu différente de la politique de la gauche dans le reste de l’Europe, mais son choix a été de concentrer la composante social(ist)e sur l’égalité, plutôt que sur la propriété de l’État. C’est une différence de fond. Elle s’incarne dans un certain nombre de formes différentes : l’une est un féminisme féroce qui imprègne toute la vie, et a produit un niveau de réduction des inégalités liées au genre sans comparaison dans le monde nordique, et donnant une nouvelle dimension à la société. Il entraîne dans son sillage non seulement un excellent système de garde d’enfants, mais aussi une succession de femmes premières ministres à succès — et d’autres ministres dans toute la région.
Une deuxième composante est, par rapport au reste de l’Europe, des impôts plus progressifs qui ne semblent plus aussi « extorqués » qu’ils l’étaient autrefois. Comme dans de nombreux autres domaines de recherche, l’équilibre du juste milieu comporte un élément d’essai et d’erreur dans son développement. Cela contraste avec de nombreux pays — le mien et les États-Unis par exemple — où les riches paient proportionnellement moins d’impôts que les pauvres. Dans le passé, la fiscalité dans les pays nordiques était considérée comme punitive. Aujourd’hui, elle suscite moins de commentaires hostiles, à la fois parce que les taux d’imposition sont plus modérés, mais surtout parce que le public comprend qu’il paie pour des services publics de première classe, notamment en matière de soins de santé et d’éducation. La différence est dans la qualité : en particulier dans l’éducation, où un effort systématique est fait pour garantir que les chances sont réellement égales. La notation, par exemple, est introduite beaucoup plus tard que dans la plupart des autres pays. Le résultat n’est pas seulement un système éducatif plus égalitaire, mais aussi une meilleure éducation en général. Et avec cela vient un plus grand respect pour l’élite que le système éducatif produit : l' »épistocratie », comme l’appelle Tassinari. Cela contribue également à fournir une bureaucratie de premier ordre, indispensable à tout gouvernement moderne. Et avec un système éducatif consciemment moins élitiste, la technocratie a elle aussi une meilleure compréhension et une meilleure communication avec les gens ordinaires — contrairement, par exemple, aux produits des écoles d’élite au Royaume-Uni.
Tout cela contribue non seulement à une société mieux éduquée, mais aussi à une société fière de l’égalité des chances, et orientée vers l’avenir — ce qui est le but de l’éducation. L’inégalité n’a pas été abolie, mais elle est moins évidente que dans d’autres pays européens. Les détracteurs de ces systèmes —qui s’en prennent généralement à la Suède — décrivent la société comme morne et conformiste ; les Suédois ont un mot pour cela : la « conflictophobie » — « peu compétitif sans être véritablement coopératif » disait Susan Sonntag. Il ne fait aucun doute que c’est ainsi qu’elle apparaîtrait à de nombreux autres New-Yorkais également : quel ennui !
Mais la pandémie de Covid-19 a montré la Suède sous un jour intéressant et différent. Contrairement au Danemark, il n’y a pas eu de confinement en Suède. Toute mesure de ce genre aurait constitué une violation des droits constitutionnels. Le gouvernement danois — ou dans certains cas les autorités municipales — a très tôt mis en place des interdictions de voyager, puis a fermé les bars, les frontières et les restaurants, lorsque les cas de Covid ont commencé à apparaître dans toute l’Europe. La Suède, en revanche, a attiré l’attention sur les risques et a conseillé ses citoyens de manière assez détaillée sur la manière de se comporter pour réduire les risques. Le nombre de décès par habitant en Suède semble être proche d’une fois et demie celui du Danemark. Ces deux conceptions très différentes de la liberté montrent qu’il serait erroné de supposer une uniformité dans le monde nordique.
La pandémie de Covid a été un moment exceptionnel. L’égalité est une valeur fondamentale dans tous les pays nordiques : non seulement tous sont égaux devant la loi, et ont les mêmes droits politiques, mais les individus ont aussi en pratique les mêmes droits sociaux. Une liberté égale aussi, puisque tous sont des démocrates passionnés. L’effet de ces deux valeurs conjointes, qui sont l’essence de la social-démocratie, est une population plus consciente politiquement que la plupart des autres en Europe. De cette société égalitaire, éduquée et politiquement consciente naît un intérêt et une implication dans la vie politique qui vont bien au-delà de la norme des autres pays européens.
Cela se manifeste par les festivals politiques qui ont lieu pendant les longues soirées d’été sur les nombreuses îles scandinaves. Dans d’autres pays, les gens vont à des concerts de rock en plein air ou à l’opéra, et pique-niquent ensuite sur les pelouses des grandes maisons. Les Suédois, les Danois et les Norvégiens vont à la campagne pour discuter de politique, faisant de la politique sérieuse un passe-temps.
Certaines théories suggèrent que, dans le contrat social, les hommes ont échangé la liberté contre la sécurité. C’est faux. Dans l’état de nature hobbesien, du moins, il n’y a pas de liberté, seulement de l’insécurité ; pas de société, seulement un danger constant de mort violente. Sans État, il n’y a pas d’État de droit, et sans État de droit, il n’y a pas de liberté. Le contrat social crée à la fois la liberté et la sécurité ; la prochaine étape devrait être de construire une société dans laquelle les gens s’écoutent les uns les autres, et, peut-être, commencent à se comprendre et à se faire confiance. Les rassemblements informels lors des longues soirées d’été en font partie. La liberté et l’égalité sont complétées par la fraternité…
On trouve beaucoup d’autres choses dans le livre de Fabrizio Tassinari. Il se penche ensuite sur la gouvernance au-delà de l’État : l’Union européenne d’abord, puis l’ordre mondial tel qu’il est. L’un des problèmes de l’Union européenne est que, bien que tous ses États membres soient démocratiques — c’est une condition d’adhésion — les cultures politiques à travers l’Europe, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, peuvent être très différentes. On peut essayer d’implanter des pratiques nordiques dans le Sud mais il est peu probable qu’elles prennent racine. Comme pour le jardinage, il faut du temps et de la patience — et la capacité d’apprendre de ses échecs. Ce n’est pas une surprise. Quoi qu’il en soit, la mission de l’Union n’est pas de créer des États uniformes à travers le continent, mais de permettre à ceux qui ont des histoires et des habitudes différentes de s’entendre de manière pratique — ou du moins de ne plus jamais prendre les armes les uns contre les autres. Compte tenu de notre histoire, c’est en soi une grande réussite. Si, en même temps, ils peuvent apprendre les uns des autres, tant mieux. Des livres comme celui-ci y contribueront.
Enfin, l’auteur se penche sur un cas de bonne gouvernance sur le théâtre mondial. Il s’agit de l’intéressante success story du « Processus de Kimberley », une collaboration entre une ONG américano-britannique, plusieurs gouvernements et le secteur commercial pour couper les liens entre le commerce des pierres précieuses et les conflits violents, principalement en Afrique dans les années 1990 au moment plusieurs guerres avaient été financées par les fameux « diamants de sang ». Il se peut que ce soit un cas unique. La conclusion est que le traitement des problèmes au niveau mondial est possible mais qu’il est compliqué et implique de nombreux acteurs différents.
On ressort de cette lecture avec la question suivante : pourquoi les pays nordiques sont-ils si différents ? Une réponse se trouve peut-être dans l’essai du biologiste J. B. S. Haldane, On Being the Right Size, dans lequel il explique pourquoi les baleines sont grandes et les souris petites. La taille compte aussi en politique. La démocratie directe a pu fonctionner dans les cités-états, avec peu de citoyens. La démocratie représentative a été inventée pour les États plus grands. En général, la démocratie ne s’améliore pas, lorsque les États deviennent plus grands. L’Inde prétend être la plus grande démocratie du monde. Aujourd’hui, sa taille est plus évidente que sa démocratie. Les États-Unis, la deuxième plus grande et la plus importante démocratie du monde, semble aujourd’hui être en danger : les auditions sur les événements du 6 janvier 2021 sont alarmantes. Elles sont la preuve que les institutions américaines peuvent encore fonctionner, mais aussi que leur démocratie a été et peut à nouveau être en danger. Entre-temps, la Cour suprême est désormais entre les mains d’une faction politique. Ce n’est pas un joli tableau.
Se pourrait-il que les pays nordiques aient simplement la bonne taille ? Assez grande pour offrir des économies d’échelle dans le domaine de la santé et de l’éducation, mais pas si grande pour que la capitale semble être en pays étranger — comme Londres ou Paris contre les provinces — ou qu’il puisse y avoir un caractère distinct au Nord et au Sud, comme en Italie. Les Nordiques sont post-impériaux ; ils regardent vers l’avant et non vers l’arrière. L’Écosse les regarde avec envie.
Xi Jinping a raison. Si la démocratie est une compétition entre menteurs — Johnson et Trump ont tous deux montré un talent dans ce domaine — elle sera sans valeur. Nous pouvons organiser des élections et construire des parlements. Mais à quoi servent-ils si les dirigeants élus mentent ? Les institutions ont besoin d’intégrité. À cet égard, l’institution qui nous manque le plus aujourd’hui est peut-être l’Église — elle qui se tenait autrefois au-dessus des rois et de leurs ministres, et dénonçait leurs échecs et leurs mensonges.

