Cet entretien est la transcription d’un échange entre Katarina Csefalvayova et Boštjan Videmšek qui s’est tenu à Ljubljana le 27 janvier 2022 dans le cadre de la Nuit des Idées et de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. En partenariat avec l’Institut Français, le Grand Continent publie une série de textes et d’entretiens : ces « Grands Dialogues » forment un dispositif réunissant des personnalités intellectuelles de premier plan venues du monde des arts, des lettres, des sciences, du journalisme et de l’engagement et représentant l’ensemble des États membres de l’Union européenne.
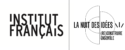
Vous avez tous les deux eu un parcours assez éloigné des questions climatiques. Pourriez-vous revenir sur la manière dont vous avez effectué une transition vers les sujets environnementaux ?
Katarina Csefalvayova

Personnellement, je n’appellerais pas cela une transition, et je ne me considère toujours pas comme une spécialiste des sujets environnementaux et climatiques. J’ai essayé, depuis le début de mes études puis de ma carrière, de garder à l’esprit cette dimension écologique, car je pense que nous devons avoir pleinement conscience du grand défi qui nous attend.
J’ai grandi dans une famille où deux de mes oncles représentaient deux camps opposés dans le conflit entre la Hongrie et la Slovaquie à propos du partage des eaux du Danube. Le premier était du côté hongrois des négociations et l’autre était du côté slovaque. L’environnement dans lequel j’ai grandi était si fascinant que dans mon mémoire de master, je me suis intéressé à ce sujet du barrage du Gabcikovo et, plus largement, au partage des eaux internationales.
Plus tard, au cours de mon doctorat, qui relevait plutôt de la politique internationale, j’ai étudié plus spécifiquement les problèmes de rareté de l’eau non pas, encore une fois, dans une perspective purement environnementale mais à travers le prisme de la coopération internationale et des conflits qui pourraient en émerger. Ensuite, au cours de ma carrière académique, ces sujets sur la rareté de l’eau m’ont amené, quand je recherchais des partenaires, à coopérer, dans le cadre académique, tant au niveau national, où ces sujets n’étaient pas vraiment étudiés à l’époque, qu’au niveau international où cela m’a amené à des questions bien différentes comme celle des migrations internationales, du changement climatique et de la sécurité climatique. Des questions qui s’imposent avec le temps mais auxquelles je n’avais pas forcément pensé au départ.
De même, au niveau politique, je travaillais principalement avec des dirigeants s’intéressant à des sujets internationaux, à l’instar du chef de la commission des Affaires étrangères et du vice-président de la commission des Affaires étrangères au Parlement. Mais j’essayais toujours de glisser certains aspects du changement climatique et des politiques et de la gouvernance climatique au sein de nos travaux car je pense que c’est une dimension qui doit être présente dans tous les aspects de notre société en ce que c’est une question qui touche toutes les dimensions de nos vies.
Dans votre cas, Boštjan Videmšek, pourrions-nous parler de transition ?
Boštjan Videmšek

Pour moi non plus, je dois dire, cela n’a pas été une transition. 85 % des conflits armés qui sont en cours aujourd’hui se déroulent dans les lieux les plus chauds et les plus secs du monde. La plupart de ces lieux sont également des endroits d’où les gens fuient, en tant que réfugiés climatiques. Dès 2004, alors que je couvrais la guerre du Darfour, le premier génocide du XXIe siècle, dans le Soudan occidental, il est devenu évident pour mes collègues et moi-même que nous avions affaire à un conflit causé par le changement climatique. C’était il y a dix-huit ans. Un rapport de l’ONU avait montré à l’époque que 1500 sources d’eau douce s’étaient asséchées en un an et que le Sahara s’étendait au Sud d’1,5 à 7 kilomètres par an.
85 % des conflits armés qui sont en cours aujourd’hui se déroulent dans les lieux les plus chauds et les plus secs du monde.
Boštjan Videmšek
À cette époque, en couvrant le conflit, je prenais conscience qu’il s’agissait de la répétition d’une guerre globale. C’était il y a dix-huit ans. Depuis, les choses se sont accélérées au point que nous nous enlisons dans une crise profonde qui n’est pas seulement climatique mais également sociale, politique, économique. C’est une crise majeure qui est toujours ignorée – de ce point de vue, la COP de Glasgow a été, selon moi, un échec absolu.
À propos de mon parcours personnel, je parlerais donc moins de transition que d’un nouveau champ de bataille. La méthodologie et la manière avec lesquelles j’approche mes sujets a peut-être légèrement changé mais j’essaie, sans doute avec une grande naïveté et un certain idéalisme, de faire passer le message. Pas seulement en citant les faits, en montrant à quel point ce que nous faisons est mauvais pour la planète. Toutes ces informations apocalyptiques sont évidentes : elles sont utiles mais certainement pas suffisantes. Bien évidemment, nous devons sans cesse répéter les faits, particulièrement dans cette ère de la « post-vérité ». Mais sans histoires positives, sans parler des bonnes pratiques, sans proposer des approches directes et des solutions, et, en tant que journalistes, sans donner de réponses et seulement en posant des questions, on ne peut pas avancer.
On peut peut-être parler de “journalisme constructif” – dans le monde académique anglo-saxon, ce modèle existe déjà. Je pense que lorsque l’on a des connaissances, de l’expérience, on a également une responsabilité, pas seulement à agir mais également à diriger, à commenter les choses d’une certaine manière.
Lorsque nous faisons des reportages dans des zones de guerre, nous avons d’une certaine manière une perception de notre futur. C’est une perspective particulièrement sombre à l’heure où l’Europe est incapable d’arrêter le conflit qui se profile. À ce titre, parler d’écologie n’a pas de sens à la veille d’un nouveau conflit. Tout ce dont nous sommes en train de parler devrait être immédiatement rejeté car l’Europe devrait être concentrée, dès aujourd’hui, sur la manière dont elle peur arrêter le conflit sanglant qui s’approche, retenir la guerre qui vient à ses frontières 1.
Le changement climatique ne sera pas un sujet dans trois semaines ou deux mois si quelque chose de véritablement terrible survient. Nous sommes si proches de l’éclatement d’un tel événement que parler du changement climatique maintenant – pour quelqu’un qui a impliqué tout ce qu’il est dans la lutte contre le changement climatique – me fait me sentir coupable. La priorité doit être d’arrêter la guerre.
L’environnement et l’écologie sont-ils des sujets que nos jeunes États – la Slovénie et la Slovaquie – prennent véritablement au sérieux ? À quel point sont-ils présents dans les programmes gouvernementaux, dans les discussions budgétaires ?
Katarina Csefalvayova
Je pense que la prise de conscience croît, ce qui est bien sûr une bonne nouvelle. Mais elle croît trop lentement. Lorsque nous parlons du changement climatique et des politiques climatiques, je suis souvent frustrée de voir que ces problèmes sont souvent considérés comme tout à fait distincts et j’observe un très important problème de perception, en Slovaquie et ailleurs dans le monde. On parle encore du changement climatique comme si c’était une sorte de religion. Des personnes demandent : croyez-vous au changement climatique ? – et maintenant, croyez vous aux vaccins ? – comme on demande si l’on croit en Dieu, et comme si nous ne prenions pas des faits scientifiquement prouvés pour tels mais pour quelque chose qui pourrait ou ne pourrait pas advenir.
Cette conscience de la réalité du changement climatique n’est donc pas tout à fait ancrée dans les esprits. Toutes ces histoires, ces faux arguments, tout ce récit qui a été construit sur le fait qu’il y a eu un changement climatique auparavant, qu’il y a eu un âge glaciaire, relativisent la crise que nous vivons. Il n’y a jamais eu autant de personnes dans le monde. Je ne suis pas inquiète pour la planète, je suis inquiète pour nous, pour les sociétés et pour les individus.
Il n’y a jamais eu autant de personnes dans le monde. Je ne suis pas inquiète pour la planète, je suis inquiète pour nous, pour les sociétés et pour les individus.
Katarina Csefalvayova
C’est donc d’abord un problème de perception.
Un autre problème, qui est aussi très présent, en Slovaquie et ailleurs, est de considérer le changement climatique comme une urgence simplement environnementale et d’en faire la cause d’activistes barbus aux cheveux longs ou à des enfants qui ne veulent pas aller à l’école le vendredi, alors même que cela ne relève pas seulement de l’environnement et d’une petite partie du spectre politique. Le changement climatique est un problème environnemental, mais c’est également un problème économique, social, sécuritaire et bien plus large. C’est donc d’abord et avant tout un problème politique et qui exige un effort conjoint du spectre politique. En Slovaquie, nous nous sommes engagés à respecter ce très bel et ambitieux objectif de neutralité carbone, dont je suis très reconnaissante et fière, dans le cadre du plan Fit for 55. Cependant, il y a seulement quelques jours, le Club des 500 en Slovaquie, un groupe plus ou moins formel qui regroupe les plus grandes entreprises qui ont plus de 500 employés, ont fait entendre leur voix et se sont proclamés défavorables à ce plan en mettant en avant leur peur d’une perte de compétitivité et de la compétitivité des industries européennes.
C’est un exemple très typique de comment, il y a trois ans, nous nous sommes engagés à des efforts très ambitieux en les laissant ensuite au ministère de l’Environnement, sans calculer l’impact que la transition aurait sur les entreprises slovaques. Nous n’avons pas établi de stratégies et de programmes afin d’accompagner ces entreprises dans une transition qui leur permettrait de devenir en réalité plus compétitives…
Dans deux élections, nous serons en 2030. Ces deux mauvaises conceptions du changement climatique devraient être nos premières préoccupations afin d’avancer et de faire des politiques climatiques véritablement puissantes.
Comment sensibiliser les dirigeants politiques à ces urgences ?
Une anecdote me revient des Maldives, où nous travaillions, durant ma carrière académique, sur un projet de consultation pour l’État. L’idée était de fournir des outils aux Maldives, leader des États des petites îles dans les négociations de la COP, car ces îles sont les plus directement menacés par le changement climatique : ils font face au risque de la disparition, dans 10 ou 20 ans, de leur territoire, qui est un attribut fondamental de leur qualité d’États. Nous essayions de les équiper car de petits États comme Nauru, Paula, n’avaient même pas les ressources financières pour être représentés dans les forums de négociations internationales. Nous y sommes allés et nous avons essayé de faire un projet de consultation, de mener des dialogues politiques avec des individus du monde académique, politique, etc.
Je croyais qu’un pays qui était menacé d’une disparition dans un délai aussi court que vingt ans ferait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter que cela n’arrive et que tout le gouvernement vivrait avec cet agenda. J’espérais que nous pourrions trouver une certaine inspiration chez eux, sur notre manière d’organiser nos approches gouvernementales une fois de retour chez nous.
Mais nous avons été choqués de réaliser que, aux Maldives, 30 % des habitants pensent que le changement climatique n’existe pas, et 30 % environ pensent que c’est la volonté de Dieu – et que ce que Dieu veut adviendra. Seuls les 30 ou 40 % restants veulent vraiment faire quelque chose pour renverser le cours des choses. Une fois de plus, c’est le ministère du Changement climatique qui porte seul cet agenda. Notre projet de consultation, finalement, s’est transformé en une réponse à cette question : “comment faire en sorte que la lutte contre le changement climatique passe par une approche gouvernementale globale et comment expliquer aux citoyens ce qui est en train de se dérouler ?”
Aux Maldives, 30 % des habitants pensent que le changement climatique n’existe pas, et 30 % environ pensent que c’est la volonté de Dieu – et que ce que Dieu veut adviendra. Seuls les 30 ou 40 % restants veulent vraiment faire quelque chose pour renverser le cours des choses.
Katarina Csefalvayova
Qu’en est-il de la Slovénie, Boštjan ?
Boštjan Videmšek
Nous vivons dans un environnement formidable, vert, agréable… Les forêts sont partout mais nous traitons l’environnement comme si nous possédions la nature et que nous pouvions faire ce que nous voulons avec, en toute impunité. Je n’aime pas cela parce que si vous replacez ces actions dans un contexte économique, social et politique plus large, c’est catastrophique. Deux études scientifiques traitant des années 2020 sont importantes pour comprendre la situation de la Slovénie. Une première a mis au jour que la Slovénie était le deuxième pire pays de l’Union européenne en termes de mise en œuvre des engagements climatiques. Au même moment, une deuxième étude a étudié comment la première vague du Covid avait affecté l’ouverture de la société et son caractère démocratique : la Slovénie était le deuxième pays le plus affecté.
La conscience climatique et le niveau de démocratie sont, à mon avis, des données corrélées. De l’autre côté, si vous êtes confrontés à des conséquences directes du changement climatique, comme les pays qui composent l’Arctique et les pays limitrophes, les pays situés sur l’Équateur, le pays secs, les pays du Moyen-Orient, d’Asie centrale, d’Afrique subsaharienne et du Nord, alors vous ne pouvez pas vraiment remettre cela en cause car vous y êtes confrontés tous les jours.
En Slovénie, mais également en Slovaquie et en Europe centrale, nous sommes dans un contexte climatique et géographique favorable. Mais cela ne veut pas dire que nous soyons du côté des privilégiés, ni que nous soyons en sécurité – toutes les projections pour les 20, 30 ou 50 prochaines années montrent des signaux très sombres.
Quel déclic pourrait permettre ce saut mental, cette prise de conscience ?
Si vous ne ressentez pas les effets directs, vous ne pouvez pas ressentir l’omniprésence de ce problème, et c’est ce qui nous arrive je pense. Même l’été dernier, les feux en Allemagne et en Australie, l’ouragan en République tchèque, n’ont pas changé grand chose, et ce que nous avons vu à Glasgow en était un résultat direct.
La métaphore du film Don’t Look Up est la meilleure manière de décrire ce phénomène et dans les plus petits pays, qui sont encore plus politisés et obsédés par eux-mêmes, le changement climatique n’a pas encore pénétré le cœur des politiques.
Lorsque nous avons connu nos premières élections démocratiques en avril 1990, notre parti vert a obtenu 8,7 % des suffrages. C’était le pourcentage le plus élevé jamais reçu par un pays en Europe. C’était en 1990, il y a 32 ans. Aujourd’hui, 32 ans plus tard, nous n’avons pas de parti vert solide. La dernière fois que nous avons eu un député vert, c’était en 1996. Dans le même temps, la crise climatique est devenue la principale menace pour l’humanité et pour la vie sur terre en général.
Comment est-il possible que nous soyons si peu engagés ? Il y a juste à se déplacer un tout petit peu pour le voir de ses propres yeux. Allez au Groenland 3 fois en 5 ans, vous verrez à quel point le changement est rapide. Mais vous n’avez même pas besoin de vous déplacer autant pour voir ce changement. En tant que journaliste, en tant que citoyen, je me sens frustré, car la météorite métaphorique de Don’t Look Up va nous frapper violemment. Les mesures le montrent.
En tant que journaliste, en tant que citoyen, je me sens frustré, car la météorite métaphorique de Don’t Look Up va nous frapper violemment.
Boštjan Videmšek
Quelles idées pourraient porter le changement ?
Katarina Csefalvayova
Je pense que les histoires positives sont extrêmement importantes afin d’avoir un récit positif et d’apprendre des leçons de bonnes pratiques qui peuvent également être utilisées ailleurs. Mais je pense toujours que la chose cruciale désormais est de recadrer ce discours politique et d’effacer les mauvaises perceptions qui peuvent exister. Parler plus du changement climatique et essayer de persuader les citoyens car, politiquement, le fait de prendre des mesures afin de limiter le changement climatique n’est pas très attrayant pour les politiciens.
J’en ai été une, donc je peux en témoigner. Les dirigeants politiques pensent en termes d’échéances électorales et si vous prenez des mesures qui peuvent être douloureuses maintenant mais dont vous ne voyez pas les effets à 4, 8 ou même peut-être 12 ans, les fruits de vos actions ne sont pas suffisamment intéressants. Et il y a très peu de politiciens qui le feraient malgré cette absence de rendement électoral. Mais il y a une chose qui peut persuader les dirigeants : ce sont les citoyens, l’électorat, la pression venue du bas. Nous devons, en tant que citoyens, demander cela et alors les mesures environnementales deviendront attrayantes pour les politiciens.
Sur une échelle de 1 à 10, où diriez-vous que se situent les tentatives slovaques pour essayer de créer un environnement intellectuel à même de produire ces changements ?
J’ai bien peur que nous soyons assez bas. Cela a quelque peu changé durant les deux dernières années. Comme en Slovénie, nous n’avons pas de parti Vert. Plusieurs partis politiques sont attentifs aux questions environnementales, mais pour la plupart d’entre eux, il ne s’agit que d’un élément qu’il faut intégrer dans l’équation de son programme pour que tout le monde puisse le trouver et qu’aucun journaliste ne puisse dire qu’on manque de programme écologique, sans se soucier vraiment de la possibilité de leur mise en œuvre dans la vraie vie.
Nous avons certes une société civile structurée. Mais les mouvements de la société civile et les institutions comme Greenpeace sont perçus comme des tenants du mouvement écologiste et les citoyens ordinaires ne peuvent pas vraiment s’identifier à eux. Nous avons donc besoin d’une approche plus large pour toucher l’ensemble de la société civile. C’est pourquoi, lorsque nous avons créé l’Institut pour l’Europe centrale, qui se focalise sur les questions de l’Europe centrale avec le credo « Réunir l’Europe », nous avons voulu effacer les écarts et les différences qui ont augmenté ces derniers temps entre l’Est et l’Ouest du continent, car nous pensons que pour avancer, l’Europe doit être unie. L’objectif de l’Institut est donc l’unité de l’Europe mais avec un accent particulier sur le climat.
Il y a une chose qui peut persuader les dirigeants : ce sont les citoyens, l’électorat, la pression venue du bas.
Katarina Csefalvayova
Je suis persuadée que nous avons besoin d’organisations provenant de la société civile qui ne sont pas des organisations écologistes en soi et qui ne s’intéressent pas en premier lieu, par exemple, aux espèces en voie d’extinction – même si c’est très important. Nous devons faire en sorte que toute la société civile soit consciente du changement climatique et ait assimilé cette prise de conscience climatique et la nécessité de mettre en place des politiques publiques climatiques.
Boštjan, partagez-vous ces constants ?
Boštjan Videmšek
La première proposition que j’aurais se formule très simplement : confions le récit du changement climatique aux personnes qui en font l’expérience au quotidien et pas à ceux qui le traitent encore comme une fiction. Car, pour eux, c’est une fiction.
Des pratiques à grande échelle existent, et celles-ci devraient être présentées à toutes les occasions possibles au Parlement, aux Conseils européens, aux ONG, à la société civile et également par le biais des médias. Cela ne donne pas seulement aux individus de l’espoir – l’espoir est une conception métaphysique – cela donne une chance réelle, aux grandes entreprises, aux petits entrepreneurs, aux scientifiques, aux innovateurs, toutes les personnes possibles qui sont motivées à contribuer au changement positif. Si vous n’êtes pas physiquement motivés, rien ne va changer.
Allez en Islande, et vous verrez comment ce pays s’est transformé ces dix dernières années, et comment cela est principalement lié au changement climatique et à l’abondance des énergies renouvelables. Allez dans certaines îles grecques qui ont créé des miracles durant la période d’une très dure crise économique et financière. Contre toute attente, ils ont réussi et la Grèce est maintenant l’un des pays leaders de l’Union européenne dans les énergies renouvelables. Comment cela est-il possible alors que le pays était presque en faillite ? La crise était là et il n’y avait pas d’échappatoire. C’est triste à dire, mais si l’on ne ressent pas la chaleur, il n’y aura pas de changement. La zone de confort est une prison de dissonance cognitive.
Dans mon livre, les cas que je présente ont tous le même logiciel : des conséquences directes de la crise climatique sont là. Des individus dans les sociétés ont la volonté de prendre des risques et de diriger la solidarité de la communauté existante. Il n’y a pas de choix, pas d’issues. Dans tous les endroits que j’ai visité qui avaient une histoire positive en termes de lutte contre le changement climatique, il y avait une initiative financière et économique fonctionnelle.
C’est triste à dire, mais si l’on ne ressent pas la chaleur, il n’y aura pas de changement. La zone de confort est une prison de dissonance cognitive.
Boštjan Videmšek
S’il y a une société, il y a une solution, car la société a une volonté presque biologique de se préserver. Partant, cette dynamique peut toucher les politiciens, car c’est une idée fondamentalement politique. Parler de changement climatique en d’autres termes que politiques est impossible. Le changement climatique est profondément politique. Quelle question est plus politique que celle du vivre ensemble ? Or aujourd’hui, ce n’est même pas seulement la question de comment vivre ensemble mais de comment survivre ensemble. La question de notre survie est au-delà de la politique, elle est métapolitique.
Ce n’est pas une coïncidence si l’Europe a été à l’avant-garde dans la lutte contre le changement climatique. Il s’agit du continent le plus riche. Il est coûteux d’entreprendre la capture et le stockage de carbone, mais il serait bien plus coûteux de ne pas le faire.
Mais comment persuader l’autre partie du spectre politique, qui est toujours dans une forme de déni ?
Par des initiatives financières, en leur montrant que le changement climatique est déjà en train de coûter plus d’argent aux contribuables que les solutions. En leur disant : “Cela va devenir beaucoup trop coûteux pour rester durable. Si nous n’utilisons pas l’argent qui est dépensé dans le statu quo, alors toute l’économie va s’effondrer.”
Des centaines de milliards de billets ont été imprimés ces 18 derniers mois et nous lisons ces grandes histoires à propos de projet vert, de digitalisation, de résilience, de récupération. Mais dans le cas de la Slovénie, nous n’avons pas bougé d’un seul millimètre. Et une chose qui est pour moi personnellement mais également professionnellement très problématique, c’est que l’on ait défini le nucléaire et le gaz comme des énergies semi-vertes sur lesquelles nous devons compter. Est-ce la victoire finale des lobbyistes de l’énergie fossile ? Et il n’y a même pas de discussion publique. Une majorité des partis politiques slovènes s’est accordée sur le fait qu’une deuxième centrale nucléaire était quelque chose de banal à construire, sans débat public. Pas ou peu de voix se sont élevées. Il y a un consensus que je ne parviens pas à comprendre. Lorsque l’on retourne aux années 1990, le Parti Vert a eu ses voix avec un programme antinucléaire, suivant l’ancien parti vert allemand. C’est comme si on niait que quelque chose existe – et c’est très douloureux.
Que pensez-vous de ce que Boštjan vient d’affirmer Katarina ?
Katarina Csefalvayova
Il y a tant d’idées, de technologies qui n’ont pas l’espace et les opportunités qu’elles devraient avoir… La cause en est le paradigme qui est toujours présent dans les esprits individuels que le changement climatique serait une chose hors de portée ou qui n’existe même pas vraiment. Ce dont nous devons nous assurer, et ce dont les politiciens devraient s’assurer, est que les citoyens soient sur la même longueur d’onde. Les idées sont là, il faut montrer qu’elles sont nécessaires, continuer à investir dans cette recherche et rassurer les entreprises qui produisent des voitures aujourd’hui, car elles sont effrayées par cette transition verte dont elles se considèrent perdantes. Nous devons nous assurer qu’ils sachent qu’ils seront en réalité les gagnants.
J’ai tiré une idée d’une expérience personnelle qui concerne mon voyage de Bratislava à Ljubljana. Je cherchais une solution écologique pour me déplacer et nous avons fini par venir en voiture : nous voulions prendre le train mais cela aurait été bien trop compliqué. J’en ai conclu que ce dont nous avions besoin était que les citoyens qui veulent se comporter d’une manière responsable puissent avoir les infrastructures adaptées et soient encouragés à le faire. Si nous ne voyons pas cela comme une priorité, alors c’est un problème.
Comment faire en sorte de réduire cet écart qui peut exister entre la responsabilité individuelle du sauvetage de la planète et la responsabilité que nos États, nos entreprises et nos organisations internationales ont. Comment articuler ces responsabilités ?
Boštjan Videmšek
Bien trier ou être plus efficace dans nos conduites, notre agriculture, nos logements… Ce n’est jamais assez, c’est frustrant, cela crée des traumatismes et cela fait finalement de vous un citoyen passif – ce qui est le but des militants en faveur du statu quo et du business as usual, les grandes entreprises, certains gouvernements… C’est ce que Michael Mann écrit dans son livre The Environmental War, et je suis tout à fait d’accord avec lui.
J’ai pu développer l’idée que nous devions mettre en avant un agenda individuel, certes, mais lorsque l’on voit ce qu’ont pu faire l’industrie du tabac, de l’alcool ou des énergies fossiles… la même histoire se répète à travers les décennies. La publicité met en avant de jeunes personnes dynamiques en montrant que leur choix est fondamental, alors que le business continue, as usual, voire se développe. Depuis 1990, nos émissions ont considérablement augmenté. Tout a été multiplié depuis les années 1990 alors que les citoyens sont devenus plus passifs, plus frustrés et agressifs.
Avec la pandémie de Covid-19, on a assisté à la dictature d’un seul problème qui a pénétré dans toutes les sphères – sociale, politique, économique et même sexuelle – de la vie. Nous devrions véritablement nous concentrer sur les choses fondamentales, existentielles, essentielles : le changement climatique est de celles-ci.
Si notre paradigme ne change pas, c’est impossible. Mais si le paradigme social, économique et politique change, alors nous avons une chance.
Boštjan Videmšek
Il est la somme de tous les problèmes créés par l’avidité humaine. Comment traiter cela ? Si notre paradigme ne change pas, c’est impossible. Mais si le paradigme social, économique et politique change, alors nous avons une chance.
Katarina, qu’en pensez-vous ?
Katarina Csefalvayova
En tant que citoyen, nous trions correctement puis nous voyons, comme ce qui s’est passé par exemple à Bratislava il n’y a pas si longtemps, que les poubelles de plastique, de papier débordent car les villes ne s’occupent pas de les enlever. Savoir qu’alors même qu’on leur demande de trier leurs déchets, ils finissent aux mêmes endroits décourage et frustre les citoyens.
Nous ne devrions pas décourager les citoyens. C’est une question globale sur laquelle tout le monde devrait se pencher.
Boštjan a déjà parlé de la COP26, où nous donnions l’impression d’être tous volontaires. Mais c’est un problème si asymétrique qu’il est très difficile de régler internationalement et nous n’utilisons clairement pas les bons outils. Tout se passe comme si nous étions en train de chercher une solution à un problème du XXIe siècle avec des outils du XXe siècle. Nous devons aller plus loin dans ce domaine, et j’ai plus de questions que de réponses à fournir. Je pense que nous avons besoin de changements qui soient réellement majeurs. Ce qui est, dans une certaine mesure, une bonne nouvelle concernant les COP, même si la dernière en date n’a pas été un franc succès, est que nous impliquons l’ensemble des parties.
Tout se passe comme si nous étions en train de chercher une solution à un problème du XXIe siècle avec des outils du XXe siècle.
Katarina Csefalvayova
Nous n’avons pas seulement besoin des États et des politiciens mais également des municipalités, des entreprises et il est important de voir l’ensemble de ces parties rassemblées pour régler cette crise. Le problème est qu’il s’agit d’un sujet fondamentalement asymétrique car ceux qui ont le plus contribué à sa résolution ne sont pas ceux qui en ont le plus souffert.
Cette crise pose des défis particulièrement complexes, et si nous n’adoptons pas une approche différente, ou si nous n’essayons même pas, alors cela ne va pas être un succès. Car avec les outils que nous avons, nous ne pouvons pas réussir comme nous le souhaitons.
Comme nous l’avons vu à Glasgow, les grandes entreprises peuvent s’adapter très vite, et elles ont appris à monétiser le changement climatique il y a des années. Les États-nations peuvent-ils faire quelque chose ?
Boštjan Videmšek
Nous avons besoin d’une organisation globale qui puisse s’occuper du changement climatique. L’ONU ne fait rien pour régler cette crise. Nous avons besoin d’une organisation parallèle, quelque chose de nouveau, qui se concentre uniquement sur cela. C’est une idée qui a déjà été discutée, mais rien n’a encore émergé. Cela pourrait changer la donne, nous n’aurons plus besoin de COP car il y aura une rencontre permanente entre les personnes clés, et les personnes clés ne sont pas seulement les grandes entreprises et les chefs d’Etats. Nous avons besoin de milliers de Greta et nous avons besoin de personnes provenant des lieux les plus efficaces. Nous avons besoin d’ambassadeurs futurs.
En tant que journaliste avec un esprit technique, je pense que c’est assez simple. De quoi avons-nous besoin ? D’États qui étaient déjà présents durant les COP et de personnes qui sont volontaires pour être là. Cela pourrait être un hub d’idées : des ingénieurs, des techniciens, des philosophes, des équipes d’évaluation des risques éthiques
à une échelle globale avec des représentations nationales. Il est trop tard pour mettre en place des Conseils de sécurité avec droit de véto. Nous n’en sommes plus là.
Katarina Csefalvayova
L’argent est certainement très important et un fond serait certainement très utile car cela ne fonctionne pas par soi-même. Cela me rappelle tout de même un exemple de mon expérience aux Maldives où l’on nous disait que les Chinois faisaient affluer beaucoup d’argent afin que cet État se taise à propos de la lutte contre le changement climatique pour se concentrer sur l’adaptation, mais comment pouvez-vous vous adapter à la disparition de votre pays ? L’argent n’est pas toujours une solution.
Je pense que nous devons faire de cette transformation verte quelque chose d’attrayant, quelque chose qui sera un modèle que les autres pays voudront suivre. Ici, l’Union européenne a un rôle important à jouer si nous réussissons à faire cela à un niveau européen. Il est donc important de parler à tout le monde, de rassembler tout le monde, y compris les entreprises, qui ont peur d’être les perdantes de la transition. L’Union européenne a la belle ambition d’être leader, nous ne traitons peut-être pas le problème de la bonne manière, nous pourrions avoir oublié certaines choses. Mais nous devrions être motivés par le fait que, si nous réussissons, cela pourrait être la plus grande histoire de réussite du XXIe siècle, qui sauvera finalement tout le monde car elle rassemblera tout le monde.
Mais une réunion d’urgence d’individus proposant des solutions, comme le propose Boštjan, est-elle possible ?
C’est en effet possible et cela a été en partie fait. Mais comme il l’a dit et comme j’ai pu le dire plus tôt, il faut surtout faire en sorte que tout le monde puisse croire dans le processus.


