Cet entretien est la transcription d’un échange entre Matthew Caruana Galizia et Pavla Holcová qui s’est tenu à Prague le 27 janvier 2022 dans le cadre de la Nuit des Idées et de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. En partenariat avec l’Institut Français, le Grand Continent publie une série de textes et d’entretiens : ces « Grands Dialogues » forment un dispositif réunissant des personnalités intellectuelles de premier plan venues du monde des arts, des lettres, des sciences, du journalisme et de l’engagement et représentant l’ensemble des États membres de l’Union européenne.
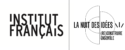
Vous avez tous les deux une longue expérience dans le journalisme d’investigation. J’aimerais commencer par vous demander comment, Matthew, vous êtes devenu journaliste ?
Matthew Caruana Galizia

À l’origine, je souhaitais travailler dans le domaine des nouvelles technologies. J’ai toujours beaucoup aimé le journalisme et j’ai grandi avec en quelque sorte, car ma mère a pratiqué ce métier pendant 30 ans. Je l’admirais. Les ennuis qui pouvaient accompagner au quotidien l’activité de journaliste d’investigation ne m’effrayaient pas. Je trouvais cela normal que notre maison soit entourée de gens, que le téléphone sonne sans arrêt…
C’est après l’assassinat de ma mère en 2017 1 que j’ai quelque peu délaissé le journalisme tech pour me concentrer sur le journalisme d’investigation. Ce fut une période extrêmement dure et pénible pour moi : je ne pouvais plus exercer le métier de journaliste à plein temps et je devenais au même moment un activiste pour cette cause. Ce passage a été très exigeant et difficile : j’ai dû renoncer à une activité que j’aimais beaucoup. Mais c’était une nécessité, il fallait le faire. Le combat pour la justice était trop important pour moi.
Et vous Pavla, comment êtes-vous arrivée à cette profession ?
Pavla Holcová

Si j’ai travaillé longtemps dans des médias en ligne, j’ai toujours voulu être journaliste. Alors que je m’en étais partiellement éloignée, j’y suis revenue au moyen d’un déclic, dans une prison cubaine. Enfermée avec un autre journaliste alors que je couvrais les abus à l’encontre des droits fondamentaux sur l’île, nous avons discuté du journalisme d’investigation, des projets qu’il envisageait et je me suis décidée : « une fois sortie de Cuba, c’est ce que je ferai. » En 2013, j’ai donc créé le Centre tchèque pour le journalisme d’investigation, où je travaille depuis.
Beaucoup ont une vision « romantique » du journalisme d’investigation. Quelle est votre journée type ?
Le café y joue une part importante. Je me lève, je bois mon café. Je vais au travail, je bois mon café. Je m’assieds devant l’ordinateur, je bois mon café. 80 % de mon travail se passe devant un ordinateur. Nous étudions des documents, nous écrivons à des gens, nous leur demandons des explications. Je dirais que le travail « de terrain » concerne à la rigueur 20 % du temps de mon activité. Cela peut-être très intéressant, particulièrement lorsque vous travaillez sur des sujets comme le crime organisé. Mais la majorité de mon travail se fait sur ordinateur. Je ne mentirais pas en disant que lorsque je m’endors après ma journée de travail, je rêve de tableaux Excel et de transactions financières ! Voilà la vie d’un journaliste d’investigation.
Matthew, y a-t-il une différence entre la vie d’une journaliste d’investigation tchèque et celle d’un journaliste d’investigation maltais ?
Matthew Caruana Galizia
Depuis 2018, je ne travaille plus pour un journal. Je dirige une ONG qui porte le nom de ma mère, dont le siège est à Malte. Nous ne sommes pas journalistes à proprement parler mais nous nous battons pour la liberté d’expression, pour promouvoir le travail des journalistes contre la corruption, et nous soutenons le travail des journalistes d’investigation. Notre combat porte aussi sur l’usage de différentes technologies dans le domaine de l’investigation.
Nous permettons également aux journalistes d’obtenir de l’aide et des conseils juridiques quand ils sont menacés de poursuites pénales par exemple, car ils sont très souvent le cible de ce genre de poursuites ou de calomnies pour les empêcher de faire leur travail. Le but est d’exercer une pression : un homme d’affaires va par exemple attaquer un journaliste en justice en lui demandant deux millions d’euros de dommages et intérêts. L’objectif n’est évidemment pas d’obtenir les 2 millions d’euros, mais de faire peur aux journalistes pour espérer les faire taire. Je connais bien cette situation car ma mère a dû faire face à quarante-six plaintes de ce genre.
Ces accusations peuvent détruire la vie d’un journaliste. Notre objectif est donc d’essayer de protéger ceux qui sont menacés par de telles situations. Nous ne faisons pas un travail de reporter au quotidien comme Pavla, nous nous occupons de cet autre volet. Il est évident que dans le travail d’investigation, les journalistes doivent affronter beaucoup d’obstacles, qui ne sont pas seulement des menaces : pour y faire face, certains journalistes peuvent avoir besoin de conseils, d’une assistance en matière juridique. Nous la leur proposons.
Est-ce que votre spécialisation initiale dans le domaine des nouvelles technologies a rendu ce travail plus facile ?
Mon père est un juriste, mon grand-père aussi. Mon père voulait que l’un de ses fils le devienne à son tour. Ma mère quant à elle ne le souhaitait pas car elle trouvait cela ennuyeux. Elle a été heureuse que je choisisse une autre voie. Mon père fut assez déçu de mon choix de carrière journalistique. Or aujourd’hui, je consacre la majeure partie de mon temps au domaine du droit : je fais le travail d’un juriste sans en être un. J’imagine que mon père doit être content car c’était son désir. Je pense que les instruments juridiques peuvent être très efficaces pour soutenir le journalisme. Cela ne veut pas dire que des journalistes doivent faire le travail de juristes, mais ils peuvent utiliser des organisations comme celles dans laquelle je travaille pour protéger leur droit.
Voilà pour la méthode. Passons désormais au concret : la question du respect de l’État de droit. Assistons-nous aujourd’hui en Tchéquie, et ailleurs de manière plus générale, à une détérioration de la situation des journalistes ? Les situations comme celles décrites par Matthew sont-elles nombreuses ?
Pavla Holcová
Je pense que l’on ne consacre pas assez d’attention à ce point. C’est peut-être pour cette raison que la situation empire. Pour être concrète, je partirai de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie. Auparavant personne n’osait vraiment parler haut et fort du problème de la justice et de l’État de droit, aujourd’hui, vingt-et-un magistrats sont accusés à la Cour suprême. On parle de pots-de-vin, de corruption… c’est une catastrophe considérable. Je pense que nous assistons à une révolution dans le domaine judiciaire, qui aura une vertu cathartique.
L’endroit qui devrait retenir notre attention est la Slovaquie, bien davantage que la Tchéquie. En ce qui concerne l’État de droit, le système slovaque offre de bonnes garanties sur le papier, meilleures mêmes que celles de la Tchéquie. Le Conseil judiciaire (Sudna rada) doit surveiller la bonne administration de la justice et il est épaulé par d’autres d’organisations qui sont censées s’assurer de la bonne marche du système judiciaire, mais qui ne fonctionnent pas en pratique.
En Tchéquie, nous n’avons certes pas d’institutions du genre du Conseil judiciaire, mais nous avons d’autres organisations qui, elles, font un travail différent, comme Watchdog. Il est cependant vrai que le niveau de morale au début des années 1990 était beaucoup plus élevé en République Tchèque qu’en Slovaquie, où la politique est très liée à la vie judiciaire. Ici, la séparation est bien plus nette. En Slovaquie, le lien est toujours très étroit, le contrôle ne fonctionne pas très bien, beaucoup d’hommes politiques poursuivent une carrière dans le domaine judiciaire. Nous assistons à la même situation en Hongrie et en Pologne. La question se pose de savoir si cela ne surgit pas aussi un petit peu en Tchéquie.
Du point de vue de la protection juridique du journalisme, où en sommes-nous en Tchéquie, par rapport à ces trois pays – mais aussi par rapport à l’Europe dans son ensemble ?
Les conditions ne sont pas trop mauvaises mais cela se dégrade assez facilement.
Du côté de Malte, qu’est-ce qui s’est amélioré ? Qu’est ce qui s’est dégradé ?
Matthew Caruana Galizia
Je pense que l’une des choses qui a changé est le rôle et l’implication de la société civile. On a du mal à imaginer comment cela se passe chez nous car la majorité des pays de l’Union européenne ont une société civile très forte et structurée, y compris la Tchéquie, avec des ONG, des organismes de contrôle qui se battent contre la corruption, pour la liberté d’expression, etc… À Malte, nous avions une seule ONG qui soutenait les droits de l’Homme, une toute petite agence composée de trois salariés. La société civile était donc quasiment inexistante. Les Maltais considéraient que, s’il fallait faire quelque chose pour le bien public et participer au débat politique, le seul moyen possible était de passer par la sphère politique. Cette situation n’était pas tenable : nous nous transformions en une société tribale. Soit vous étiez membre d’un parti politique et vous vous battiez pour les intérêts de votre parti, soit vous étiez membre d’un autre parti : vous vous battiez uniquement pour les intérêts défendus par le parti dont vous étiez.
Depuis l’assasinat de ma mère en 2017, les gens se sont rendu compte qu’il y avait une vie en dehors des partis politiques et que l’on pouvait obtenir des résultats en travaillant de manière indépendante, comme elle le faisait. Car elle travaillait seule. Or les journalistes et les activistes se rendent de plus en plus compte qu’il faut être ensemble et qu’on ne peut plus travailler seuls. Cette prise de conscience est importante. Elle a changé notre culture. Nous arrivons à parler de sujets comme l’avortement par exemple, de manière apaisée, alors que c’était un sujet tabou, un sujet dont on ne parlait pas avant. Les jeunes ont désormais une meilleure opinion de la société, ils se sentent encouragés ; le travail de ma mère y est pour beaucoup. Ils se disent aussi que si elle a été prête à consacrer et à donner sa vie pour cette cause, ils devraient faire sinon la même chose, du moins quelque chose.
Vous disiez au début de notre conversation que vous étiez journaliste hier et aujourd’hui activiste. Mais peut-on vraiment faire les deux ? Où tracez-vous la frontière ?
Malheureusement, le journaliste se retrouve parfois dans une situation où il doit devenir activiste. On pourrait avoir l’impression que ce n’est pas une bonne chose mais si vous êtes vraiment entravé par quelqu’un, menacé avec violence, il faut avoir recours à l’activisme. C’est une situation inconnue et nouvelle pour certains journalistes, mais si l’on ne se bat pas contre ces menaces, cela ne changera pas.
Quant à moi je suis activiste à cent pour cent.
Je ne m’attends pas à ce que tous les journalistes fassent de même, mais je pense que certains devraient aussi être activistes. Si le public n’a pas accès à une information par exemple, un journaliste ne peut pas en conscience dire : « je ne pouvais pas avoir cette information, car on m’empêchait d’y avoir accès. » Il faut être activiste donc, travailler en lien avec des juristes parfois pour obtenir des informations.
Pour vous Pavla, où est la frontière entre un activiste et un journaliste ?
Pavla Holcová
Je suis sans doute la personne la moins bien placée pour répondre à cette question car j’ai commencé en tant qu’activiste. Je suis parti de l’activisme vers une carrière de journaliste d’investigation.
Dans quelles circonstances ce changement a-t-il eu lieu ?
C’est au moment où j’ai écrit le premier article pour le Organized Crime and Corruption Reporting Project. À ce moment-là, mon rédacteur en chef m’a dit « c’est un article activiste, il faut que tu le rédiges différemment ». J’ai donc commencé à réfléchir. Très vite, ma conclusion a été que je ne devais pas « ne pas donner mon opinion » mais qu’il fallait la mettre en contexte, l’argumenter, l’étayer. Cela m’a pris un certain temps.
Est-ce que la situation actuelle en Tchéquie, qui n’est peut-être pas tout à fait la même qu’en Hongrie, en Slovaquie ou en Pologne, ne nous conduit pas à devenir un peu plus activiste ?
Pour informer, oui. Mais en même temps, je ne suis pas certaine de pouvoir me faire l’avocate de certaines opinions journalistiques. Matthew a expliqué qu’il y a des moments où il faut vraiment agir, où il faut devenir activiste.
En Tchéquie, n’êtes-vous pas parfois amenée à redevenir activiste ?
Non justement. Cela m’a pris un certain temps de laisser cette carrière d’activiste derrière moi, mais quelqu’un d’autre le fera à ma place. Nous avons une société civile très forte, elle peut défendre des journalistes et se battre pour eux. Il va peut-être falloir être davantage activiste étant donné la situation actuelle mais je pense qu’on peut apporter des informations sur une base factuelle, juste et factuelle, informer sur la situation de nos collègues journalistes dans d’autres pays. Certains de nos collègues sont de vrais commentateurs. Dans certaines salles de presse, recueillir des commentaires et des opinions n’est pas une mauvaise chose : cela peut nous permettre d’attirer l’attention sur ce qui se passe chez nos voisins.
Certaines personnes disent que la parole et la légitimité des journalistes est diluée aujourd’hui car tout un chacun pourrait devenir journaliste sur les réseaux sociaux. Qu’en pensez-vous ?
C’est un enfer. Je suis tout à fait d’accord avec Maria Ressa, prix Nobel de la paix 2021, qui a écrit un livre sur les algorithmes et leur influence néfastes sur les réseaux sociaux. Elle y explique comment les réseaux tuent le travail étayé et argumenté de journaliste.
Un vrai travail de journaliste se base sur les faits et il est sérieux. Il n’y a pas d’emoji ou de smileys qui vont pousser les gens à « liker ». Alors que nous en discutions récemment avec un groupe de journalistes, quelqu’un a comparé ce nous vivions sur les réseaux avec le moment de l’invention de l’imprimerie, lorsque l’Église perdit son monopole de l’interprétation de la Bible. Des histoires terribles commençaient à circuler. On parlait de dragons qui avaient mangé la moitié d’un village, de « fausses informations » qui circulaient pour amuser la population. Pour beaucoup de gens, il était difficile de saisir la frontière entre les informations sérieuses et celles qui avaient pour but d’amuser. Je pense que les réseaux sociaux nous conduisent à une situation similaire. Il faudrait inventer une nouvelle profession où des gens puissent servir de filtres. Seuls les journalistes peuvent dire : « voici de vraies nouvelles, sérieuses, par rapport à celles qui servent à amuser, à divertir. »
Dans un petit pays comme Malte, les réseaux sociaux aident-ils les journalistes dans leur travail ou ont-ils vocation à les remplacer ?
Matthew Caruana Galizia
Il y a de tout. Je serais hypocrite si je disais que les réseaux sociaux sont entièrement mauvais. J’ai moi même commencé à m’en servir lorsque j’appelais à la liberté ou pour expliquer ce qui se passait à Malte. En ce sens et si vous les utilisez à bon escient, ils sont utiles. Ils peuvent constituer une plateforme accessible à tous : tout le monde ne peut pas appeler CNN et leur signaler avoir une information, mais je peux le faire sur les réseaux. Si quelque chose de terrible se passe, je peux en parler sur les réseaux.
Mais je sais aussi qu’ils sont utilisés comme une arme, qu’ils ont pu conduire par exemple à des massacres au Myanmar, avec des publications Facebook incitant à la violence, à sortir dans les rues, avec des machettes, tout cela a été rendu possible à cause de Facebook. Pour ce qui est de la façon dont les journalistes utilisent les réseaux sociaux, n’importe quelle plateforme qui est utilisable pour la communication des informations ou de nos découvertes peut être utile. Avoir cette possibilité est une bonne chose.
Mais les journalistes maltais font souvent l’erreur suivante : ils se limitent aux réseaux sociaux et considèrent comme important uniquement ce qui a été publié. L’on se retrouve donc avec des titres ubuesques : « X a dit ceci sur Facebook… » – cela ne m’intéresse pas. Si cela m’intéressait, j’irais le voir sur les réseaux sociaux, mais la réalité se passe au-delà des réseaux. Ce qui est important n’est pas ce qui s’est dit sur Facebook mais ce qui est réellement arrivé.
Je mets donc en garde contre ce piège : il ne faut pas seulement commenter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J’invite les journalistes à aller sur le terrain, à observer, à voir ce qui se passe. Avoir de bonnes sources et être actif est ce qu’il y a de plus important, c’est ce que font Pavla et son équipe.
Vous êtes originaires de pays relativement petits où les sphères médiatiques et politiques sont parfois très liées. Dans de telles situations, comment fait-on pour maintenir de la distance avec la politique ?
Bien sûr, dans notre société cela peut poser des problèmes car certains reportages ou certaines enquêtes peuvent concerner quelqu’un que vous connaissez. Soit vous pensez qu’il serait mieux de, peut-être, ne pas les publier et cela devient vite un problème. Soit vous pensez que cette personne mérite en effet d’être contrôlée, surveillée, mais vous ne le faites pas. Vous vous dites : « si je critique telle ou telle personne, je vais le rencontrer quelque part, ce sera gênant. » Mais il faut le faire, il faut l’accepter.
Une fois journaliste, il faut accepter la responsabilité, porter le fardeau et se préparer au fait qu’il y aura d’autres situations de ce genre. Il faut repousser les peurs de se retrouver dans une situation gênante. Il est important de savoir qu’il faut critiquer si et quand les critiques sont nécessaires. C’est précisément pour cela que ma mère était différente, que certains voyaient en elle une personne dangereuse. Elle n’y faisait pas attention pour ainsi dire, elle était prête à critiquer quelqu’un et le rencontrer le lendemain, ce n’était pas un problème pour elle. Elle disait qu’à New York, les journalistes n’avaient pas peur de critiquer et donc qu’il ne fallait pas avoir peur.
Pavla, quelle est votre attitude ?
Pavla Holcová
Je n’ai pas de contact avec des personnalités politiques, aucun. C’est quelque chose que je considère comme dangereux. Cela dit, j’ai tout à fait conscience que c’est un luxe que je peux me permettre mais que la majorité ne peut pas le faire. J’ai un seul contact politique avec un député qui vit en Islande. C’est le seul contact que j’ai dans ce domaine.
Comment le journalisme indépendant peut-il trouver son business model. On sait tous qu’il est parfois difficile de maintenir son indépendance, en particulier dans les périodes de difficulté économique. Quelles sont vos expériences sur ce plan-là ?
C’est une très bonne question. Pour ce qui nous concerne, nous avons de l’argent de projets norvégiens, nous avons aussi des donateurs qui sont importants et également des donateurs qui le sont moins. Ceux qui sont importants payent 500 couronnes par mois et c’est de l’argent que nous pouvons utiliser comme nous le voulons, d’une manière qui nous semble importante. Toucher de l’argent dans le cadre d’un projet est toujours un peu fragile.
Six mois auparavant, vous êtes en mesure de prévoir quel sera le sujet traité, mais au bout de cette période la réalité peut-être différente. Cela arrive très souvent et vous pouvez vous imaginer qu’il est quasiment impossible de deviner ce que sera le centre d’intérêt des lecteurs dans six mois. Je ne suis pas certaine mais je pense que si les éditeurs pouvaient revenir à la veille des années 2000, je leur dirais : il faudrait vraiment garder le contenu des journaux payants, ce n’est pas la publicité qui va faire vivre les journaux. La situation est vraiment difficile, nous devons toujours expliquer aux gens que cela vaut la peine de payer pour recevoir une information de qualité. Parfois, le prix pour de telles informations se compte en vies humaines. Il faut donc comprendre que ce que nous produisons pendant de longues nuits ne peut pas être un travail gratuit.
Qu’en pensez-vous Matthew : le constat de Pavla vous semble-t-il correspondre à la réalité maltaise ?
Matthew Caruana Galizia
Je ne chercherais pas un exemple similaire chez nous. Je ne pense pas que nous puissions vous donner d’exemple de financement de journalisme.
On peut cela dit tirer des leçons en ce qui concerne la manière de coopérer, de travailler de manière transfrontalière. Pour certains dossiers, les journalistes essayent de travailler au niveau international, notamment lorsqu’ils font des enquêtes importantes. Mais qui les finance ? Il est impossible de mener à bien de tels projets sans argent. Il provient souvent du secteur public, de la Commission européenne, des gouvernements des pays tiers, le cas échéant des milieux d’affaires, des dons, etc… Il est quasiment impossible de faire autrement.
Je ne dis pas que c’est le meilleur modèle, je ne sais même pas si c’est un modèle proprement dit. Mais chez nous, cela fonctionne : nous sommes capables de financer un certain nombre de journalistes d’investigation grâce à l’argent que nous recevons de la Commission européenne, qui a des fonds à partir duquel on peut financer le journalisme d’investigation. Les fonds norvégiens sont également utiles. Nous n’avions jamais eu d’aide du secteur privé, mais une autre organisation pour laquelle j’ai travaillé jadis avait reçu de l’argent du secteur privé. On peut travailler avec ces fonds, comme ce fut le cas pour les Panama Papers. Autrement,je ne sais pas…
Je dirais aussi qu’il est important d’avoir par exemple des canaux de financements publics, comme par exemple avec la BBC au Royaume-Uni. Car ce sont des canaux indépendants, et l’indépendance, le caractère autonome, est absolument crucial pour pouvoir exercer la profession de journaliste d’investigation.
Bien sûr, nous pourrions parler aussi du fonctionnement des médias publics chez nous, à Malte, sur comment ils peuvent devenir des machines de propagandes… À La Valette, une station de radio publique sert par exemple de canal de propagande au gouvernement. Ce n’est pas le cas de tous les médias publics mais il faut s’assurer des conditions dans lesquelles ces médias puissent être vraiment indépendants, sans que le gouvernement ne puisse les influencer, s’y immiscer, en influencer la direction ou la ligne éditoriale. Il est toujours facile de transformer un média en organe de propagande.


