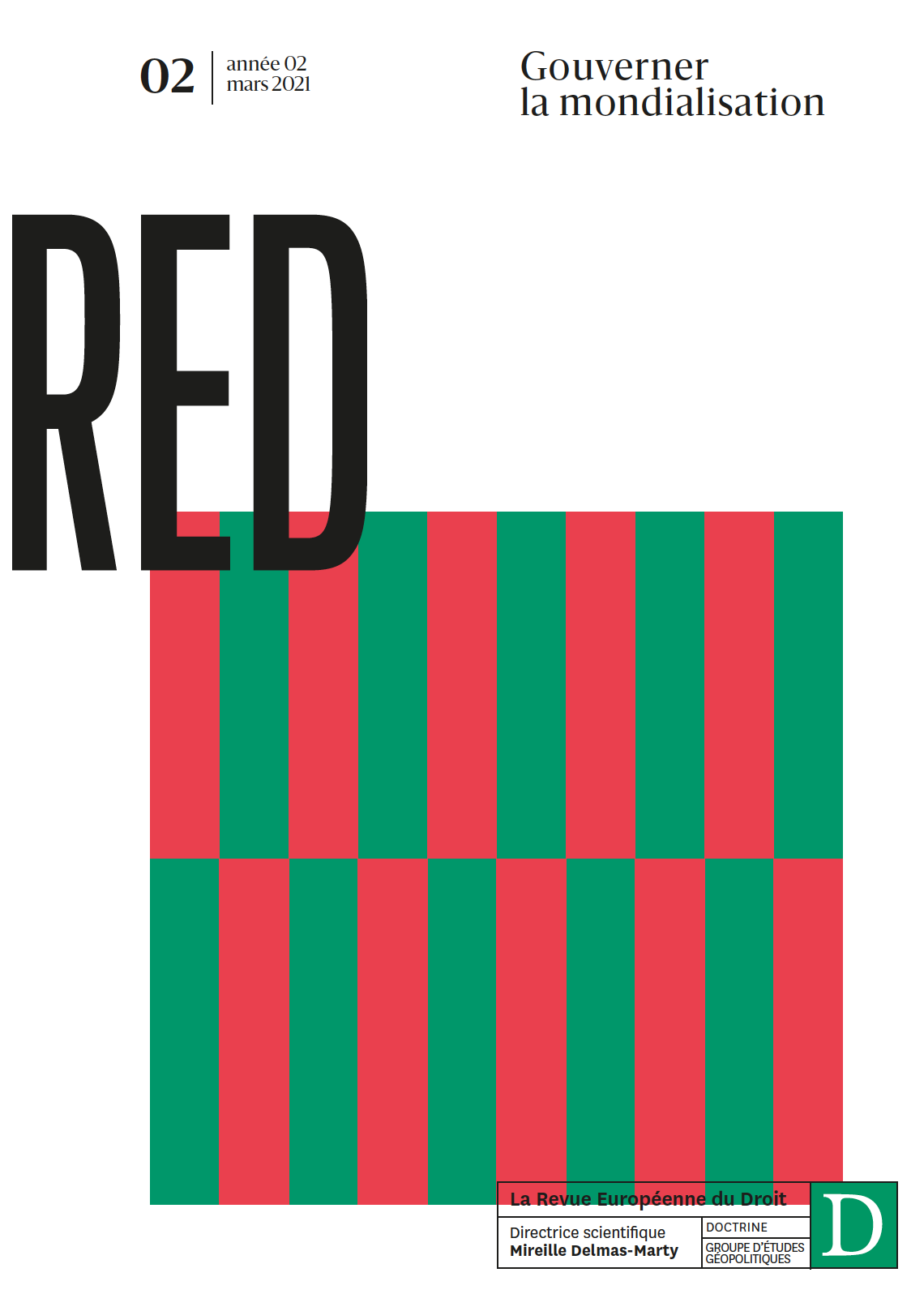Cet article est aussi disponible en version anglaise sur le site du Groupe d’études géopolitiques.
Plus on prend de la hauteur, et plus on voit loin dit un proverbe chinois. Imaginons donc, pour mieux y voir, qu’un Martien vienne observer la Terre et ses habitants. Que penserait-il, vu d’en haut depuis sa soucoupe, des us et coutumes de cette curieuse espèce en pleine expansion : les êtres humains ? Comment jugerait-il l’état de la planète et l’efficacité de la gouvernance mondiale de l’environnement ?
C’était donc un Martien, mais un Martien juriste – et qui aimait la Terre 1. Il était venu d’abord il y a 50 ans, à l’occasion de la Conférence des Nations unies sur l’environnement de 1972 à Stockholm, puis revenait régulièrement depuis.
Le Martien avait longuement observé la Terre, ahuri de l’extraordinaire dégradation de l’état de l’environnement. Tous les indicateurs étaient au rouge : l’accroissement de la pollution atmosphérique, la diffusion de la matière plastique dans les océans, le déclin irrémédiable de la biodiversité, le changement climatique, la fonte des glaces, ou encore l’accentuation des phénomènes météorologiques extrêmes. Le Martien était tout autant troublé par la place occupée par l’être humain sur cette planète et par sa capacité de colonisation de tous les écosystèmes. En 1950, la population mondiale était estimée à près de 2,6 milliards de personnes. Cinquante ans plus tard, en 2000, elle avait plus que doublé, atteignant un peu plus de 6 milliards. En 2020, elle était passée à 7,8 milliards. L’impact de l’existence de l’espèce humaine sur la planète était tel que les humains eux-mêmes avaient identifié une nouvelle ère de l’histoire géologique de la Terre, dans laquelle l’Homme était devenu la principale force de modification planétaire : l’Anthropocène.
Le Martien avait cru pouvoir se rassurer, un court moment, en 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio. Enfin, pensait-il, le temps de la prise de conscience était venu ! Le rapport Brundtland venait de dresser en 1987 un tableau sombre, mais juste et précis de la situation. Le doute n’était plus permis : l’homme était désormais au courant de sa gigantesque capacité à modifier les équilibres naturels de sa planète et à précipiter son environnement vers un état mettant en péril ses conditions de vie sur Terre, voire sa propre survie. À Rio, les Nations unies avaient donc adopté deux grandes conventions internationales, la Convention-cadre sur le changement climatique (CCNUCC) et la Convention sur la diversité biologique (CBD).
Mais en 2015, notre Martien était revenu à Paris. S’y tenait alors la « COP 21 », la 21e conférence des parties de la convention climatique. Depuis 1992, les émissions mondiales de gaz à effet de serre, loin de se réduire, avaient poursuivi leur inexorable hausse, en augmentant de 60 %. Inquiet, le Martien se demandait alors comment ces petits êtres humains, qui avaient tant dégradé leur environnement, allaient s’organiser pour réagir. Depuis son vaisseau spatial, il observait… Alors, que faisaient les Terriens en ces jours de décembre 2015 ?… Ils se mettaient autour d’une table et discutaient… À 193 États, ils discutaient et discutaient, des jours et des nuits. Comme lors du Sommet de Copenhague de 2009, comme à chaque COP, pendant deux semaines interminables, les États discutaient. Les négociations se poursuivirent jusqu’au dernier jour, et même la dernière nuit. Comme dans un film, jusqu’à la fin, le suspense demeurait à son comble : allait-t-on enfin obtenir un accord ? Enfin, après la prolongation de la conférence jusqu’au lendemain, au petit matin du 12 décembre 2015, le président de la conférence, les yeux cernés, leva son marteau et frappa, sous les applaudissements de la salle enthousiaste : « Nous avons un accord » !
Un tel processus de décision était-il rationnel ? Était-il sérieux ? Était-il à la hauteur des enjeux ? N’y avait-il pas un immense décalage entre d’un côté la gravité de la crise écologique et, d’un autre côté, l’inefficacité des méthodes de gouvernance ?
Telles étaient les pensées qui traversaient l’esprit de notre ami Martien. Il entreprit alors de rencontrer le Secrétaire général des Nations unies pour tenter de mieux comprendre. Son objectif était d’élaborer un petit rapport destiné aux autorités martiennes sur la situation sur Terre, en trois points 2 : d’abord un état des lieux des difficultés de la gouvernance mondiale de l’environnement ; ensuite un diagnostic, pour identifier certaines causes de ces difficultés ; enfin, quelques pistes de réflexion naïves pour tenter d’aider à la mise en place d’un système de gouvernance mondiale plus efficace et plus juste.
I/ Constat : le double échec de la gouvernance mondiale de l’environnement
Le Martien se rendit alors au siège des Nations unies, à New York. Le Secrétaire général des Nations Unies l’accueillit chaleureusement dans son bureau et lui indiqua qu’il était tout disposé à répondre à ses questions. Il posa d’emblée sur la table son rapport de 2018, qui était précisément consacré aux « Lacunes du droit international de l’environnement ». Le Martien put y découvrir un diagnostic complet de la situation : absence de principes partagés et contraignants, fragmentation du droit international de l’environnement caractérisé par un manque général de cohérence et de synergies entre les cadres règlementaires sectoriels, fragmentation des institutions internationales, difficultés d’application, difficultés des cours et tribunaux à faire appliquer le droit existant, etc. 3
La gouvernance mondiale de l’environnement, si elle avait produit quelques grands succès tel que l’Accord de Paris, semblait en effet marquée par la fatalité d’un double échec : d’une part, dans l’élaboration de normes nouvelles ambitieuses (A) ; d’autre part, dans l’application des normes existantes (B).
A/ L’incapacité tragique à élaborer des normes nouvelles ambitieuses
Le Secrétaire général des Nations Unies relevait d’abord certains aspects positifs : depuis la conférence de Stockholm en 1972, de nombreux textes internationaux avaient été adoptés en matière d’environnement.
Toutefois, observait le Martien, il semblait que ces textes se regroupaient en deux catégories : soit des textes ambitieux mais relevant du droit souple, sans caractère réellement contraignant (les objectifs d’Aichi en matière de biodiversité, l’Accord de Paris en matière de changement climatique) ; soit des accords obligatoires mais limités à des domaines très techniques et sectoriels (les déchets, les matières dangereuses, la pollution des navires). Les États semblaient être incapables de s’accorder sur des textes à la fois ambitieux et obligatoires.
Les États semblent éviter soigneusement un mécanisme qui pourrait rendre le droit international de l’environnement « sanctionnable » et coercitif.
yann aguila, marie-cécile de bellis
Pourtant, plusieurs projets ambitieux avaient émergé durant cette période, qui auraient pu donner une impulsion salutaire à la gouvernance mondiale de l’environnement. Trois initiatives illustraient de façon éclatante l’inexorable échec de l’ambition
1/ Le projet d’une Organisation Mondiale de l’Environnement
En premier lieu, la création d’une Organisation mondiale de l’Environnement a été proposée au début des années 2000. Ce projet avait pour objectif de redonner impulsion et unité à la gouvernance mondiale de l’environnement, éclatée entre près de 20 institutions différentes et plus de 500 traités multilatéraux. Il s’agissait de donner au domaine de l’environnement une dynamique semblable à celle initiée par la création de l’OMS en matière de santé ou de l’OMC dans le commerce international. Le projet a été présenté lors du Sommet de la Terre de Johannesburg en 2002 et était soutenu avec vigueur par plusieurs Chefs d’État. Chacun se souvient à cet égard des mots du président de la République française Jacques Chirac lors de ce Sommet pour illustrer ce besoin d’action : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Discuté tout au long de la décennie, remis à plusieurs reprises sur la table des négociations, le projet a finalement été abandonné en 2012, lors de la conférence dite « Rio + 20 », au profit d’un simple renforcement du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE).
2/ Le projet de Cour Internationale de l’Environnement
En deuxième lieu, la proposition d’une Cour Internationale de l’Environnement a été portée par plusieurs initiatives, telles que la International Court of the Environment Foundation, fondée en 1992 par le professeur italien Amedeo Postiglione, et la International Court of the Environment Coalition, créée en 2009. En trois décennies et malgré plusieurs propositions, aucun projet n’a jamais pu aboutir. Les bonnes volontés ne manquaient pourtant pas, la proposition semblait logique. Selon les propres mots de Sir Robert Jennings, juge puis président de la Cour Internationale de Justice, l’environnement étant un domaine particulièrement spécialisé et éminemment international, une structure de contrôle au niveau international semble la solution la plus pertinente 4. Mais la volonté politique n’a pas été au rendez-vous : les États semblent éviter soigneusement un mécanisme qui pourrait rendre le droit international de l’environnement « sanctionnable » et coercitif.
3/ Le projet de Pacte mondial pour l’environnement
En troisième et dernier lieu, le projet de Pacte mondial pour l’environnement s’est également heurté a des résistances. L’initiative visait à consacrer dans un texte général les principes fondamentaux du droit international de l’environnement. L’idée n’est pas nouvelle : elle figurait déjà dans le rapport Brundtland de 1987. Elle a été reprise par l’UICN, qui a rédigé en 1995 un projet de International Covenant on Environment and Development. À son tour, le Club des juristes proposait en 2015 l’adoption d’un Pacte mondial pour l’environnement. L’initiative a d’abord connu un certain succès : en 2017, le président Emmanuel Macron l’a porté à l’ONU, sur la base d’un avant-projet rédigé par un réseau international de juristes présidé par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel et ancien président de la COP21. Le 10 mai 2018, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution ouvrant les négociations, « Vers un Pacte mondial pour l’environnement », votée par 143 États pour et – seulement – 5 États contre. Pourtant, les discussions se sont ensuite enlisées lors des séances du groupe de travail des États au PNUE à Nairobi. Si ces négociations sont toujours en cours, elles ont fait place à un projet à l’ambition beaucoup plus réduite, puisque les États ont choisi de s’orienter vers une simple « Déclaration politique » sans portée juridique, bien loin du projet initial de quasi-constitution environnementale.
4/ Une histoire parsemée de revers
Le Martien devait se rendre à l’évidence : ce triptyque ambitieux de la gouvernance (organisation mondiale, cour de justice, constitution) s’était heurté à la tiédeur et aux craintes des États.
Les exemples d’échec pouvaient d’ailleurs être multipliés, tels que celui du projet, intelligent et novateur, du président Rafael Correa : celui-ci proposait le renoncement de son pays, l’Équateur, à l’exploitation pétrolière d’une partie de l’Amazonie en échange d’une aide internationale. Cette idée n’a malheureusement pas eu le succès escompté auprès des pays riches. De même, l’histoire des négociations climatiques est-elle parsemée de revers, depuis l’annonce en 2001 par le Président des États-Unis du refus de son pays de ratifier le Protocole de Kyoto, jusqu’à l’échec en 2009 de la COP 15 de Copenhague, qui était supposée adopter un nouvel accord international pour le climat prenant la relève de ce Protocole. Il aura fallu attendre 2015 pour qu’un tel accord soit adopté à Paris lors de la COP 21… jusqu’à l’annonce en 2016 par le Président des États-Unis du retrait de son pays de l’Accord de Paris…
Il y a une dimension tragique dans la gouvernance mondiale de l’environnement, pensait le Martien. Dès 1992, à Rio, tout avait été dit. Le constat de l’urgence à agir avait été posé, un ensemble de principes guidant l’action mondiale avaient été reconnus, les solutions avaient été discutées. Pourtant, dès qu’un projet ambitieux est proposé, il semblait se heurter à un mur invisible. Le Secrétaire général des Nations Unies lui-même devait bien l’avouer : la situation actuelle devenait désespérante. À quoi bon s’engager, si le résultat est connu par avance ?
Pourtant, dès qu’un projet ambitieux est proposé, il semblait se heurter à un mur invisible. Le Secrétaire général des Nations Unies lui-même devait bien l’avouer : la situation actuelle devenait désespérante. À quoi bon s’engager, si le résultat est connu par avance ?
yann aguila, marie-cécile de bellis
Ainsi, concluait le Martien, quelque chose ne va pas au royaume des êtres humains.
B/ La difficulté à appliquer les normes existantes
Notre ami Martien, souhaitant introduire une touche d’optimisme, observait que, malgré tout, de nombreux textes avaient été adoptés. Il s’enquit alors de la manière dont les États appliquaient les accords existants. Le Secrétaire général, accablé, lui apporta toutefois une réponse décevante : le droit international de l’environnement était marqué par un défaut de mise en œuvre récurrent. Dans de nombreux cas, les normes n’étaient tout simplement pas obligatoires. Dans d’autres, elles étaient obligatoires mais leur violation n’est pas sanctionnée.
Le droit international de l’environnement était marqué par un défaut de mise en œuvre récurrent.
YANN AGUILA, MARIE-CÉCILE DE BELLIS
1/ De nombreuses normes de droit souple, sans caractère obligatoire
En premier lieu, de nombreuses normes relèvent seulement du droit souple : elles ne sont que des objectifs sans caractère obligatoire. C’est le cas pour les « Objectifs d’Aichi », fixés dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Adoptés par la Conférence des Parties de cette convention en octobre 2010, dans la ville d’Aichi au Japon, ils devaient constituer le nouveau « Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 » pour la planète. Enfin, pensa le Martien, les êtres humains avaient pris des mesures ambitieuses ! « Ces objectifs ont-ils été respectés ? » interrogea-t-il. Le Secrétaire général des Nations Unies posa alors un autre rapport sur la table : le 5 e rapport sur les Perspectives mondiales de la diversité biologique, réalisé en 2020 par le secrétariat de la convention sur la diversité biologique 5. Publié dix ans après l’adoption des objectifs d’Aichi, à la veille de l’adoption du nouveau cadre mondial de la biodiversité à l’occasion de la COP 15 à Kunming (Chine) en mai 2021, ce rapport doit servir de base au Plan stratégique suivant, pour la période post-2020. Le constat est sans appel : presqu’aucun objectif n’a été atteint. Sur les 60 critères de réussite des objectifs, seuls 7 peuvent être considérés remplis.
2/ Des normes obligatoires souvent sans système effectif de sanction
En second lieu, même lorsque les normes internationales sont obligatoires, on se heurte souvent à l’absence de sanction effective. Un des exemples marquants est celui du Protocole de Kyoto de 1997, adopté dans le cadre de la Convention-cadre sur le changement climatique. Le Canada n’ayant pas respecté ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (il était le premier fournisseur de pétrole brut des États-Unis) risquait de se voir infliger les sanctions prévues par le Protocole. En 2006, lors de la 12e Conférence des Nations unies sur le climat à Nairobi, il avait d’ailleurs souhaité réviser ce Protocole, considérant les objectifs imposés comme « irréalistes et inaccessibles ». Finalement, en 2011, après l’élection de représentants fédéraux conservateurs, le Canada a annoncé qu’il préférait se retirer du Protocole de Kyoto. Pour éviter les sanctions, le Canada avait choisi une option plus économique et plus pratique : le retrait pur et simple.
Le Martien ne comprenait pas : lorsque deux particuliers signent un contrat, ils sont tenus par leur promesse, ils ne peuvent pas s’en retirer. Et en cas de violation, la justice peut être saisie, n’est-ce pas ? Pourquoi des États, qui s’engagent dans une convention internationale, ont-ils le droit de se retirer ? Pourquoi ne serait-il pas possible de saisir un tribunal s’ils ne respectent pas leurs engagements ? Cette difficulté, lui répondit le Secrétaire général des Nations Unies, provient de la nature même du droit international, qui repose sur le consentement des États. Le Martien souhaita alors en savoir davantage sur le fondement même du droit international.
II/ Diagnostic : la théorie de l’autolimitation des États et le Syndrome du Buffet
Le fondement du droit international, dans la conception traditionnelle, repose sur la théorie de l’autolimitation des États (A). En pratique, cette théorie aboutit toutefois à faire primer les intérêts égoïstes nationaux des États sur le bien commun, ce que l’on peut désigner par le Syndrome du Buffet (B).
A/ Fondement : la théorie de l’autolimitation des États
Sur Terre, expliqua le Secrétaire général des Nations Unies à son visiteur Martien, l’État est devenu progressivement la forme d’organisation politique privilégiée des sociétés. C’est vrai sur le plan interne, pour organiser les relations sociales au sein d’un peuple. C’est vrai également au plan international : les États sont au cœur de la gouvernance mondiale de l’environnement.
1/ Les États devant le Buffet des ressources naturelles
Dans la conception traditionnelle, le droit international est fait par les États et pour les États. Cette vision est souvent qualifiée de « système westphalien », du nom des traités de Westphalie de 1648 qui ont mis fin à la guerre de Trente ans en Europe. Depuis, l’organisation de la société internationale repose exclusivement sur des relations entre des États égaux et souverains. Historiquement, poursuivit le Secrétaire général, ce système a représenté un progrès : il a permis d’introduire un peu d’ordre dans des relations internationales qui étaient et qui restent encore trop souvent marquées par l’anarchie ou la guerre. Il repose sur un principe majeur : la souveraineté des États.
« Mais », interrogea le Martien, « si chaque État est souverain, s’il ne reconnaît aucune autorité supérieure à lui, comment peut-il être soumis au droit ? ». « C’est effectivement une question délicate », reconnut le Secrétaire général : « comment concilier la souveraineté des États et le caractère obligatoire du droit international ? Nos juristes l’ont réglée par la « théorie de l’autolimitation ». Certes, un État souverain ne saurait se soumettre à une volonté extérieure et supérieure. En revanche, il peut décider librement, par sa propre volonté, de respecter l’ordre juridique international. La pierre angulaire du droit international, la base de son caractère obligatoire, est ainsi l’autolimitation des États. Les normes internationales ne sont obligatoires que parce que les États consentent à s’autolimiter ».
La pierre angulaire du droit international, la base de son caractère obligatoire, est l’autolimitation des États.
yann aguila, marie-cécile de bellis
Cette théorie commande tant l’élaboration du droit international que son application.
2/ Des normes en négociation permanente
S’agissant de son élaboration, cette théorie commande les sources du droit international et, partant, le decision-making process. Le droit international est essentiellement un droit conventionnel, un droit de contrats. Parmi les différents instruments juridiques, les conventions internationales sont privilégiées : parce qu’elles permettent de recueillir systématiquement le consentement des États parties, elles correspondent le mieux à la théorie de l’autolimitation. Même les actes de droit dérivé, c’est-à-dire la grande famille des résolutions et autres décisions adoptées par les organes des institutions internationales, sont marqués par cette conception : alors même qu’ils sont juridiquement des actes unilatéraux, ils sont en pratique des actes négociés entre États. Ils sont d’ailleurs parfois désignés, à tort, sous le nom d’« accords » : tel est le cas par exemple en matière climatique de la décision de la COP 7, de 2001, connus sous le nom d’« Accord de Marrakech » 6, ou encore, en matière de santé, du règlement sanitaire international de 2005, que l’on qualifie parfois d’« accord signé par 196 pays » 7 ou de « traité » 8 alors qu’il s’agit en réalité d’un acte unilatéral adopté par un organe de l’OMS, l’assemblée mondiale de la santé.
Ainsi, dans la gouvernance mondiale de l’environnement, la procédure de décision ou decision-making process suppose de mettre d’accord les 193 États membres des Nations Unies. Tout le processus repose sur la recherche permanente d’un équilibre, entre consensus et compromis. Les diplomates sont souvent confrontés à un dilemme : ils doivent viser soit un accord ambitieux mais, dans ce cas, ne regroupant qu’un nombre limité de pays, soit un accord universel (rassemblant de nombreux pays), mais peu ambitieux (les États ne s’alignant que sur le plus grand dénominateur commun).
3/ La justice internationale en option
S’agissant de l’application du droit international, la théorie de l’autolimitation touche aux mécanismes de sanction : en matière internationale, la justice n’est souvent qu’une simple option. Les mécanismes de contrôle prévus par la plupart des accords internationaux environnementaux relèvent davantage de la conciliation que de la véritable sanction. Ils sont confiés non pas à des juridictions mais à des comités de suivi à caractère administratif, les « compliance committee », dont les pouvoirs sont réduits. Les sanctions, lorsqu’elles sont prévues, sont souvent limitées à des actes purement déclaratifs, le « name and shame ». La saisine de ces comités est en général limitée aux seuls États et à l’administration chargée du suivi de la convention : elle est rarement ouverte aux acteurs non-étatiques.
Cette situation conduit à d’importantes limitations dans l’application du droit international existant : la sanction en cas de non-respect des engagements est rare. Les organes de la convention chargés du contrôle exercent leur mission en intégrant, consciemment ou non, la faculté des États de se retirer à tout moment de l’accord conclu en cas de conflit majeur. Telle est d’ailleurs, releva le Secrétaire Général, la difficulté de ma propre mission et, plus généralement, de celle de l’Organisation des Nations Unies : face à des États qui décident souverainement de suivre ou non les règles du jeu, tout est affaire de force de conviction et de diplomatie.
B/ Limites de la théorie de l’autolimitation : le Syndrome du Buffet
Les limites de la théorie de l’autolimitation peuvent être illustrées par la métaphore du Buffet. Elles expliquent les difficultés à mettre en place un système de gestion désintéressée des biens communs.
1/ Les États devant le Buffet des ressources naturelles
Dans le partage de l’espace mondial et des ressources communes, les États sont comme des invités à un cocktail, placés devant un buffet de nourriture. Ab initio, conscients du caractère limité des ressources, chacun accepte volontiers la règle qu’impose la raison et l’équité, celle d’un partage égal. Dans les deux cas, le mécanisme repose ainsi sur une autolimitation personnelle : chacun s’engage à limiter leur propre consommation afin de garantir l’accès de tous à la nourriture.
Comment ne pas songer au buffet en observant le comportement des États face aux ressources limitées de la planète ? Les appétits nationaux sont tels que l’idée d’une autolimitation trouve rapidement ses limites. La consommation frénétique finit par n’être qu’un moyen de ne pas se voir dépassé par un État concurrent.
yann aguila, marie-cécile de bellis
Mais la théorie de l’autolimitation se heurte à la réalité. Il suffit pour s’en convaincre d’observer le comportement réel des invités face au buffet : la tentation est grande, la nourriture est à portée de main… et chacun se rue sur le buffet pour empiler dans son assiette des quantités de mets sans se préoccuper des autres. Le pire se trouve dans la justification de ce comportement vorace : chacun anticipe le fait que, de toute façon, son voisin ne respectera pas la règle et qu’il vaut donc mieux le devancer pour ne pas se retrouver victime.
Comment ne pas songer au buffet en observant le comportement des États face aux ressources limitées de la planète ? Les appétits nationaux sont tels que l’idée d’une autolimitation trouve rapidement ses limites. La consommation frénétique finit par n’être qu’un moyen de ne pas se voir dépassé par un État concurrent. Si tout le monde vivait comme un habitant des États-Unis, il faudrait 5 planètes 9.
En réalité, les États se trouvent entraînés dans une forme de « course de la Reine rouge ». Dans un épisode d’Alice au pays des merveilles 10, Alice et la Reine rouge se lancent dans une course effrénée et, pourtant, elles n’avancent pas. En effet, explique la Reine, dans ce pays, tout change en permanence et ainsi « il faut courir le plus vite possible pour rester au même endroit ». En biologie, « l’hypothèse de la Reine rouge » explique la nécessité de l’évolution des espèces, comme résultat d’une course à l’adaptation 11. Employée en économie pour décrire la concurrence entre entreprises ou encore dans les relations internationales, à propos de la course aux armements entre États, cette métaphore explique que, dans un environnement compétitif, on s’adapte pour survivre : celui qui n’avance pas recule.
De même, dans la course aux ressources naturelles, les États considèrent leur consommation comme nécessaire pour maintenir leur aptitude face aux autres États, avec lesquels ils sont en concurrence. Ils se voient donc obligés de courir tout simplement pour rester à la même place. Le buffet des ressources naturelles reste donc surexploité par les États, confortés par la pensée magique que les limites invoquées par les scientifiques ne sont qu’une illusion et que le monde est comme une boîte à double-fond qui cache en réalité une quantité infinie de ressources disponibles. Beaucoup mangent comme si le buffet était illimité. Et lorsque la prise de conscience des limites planétaires parvient à s’imposer à certains États, ils semblent manger encore davantage par peur d’en céder au voisin. La règle de l’autolimitation n’est pas adaptée à un tel contexte : elle est perçue comme un désavantage évolutif pour celui qui l’appliquerait.
2/ L’absence de système de gestion désintéressée des biens communs
Certains biens sont utiles à toute l’humanité : les forêts tropicales, les océans, les grandes rivières, l’air ou encore les calottes glaciaires des pôles. Pourtant, notre système de gouvernance interétatique ne parvient pas à mettre en place une gestion désintéressée de ces biens communs.
Les récents feux de forêt en Amazonie ou en Australie ont placé sur le devant de l’actualité la nécessité d’agir. Le visiteur Martien lui-même en avait entendu parler : les dégâts causés par ces incendies étaient visibles depuis sa propre planète. Il s’interrogeait donc sur les mesures qui avaient été mises en place pour préserver les forêts tropicales, réservoirs de carbone et donc véritables « poumons verts » de la Terre.
À nouveau, la réponse du Secrétaire général des Nations Unies fut décevante. Certes, les travaux scientifiques sur la nécessité d’une gouvernance collective de ces biens étaient nombreux. Mais la « tragédie des communs », conceptualisée par Garrett Hardin en 1968 dans son article paru dans Science, semblait inéluctable. Déclinaison du dilemme du prisonnier 12 à la question des bien possédés par tout le monde, cette théorie expliquait que les individus adoptent des stratégies qui semblent rationnelles au plan individuel, mais qui conduisent à des résultats irrationnels sur le plan collectif. Pour cette catégorie particulière de biens dont tous bénéficient, la maximisation immédiate de l’intérêt de chacun entraine paradoxalement une détérioration de la situation sur le plan collectif et une dégradation du bien. La surexploitation entraîne la destruction des biens collectifs.
Pourtant les projets initiés dans ce domaine avaient jusqu’à présent échoué. Même lorsque certains acteurs jouent le jeu de l’autolimitation, ils ne sont ainsi guère aidés dans leur tâche par leurs voisins.
Ainsi en 2007 Rafael Correa, président de l’Équateur, avait fait une proposition novatrice pour gérer une portion nationale de la forêt amazonienne comprenant un gisement de pétrole. Son échec montre que la mise en place d’un tel système d’autolimitation ne peut fonctionner sans la solidarité des pays riches vis-à-vis des pays en voie de développement.
L’Équateur avait découvert d’importants gisements pétroliers 13 dans le parc Yasuni, classé au patrimoine mondial de l’Unesco et recensé comme ayant l’une des plus grandes biodiversités au kilomètre carré du monde. Se posait ainsi la question de la mise en balance de la préservation de l’environnement face à aux intérêts économiques nationaux, en particulier face aux besoins d’un pays en voie de développement.
Le président Correa proposa alors un mécanisme original : l’Équateur acceptait de renoncer à l’exploitation pétrolière sur le parc en échange d’une aide internationale, plus précisément 3,6 milliards de dollars sur 12 ans soit la moitié des revenus que génèrerait l’exploitation du pétrole de Yasuni. Cette contribution permettait ainsi de sauvegarder un pan de l’Amazonie, d’éviter des émissions de gaz à effet de serre et d’aider le pays dans sa transition énergétique, sans pour autant le pénaliser dans son développement économique.
Cette initiative, qui devait « inaugurer une nouvelle logique économique pour le XXIe siècle » selon les mots de Rafael Correa lorsqu’il l’avait présentée devant l’ONU en 2007, reçut rapidement 100 millions de dollars en promesses de don, sous les applaudissements des États et associations de protection de l’environnement. Mais sur les 3,6 milliards de dollars demandés au total, seuls 13,3 millions furent apportés – soit seulement 0,37 % du total. Sans la contrepartie financière promise, le pays décida donc de commencer l’exploitation des gisements situés sous le parc Yasuni.
L’autolimitation n’est rien sans solidarité.
yann aguila, marie-cécile de bellis
Le visiteur Martien retenait cet enseignement que l’autolimitation n’est rien sans solidarité. Plus que jamais, selon la formule de Mireille Delmas-Marty, il convenait de passer « de la souveraineté solitaire à la souveraineté solidaire » 14, c’est-à-dire une souveraineté dans laquelle les États ne se limitent pas à la défense de leurs intérêts nationaux mais se préoccupent également des biens communs.
III/ Pistes de réflexions
Fort logiquement, une fois le constat et le diagnostic opérés, le Martien et le Secrétaire général des Nations Unies poursuivirent leur dialogue en imaginant, avec une certaine dose de naïveté, quelques pistes de solutions. Celles-ci leur semblaient pouvoir être ordonnées autour de deux grandes idées : le retour aux valeurs (A) et la reconnaissance d’un intérêt public mondial (B).
A/ Le retour aux valeurs
Le droit international de l’environnement se limite trop souvent à une approche technicienne. « Peut-être avons-nous oublié que le droit est vecteur de valeurs ? » songea le Secrétaire général.
1/ L’approche technicienne du droit international de l’environnement
Lorsqu’on observe l’état du droit international de l’environnement, il y a un décalage saisissant entre, d’un côté, l’échec des projets ambitieux mentionnés plus haut (Organisation mondiale de l’environnement, Cour internationale de l’environnement, Pacte mondial pour l’environnement) et, d’un autre côté, le foisonnement de textes techniques et sectoriels (en matière de déchets, de produits chimiques, etc). On pourrait y voir un lien de cause à effet. Faute de pouvoir s’entendre sur des enjeux majeurs, on préfère discuter de sujets précis et techniques. C’est d’ailleurs une dérive du droit de l’environnement en général, y compris sur le plan interne : visant à régir un ensemble d’activités économiques industrielles, et reposant sur un arrière-plan scientifique, il a rapidement tendance à devenir un droit de technicien, fait d’annexes, de tableaux chiffrés, de classifications, de statistiques et de formules chimiques. En matière internationale, cette tendance semble comme exacerbée par la lourdeur des bureaucraties et des procédures des organisations internationales.
Cette vision pragmatique présente certains avantages. Certains prônent ainsi, pour la gouvernance internationale de l’environnement, la méthode du « sur mesure » : à chaque problème spécifique doit correspondre une convention sectorielle spécifique. Cette approche permet d’éviter de se diviser sur des débats trop abstraits sur les valeurs, pour se concentrer sur la résolution de problèmes concrets. Elle permet aussi parfois de construire des majorités à géométrie variable selon les questions, certains pays souhaitant avancer sur un sujet mais étant plus réticents pour d’autres domaines.
On peut d’ailleurs faire le parallèle avec la construction européenne : celle-ci s’est faite initialement sur la base d’un projet très concret et délimité, la création d’un marché unique du charbon et de l’acier.
Cette méthode peut présenter une certaine efficacité, dans le court terme. Elle peut fonctionner dans le champ étroit du problème considéré. Elle a toutefois ses limites.
C’est un peu comme si, en droit interne, pour chaque loi on créait un gouvernement spécifique pour en assurer le suivi.
yann aguila, marie-cécile de bellis
D’abord, elle a une conséquence institutionnelle : la fragmentation de la gouvernance mondiale de l’environnement. Si à chaque problème correspond une convention spécifique, il ne faut pas oublier qu’à chaque convention correspond une administration. De nombreuses conventions ont en effet leurs propres organes de suivi : une conférence des parties (COP), un secrétariat exécutif, des bureaux, des comités d’experts, etc. Une convention, ce n’est pas seulement un texte, c’est aussi souvent une administration. C’est ainsi qu’à côté de l’administration du PNUE, à Nairobi, on trouve le secrétariat de la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique à Bonn, ou encore le secrétariat de la convention sur la diversité biologique à Montréal. Certaines de ces administrations comptent plusieurs centaines d’employés. Il s’en suit une multiplication des coûts et une lourdeur des procédures : chacune de ces conventions a sa propre COP, réunissant régulièrement l’ensemble des États parties. C’est un peu comme si, en droit interne, pour chaque loi on créait un gouvernement spécifique pour en assurer le suivi.
Surtout, comme le montre l’histoire de la gouvernance mondiale de l’environnement, comme d’ailleurs celle de l’Union européenne, tôt ou tard apparaît le besoin de poser des valeurs communes.
2/ Le besoin de valeurs communes
À s’en tenir à des règles techniques, on perd la vision d’ensemble, la cohérence du système et, pire encore, l’objectif final de ces règles.
Les juristes connaissent bien l’utilité des principes généraux dans un système juridique. Il ne s’agit pas du simple plaisir de rédiger de belles déclarations de droits. Les principes sont les fondations et le ciment du système, ils font tenir l’édifice debout. Lorsque viendra le jour, inévitable, où les règles deviendront difficiles à appliquer, où leurs destinataires peineront à les respecter, alors ils devront se souvenir des raisons profondes pour lesquelles ils les avaient acceptées. Faute de quoi, la tentation du départ sera grande. Rappelons ici le retrait du Canada face au Protocole de Kyoto. Ou, dans le cas de l’Union européenne, le départ du Royaume-Uni, qui n’est peut-être pas sans lien avec un malentendu initial sur la vraie nature du projet européen. Un peu comme dans un couple : lorsque surgissent les difficultés, il faut se ressourcer dans les valeurs communes.
Le droit est vecteur de valeurs et ces valeurs se traduisent dans des principes juridiques 15. C’est pourquoi dans un État, l’ordre juridique repose sur un ensemble de principes, souvent consacrés dans une Constitution. La consécration de ces principes dans un texte de nature constitutionnelle présente notamment l’avantage de les inscrire dans le temps long : sacralisés, ils sont mis à l’abri des changements conjoncturels de majorité.
Le droit est vecteur de valeurs et ces valeurs se traduisent dans des principes juridiques. La consécration de ces principes dans un texte de nature constitutionnelle présente notamment l’avantage de les inscrire dans le temps long : sacralisés, ils sont mis à l’abri des changements conjoncturels de majorité.
yann aguila, marie-cécile de bellis
Le droit international n’échappe pas à cette exigence.
D’ailleurs, se souvenait le Secrétaire général, les pères fondateurs des Nations Unies ne s’y étaient pas trompés. En 1945, ils avaient commencé par le commencement : les valeurs. En témoignait le souffle des premiers mots de la Charte des Nations Unies « Nous, peuples des Nations Unies… ». Quelle audace, portée par l’espérance d’un monde nouveau ! Comment ne pas faire le rapprochement avec les premiers mots de la Constitution américaine « Nous, le peuple des États-Unis… ». Et comment ne pas se désoler, par comparaison, du manque d’ambition actuel de la gouvernance mondiale de l’environnement et de son approche purement technicienne ?
En réalité, si l’on juge un arbre à ses fruits, il faut se rendre à l’évidence : après des décennies de traités sectoriels techniques, cette méthode n’a pas réussi à endiguer le déclin de la biodiversité et le réchauffement climatique.
L’aggravation de la crise écologique depuis 50 ans ne démontre-t-elle pas l’échec de la politique de la diplomatie des petits pas ? À vouloir n’évoluer que progressivement, on finit par reculer. Les mesures prises demeurent largement en-deçà de l’ampleur nécessaire pour mettre en œuvre un véritable changement. Elles se limitent à des corrections à la marge et des objectifs non appliqués, conservés dans le cadre souple et minimal de la gouvernance mondiale de l’environnement telle qu’elle a été créée il y a plusieurs décennies. Le monde entier est conscient de l’ampleur et de la gravité de la crise écologique et pourtant les actions ne sont pas à la mesure – et même à la démesure de la catastrophe qui s’annonce.
Malgré toute la bonne volonté des diplomates et des fonctionnaires des organisations internationales environnementales, malgré la formidable énergie qu’ils consacrent au service des accords multilatéraux environnementaux, ils ne parviennent pas à enrayer la crise. La raison se trouve dans la conception même de la gouvernance mondiale de l’environnement. En l’absence de principes communs, elle est aujourd’hui comme un édifice sans fondation. Comme un bâtiment que l’on aurait construit en commençant directement par le 1er étage. Comme un pays qui disposerait d’un ensemble de lois nationales techniques mais qui serait dépourvu de Constitution.
Tel est le but du projet de Pacte mondial pour l’environnement : créer un moment constitutionnel, en consacrant les principes fondamentaux de la gouvernance mondiale de l’environnement 16.
Les principes sont comme les étoiles : on ne peut pas les toucher, mais ils montrent la direction.
yann aguila, marie-cécile de bellis
Le Martien écoutait le Secrétaire général avec attention. Puis son regard s’illumina : « J’ai compris » dit-il « les principes sont comme les étoiles : on ne peut pas les toucher, mais ils montrent la direction ».
3/ Le principe des responsabilités communes mais différenciées : l’outil d’un universalisme contextualisé
Il est vrai que, chaque culture produisant son propre système de représentation, il est difficile de dégager un ensemble de valeurs qui pourraient être valables en tous lieux et en tout temps. C’est pourquoi, relève Monique Chemillier-Gendreau « beaucoup d’obstacles se dressent encore cependant sur la voie des valeurs communes qui rendraient possible la réalisation d’un droit réellement international » 17.
Toutefois, de ce point de vue, la crise écologique pourrait être la chance du droit international.
D’abord, le domaine de l’environnement propose une valeur sur laquelle les peuples du monde entier, quelle que soit leur histoire, leur culture ou leur religion, devrait pouvoir réussir s’accorder : la nécessité de préserver la planète, leur maison commune. Même s’il existe des différences d’approche selon les pays, la prise de conscience d’une interdépendance entre l’Homme et la nature se répand progressivement à l’échelle mondiale.
Ensuite, le droit de l’environnement offre un principe matriciel intéressant dans la recherche d’un équilibre entre universalisme et pluralisme : le principe des responsabilités communes mais différenciées.
Consacré pour la première fois en 1992 dans la Déclaration de Rio sur le développement et l’environnement, ce principe vise à prendre en compte « la diversité des rôles joués dans la dégradation de l’environnement » (principe 7 de la Déclaration). Il affirme expressément la double face de la responsabilité des États : certes, elle est commune, de telle sorte que chaque État doit assumer une part du fardeau ; mais elle est différenciée, ce qui conduit à faire peser sur des obligations plus lourdes sur les pays riches, compte tenu de leur part historique dans la pollution de la planète.
C’est essentiellement dans le domaine du climat que ce principe a été consacré. Repris dans l’Accord de Paris, le principe figurait déjà dans la convention-cadre sur les changements climatiques de 1992, qui affirmait dans son préambule que « le caractère planétaire des changements climatiques requiert des pays qu’ils coopèrent le plus possible » tout en précisant « selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation économique et sociale ».
Cette exigence de différenciation en fonction de la diversité des situation concrètes n’est pas sans rappeler l’idée de justice distributive : selon Aristote, la véritable justice consiste à tenir compte des inégalités de fait, pour procéder à une distribution des biens proportionnée aux talents et aux capacités de chacun.
Le principe des responsabilités communes mais différenciées pourrait préfigurer une méthode plus globale pour le droit de la mondialisation, en ce qu’il permet de concilier unité et diversité.
yann aguila, marie-cécile de bellis
Le principe des responsabilités communes mais différenciées permet d’accorder d’un côté, l’objectif général de protection de l’environnement et, de l’autre côté la prise en compte des situations particulières. A cet égard, il pourrait préfigurer une méthode plus globale pour le droit de la mondialisation, en ce qu’il permet de concilier unité et diversité : d’un côté, volonté de se rassembler autour de principes universels communs ; de l’autre, ancrage dans le réel et respect de la diversité des situations.
B/ La reconnaissance d’un intérêt public mondial
Le Secrétaire général des Nations Unies rappela au Martien que les États souverains étaient, jusqu’à présent, les seuls décideurs des normes internationales. Il en découlait que le système normatif international était presque exclusivement fondé sur la représentation des intérêts nationaux des États. Malheureusement, regrettait le chef de la diplomatie onusienne, dans un tel système, personne n’avait intérêt à ce que la situation change. Les rares États qui souhaitaient porter une réforme ambitieuse en matière d’environnement se heurtaient à une convergence des oppositions des pays du Nord et de ceux du Sud. Les pays développés risquaient l’engagement de leur responsabilité pour les pollutions et destructions historiques dont ils avaient tiré profit et ne tenaient pas à devoir contribuer économiquement à la hauteur de leur histoire. Les pays en voie de développement étaient nombreux à miser sur leurs ressources naturelles encore inexploitées pour accélérer leur développement et permettre à leur population d’accéder au confort de vie que les populations des pays développés tenaient pour acquis. Comme dans une sorte de pax nuclearis politique et économique, personne ne tenait à créer le premier une source de responsabilité qui risquerait de lui être opposée immédiatement par un autre État.
Le visiteur extra-terrestre s’étonna de cette exclusivité accordée aux États. Il était bien placé pour savoir qu’il pouvait y avoir des intérêts extérieurs et supérieurs à ceux des États.
1/ L’existence d’un intérêt public mondial, distinct des intérêts particuliers des États
Il est devenu évident de relever que la multiplication des crises transfrontières appelle une réponse à l’échelle globale. La crise écologique ne connaît pas les frontières nationales. Un État, aussi puissant soit-il, ne peux pas lutter seul contre le réchauffement climatique ou la sixième extinction de masse des espèces. Il en va de même pour faire face à la crise économique, au risque terroriste ou à la pandémie de Covid-19.
Pourtant, il semble moins facile de tirer la conséquence de ce constat : il existe bien un intérêt public mondial, qui ne se confond pas avec la somme des intérêts particuliers des États.
Cet intérêt public mondial est le fil rouge sous-jacent des appels à la consécration d’un statut pour les « biens publics mondiaux » ou encore les débats autour la notion de « patrimoine commun de l’humanité » : tous ces concepts pourraient être des éléments fondateurs de la reconstruction d’une gouvernance mondiale de l’environnement en cohérence avec la réalité.
Certes, cet intérêt commun est protéiforme. Son contenu reste indéterminé. Selon les conceptions, il peut recouvrir l’intérêt des seules générations présentes (la communauté des habitants actuels de la planète) ou inclure également l’intérêt des générations futures (l’humanité) ou encore, plus largement, s’étendre à l’intérêt de l’ensemble de la planète (la communauté de vie planétaire).
Mais, moins que le contenu, ce qui importe à ce stade, c’est la force de l’affirmation de cette catégorie juridique : il existe donc un intérêt public mondial qui est distinct de celui des États. Il est différent de la somme des intérêts particuliers des États : cette somme n’aboutit qu’à l’intérêt collectif des États, qui n’est qu’une juxtaposition d’intérêts nationaux. Il ne faut pas confondre intérêt collectif et intérêt public.
Si cet intérêt est mondial, il faut aller au bout de la logique et en affirmer les attributs : l’intérêt public mondial est supérieur et extérieur à l’intérêt des États.
yann aguila, marie-cécile de bellis
À terme, une telle affirmation porte donc en elle une relecture de la notion de souveraineté. Il ne s’agit pas de la remettre en cause, mais il convient de la mettre à sa juste place : elle ne saurait être absolue. Elle est relative et rencontre une limite : le respect de l’intérêt public mondial. En outre, cette affirmation pourrait permettre de fonder la force intrinsèque du droit international.
Surtout, si cet intérêt est mondial, il faut aller au bout de la logique et en affirmer les attributs : l’intérêt public mondial est supérieur et extérieur à l’intérêt des États. À terme, une telle affirmation porte donc en elle une relecture de la notion de souveraineté. Il ne s’agit pas de la remettre en cause : la souveraineté est essentielle aux États comme la liberté l’est pour les individus. Mais il convient de la mettre à sa juste place : elle ne saurait être absolue. Elle est relative et rencontre une limite : le respect de l’intérêt public mondial. En outre, cette affirmation pourrait permettre de fonder la force intrinsèque du droit international : le caractère obligatoire des normes internationales ne viendrait pas d’une autolimitation des États, mais découlerait des exigences de l’intérêt public mondial.
Se pose alors la question de savoir qui peut représenter l’intérêt public mondial.
2/ La difficile représentation de l’intérêt public mondial par les États
En l’état du mode de décision dans la gouvernance mondiale, les États étant les principaux acteurs, on peut d’abord songer à confier aux États le soin de porter cet intérêt public mondial. C’est ce que reflète le concept de souveraineté solidaire de Mireille Delmas-Marty : « L’idée sous-jacente est en effet que les États sont souverains pour défendre leurs intérêts nationaux, certes, mais aussi pour défendre l’intérêt commun de l’humanité » 18.
Cette prise en compte de l’intérêt mondial par les États eux-mêmes est à la fois possible et éminemment souhaitable. Elle peut se faire en particulier par les juridictions nationales. À cet égard, le Conseil constitutionnel a rendu le 31 janvier 2020 une décision remarquable 19. Était en cause l’interdiction d’exporter certains pesticides dans des pays tiers – mesure instituée en vue de protéger ces derniers. En se fondant sur la notion de « patrimoine commun des êtres humains » consacrée au préambule de la Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel juge que la protection de l’environnement suppose la prise en compte les effets extraterritoriaux des activités exercées sur le territoire national.
Cette solution peut se prévaloir d’un certain pragmatisme : à court terme, faute d’une autorité mondiale puissante représentant l’intérêt commun, il faut faire en sorte que ce dernier soit pris en compte par les puissances nationales. Cette mission assignée à l’autorité n’est pas sans rappeler le rapport entre la justice et la force dans les Pensées de Pascal 20.
Surtout, on pourrait relever que, loin de s’opposer, les deux intérêts convergent : l’intérêt bien compris des États rejoint en grande partie l’intérêt commun. A cet égard, si par une sorte d’aveuglement sur leur propre intérêt, certains États privilégient parfois le court terme, en exploitant de façon abusive leurs propres ressources naturelles, ils ne peuvent ignorer leur intérêt futur : la destruction de l’environnement engendre des coûts croissants qui pèseront sur tous, que ce soit au travers du changement climatique, de l’effondrement de la biodiversité, de l’assèchement de terres arables ou de l’épuisement des ressources. La perte de productivité mondiale liée au changement climatique a déjà été estimée à 2.000 milliards de dollars par an à l’horizon 2030, d’après un récent rapport de l’ONU 21.
Loin de s’opposer, les deux intérêts convergent : l’intérêt bien compris des États rejoint en grande partie l’intérêt commun. Si par une sorte d’aveuglement sur leur propre intérêt, certains États privilégient parfois le court terme, en exploitant de façon abusive leurs propres ressources naturelles, ils ne peuvent ignorer leur intérêt futur.
yann aguila, marie-cécile de bellis
Toutefois, l’expérience montre que les États ne sont malheureusement pas toujours enclins à défendre l’intérêt public mondial. En cas de tension, ils privilégient généralement leur propre intérêt national.
Cette difficulté se retrouve devant la Cour suprême des États-Unis. Dans une affaire Kiobel, en 2013, citée par Mireille Delmas-Marty dans l’article précité, une opinion dissidente avait émis l’idée que la notion d’intérêt américain pouvait être élargie au point d’englober l’intérêt mondial. Cet opinion, portée par le juge Breyer, reposait sur le concept d’« ennemi du genre humain », posé par un texte de 1789, l’« Alien Tort Act », afin de fonder une extension de la compétence des juridictions américaines, à l’époque aux pirates et aujourd’hui aux violations des droits de l’homme commises à l’étranger. Mais la Cour suprême n’a pas suivi ce raisonnement : selon elle, « US Law does not rule the world » (le droit américain ne régit pas le monde) 22.
De même, le decision-making process aux Nations Unies illustre les difficultés de prise en compte d’un intérêt commun par les États. Dans les enceintes internationales, le mode de décision qui prévaut est celui du consensus. Théoriquement, bien comprise, cette méthode s’inscrit dans cette perspective : un État qui pourrait être réservé sur une proposition choisit de taire son opposition et de s’abstenir, au profit de l’intérêt commun. L’abstention est privilégiée sur l’opposition, ce qui permet aux États qui le souhaitent d’aller de l’avant. Mais l’expérience montre les limites de la méthode du consensus. Ainsi en est-il des discussions du projet de Pacte mondial pour l’environnement : alors que la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies ouvrant les négociations avait été adoptée par une écrasante majorité (143 voix pour, 5 contre), le premier round de négociations à Nairobi en 2019 s’est soldé par un blocage dû à l’opposition de certains États : ces derniers, minoritaires mais puissants (on y trouvait les États-Unis et la Russie), réclamaient avec force que la méthode du consensus soit appliquée.
Autre exemple, le Brésil seul a réussi à bloquer le processus de décision permettant de voter le budget 2021 de la Convention sur la diversité biologique pendant plusieurs semaines – compromettant ainsi la tenue de la 15e Conférence des parties sur la biodiversité (COP15). Ce budget, devant être voté avant le 31 décembre de chaque année sous peine d’empêcher le secrétariat de la COP de pouvoir travailler à partir du 1er janvier suivant, fait l’objet d’une procédure d’accord tacite dans laquelle le silence des États vaut consentement. En brisant le silence traditionnel, le Brésil a unilatéralement entravé le processus de décision pour les 196 États parties.
Cet exemple montre le risque que l’exigence du consensus ne soit détournée de son objet : initialement destinée à permettre de faciliter l’émergence d’un intérêt commun, elle peut être interprétée comme une exigence de quasi-unanimité et déboucher finalement sur une tyrannie de la minorité.
Cette méthode est particulièrement paralysante dans une société internationale de près de 200 États. Certes, il est parfois possible à un groupe d’États de décider d’agir ensemble sans attendre les autres États. Mais dans le domaine de l’environnement, les négociations interétatiques se doivent souvent d’accorder toutes les parties. Il est difficilement concevable par exemple, en matière climatique, que les grands pays ne soient pas soumis à l’effort collectif. Ainsi, le retrait de l’Accord de Paris des États-Unis, premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, était-il de très mauvais augure pour le succès de ce traité.
Au total, il est difficile de compter sur les États pour privilégier l’intérêt public mondial sur leurs intérêts nationaux.
3/ Les autres modalités de représentation de l’intérêt public mondial
Même si les États jouent un rôle nécessaire, il n’est pas sain qu’ils soient les dépositaires exclusifs de l’intérêt mondial. Dans la tradition des checks and balances, il faut mettre en place des contrepoids pour éviter les risques d’abus liés à l’exercice de la souveraineté.
La première solution vise à renforcer le rôle des acteurs non étatiques sur la scène internationale.
Il existe sur ce sujet un décalage entre la pratique et le droit. En pratique, on observe une montée en puissance des acteurs non étatiques, collectivités territoriales, ONG, scientifiques, acteurs économiques : tous sont présents dans les forums internationaux en matière d’environnement. En droit, toutefois, ils n’ont pas de véritable existence dans le decision making process, qui ne reconnaît officiellement aucune autre institution que les États et certaines organisations internationales dans l’édiction de normes internationales. Les acteurs non étatiques ne sont pas des sujets du droit international.
Les acteurs non étatiques ne sont pas des sujets du droit international. Pourtant, ces entités jouent un rôle important dans son application même.
yann aguila, marie-cécile de bellis
Pourtant, ces entités jouent un rôle important dans l’application même du droit international. En témoigne la formidable mobilisation des villes et entreprises américaine lorsque les États-Unis ont annoncé leur retrait de l’Accord de Paris. La United States Climate Alliance est ainsi créée en juin 2017, regroupant 24 États fédérés et 2 territoires américains s’engageant à respecter les engagements américains de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour la première fois, des acteurs non étatiques allaient jusqu’à se substituer à un État défaillant en vue de respecter un traité que ce dernier avait pourtant signé.
Certains de ces acteurs infra-étatiques, même s’ils ne sont pas des États, disposent d’ailleurs d’une forte légitimité en ce qu’ils représentent des groupes de population. Tel est évidemment le cas des collectivités territoriales, qui incarnent les habitants d’un territoire donné. Tel est aussi souvent le cas d’organisations associatives, économiques ou sociales, qui représentent pour leur part des corps intermédiaires. On peut y voir de véritables institutions, au sens large du terme. En considérant ces entités comme de simples individus, et en les laissant exclues du système institutionnel international, la gouvernance mondiale ignore leur influence réelle et leur pouvoir de représentation. La fiction juridique d’une scène internationale uniquement peuplée d’États n’est plus adaptée à la réalité du monde.
Une seconde solution consiste à renforcer le rôle des organisations internationales. En toute rigueur, ce sont elles qui ont une vocation naturelle à porter l’intérêt public mondial. Or, leur rôle dans le processus normatif n’est pas toujours clairement affirmé.
On peut d’abord penser à leur conférer des attributions plus directes dans l’élaboration des traités. Dans ce domaine, leur mission se limite souvent à un travail d’ordre technique, d’animation de groupes de travail ou d’élaboration de plans d’action : on peut mentionner par exemple le programme de Montevideo qui est géré par l’UNEP. Pour aller plus loin, pourquoi ne pas donner au Secrétaire Général des Nations Unies un véritable pouvoir de proposition en matière de traités ? Dans la procédure actuelle seuls les États disposent d’une telle prérogative. Plus largement, pourquoi ne pas conférer aux secrétariats exécutifs des différentes conventions multilatérales environnementales des prérogatives renforcées dans le processus d’élaboration des normes ? Par analogie avec l’Union européenne, on peut imaginer une pluralité d’institutions impliquées dans la « fabrique des normes », chacune d’elle représentant des intérêts différents : le Conseil européen représente les États, et la Commission européenne, gardienne l’intérêt de l’Union, dispose d’un pouvoir de proposition.
Pourquoi ne pas conférer aux secrétariats exécutifs des différentes conventions multilatérales environnementales des prérogatives renforcées dans le processus d’élaboration des normes ? Par analogie avec l’Union européenne, on peut imaginer une pluralité d’institutions impliquées dans la « fabrique des normes », chacune d’elle représentant des intérêts différents.
yann aguila, marie-cécile de bellis
On peut aussi renforcer plus directement le pouvoir normatif des organisations internationales. Il s’agirait, parmi les diverses sources du droit international, d’accorder une place plus importante aux actes de droit dérivé, c’est-à-dire aux actes directement édictés par les organisations internationales. Ses actes peuvent en effet être adoptés par les organes délibératifs des organisations internationales à la règle de la majorité, parfois qualifiée. A la différence des traités, ils n’exigent pas nécessairement de recueillir l’accord de la totalité des États concernés. On peut citer à titre d’exemple le mécanisme original prévu la « Constitution » de l’OMS (son traité constitutif) pour l’adoption du règlement sanitaire international, instrument international à caractère obligatoire : d’une part, il est adopté par l’organe délibératif de l’OMS, l’Assemblée de la santé, à la majorité des deux tiers (article 19) ; d’autre part, il entre en vigueur pour tous les États membres, à l’exception de ceux qui ont fait connaître leur refus dans un certain délai. Cette procédure subtile, mêlant règle de majorité et exigence de consentement, constitue un modèle et préfigure le type d’évolution que pourrait connaître la gouvernance mondiale de l’environnement pour être plus efficace.
Conclusion
Au moment de partir, le Martien s’aperçut d’une lacune. S’il avait identifié quelques solutions possibles, il ne s’était pas penché sur la question la plus difficile : l’art de la réforme. Comment des changements d’une telle envergure pourraient-ils être acceptés et mis en œuvre par les États ? L’histoire des Terriens montraient malheureusement qu’il avait souvent fallu la survenance de catastrophes pour provoquer des remises en cause profondes. Il avait fallu le choc de la Première Guerre mondiale pour susciter la création de la Société des Nations. Il avait fallu les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah pour aboutir à l’adoption de la Charte des Nations Unies et, quelques années plus tard, à la Déclaration universelle des Droits de l’homme. Combien d’espèces disparues, combien d’ouragans, combien de réfugiés climatiques, combien de villes rayées de la carte par la montée des eaux allait-il falloir aux Terriens pour se décider à agir ?
Le visiteur Martien se leva, se dirigea vers la porte pour quitter le bureau du Chef des Nations Unies. Puis, se ravisant un instant, il se retourna vers le Secrétaire général et lui dit, comme pour lui livrer un dernier message : « Votre planète est belle. Vue du ciel, elle n’a pas de frontières ».
« Votre planète est belle. Vue du ciel, elle n’a pas de frontières ».
yann aguila, marie-cécile de bellis
Les réflexions de notre ami Martien étaient sans doute trop naïves. Là où la raison et le sens de la mesure ont jusqu’à présent échoué à réformer la gouvernance mondiale de l’environnement, comment un visiteur venu d’une autre planète pourrait-il réussir ? Mais, porté par l’élan d’un certain optimisme, on se prend parfois à croire que de tels changements finiront par s’imposer par eux-mêmes, ou par la force des faits. On se prend à espérer qu’on pourra un jour briser ce mur invisible contre lequel buttent les politiques ambitieuses pour protéger la nature.
D’aucuns soutiendront peut-être que le temps présent est mal choisi pour une telle révolution et qu’il faut faire confiance à l’avenir. Ils estimeront, de façon sans doute réaliste, que le rêve d’un monde soumis à des règles de gouvernance fortes est hors de portée à court terme. Il est simplement à craindre qu’à attendre encore un moment meilleur pour changer de modèle, le Martien n’aura plus grand-chose à observer lors de son prochain passage au-dessus de la Terre.
Sources
- Cet article ne sera pas sans rappeler aux juristes français de droit public un fameux article du professeur Jean Rivero, auquel les auteurs rendent hommage (Jean Rivero, « Le Huron au Palais-Royal ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir », Dalloz, 1962, Chronique VI, p. 37-40).
- Les règles académiques sur la planète Mars privilégiaient en effet le plan en trois parties.
- Rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 13 décembre 2018, « Lacunes du droit international de l’environnement et des textes relatifs à l’environnement : vers un pacte mondial pour l’environnement », rapport A/73/419, disponible en ligne sur le site des Nations Unies. Les mêmes constats étaient dressés en 2015 dans le rapport d’un Think-tank français, le Club des juristes, sur la nécessité de « renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement » (rapport de la Commission Environnement du Club des juristes « Renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement : devoirs des États, droits des individus », novembre 2015, disponible en ligne sur le site du Club des Juristes).
- P. Sands, Principles of International Environmental Law. 2nd Edition, Cambridge University Press, p. 187 : « It is a trite observation that environmental problems, although they closely affect municipal laws, are essentially international ; and that the main structure of control can therefore be no other than that of international law ».
- 5e rapport sur les Perspectives mondiales de la diversité biologique (GBO-5), disponible en ligne sur le site de la convention sur la diversité biologique.
- Voir le site de la Convention-cadre sur les changements climatiques.
- Voir le site d’un centre de recherche au Canada.
- Voir le site Wikipedia en anglais, à la rubrique « International Health Regulations ».
- Source : Global Footprint Network.
- Cet épisode est tiré plus précisément de « De l’autre côté du miroir », deuxième volet du livre fameux de Lewis Carroll.
- L’hypothèse de la Reine rouge est proposée par Leigh Van Valen, biologiste américain du XXe siècle. Dans un environnement en modification constante, le comportement d’une espèce influence celui des autres : dès lors, pour éviter l’extinction, une espèce doit s’adapter aux évolutions des autres espèces.
- Le dilemme du prisonnier a été proposé en 1950 par Albert W. Tucker, un mathématicien américain, dans le cadre de la théorie des jeux. Il illustre la situation dans laquelle des joueurs auraient en réalité intérêt à coopérer, mais où, étant mal informés en l’absence de communication entre les joueurs, chacun choisit de trahir l’autre.
- Plus de 920 millions de barils de pétrole, soit 20 % des réserves de l’Équateur, avaient été découverts.
- Voir notamment « De la souveraineté solitaire à la souveraineté solidaire », Mireille Delmas-Marty, présentation faite au Collegium International du 25 juin 2014 (http://www.collegium-international.org/fr/) ou plus récemment dans cette revue M. Delmas-Marty, « Gouverner la mondialisation par le droit », Revue européenne du droit, septembre 2020.
- Les principes remplissent diverses fonctions dans un système juridique : une « fonction interprétative » (ils peuvent inspirer l’interprétation de certaines dispositions), une « fonction conciliatrice » (en cas de contradiction entre des normes, les principes offrent une matrice conceptuelle qui aide à concilier des exigences contradictoires) ou encore une « fonction supplétive » (en permettant d’offrir une base juridique au raisonnement, même en l’absence de règles précises).
- Voir le site du Pacte.
- Humanités et souveraineté, Essai sur la fonction du droit international, in chapitre 14. « À la recherche de valeurs communes », Monique Chemillier-Gendreau, La Découverte, 1995, p. 330.
- M. Delmas-Marty, « De la souveraineté solitaire à la souveraineté solidaire », op. cit.
- Cons. const., décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes.
- B. Pascal, Les pensées, 1670 : « La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique (…). Ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste ».
- “Climate change and labour : impacts of heat in the workplaceclimate change, workplace environmental conditions, occupational health risks, and productivity –an emerging global challenge to decent work, sustainable development and social equity”, UNDP, 2016.
- V. sur ces points : S. Breyer, La Cour suprême, le droit américain et le monde, préf. G. Canivet, Odile Jacob, 2015, p. 382.