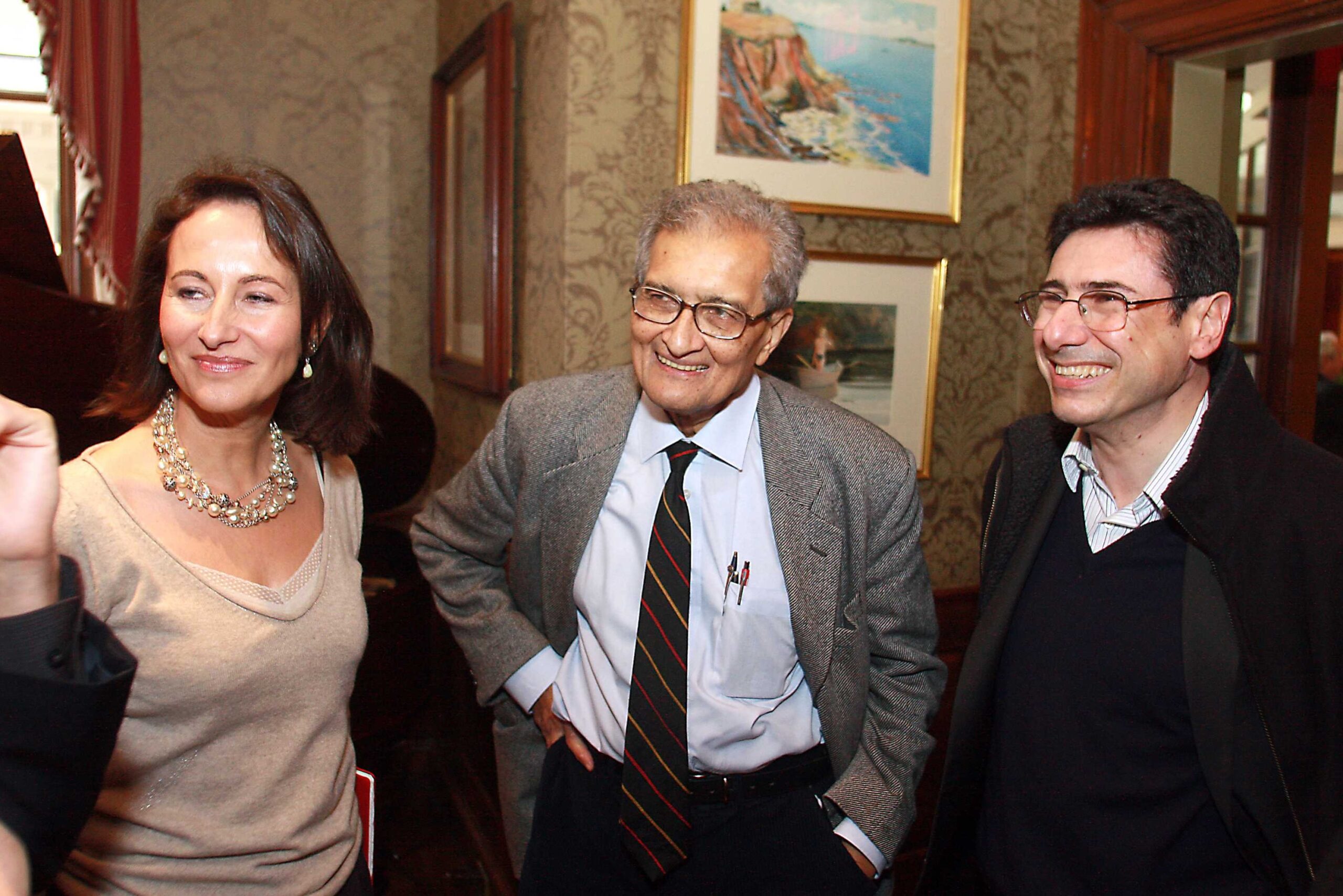Vous souhaitez soutenir la première revue européenne indépendante ? Découvrez nos offres et abonnez-vous au Grand Continent
Comment votre trajectoire intellectuelle vous a-t-elle mené à la question de la croissance, de l’innovation et de son rôle central pour le développement des économies modernes ?
Je suis venu à l’économie par la politique.
La pauvreté était mon obsession — et la question lancinante : comment sortir de la pauvreté ? À un moment donné, j’ai compris qu’on ne peut pas sortir de la pauvreté sans avoir de la croissance — ou du moins que c’est très compliqué. Alors, comment peut-on rendre cette prospérité partagée ? Il y avait donc un peu l’idée issue de mon passé politique à gauche de dire : je veux sortir les gens de la pauvreté et je veux que cela soit partagé.
On apprenait avec le modèle de Solow qu’il fallait quelque chose qui s’appelait le progrès technique.
On ne voyait pas trop d’où ça venait.
D’autre part, Schumpeter parlait de destruction créatrice — mais il n’y avait pas de modèle schumpétérien.
Schumpeter était une curiosité dans les cours de l’histoire de la pensée économique, ou bien dans le cours d’IO 1. Je me souviens du cours d’IO avec Richard E. Caves à Harvard en 1984, lorsqu’il avait mentionné que Schumpeter n’avait pas de modèle auquel se raccrocher… C’est à ce moment je pense que m’est venue l’idée de faire un modèle qui incorpore la destruction créatrice.
Ayant étudié beaucoup l’IO, j’avais une idée fixe : mettre l’IO dans la croissance.
Dès 1982, dans mon statement pour Harvard, j’avais dit que je voudrais intégrer la concurrence imparfaite dans la croissance. Il devait y avoir quelque chose à trouver. Lorsque je suis arrivé au MIT en 1987 comme professeur associé, Peter Howitt était visiteur de Western Ontario pour un an. Il avait son bureau à côté du mien et j’y suis allé un jour pour lui dire : « Écoute, tu as une formation de macroéconomiste, moi, je suis plutôt micro. Pourquoi ne pas essayer de se mettre ensemble et de faire un modèle de croissance schumpétérien ? »
Je voulais comprendre les ressorts de la prospérité — et je sentais que Schumpeter avait raison, mais je devais trouver un modèle testable et falsifiable.
On avait l’idée décrite par Schumpeter effectivement — mais pas de modèle. Et donc aucune manière de l’intégrer dans le reste de la discipline telle qu’elle progressait…
Ce n’était pas mainstream du tout !
En cours de macro, on n’étudiait pas Schumpeter.
En cours de base de micro et de macro, on n’avait pas de modèle de croissance schumpétérien. Cela n’existait pas.
Il y a quelques années, en 2018, l’économiste Paul Romer a néanmoins obtenu le prix Nobel pour la croissance endogène avec le modèle de compétition monopolistique. Est-ce que vous pourriez expliquer la différence par rapport au vôtre — le modèle schumpétérien ?
L’idée de Romer est qu’en innovant, on arrive à une meilleure division du travail, ce qui crée ensuite de la croissance.
La division du travail empêche d’avoir des rendements décroissants du capital au sein de chacun des secteurs. Donc, en divisant de plus en plus, on évite les rendements décroissants. C’est donc un modèle de croissance très youngien — issu de Allyn Young, qui s’était inspiré d’Adam Smith sur la division du travail — qui arrivait à générer de la croissance par une amélioration, en trouvant de nouvelles idées qui permettent de diviser de mieux en mieux.
Je voulais comprendre les ressorts de la prospérité — et je sentais que Schumpeter avait raison, mais je voulais trouver un modèle testable et falsifiable.
Philippe Aghion
Ce modèle mérite le prix Nobel qu’il a eu, évidemment.
Ce qui manquait toutefois, c’est que, dans la croissance, il y a de l’entrée et de la sortie. Il faut du turnover. Or dans le modèle de Romer, il n’y en avait pas. Ni de l’hétérogénéité d’ailleurs — tout le monde est pareil. Or on sait bien qu’il y a des entrants et des incumbents, des petites et des grosses entreprises, des leaders et des followers. Nous sommes dans un monde d’hétérogénéité. Tout ce qui fait la dynamique — firm dynamics, en anglais— n’est pas dans le modèle de Romer.
Notre paradigme fonctionne avec beaucoup d’autres, puisque nous avons fait un modèle de step-by-step innovation que d’autres ont beaucoup utilisé. Le papier de Klette et Kortum en 2004 2 avait été très important, introduisant les firm dynamics pleinement dans le modèle schumpétérien.
Nous avons ouvert une voie qui a été fructueuse parce que non seulement il y a eu des développements théoriques très utiles — qui ont permis de voir la relation entre concurrence, IO et croissance dans le modèle de step-by-step innovation — mais nous avons en plus pu réconcilier la croissance avec des hypothèses bien connues — comme le fait que la distribution de la taille des entreprises est très asymétrique, que le taux d’exit des petites entreprises est plus grand que celui des grandes entreprises, qu’il y a une relation positive entre l’âge et la taille des entreprises, etc…
Nous avons ouvert un champ de la théorie de la croissance qui permet d’intégrer toutes ces questions et de tester la théorie de la croissance avec des données micro, c’est-à-dire des données d’entreprises. Auparavant, le modèle de Solow sans rendements décroissants faisait des cross-country growth regressions. Aujourd’hui, ces papiers ne seraient jamais publiés ; la croissance se teste : il y a un dialogue permanent entre nos théories et de nouvelles données microéconomiques, alors qu’avec Romer, cela n’était pas possible.
Un point central dans le modèle schumpétérien et dans votre modèle est celui des profits, qui relève d’une tradition « autrichienne » — assez lointaine de votre propre tradition politique. Dans celle-ci, l’entrepreneur, avec son innovation et ses profits individuels, vient perturber le modèle économique existant avec une innovation et fait des profits qui n’existent pas à la marge dans le modèle le plus traditionnel de concurrence parfaite.
Cette dimension était également présente dans les travaux de Romer.
Personnellement, je ne connaissais pas du tout le modèle Romer quand j’ai travaillé avec Peter Howitt en 1987. La différence, chez nous, c’est la contradiction au cœur du processus de croissance dans le modèle schumpétérien.
D’un côté, pour motiver l’innovation il faut des profits issus des rentes d’innovation.
Mais de l’autre, les innovateurs d’hier sont tentés d’utiliser leurs rentes pour empêcher de nouvelles innovations, parce qu’ils ne veulent pas être eux-mêmes sujets à la destruction créatrice. Cette contradiction est au cœur du processus de croissance, ce qui donne lieu à une économie politique de la croissance.
Schumpeter lui-même était très soucieux du risque que les premiers innovateurs deviendraient des entrenched incumbents qui empêcheraient le processus de se perpétuer. C’est alors que la politique de concurrence et les gouvernements jouent un rôle très important, mais ces gouvernements peuvent aussi être achetés par les entreprises en place pour justement ne pas mettre en œuvre ces politiques de concurrence. Du coup, la société civile devient aussi cruciale pour contrôler les gouvernements.
Aujourd’hui, il y a deux manières de croître pour un pays. On peut d’une part être à la frontière, c’est-à-dire avoir un maximum d’entreprises qui sont ces innovateurs, qui vont faire le dernier step, qui vont même aller au-delà de la frontière. Mais il y a aussi l’imitation pour des pays qui sont au niveau du middle et du low income — et qui doivent encore rejoindre la frontière. Y a-t-il toujours intérêt à être à la frontière — ou pas ?
Depuis Deng Xiaoping, la Chine a connu une croissance de rattrapage.
Elle n’était pas à la frontière, mais elle a absorbé et imité des technologies plus avancées.
Elle avait des institutions qui le permettaient. Je mets souvent l’accent sur la réallocation de facteurs — de la campagne à la —ville, sur l’absorption, sur les transferts de technologies, ainsi que les gros investissements.
Mais à un moment donné, les pays qui commencent à rattraper épuisent les sources du rattrapage et doivent passer à une croissance par l’innovation à la frontière, c’est-à-dire innover eux-mêmes au lieu de rattraper. Cela nécessite d’autres institutions, dont la concurrence, qui est très importante.
Quand il y a plus de concurrence, on innove plus. Quand le pays adopte la stratégie du rattrapage, ce n’est pas très grave de ne pas avoir beaucoup de concurrence. À l’inverse, dans l’innovation à la frontière, elle est très importante, car tout le monde se fait la course. C’est ce qu’on appelle l’émulation neck-and-neck.
L’idée que la distance à la frontière module les politiques publiques pertinentes est un point vraiment central dans votre chaire.
En effet.
Pendant la phase de rattrapage se développent souvent de grosses entreprises — comme les chaebols en Corée, les keiretsus au Japon — qui non seulement inhibent l’entrée de nouvelles entreprises innovantes, mais qui font pression sur les gouvernements pour ne pas passer à un monde avec plus de concurrence.
Elles bloquent le passage nécessaire d’institutions qui favorisent le rattrapage à des institutions et politiques qui favorisent l’innovation à la frontière. Le risque est ainsi de tomber dans le syndrome dit du middle income trap.
En termes sectoriels, on a l’impression que le modèle schumpétérien s’applique très bien au développement des médicaments, aux startups de la tech, etc. Mais est-ce que les secteurs de services à la personne — ceux qui connaissent les effets de la « maladie des coûts » et de la loi de Baumol — sont des secteurs dans lesquels l’avancée de la frontière par l’innovation step by step est également possible ? Ou est-ce qu’on doit penser qu’au fur et à mesure que ces secteurs de services représentent une plus grosse part de l’économie, le rôle de l’innovation sectorielle deviendra plus limité ?
Non — parce qu’il existe déjà de l’innovation dans les services !
L’innovation devient souvent plus qualitative, moins quantitative. C’est ce qu’on voit dans nos travaux avec Fabrizio Zilibotti.
C’est une innovation continue, mais elle se mesure plus difficilement dans le PIB, elle est davantage orientée vers la qualité (quality-driven) que vers la quantité.
Pourtant, elle contribue bel et bien à améliorer les standards de vie.
On peut réconcilier politique industrielle et politique de concurrence : la DARPA est un des moyens de le faire.
Philippe Aghion
En parlant de standards de vie, l’une des grandes questions aujourd’hui concerne l’articulation entre croissance et soutenabilité environnementale. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de la croissance verte, de la taxe carbone ou des subventions à l’innovation verte. Quelles sont les leçons aujourd’hui en termes de politiques publiques ou en termes d’institutions pour concilier soutenabilité environnementale et croissance ?
Je dirais qu’il y a des politiques.
Les Chinois ont privilégié la politique industrielle verte, et les Américains aussi, avec l’Inflation Reduction Act en particulier, même s’il est un peu mis à mal en ce moment. Les Européens ont privilégié la taxe carbone, mais on a vu avec les Gilets jaunes qu’il y avait des limites à cette méthode — elle peut devenir très rapidement insupportable.
Je dirais qu’il faut les deux parce qu’il y a deux types d’externalités en jeu.
D’abord il y a les externalités environnementales comme la pollution. Mais il y a aussi des externalités technologiques, dans la décision d’innovation. On sait que les entreprises qui ont beaucoup innové dans le passé dans les technologies polluantes continuent spontanément d’innover dans les technologies polluantes. C’est ce qu’on appelle la path dependence.
Face à ces deux types d’externalités, il faut au moins deux instruments. Les travaux que j’ai faits montrent qu’il faut à la fois de la taxe carbone et une subvention à l’innovation verte ou politique industrielle verte. La politique industrielle est d’autant plus importante quand il s’agit de chaînes de valeurs — par exemple la voiture électrique, la batterie, les composants clean des batteries… La taxe carbone ne suffira pas.
Et en termes de politique industrielle ?
C’est là que le modèle de la DARPA — l’Agence pour les projets de recherche avancée de défense aux États-Unis — intervient.
Le fonctionnement de la DARPA repose sur l’argent provenant du ministère de la Défense, et donc sur des chefs d’équipe, qui ont des moyens et qui suscitent des projets concurrents. Donc, il y a une partie top–down, car ils choisissent le secteur, mais il y a aussi une partie bottom-up, c’est-à-dire qu’ils ne prennent pas une seule entreprise, mais laissent plusieurs entreprises venir.
On peut donc réconcilier politique industrielle et politique de concurrence : la DARPA est l’un des moyens de le faire.
Les Chinois en ont un autre — encore plus compétitif. Ils sélectionnent plusieurs entreprises et puis voient qui se débrouille le mieux.
Cela nous conduit à la question du lien entre innovation, entreprises et universités. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de l’autonomie des universités et de l’effet qu’elle peut avoir sur l’innovation. Dans votre longue carrière qui vous a mené dans au moins quatre à cinq pays avec des environnements institutionnels universitaires différents, avez-vous pu observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le monde universitaire pour l’innovation et pour l’éducation ?
Ce qui fonctionne bien pour la production académique, c’est l’autonomie des universités.
Avec un gouvernement qui dicte ce qu’il faut faire, cela ne fonctionne pas.
J’ai fait un certain nombre de travaux, à la fois sur les données américaines et sur les données européennes, montrant qu’il est important de donner de l’autonomie — liberté de choix de chercheurs, de budget et de son allocation — aux universités.
Deuxièmement, il est important d’avoir des gouvernances où d’un côté il y a le Sénat académique composé de professeurs qui décident de la politique au jour le jour, et de l’autre, un Board qui est constitué d’anciens alumni ou d’entrepreneurs. Cette séparation du Board est importante, car il élit le président de l’université. Je ne pense pas que ce soit aux étudiants ou aux professeurs de le faire. Autant il faut que les étudiants puissent évaluer leurs professeurs pour améliorer leurs performances, autant leur rôle n’est pas de choisir la direction.
Je pense qu’avec la structure bicéphale — Board académique d’un côté, Sénat de l’autre — et l’autonomie dont je parlais, il y a plus de chances d’avoir des bons résultats à l’université.
Évidemment, il faut aussi un bon financement.
Dans les universités, comment concilier innovation et frontières technologiques d’une part, et éducation et transmission des savoirs de l’autre ?
Cela dépend.
Certaines universités sont très bonnes en recherche ; d’autres sont meilleures pour l’enseignement.
Il y a ce qu’on appelle des liberal arts colleges par exemple, qui ont davantage développé leur enseignement et d’autres universités qui sont davantage tournées vers la recherche.
C’est aussi une division du travail : l’important est d’avoir l’excellence dans l’un ou dans l’autre.
Je crois en une fiscalité raisonnablement redistributive.
Philippe Aghion
En termes de valorisation des brevets et du travail académique, on sait que les États-Unis sont très désireux d’encourager les innovateurs.
Oui, ils ont les Bureaux de transfert de technologie par exemple — que nous n’avons pas ici.
Est-ce que l’Europe a des choses qui ressemblent — ou bien a-t-elle encore beaucoup de marge de progrès ?
Elle pourrait progresser là-dessus, en ayant plus d’incubateurs et de Bureaux de transfert de technologie. Les LabEx — analysés dans le papier sur les laboratoires d’excellence de mon ami Antonin Bergeaud — ont très bien fonctionné en France.
Ces laboratoires d’excellence ont reçu un financement sur dix ans, avec un jury international, ce qui a stimulé l’innovation de rupture dans les industries technologiques géographiquement situées en France. C’est une expérience très intéressante à généraliser.
Aujourd’hui, l’exemple de la recherche sur l’IA aux États-Unis donne l’impression que l’innovation de rupture se déplacerait hors des universités pour rejoindre le secteur privé, car entraîner les IA est très coûteux et les universités manquent de plus en plus de moyens. Y a-t-il un risque ? Est-ce que certaines innovations se développent mieux dans les universités et d’autres mieux dans le secteur privé ?
Je ne peux pas généraliser, car je pense que les deux types de recherche sont essentiels.
Sans doute la recherche fondamentale, qui nécessite plus de liberté, se fait-elle mieux à l’université. L’université permet la liberté et l’ouverture. L’entreprise permet davantage de concentration des ressources. Or dans les stades préliminaires de la recherche, c’est le premier aspect qui est le plus important. Plus tard dans le processus de recherche, il est au contraire plus important d’avoir davantage de focus. Naturellement, les stades ultérieurs de la recherche sont davantage conduits dans l’entreprise que dans l’université.
Ce sujet sur la distinction entre public et privé nous amène à la question centrale des inégalités. L’innovation encourage la croissance, développe les standards de vie et en même temps, on le sait — on l’a vu dans vos travaux notamment avec Bergeaud et d’autres — accroît probablement les inégalités tout en haut de la distribution. A-t-on trouvé un modèle idéal de redistribution des rentes qui ne décourage ni la croissance, ni l’innovation, mais qui assure quand même une redistribution relativement égalitaire des fruits de la croissance ?
Il faudrait commencer par préciser que l’innovation augmente les inégalités en haut de la distribution des revenus mais qu’elle crée aussi de la mobilité sociale par les entrants.
L’effet de l’innovation sur l’inégalité globale, mesurée par l’indice de Gini, par exemple, s’annule par ces deux effets contradictoires.
D’un côté, l’inégalité augmente en haut — puisque l’innovation procure des rentes. Naturellement, les rentes d’innovation permettent de monter en haut de la distribution des revenus.
De l’autre, la destruction créatrice génère de la mobilité sociale.
C’est précisément cet aspect qui est très intéressant : l’innovation, source d’inégalité, est aussi une source vertueuse de croissance et de mobilité sociale — sans augmenter les inégalités globales. À titre comparatif, le lobbying et les barrières à l’entrée, par exemple, sont une source mauvaise, réduisant la mobilité sociale et la croissance et augmentant non seulement les inégalités en haut de la distribution, mais les inégalités globales.
Il faut donc commencer par prendre conscience que la rente d’innovation est une bonne rente.
Le défi est de s’assurer qu’elle ne soit pas utilisée pour empêcher de nouvelles innovations.
Pour cela, la politique fiscale est utile mais elle n’est pas le seul outil efficace — la politique de concurrence et la politique de financement des campagnes politiques sont aussi cruciales.
Il est important de s’assurer que les riches n’ont pas un pouvoir exorbitant dans la politique. Ces outils sont essentiels dans le monde schumpétérien dans lequel nous vivons.
Je crois en une fiscalité raisonnablement redistributive. Celle qu’on a en France l’est déjà beaucoup, puisque entre le top 10 % et le bottom 10 %, je crois que c’est 18 sur 1 avant impôts et 3 sur 1 après impôts. Nous payons des impôts de succession que les Suédois ne payent plus depuis longtemps. Nous sommes encore un des pays qui taxe le plus le capital ; nous sommes un pays très redistributif.
Je crois à la taxation progressive.
Je pense que c’est l’un des outils importants pour s’assurer que des gens qui deviennent trop puissants n’empêchent pas les nouveaux arrivants d’avoir une chance. Toutefois, il ne faut pas décourager l’outil de travail, ni l’innovation et la croissance des entreprises. Il faut s’assurer que cette croissance est bien utilisée. Dans le cas inverse, si les startups sont encouragées, mais que dès qu’elles grandissent on leur tombe dessus, elles vont partir.
Lorsqu’on regarde la distribution des âges des grandes entreprises aux États-Unis et en France, on constate que certaines entreprises sont, ici, très enracinées.
Oui — et cela n’est pas bon.
Le danger actuel est de manquer la révolution de l’IA.
En appliquant la taxe Zucman — même si j’aime beaucoup Gabriel — la France restera un pays producteur de fromages mais ne gagnera pas la course à l’IA.
J’adore le camembert, le rocamadour je suis fan — mais c’est aussi le meilleur moyen de passer à côté de la révolution de l’IA. C’est absolument sûr.
Certes, mais en regardant qui sont les riches en France, ces rentes ne semblent pas toujours être vertueuses pour l’innovation. Souvent, elles sont plutôt celles d’un capital issu d’un passé lointain.
En effet, c’est la raison pour laquelle il faut encourager l’usage innovant de la richesse.
Certains souhaitent peut-être utiliser leur fortune une fois qu’ils ont beaucoup innové. Mais s’ils savent d’avance que, dès qu’ils deviendront riches, ils seront pénalisés, ils ne joueront même pas.
Il y a toujours cette tension entre l’ex ante et l’ex post : ex post, bien sûr, on peut toujours exproprier — mais cela crée de mauvaises incitations ex ante.
La concurrence économique joue en partie aujourd’hui le rôle que jouait jadis la menace de guerre.
Philippe Aghion
C’est-à-dire, concrètement ?
Prenons un exemple : même dans la recherche ou dans le cinéma, il faut des investisseurs.
Le réalisateur n’est pas dans le top 0.01 % des plus riches, mais le producteur, lui, l’est.
Si l’on taxe trop les producteurs, on les perd — et on perd avec eux les réalisateurs.
C’est toute la difficulté : les très riches financent souvent l’innovation. Aux États-Unis, beaucoup deviennent venture capitalists. J’ai connu quelqu’un qui avait créé une entreprise très prospère. Après son introduction en bourse, il est devenu très riche, puis venture capitalist, finançant de nouvelles start-ups.
Aurait-il fallu l’empêcher de le devenir ? Tout dépend de ce que l’on fait de son argent : s’il sert à soutenir de nouveaux projets, c’est très différent de quelqu’un qui se contente d’acheter des villas et de ne rien faire. C’est là qu’il faut distinguer le bon grain de l’ivraie — mais ce n’est pas simple.
On le voit bien en France, par exemple avec la niche Dutreil : il y a certes des abus, notamment dans les transmissions patrimoniales, mais cette niche reste nécessaire, car elle permet la continuité des entreprises et donc de l’emploi. Il faut donc apprendre à détecter les usages abusifs. C’est la même chose pour les holdings patrimoniales : certains les utilisent pour acheter un chalet ou un avion privé — ce qui est inacceptable — mais d’autres s’en servent pour structurer des investissements productifs.
En fin de compte, tout se joue dans le détail.
Vous soulevez ici un sujet clef : celui de la réallocation du capital. Aux États-Unis, on a l’impression qu’il y a vraiment une fluidité du marché du capital qui permet de réinvestir assez rapidement. En France et en Europe, généralement, on a souvent un capital qui est bloqué dans des véhicules privés ou défiscalisants — ce qui fait que le capital se réalloue très mal. À partir de vos recherches, quels seraient les bons modèles pour encourager cette réallocation du capital ?
Le bon modèle est avant tout d’encourager l’innovation.
L’épargne ne s’investit pas dans l’innovation chez nous parce qu’il n’y a pas de vrai marché unique pour l’innovation. Or comme l’indique Mario Draghi, un marché unique est nécessaire pour obtenir de bonnes rentes d’innovation. L’Europe, avec la pratique du gold plating où chaque pays européen ajoute ses réglementations, ne favorise pas le marché unique.
La deuxième chose, c’est qu’effectivement, le capital risque est sous-développé. On n’a pas d’investisseurs institutionnels comme aux États-Unis — sauf un peu en Suède — et donc pas de véhicules qui drainent l’épargne vers de l’innovation.
Troisièmement, il n’y a pas d’institutions comme la DARPA qui sont des vecteurs de co-investissement public-privé, qui encouragent aussi des gens qui ont de l’épargne privée à investir parce que l’État participe également.
L’idée que l’État a un rôle à jouer dans l’encouragement à l’innovation — tout comme le secteur privé a un rôle dans l’allocation du capital, fonctionnel ou pas — va au-delà des questions qu’on se pose souvent de redistribution, de questions fiscales, de questions de régulation. Cela soulève une question sur la manière de faire émerger un écosystème financier de l’innovation, qui est sans doute ce qui manque beaucoup en Europe.
En Suède, 2,5 % des impôts vont immédiatement alimenter un fonds de pension. C’est intéressant. Ils ont fait plusieurs choses qui ont permis de développer leur écosystème financier plus que les autres.
Certains pays donnent l’impression de réussir à se sortir de ce piège de stagnation quand d’autres n’y arrivent pas — car les incumbents n’ont pas intérêt à redistribuer ou à changer les règles du jeu et les jeunes innovants sont si impuissants qu’ils sortent du système. Est-ce qu’on sait quelque chose de ce qui fonctionne pour débloquer cette économie politique de l’innovation ?
Je pense que la pression extérieure — la concurrence d’autres pays — est ce qui peut pousser à sortir de ce piège.
L’Europe peut se réveiller parce qu’elle sent que les États-Unis et la Chine nous distancent et que nous sommes menacés par Poutine. L’espoir, c’est que les gens prennent conscience de l’ampleur du problème et de la nécessité d’agir.
Dans l’histoire, la concurrence militaire a souvent poussé au changement. La bataille de Sedan a dans une certaine mesure joué un rôle déterminant dans la naissance des lois Ferry — mais il a fallu des guerres terriblement meurtrières.
La concurrence économique joue en partie aujourd’hui le rôle que jouait jadis la menace de guerre.
Il faut donc espérer que la concurrence entre pays nous pousse à dire : « Je ne veux pas être le dernier de la classe, il faut quand même que je sois présent. »
Et la menace militaire, aujourd’hui, joue de nouveau un rôle important ?
C’est évident. Même s’il ne faut pas négliger que peut jouer, que joue déjà, la concurrence économique entre les pays.
Si l’on pense à la Guerre froide entre l’URSS et les États-Unis, cette concurrence entre les pays a clairement joué en faveur de l’innovation.
C’est le seul moment où l’URSS innovait.
Elle n’avait pas du tout un système poussant à l’innovation — sauf dans la défense à cause de la concurrence avec les États-Unis.
Y a-t-il un risque, qu’une Union européenne trop uniformisée annule ces forces de compétition entre pays membres ?
Non : en uniformisant on augmente la concurrence.
Dans un marché unique, on a beaucoup plus de concurrence puisque les réglementations mettent des barrières à l’entrée. Si nous parvenons à un vrai marché unique en Europe, non seulement nous aurons une taille de marché plus grande — mais nous aurons davantage de concurrence. C’est tout l’intérêt du marché unique : faire d’une pierre deux coups.
Ce que Mario Draghi propose dans son rapport, c’est d’avoir à la fois une taille de marché plus grande — et donc un effet de market size — mais également un effet de concurrence dû à l’absence de barrières réglementaires entre les pays.
Une autre différence majeure par rapport aux États-Unis — qu’on voit particulièrement dans le monde académique — c’est que l’Europe a du mal à attirer une immigration qualifiée. C’est vrai dans le secteur de la recherche, mais aussi dans beaucoup d’autres : les ingénieurs, les data scientists…
La transition en Europe de l’Est aurait pu être notre vivier — mais nous avons manqué le coche.
Les États-Unis ont été beaucoup plus proactifs pour donner des visas de travail à des ressortissants d’anciens pays du bloc soviétique. Washington a tout de suite été très volontaire là où nous étions très frileux sur les visas. De nombreux Russes et Polonais talentueux ont émigré aux États-Unis pensant qu’il y a davantage de moyens et de possibilités.
Un exemple récent a frappé la communauté des économistes : Esther Duflo et Abhijit Banerjee sont récemment partis en Suisse. La géographie de cette immigration qualifiée dans le monde scientifique est-elle en train de changer ?
Il faut des politiques qui attirent les bons chercheurs, en donnant de bons salaires et de bonnes conditions.
Les LabEx étaient une bonne initiative.
Une combinaison d’autonomie et de moyens est nécessaire : avec de l’autonomie et sans salaire, on n’attire personne.
Quelles sont à votre sens les grandes thématiques aujourd’hui les plus innovantes dans le domaine économique et les plus susceptibles de générer de nouveaux agendas de recherche à long terme ?
Je n’ai pas la prétention de dire ce qui va se passer ailleurs, car il y a de nombreux sujets dynamiques. De nombreux champs vont s’ouvrir — de l’IA à l’innovation verte.
Le domaine des réseaux par exemple, sur lequel travaille Matthew O. Jackson, peut être appliqué au développement, à la finance, et à bien d’autres champs.
L’économie industrielle est aussi un domaine très important. Blundell continue de faire une microéconométrie formidable — avec d’autres.
L’économie comportementale est également un domaine très dynamique, sur lequel travaillent David Laibson, Roland Bénabou, et d’autres.
Un consultant américain à Boston me disait un jour : « Notre travail, c’est d’accueillir ici des start-ups qui n’arrivent pas à grandir en France ».
Philippe Aghion
Les études sur les inégalités, évidemment, demeurent essentielles — et il faut les poursuivre.
On dit qu’il est de plus en plus difficile d’avoir de nouvelles idées. Mais je pense qu’on voit du nouveau émerger dans chaque domaine pris isolément. En même temps, on vit un reset : de nouveaux domaines s’imposent. Presque d’une manière « romérienne », on trouve tout le temps de nouvelles lignes qui permettent de remettre l’horloge à zéro. Ce n’est pas exactement comme de la division du travail. Sur chaque ligne en particulier, il y a des rendements décroissants d’innovation — mais il y a toujours de nouvelles lignes qui arrivent.
On observe bien cela en économie.
La théorie des contrats et la théorie des jeux ont eu leurs grandes heures — mais plus aujourd’hui. Pour continuer à filer cette métaphore de l’innovation, elles sont en quelque sorte devenues des General-purpose Technologies, utilisées par tout le monde. Elles ont un futur sans qu’elles soient un domaine actif de recherche.
Le flux de bons papiers en économie ne tarit pas.
Au-delà de l’économie, la population vieillit : les travaux de Jesús Fernández-Villaverde sur la baisse de la fécondité sont assez inquiétants 3. Est-ce que ce vieillissement est susceptible, sur le long terme, de mettre fin au moteur de la croissance ?
Deux choses, là-dessus, sont clefs : premièrement, piloter l’immigration. Zéro migration, ce n’est pas tenable. Il nous faut une politique intelligente pour une immigration choisie, avec un système à points ou autrement.
Deuxièmement, nous perdons des Einstein et des Marie Curie. Comme nous l’avons souligné dans notre travail en Finlande avec Akcigit, Hyytinen, et Toivanen 4, ou Xavier Jaravel pour les États-Unis, de nombreux jeunes sont issus de familles dont les parents ne sont pas capables de leur donner le milieu, le savoir et les aspirations nécessaires pour exceller. Je suis convaincu que nous ne savons pas tirer le meilleur des talents que nous avons.
Une politique d’immigration et une politique éducative intelligentes nous aideront à surmonter ce problème en grande partie. Il faudra mener des politiques ambitieuses pour minimiser les déperditions.
Si vous étiez nommé ministre de l’Économie ou Premier ministre — ou, qui sait ? si vous étiez élu Président de la République — et que vous aviez le droit à une seule mesure pour corriger la croissance en France, que feriez-vous ?
Une seule mesure, c’est très difficile ! Généraliser les LabEx et, d’une même mesure, créer une DARPA française — nous sommes très bons dans la défense.
Je pense que son impact peut être important. Évidemment, il faudrait réformer le système éducatif qui est actuellement très déficient chez nous. Cela serait une politique à part entière, pas une simple mesure.
Tout un programme…
Nous devons faire ce que prévoit Mario Draghi, mais au niveau français. Ou avec quelques pays au sein d’une coalition de volontaires.
Deuxièmement, nous devons mettre en place des investisseurs institutionnels pour drainer l’épargne beaucoup plus vers l’innovation.
Troisièmement, il nous faut des DARPA européennes — peut-être seulement avec quelques pays — pour pousser l’innovation verte et la défense.
C’est un agenda passionnant, qui réoriente l’effort vers l’innovation. Mais n’y a-t-il pas un problème d’échelle ? On se félicite d’avoir Mistral : est-ce parce qu’on a abandonné l’idée d’avoir des Meta ou des Nvidia ?
Les investisseurs institutionnels le savent bien : nous avons beaucoup de start-ups elles ne grandissent pas en France.
Un consultant américain à Boston me disait un jour : « Notre travail, c’est d’accueillir ici des start-ups qui n’arrivent pas à grandir en France ».
Or il faut qu’on permette aux start-ups de grandir en France et en Europe.
C’est pourquoi appliquer la taxe Zucman en exonérant uniquement les startups ne fonctionnerait pas non plus : dès qu’elles s’agrandiront, elles voudront s’en aller.
Sources
- Industrial Organization, ou théorie du comportement des firmes.
- Tor Jakob Klette et Samuel Kortum, « Innovating Firms and Aggregate Innovation », Journal of Political Economy, The University of Chicago, 2004, vol. 112, n°5.
- Voir notamment : Delventhal, M. J., Fernández-Villaverde, J., & Guner, N., Demographic Transitions Across Time and Space, NBER Working Paper No. 29480, 2021.
- Philippe Aghion, Ufuk Akcigit, Ari Hyytinen, et Otto Toivanen, « Parental Education and Invention : The Finnish Enigma », NBER Working Paper 30964, 2023.