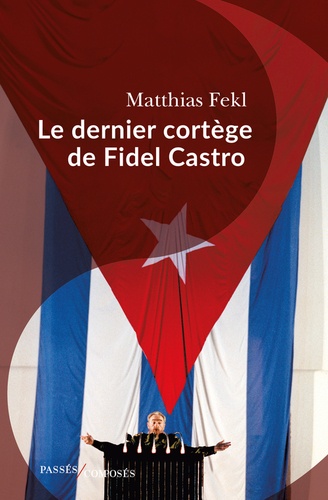Le dernier cortège de Castro et la fin d’une ère
Le 25 novembre 2016, Fidel Castro mourait à La Havane, plus d’un demi-siècle après la Révolution qui l’avait porté au pouvoir. Son enterrement fut l’occasion d’organiser un immense cortège funéraire, qui retraça, mais à l’envers, l’itinéraire de sa marche triomphale en 1958. Ce long voyage a été l’occasion pour Matthias Fekl de revenir sur l’expérience castriste à Cuba, de la construction charismatique du dictateur jusqu’aux expériences économiques ratées. En creux, c’est l’histoire de la Guerre froide qui se déroule, jusqu’à son point final, en 2016.
Votre livre encadre l’histoire de Fidel Castro entre deux marches, celle triomphale de 1959 et celle, funèbre, de 2016. Pourriez-vous décrire l’évolution de Cuba entre ces deux marches ?
Effectivement, ce long demi-siècle est le cœur de mon livre, qui s’articule autour de ces deux marches emblématiques de l’histoire cubaine. C’est une période marquée par l’empreinte de Castro, qui a dominé la scène cubaine avec une autorité et une forme de charisme incontestées.
J’essaie de donner une image aussi juste que possible de cette époque, en montrant ce qui a marché et ce qui n’a pas marché, les nombreux échecs de la révolution, notamment sur le plan économique et en matière de libertés et de démocratie. Mais aussi, il ne faut pas oublier les succès notables, comme les avancées en santé, en éducation et dans ce qu’on appelle l’indice de développement humain.
J’aborde aussi la situation actuelle, qui est très dure après des années de privations, avec une tentative de diversification économique qui n’a pas vraiment réussi. Je reviens sur tous les débats économiques internes à Cuba, entre spécialisation et diversification, entre donner la priorité à l’agriculture ou à l’industrie, et entre les incitations « matérielles » versus les incitations « morales » — une question qui était chère à Che Guevara dans le cadre de sa volonté de bâtir « l’homme nouveau ».
Aujourd’hui, on voit un modèle économique qui patine, qui s’est enlisé dans la bureaucratie, où prendre une décision devient presque impossible. Et puis, il y a cet embargo américain qui asphyxie encore un peu plus l’île, qui rend difficile tout ce qui pourrait fonctionner. Il y a eu des ouvertures, notamment avec Raul Castro, qui, paradoxalement, étant un des leaders cubains les plus communistes, a mis en place des réformes pour donner plus de liberté à l’initiative privée, pour désétatiser, pour reconnaître le petit entrepreneuriat. Ça a commencé modestement, avec les restaurants et les coiffeurs, mais cela s’est élargi avec le temps. De fait, avec la révision constitutionnelle de 2019, la propriété privée a été reconnue, soixante ans après la révolution : le modèle reste clairement communiste, mais des espaces de liberté entrepreneuriale avaient commencé à émerger, lentement.

Le pouvoir charismatique de Castro est au cœur de ce livre. Comment expliquer cette force d’attraction qu’il a su exercer à Cuba et au-delà ?
Le pouvoir charismatique de Fidel Castro est un thème central du livre. Nombre de biographies de Castro sont caractérisées par une fascination, voire un processus d’identification, avec le personnage. Ce pouvoir charismatique n’a du reste pas seulement opéré sur des sympathisants de sa cause : une journaliste comme Barbara Walters y a partiellement cédé en 1977. Au début de la révolution, une partie des élites économiques de Cuba se sont également laissées séduire, y compris de très grandes et anciennes familles industrielles du pays.
Ce livre n’est pas une biographie, mais il s’interroge sur les raisons de cette fascination. L’attrait de Castro tient à plusieurs facteurs. De manière exogène, il y avait bien sûr une réaction contre la dictature de Batista et une envie de soutien pour quelqu’un qui était perçu comme un libérateur pouvant redonner à Cuba sa dignité et son indépendance.
Nombre de biographies de Castro sont caractérisées par une fascination, voire un processus d’identification, avec le personnage.
Matthias Fekl
En plus de son art oratoire, appris chez les Jésuites et comme avocat pénaliste, Castro avait une présence et une personnalité qui le distinguaient. C’était un orateur remarquable qui fascinait les foules par son éloquence et sa capacité à communiquer de manière simple et claire. Il savait aussi mettre en scène sa proximité réelle ou supposée avec son auditoire, se déplaçant à travers Cuba pour dialoguer et écouter les gens, ce qui créait des interactions souvent surprenantes. Il semblait accessible, les citoyens pouvaient s’adresser directement à lui avec leurs griefs concernant des problèmes concrets comme l’électricité ou la pénurie alimentaire.

À vous lire, on a l’impression que la révolution cubaine est beaucoup plus nourrie par le paradigme de la révolution bolivarienne que par celui des révolutions bolchéviques. Dans quelle mesure, la mémoire des révolutions libérales est-elle présente dans l’imaginaire de Castro ? Surtout, est-ce qu’il y a un moment où Castro évolue consciemment, le dirigeant communiste autoritaire prenant le pas sur l’héritier José Marti et Bolivar ?
En effet, les débuts de la révolution cubaine sont imprégnés par les héros de l’indépendance cubaine du XIXe siècle, comme le général Gómez et surtout José Martí, dont l’influence intellectuelle et politique en France est souvent sous-estimée. Martí n’était pas seulement un penseur et poète, mais aussi un homme d’action qui est mort au combat. Les récits de l’indépendance cubaine et latino-américaine contre l’Espagne, puis contre l’influence américaine sont les véritables sources d’inspiration au commencement de la révolution, comme l’illustre le récit que donne Castro dans sa plaidoirie après l’assaut de la caserne Moncada — son premier fait d’armes — en 1953. Après sa condamnation, ce texte fut publié sous le titre « L’histoire m’acquittera ». C’est une lecture révélatrice car on n’y trouve aucune référence à Marx ou à Engels — pas une seule ! — mais plutôt des citations de penseurs libéraux comme Montesquieu et des juristes français, aux côtés bien sûr des grandes sources d’inspiration proprement cubaines.
À cette époque, Castro affirmait vouloir établir une démocratie libérale et sociale à Cuba, plutôt qu’un régime communiste, ce que reflétait aussi la composition de son état-major, à l’exception de quelques figures comme son frère Raul et Che Guevara, ce dernier étant l’un des éléments les plus radicaux de la révolution. Des démocrates chrétiens, dont certains sont morts lors de tentatives de renversement de la dictature, ainsi que des libéraux et la bourgeoisie cubaine, étaient également présents au début.
Les récits de l’indépendance cubaine et latino-américaine contre l’Espagne, puis contre l’influence américaine sont les véritables sources d’inspiration au commencement de la révolution.
Matthias Fekl
Le débat demeure sur le moment où Castro a réellement embrassé le communisme. Certains historiens penchent pour la duplicité, suggérant qu’il a toujours été communiste mais qu’il devait le cacher pour la réussite de la révolution, car même le Parti communiste cubain soutenait initialement Batista. D’autres évoquent la nécessité, le Parti communiste devenant progressivement un allié incontournable par sa capacité à fournir les cadres nécessaires pour gouverner. Pour d’autres encore, la contrainte externe aurait été le facteur décisif : à mesure que les relations avec les États-Unis se détérioraient, l’Union soviétique serait devenue le nouveau soutien économique et politique de Cuba, orientant le régime politiquement.

Au fil des ans, Castro lui-même a fait des déclarations qui semblent se contredire sur la question de son engagement communiste. D’une part, il a affirmé être devenu communiste assez tardivement. Par ailleurs, Castro a également soutenu qu’il avait adopté des idées communistes bien plus tôt, lorsqu’il était à l’université, en se plongeant dans des réflexions sur l’économie et la justice sociale.
Il est complexe de démêler la vérité ici, car les preuves tangibles font défaut parmi les sources disponibles aujourd’hui Ce qui est indéniable, cependant, c’est que dès le début des années 60, Castro adopte ouvertement le communisme comme doctrine officielle de l’État, entraînant avec lui le reste du mouvement révolutionnaire. Les autres courants idéologiques, qui avaient été présents au début de la révolution, sont alors écartés ou éliminés, laissant place à une seule et unique voix, celle du parti communiste aligné sur la vision de Castro et soutenu par l’alliance avec l’Union soviétique.
Justement, dès l’automne 1959 les modérés sont éliminés : certains par accident, comme Camilo Cienfuegos, qui se tue en avion le 28 octobre ; d’autres sont arrêtés, comme Huber Matos, jeté en prison le 21 octobre. Dans quelle mesure ce mois d’octobre 1959 constitue-t-il une rupture ?
À ce moment, il devient clair que Castro ne conçoit plus l’idée qu’il puisse y avoir un décalage entre sa personne, la révolution et Cuba. Il y avait une identification presque totale entre l’homme et le mouvement, une fusion dans laquelle Castro semblait incarner l’essence même de la révolution et de l’île. La personnalité de Castro était telle qu’il semblait inconcevable, tant pour lui que pour d’autres, qu’il puisse exister d’autres figures de pouvoir indépendantes à ses côtés. Ce mois d’octobre est symptomatique de cette rupture : avec la mort accidentelle de Camilo Cienfuegos le 28 octobre et l’arrestation de Huber Matos le 21 octobre, on assiste à une concentration du pouvoir et à une clarification irréversible de la direction que prendra la révolution.
La situation avec Huber Matos, gouverneur populaire de la province de Camaguey, est représentative de cette consolidation du pouvoir. Lorsque Matos adresse une lettre à Castro pour alerter sur le danger d’une infiltration communiste et exprimer sa crainte de voir la révolution dévoyée, Castro le perçoit immédiatement en potentiel rival, écarté pour ne pas avoir à partager le pouvoir.
La personnalité de Castro était telle qu’il semblait inconcevable, tant pour lui que pour d’autres, qu’il puisse exister d’autres figures de pouvoir indépendantes à ses côtés.
Matthias Fekl
Il est difficile de déterminer si les actions de Castro relèvent uniquement de l’affirmation de son pouvoir personnel ou si elles sont justifiées par une nécessité politique de consolider l’alliance avec le Parti communiste. Ces deux aspects semblent se développer en parallèle et finalement se rejoindre, laissant transparaître l’idée que, même au sein de l’appareil communiste, tout était in fine centré sur Castro. Chaque décision, qu’elle soit majeure ou mineure, remontait à lui, conduisant même à une forme de micro-management, qui devient caractéristique de la direction politique de la révolution cubaine.
Il y a une dimension profondément religieuse dans le cortège funèbre de Fidel Castro, quelque chose qui s’apparente à une procession à l’échelle de l’île. Quelle était sa relation avec la culture et la religion catholiques ?
Dans les années 1950, la guérilla puis la révolution cubaine et la figure de Fidel Castro ont souvent été présentées avec une iconographie qui emprunte à l’iconographie la chrétienté. Un exemple marquant est l’un de ses premiers discours à La Havane après la victoire de la révolution, où une colombe se pose sur son épaule, le plaçant dans une sorte de halo. Était-ce une mise en scène ou un pur hasard ?
De même, quelques années plus tôt, alors que Castro était encore dans les montagnes de la Sierra Maestra, il avait été faussement déclaré mort, et cette information fut reprise internationalement par les agences de presse. La « résurrection » médiatique de Castro s’est produite lorsque le New York Times a confirmé qu’il était bien vivant, dissipant ainsi les rumeurs.
La caravane de la victoire de Santiago à La Havane en janvier 1959 a été caractérisée par une ferveur révolutionnaire et une adulation mondiale envers les jeunes révolutionnaires barbus, qui semblaient incarner l’avenir.

Maintenant si l’on considère la place de la religion à Cuba avant la révolution, il a été noté que bien que 90 % des Cubains étaient baptisés, seulement environ 5 % pratiquaient réellement. Le christianisme, introduit avec Christophe Colomb et le colonisateur espagnol, s’était développé en intégrant parfois des éléments du culte catholique dans des croyances plus spécifiques à Cuba. La position de l’Église catholique à l’époque de la révolution était complexe, avec une hiérarchie généralement conservatrice, composée majoritairement d’ecclésiastiques espagnols, très largement favorables à Batista et Franco. Cependant, il y avait des exceptions, comme l’archevêque de Santiago qui est intervenu pour sauver la vie de Castro après la Moncada.
Castro lui-même avait reçu une éducation religieuse poussée et connaissait bien les textes bibliques. Néanmoins, après l’invasion de la Baie des Cochons et la découverte que deux prêtres catholiques faisaient partie de la force d’invasion, une répression contre l’Église a suivi. L’enseignement religieux fut interdit, de nombreux prêtres et religieuses espagnols furent expulsés et les chrétiens se virent refuser l’adhésion au parti communiste jusqu’au début des années 1990.
La caravane de la victoire de Santiago à La Havane en janvier 1959 a été caractérisée par une ferveur révolutionnaire et une adulation mondiale envers les jeunes révolutionnaires barbus, qui semblaient incarner l’avenir.
Matthias Fekl
À partir des années 1970, avec l’émergence de la théologie de la libération en Amérique latine, Castro s’est montré plus ouvert, soulignant les convergences entre le christianisme et la révolution. Il a même collaboré à la rédaction d’un livre avec Frei Betto, un dominicain, discutant de spiritualité, de religion, d’économie et de politique. La visite du pape Jean-Paul II à Cuba en 1998 a marqué un moment historique, avec des déclarations appelant Cuba à s’ouvrir au monde et inversement. Les successeurs de Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François, ont également visité La Havane, consolidant cet assouplissement des relations entre l’État cubain et l’Église.
L’archevêque de La Havane a joué un rôle dans une forme d’opposition modérée, alors que d’autres figures chrétiennes, comme Oswaldo Payá avec le projet Varela, ont proposé des changements radicaux inspirés par des valeurs chrétiennes.
Une autre figure traverse tout le livre : Che Guevara. Contrairement à lui, Castro n’est jamais devenu une icône pop, sans doute parce que le Che est mort en 1967. Restera-t-il quelque chose de Castro après sa mort ?
Si l’on compare la figure du jeune révolutionnaire qui trouve la mort dans l’élan de sa quête et celle du vieil homme d’État, cela soulève effectivement un contraste fascinant. Che Guevara, malgré son implication dans des actes de répression et des exécutions sommaires, a acquis une image mythique auprès de la jeunesse mondiale, symbolisant un espoir probablement exagéré et inapproprié.
Quant à savoir si cette perception perdurera, c’est incertain. Raymond Aron a parlé de ces jeunes bourgeois parisiens qui affichent des portraits de Che Guevara dans leurs chambres, soulignant l’ironie d’une telle idolâtrie à distance, dans le confort douillet d’un appartement parisien.
Fidel Castro, en revanche, restera probablement ancré dans l’histoire comme le visage de Cuba au vingtième siècle et au début du vingt-et-unième. Sa gouvernance s’étendant sur une telle période, il a été au centre des décisions cruciales et a entretenu une relation directe avec le peuple cubain, à travers sa rhétorique ainsi que son contrôle du pays.

Justement, au moment où semble émerger un nouveau mouvement des non-alignés, quelle peut y être la place de Cuba — et de la mémoire de Castro ? Ou, au contraire, leur rôle symbolique s’est-il étiolé après la fin de la Guerre froide ?
Cuba, à la fois historiquement et symboliquement, demeure une référence puissante, autour de laquelle les débats sont souvent passionnés et polarisés : bien souvent, on se rend à Cuba soit pour confirmer des préjugés défavorables, soit pour valider une opinion positive préconçue. La difficulté réside dans la capacité à adopter une perspective nuancée et réaliste.
Dans le contexte actuel de ce que l’on appelle le « Sud Global », Cuba conserve une influencenon négligeable. Historiquement, l’île a joué un rôle central dans le mouvement des non-alignés, mouvement qu’elle a même présidé. Cependant, le soutien inconditionnel de Castro à l’intervention soviétique en Afghanistan avait, à l’époque, terni quelque peu son prestige.
Malgré cela, Cuba continue à ce jour à pouvoir compter sur un soutien considérable au sein des Nations unies. Lorsque Cuba prend la tête sur une question, cela a un impact non négligeable sur les votes au sein des instances internationales. En Amérique latine en particulier, le prestige et le mythe de Cuba demeurent forts. Le récit de David contre Goliath, incarné par un petit pays qui se tient fermement face à l’impérialisme américain, continue de résonner fortement dans l’imaginaire collectif.
Plus généralement, est-ce que la réaction des États-Unis à la Révolution cubaine n’a pas contribué à éroder l’image d’un « Empire bienveillant » dans les sociétés occidentales — et ce dès le début des années 1960 ?
Oui, je le pense. Initialement, les révolutionnaires cubains n’étaient pas fermés à l’idée d’un arrangement avec les États-Unis, mais la dynamique a rapidement évolué vers une politique d’endiguement de la part des États-Unis.
Au fil de soixante années, la rhétorique cubaine a constamment peint les États-Unis comme un Goliath impérialiste, un discours qui, tout en ayant une base de vérité à cause de l’embargo qui étouffe incontestablement le pays, s’avère également très utile pour le gouvernement cubain. Cette rhétorique sert à unifier le peuple cubain contre un ennemi commun et à le rallier autour de ses dirigeants, surtout en temps de privation sévère.
Il n’empêche que les sanctions américaines apparaissent disproportionnées par rapport à la réalité de la menace que Cuba représente actuellement. Des personnalités comme Henry Kissinger ont souligné l’irritation américaine face à l’existence d’une révolution socialiste à proximité immédiate des côtes américaines. La persistance et l’intensification de l’embargo américain, qui aggrave les conditions de vie des Cubains sans pour autant favoriser un changement de régime, révèlent un usage démesuré et inefficace des instruments de la puissance. C’est ce que pensent aussi de nombreux modérés aux Etats-Unis, au premier rang desquels l’ancien président Jimmy Carter.
Outre sa longévité, y a-t-il quelque chose qui distingue Cuba des autres régimes communistes ?
Tout d’abord, Cuba avait pour particularité notable par rapport à l’URSS de ne pas représenter une menace nucléaire.
Une autre singularité de Cuba tient à la place qu’elle a occupée dans l’imaginaire des élites américaines. Imaginez que la révolution cubaine ait débouché sur des succès économiques, cela aurait remis en cause bien des idées communément admises.. C’est un point que même Kissinger a souligné avec une certaine ouverture d’esprit, reconnaissant que l’idée d’un autre système viable était difficilement supportable, car elle montrait qu’une alternative était possible, ce qui justifiait à leurs yeux la nécessité d’étouffer le régime cubain.
De manière assez similaire, des personnalités comme Kennedy ont admis que de nombreuses revendications de la révolution cubaine, telles que la souveraineté nationale, l’indépendance économique et la fin de la dépendance vis-à-vis des intérêts américains, étaient légitimes. Les aspirations de Cuba à développer un système d’éducation et de santé robuste sont également des points qu’on ne peut ignorer. L’absence de libertés fondamentales n’en demeure pas moins flagrante : le manque d’institutions démocratiques, de pluralisme dans la presse, de liberté d’association de liberté d’expression…

Les slogans révolutionnaires accompagnent le cortège funéraire de Fidel Castro. Près de soixante ans après la prise de La Havane, fallait-il qu’il disparaisse pour que le mythe de la Révolution devienne complètement inopérant ?
Indéniablement, l’hommage rendu à Fidel Castro à travers le pays, retraçant le chemin de la marche triomphale de janvier 1959, symbolise la clôture d’une ère. C’est un acte peu commun que de transporter le corps d’un chef d’État défunt à travers tout le territoire, et cela signifie symboliquement et concrètement la fin du cycle de la révolution cubaine telle qu’elle a été initiée et incarnée par Castro.
Castro et ses compagnons, ceux qui ont navigué sur le Granma ou combattu dans la Sierra Maestra, possédaient une légitimité unique forgée dans la lutte, le combat et la révolution, ayant renversé la dictature de Batista. Cette légitimité n’est pas partagée par les générations suivantes. Désormais, le régime cubain doit trouver de nouvelles formes pour asseoir sa légitimité politique, que ce soit par le biais démocratique ou le succès économique, car la génération post-Castro n’a pas cette même aura révolutionnaire.
Indéniablement, l’hommage rendu à Fidel Castro à travers le pays, retraçant le chemin de la marche triomphale de janvier 1959, symbolise la clôture d’une ère.
Matthias Fekl
Symboliquement, la page de soixante ans d’histoire se tourne avec cette procession funèbre qui suit le chemin de la révolution originelle. Castro repose désormais près de la tombe de José Martí et d’autres figures illustres de la lutte pour l’indépendance et la liberté de Cuba au XIXe siècle.
Cette inhumation, proche des héros de l’indépendance plutôt que dans un mausolée dédié, clôt une page de l’histoire cubaine. C’est aussi une manière de situer la mémoire de Castro, non en tant que leader communiste, mais comme celui qui a repris le flambeau des combats pour l’indépendance nationale.
Mon analyse, comme développée dans le livre, perçoit aussi cet événement comme un retour aux racines de la révolution. Castro revient à Santiago, où tout a commencé, dans une ville dont les inspirations premières de la révolution étaient loin d’être communistes, mais plutôt libérales et nationales, axées sur l’indépendance. Ce retour est donc aussi un retour aux sources d’inspiration premières de la révolution cubaine, si profondément ancrée dans le passé latino-américain et l’histoire nationale.