« Les gens ordinaires ont quelque chose à dire, sur le passé comme sur le futur de leur pays », une conversation avec David van Reybrouck
En France, ses livres sont qualifiés « d'inclassables ». Depuis plus de dix ans, David van Reybrouck donne la parole à des acteurs méconnus de l'histoire, à travers la collection de milliers de témoignages oraux. Avec lui, nous sommes revenus longuement sur son travail et sa méthode à l'occasion de la traduction en français de Revolusi, consacrée à la mémoire de l'indépendance indonésienne.
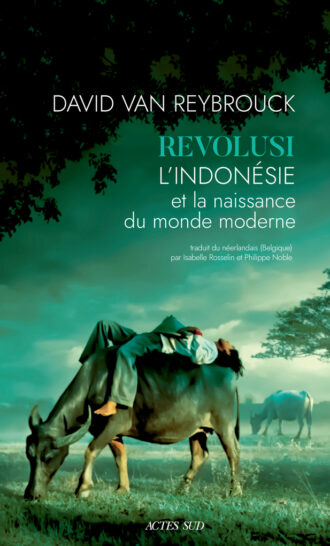
Vous avez récemment publié Revolusi. L’Indonésie et la naissance du monde moderne. Ce titre est étonnant si l’on considère que l’histoire de l’Indonésie, et notamment son histoire coloniale, est très mal connue alors même qu’elle n’est pas si lointaine : cette histoire est d’abord celle, aux Pays-Bas notamment, d’un silence, d’une méconnaissance. Comment comprendre cela, notamment en comparaison avec la France, où les débats coloniaux sont bien plus vifs ?
C’est effectivement étrange. Il s’agit de la quatrième puissance démographique au monde, d’une puissance économique majeure dans la région, du plus grand archipel du monde et du pays avec la plus grande communauté musulmane au monde. C’est le premier pays à avoir déclaré son indépendance, deux jours après la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut parler de ce pays qu’avec des superlatifs. Mais son invisibilité est tout aussi démesurée. Sa visibilité est inversement proportionnelle à son importance mondiale et ce constat est curieux quand on sait le nombre d’acteurs qui étaient impliqués aux Pays-Bas dans les années 1940 et 1950. Les Nations Unies se sont penchées pendant des années sur la question indonésienne, notamment à cause de la conférence de Bandung, et tous les pays colonisés ont tourné leur regard vers ce pays. On peut même dire que c’est lui qui a déclenché ou qui a aidé à déclencher toute la vague de la décolonisation.
Cette invisibilité est d’autant plus frappante dans l’ancienne métropole que sont les Pays-Bas. Il y a, dans ce pays, une présence indonésienne, mais celle-ci est couplée à une cécité extraordinaire vis-à-vis du passé colonial. Cette présence est d’abord liée aux 300 000 Indo-Néerlandais, comme on a pu les appeler, qui sont partis vers les Pays-Bas après l’indépendance. Aujourd’hui, le nombre de personnes descendantes des Indo-Néerlandais habitant aux Pays-Bas s’élève à environ 1,2 million, soit près de 8 % de la population nationale. À ceux-ci s’ajoutent les plus de 120 000 militaires européens qui sont rentrés après l’indépendance et 12 000 soldats des Moluques qui, comme les Harkis, se sont battus aux côtés des colonisateurs. On parle donc finalement de presque un demi-million de personnes qui ont quitté l’Indonésie pour rejoindre les Pays-Bas. En termes français, on retrouve cela avec les pieds-noirs, les harkis et les militaires. Après être rentrés aux Pays-Bas, ces acteurs de la colonisation ont dominé le discours sur les anciennes colonies pendant des années, alors que dans l’enseignement national, l’histoire, et en particulier l’histoire coloniale, a fortement diminué.
Une chape de plomb s’est installée sur ce passé colonial. Dans les rues d’Amsterdam, beaucoup de personnes ont des traits indonésiens ou asiatiques. Il y a un grand nombre de restaurants indonésiens. Mais la conscience historique collective à travers le pays est assez faible. J’ai cité dans mon livre les résultats d’un sondage réalisé par YouGov, le groupe de sondage britannique. Il se posait la question suivante : quel est le pays le plus fier de son passé colonial ? À la surprise générale, ce n’était pas l’Angleterre, mais les Pays-Bas. 50 % des personnes interrogées disaient être fières de leur passé colonial, 6 % en avaient honte et 25 % rêvaient d’avoir un nouvel empire…
Une chape de plomb s’est installée sur le passé colonial des Pays-Bas.
David Van Reybrouck
Il y a, dans vos ouvrages, une attention à la justice, à faire justice à des individus ou des événements qui ont été oubliés de l’histoire, alors qu’ils ont eu une importance majeure. Il en est ainsi du rôle du Congo et de l’Indonésie dans les guerres, en premier lieu les deux guerres mondiales. Vos ouvrages sont-ils également un moyen de faire justice à des oubliés ?
Oui, en effet. Donner la parole à celles et ceux qui ne l’ont pas toujours alors qu’ils le méritent largement. Si nous parlons de guerres mondiales, notre vision de celles-ci est tout à fait européo-centrée. La perspective des Congolais, qui ont participé aux deux guerres, est à peine connue, et la perspective des Africains en général est mal connue. Pour Revolusi, j’attire l’attention sur une vérité impressionnante : la participation précoce d’Indonésiens dans la résistance aux Pays-Bas, avant même que les Néerlandais ne s’organisent.
Parmi les premiers résistants, il y avait un grand nombre d’Indonésiens, alors même qu’ils étaient très souvent, par ailleurs, d’ardents militants anticoloniaux. Mais la résistance dépassait à leurs yeux cette question, il s’agissait de lutter contre le fascisme. J’ai rencontré un Indonésien de 102 ans qui me disait « J’étais dans le mouvement estudiantin à Leyde. Nous étions contre la colonisation dans les années 1930, mais nous étions encore plus antifascistes. Et quand nous avons vu la prise du pouvoir de Hitler puis l’invasion, nous nous sommes dit : ‘Interrompons notre engagement pour l’indépendance indonésienne’. Battons-nous d’abord côte à côte avec les Hollandais contre les fascistes allemands. Après, nous retournerons à notre lutte postcoloniale. » Ce Monsieur s’est retrouvé en camp de concentration à Dachau et son épouse néerlandaise a été envoyée à Ravensbrück.
Comment comprendre que le regard européen soit aussi aveugle au rôle des colonisés dans leur défense, puis dans la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale ?
La contribution des Indonésiens a été complètement oubliée parce qu’à la fin de la guerre, une fois que l’Allemagne nazie a été battue, ils ont tout de suite repris leur engagement pour l’indépendance de leur pays. Tout à coup, ils redevenaient des ennemis des Hollandais. Il y avait 800 Indonésiens aux Pays-Bas au moment de l’invasion allemande. Une centaine était directement impliquée et une douzaine a été envoyée dans les camps de concentration. Plusieurs ont été tués. Cet engagement est véritablement impressionnant, alors même qu’il s’agissait d’un pays qui n’était pas le leur.
Grâce aux Spielberg et autres faiseurs de mémoire de notre monde, nous avons une vision en effet extrêmement eurocentrée, notre regard se porte surtout sur les camps de concentration européens. Heureusement, Timothy Snyder a écrit son ouvrage Bloodlines, qui montre que l’essentiel de la Deuxième Guerre mondiale se déroulait en dehors de l’Europe occidentale, notamment, en bonne partie, en Europe de l’Est, en Russie, en Ukraine. L’Holocauste, c’était beaucoup plus que les camps de concentration, c’était les pogroms, les pendaisons sommaires, la décimation de villages entiers en Ukraine.
Je ne parle même pas de l’aspect asiatique, que nous connaissons à peine. C’était donc tout aussi passionnant qu’essentiel pour moi d’aller au Japon pour rencontrer les tout derniers soldats de cette guerre, qui, malheureusement, n’aiment pas beaucoup en parler. Il faut donc s’armer de patience et leur donner longuement la parole.
Grâce aux Spielberg et autres faiseurs de mémoire de notre monde, nous avons une vision extrêmement eurocentrée de la Seconde Guerre mondiale, notre regard se porte surtout sur les camps de concentration européens.
David van Reybrouck
Les voix sont par ailleurs diverses dans votre œuvre, et notamment dans Revolusi. Beaucoup d’Indonésiens mais également des Néerlandais, des Japonais, des Indo-Néerlandais, ainsi que des Népalais, trouvent une place dans cet ouvrage. Pourquoi recueillir tant de voix, et des colonisateurs comme des colonisés ?
Cela me permet la nuance, de montrer l’histoire sous différentes facettes. Je pense que ce livre pourrait se concevoir un peu comme une émission de télévision, où des caméras sont installées dans toutes les chambres, à l’inverse de beaucoup d’histoires qui s’écrivent juste avec une seule caméra sur l’épaule, ce qui fait que l’on reste coincé sur sa propre perspective. J’ai voulu montrer les différentes facettes du sujet que je traite.
Hannah Arendt montre bien, à propos de la démocratie athénienne, que ce n’est qu’en mettant ensemble les divers citoyens de la polis athénienne que l’on arrive à étudier un sujet politiquement, c’est-à-dire sous ses différents aspects. Le passé est une espèce de diamant brut. Il faut le tourner dans tous les sens pour voir toute l’étendue d’un problème. Les entretiens que je mène, l’histoire orale en général, me permettent de saisir au mieux ces différentes perspectives. Les archives sont bien sûr extrêmement importantes, et j’ai une admiration pour tous les historiens qui font ce patient travail de recherche. Mais ce qui me permet le mieux de comprendre mes sujets d’études, c’est la réalisation d’entretiens, ce sont les archives « vivantes », de « plein air » si l’on veut. Tout l’aspect émotif de ces entretiens est absolument essentiel pour comprendre les événements du passé. Quelqu’un est là, se souvient, et, soudainement, on comprend pourquoi une personne s’est comportée d’une certaine manière, ce qu’elle a ressenti à ce moment-là. Ce sont les archives qui me plaisent sans doute le plus. J’ai fait près de 200 interviews pour ce livre. Pour Congo. Une histoire, j’avais déjà 11 cahiers de notes. Je voulais me limiter pour ce nouvel ouvrage, mais je me suis finalement retrouvé avec 27 ou 28 cahiers.
Cette histoire orale, vécue, me permet non seulement de mieux comprendre les différents aspects de l’histoire, mais également de mieux les raconter. Donner la parole à des personnes qui ont vécu, voire perpétré des massacres, par exemple, change le récit que l’on peut en faire.
Par ailleurs, l’attention à ces histoires méconnues est un moyen de remettre en cause le discours officiel, qui affirme, en Belgique comme aux Pays-Bas, le caractère pacifique de la grande majorité des années d’existence des colonies, à l’exception des dernières années de révolution. Vous montrez que la révolte, même à la base, dans le peuple, est ancienne, et prend notamment ses racines dans un ressentiment puissant.
C’est absolument essentiel de comprendre cela. C’est une tendance assez lourde que de penser que tout se passait bien jusqu’à ce que, par malheur, il y ait eu un événement qui a tout renversé. Un événement qui, par hasard dit-on, a déclenché une dynamique que malheureusement on ne pouvait plus freiner. Ce discours dépeint l’époque coloniale comme si elle n’était qu’un long fleuve tranquille de contentement, d’obéissance, et de gratitude vis-à-vis des puissances coloniales.
Mais si l’on regarde en détail, on voit, par exemple au Congo, que, dès les années 1920, il y a des mouvements contestataires, qui prennent parfois des formes originales, religieuse ou ethnique par exemple. Un mécontentement sociopolitique s’exprime donc de façon religieuse. C’est intéressant et ce n’est pas si insolite que cela, preuve en est des débuts du christianisme, et de la manière dont il s’éveille face à la présence romaine.
Ce qui me permet le mieux de comprendre mes sujets d’études, c’est la réalisation d’entretiens, ce sont les archives « vivantes », de « plein air » si l’on veut. Tout l’aspect émotif de ces entretiens est absolument essentiel pour comprendre les événements du passé.
David van Reybrouck
En Indonésie, c’est la même logique. Les Hollandais ont toujours considéré les Indonésiens comme le peuple le plus gentil, le plus accueillant, le plus souriant au monde. Mais, malheureusement, dit-on, l’occupation japonaise entre 1942 et 1945 aurait semé un esprit d’amertume et de revendications à outrance. Les Japonais auraient engendré les difficultés que les Néerlandais ont rencontrées au moment de leur retour en Indonésie. Toute cette histoire relève vraiment de la mauvaise volonté. C’est une façon de réécrire, de réinterpréter l’histoire qui est tout à fait malhonnête.
Dans les années 1910, il y a déjà des revendications, non seulement d’émancipation mais également d’indépendance. Dès 1912-1913, des intellectuels réclament l’indépendance, la souveraineté de l’Indonésie. C’est terriblement tôt, ça ! Cela commence certes avec quelques esprits éduqués, mais un peu plus tard dans cette même décennie, les mouvements populaires qui veulent changer la donne coloniale arrivent à mobiliser jusqu’à deux millions de personnes. Certes, ils ne veulent pas tous nécessairement, à ce moment-là, renverser le colonialisme, mais ils veulent en tout cas un colonialisme plus respectueux des cultures islamique et javanaise.
Dans les années 1910, 1920 et 1930, les mouvances politiques que l’on retrouve ensuite sont déjà là et sont fortement réprimées ou bien par les autorités coloniales, ou bien par les colons eux-mêmes, c’est-à-dire les personnes implantées sur le sol indonésien. Dans les années 1910, les autorités coloniales ont pu réagir de façon intelligente, mais les colons ont réagi dans la panique, ils se sont armés et n’ont écouté aucune des revendications, même les plus modérées. Ensuite, dans les années 1920 et 1930, les colons et le régime colonial se sont retrouvés du même côté, et ils ont eu beaucoup moins de sagesse, ils ont réprimé massivement et brutalement. Plus de 1000 personnes ont été envoyées en asile en Nouvelle Guinée par l’autorité hollandaise. On les envoyait en pensant que, ces pommes pourries isolées, le panier irait à merveille. « La population va rester tranquille, elle est pleine de gratitude ». Cette pensée est tout à fait simpliste, elle n’arrive pas à saisir la raison de la popularité des individus qui ont été exilés. Si ces nouveaux acteurs politiques arrivaient à mobiliser les masses, c’est parce qu’il y avait un terreau fertile à la base.
Est-il possible de dresser des comparaisons entre l’émancipation du Congo et celle de l’Indonésie ?
Je pense qu’il y a de très grandes différences. La société indonésienne, ou les sociétés indonésiennes, que les Hollandais ont découvertes au début du XVIIᵉ siècle, étaient très distinctes du Congo redécouvert par Stanley au XIXᵉ siècle. À l’arrivée des Britanniques et des Belges dans la deuxième moitié du XIXᵉ siècle, les effets des trois siècles et demi du régime d’esclavage qui sévissait étaient tout à fait palpables. Toutes les forces vitales d’une région entière, de tout un continent, ont été sapées. Cela a donc affaibli la structure interne des sociétés africaines, et notamment toute la structure d’autorité qui avait pu exister. Des nouveaux venants, des commerçants africains qui naviguent sur le fleuve Congo pour apporter des esclaves, du manioc, ainsi que d’autres nouveaux riches, vont se manifester et bouleverser les ordres locaux. Le Congo était donc une société traditionnelle complètement bousculée par des siècles d’esclavage. De l’autre côté, en Indonésie, il y avait également un esclavagisme asiatique, bien sûr, mais les Hollandais sont tout de même arrivés dans une société qui, surtout à Java, prenait la forme d’une organisation féodale extrêmement hiérarchisée, avec une cohésion politique et une culture artistique, intellectuelle et linguistique tout à fait impressionnante. L’Afrique était beaucoup plus fragilisée.
Le Congo était une société traditionnelle complètement bousculée par des siècles d’esclavage. De l’autre côté, en Indonésie, la société, surtout à Java, prenait la forme d’une organisation féodale extrêmement hiérarchisée, avec une cohésion politique et une culture artistique, intellectuelle et linguistique tout à fait impressionnante.
David van Reybrouck
La société indonésienne était bien plus complexe, et d’une complexité bien plus ancrée et plus solide, que les sociétés africaines découvertes ou redécouvertes à la fin du XIXᵉ siècle, dont les structures internes avaient été complètement bouleversées. Revolusi a d’ailleurs été particulièrement difficile à écrire à cause de cette complexité de l’histoire indonésienne, de la diversité de ses acteurs et de la multiplicité des évènements. L’histoire du Congo n’est déjà pas simple, mais il m’a fallu encore plus de temps pour comprendre puis partager, raconter, la complexité du processus indonésien d’indépendance.
Pourtant, au XIXe siècle, le roi belge s’est fortement inspiré des rois hollandais quand il a commencé à coloniser le Congo. Les Pays-Bas comme la Belgique sont deux petits pays, deux jeunes monarchies qui avaient l’ambition de coloniser pour tenir la comparaison face aux Français et aux Britanniques. Il est donc évident que le roi Léopold II de Belgique s’est inspiré des rois Guillaume Iᵉʳ, II et III de Hollande dans le développement d’une politique coloniale. Notamment parce que dans les deux cas, les questions étaient similaires. Il s’agissait de se demander : en tant que petits pays avec un territoire ultramarin/outre-mer immense, comment peut-on administrer efficacement ces territoires ? En utilisant une aristocratie locale installée sur place. Le principe de l’indirect rule, du gouvernement indirect, a été appliqué au Congo après l’avoir été en Indonésie. Le but était de travailler avec l’aristocratie javanaise, avec les élites locales congolaises… Cette stratégie a été vraiment copiée.
Cependant, encore une fois, pendant la période du colonialisme, de grandes divergences se sont dégagées. Au Congo, les richesses étaient surtout d’ordre géologique. Elles se situaient dans le sud, dans le Katanga, ce qui a entraîné des migrations de travailleurs vers une zone de concentration intense des richesses. Au contraire, en Indonésie, où la période de colonisation a été beaucoup plus longue, s’étendant sur trois siècles et quelques décennies, il s’agissait plutôt de richesses agricoles, réparties sur tout le territoire, ce qui impliquait une présence coloniale plus fine et dynamique sur tout l’archipel.
Je pense par ailleurs que l’on pourrait dire que les Hollandais ont été meilleurs au niveau de la colonisation, et que les Belges ont été meilleurs au niveau de la décolonisation. Les Hollandais ont mis en place des soins de santé dès 1850, un enseignement supérieur à partir de 1900, et la participation politique, même si elle était assez faible, a été acquise à partir des années 1910. Il y a donc quand même des avancées jusqu’au début des années 1920. Au Congo belge, rien de tout cela n’existe. L’enseignement primaire se développe très timidement, l’école secondaire émerge dans l’époque de l’entre-deux-guerres et l’enseignement supérieur ne s’est développé qu’à partir de 1955, cinq années seulement avant l’indépendance. À la veille de l’indépendance, il y avait 16 diplômés universitaires congolais, tous psychologues car la politique, le droit ou encore l’histoire étaient des disciplines bien trop subversives. Il fallait diriger un pays de la taille de l’Europe occidentale avec seize psychologues.
Micro-histoire, votre ouvrage Revolusi rejoint également la macro-histoire, de telle manière que vous pouvez affirmer qu’en Indonésie naît « le monde moderne ». Pouvez-vous revenir sur le caractère mondial de votre étude ?
Je trouve que si l’on étudie l’histoire coloniale, surtout dans les écrits populaires, on a tendance à penser que les rapports entre pays colonisateurs européens et régions ou territoires colonisés sont binaires. Comme s’il n’y avait que des rapports verticaux entre l’Allemagne et la Namibie, la Belgique et le Congo, la France et l’Algérie, l’Angleterre et l’Inde, les Pays-Bas et l’Indonésie. Chaque pays européen a donc son projet outre-mer, et on oublie finalement rapidement que la France a eu beaucoup plus que la seule Algérie — l’Algérie n’étant d’ailleurs une colonie mais un ensemble de départements français à l’époque — de même que les autres pays colonisateurs, à l’instar de l’Angleterre.
Cette vision binaire n’est pas très juste au regard des profondes dynamiques horizontales entre les colonisés. Une figure comme Gandhi a eu une influence importante en Indonésie dès les années 1930-1940. Les contacts avec le monde arabe ont été très importants pour les musulmans indonésiens. Le Hadj, le pèlerinage vers La Mecque a été une source d’inspiration intellectuelle, spirituelle, religieuse et politique pour toute une série d’Indonésiens. L’université du Caire a joué un rôle important. C’est vrai pendant le colonialisme, mais aussi certainement pendant la décolonisation. Il y a toujours eu des dynamiques entre colonies, entre activistes, et nous avons tendance à l’oublier. Il y a eu à Bruxelles, en 1927, la fameuse conférence de la Ligue contre l’impérialisme et le colonialisme qui a été un des moments de fondation du communisme soviétique. En 1927, Einstein s’est retrouvé à Bruxelles avec Nehru, Mohamed Hatta, le futur vice-président indonésien, Romain Rolland, ainsi que des grands acteurs des diasporas africaines. Déjà dans les années 1920, il y avait des contacts, il y avait un réseau international, et nous l’avons un peu oublié. Nous avons réduit toute cette histoire à une relation verticale entre colonisateurs et colonisés.
Nous avons réduit toute l’histoire du colonialisme, avec les profondes dynamiques horizontales qui pouvaient exister entre colonisés, à une relation verticale entre colonisateurs et colonisés.
David Van Reybrouck
D’autant plus que, quand l’Indonésie se proclame indépendante en août 1945, d’autres pays, comme les Philippines ou l’Inde, étaient également en train d’avancer dans cette direction, et ces processus ont provoqué et stimulé les indépendances de toute une autre série de pays. En 1960, c’est tout de même 18 pays africains qui ont obtenu leur indépendance ! C’est une accélération incroyable. Mais tout cela aurait été impossible sans la dynamique déclenchée en Asie auparavant. La conférence de Bandung était nommée la conférence afro-asiatique, pour montrer à quel point ce rapprochement était souhaité.
Les clefs d’un monde cassé.
Du centre du globe à ses frontières les plus lointaines, la guerre est là. L’invasion de l’Ukraine par la Russie de Poutine nous a frappés, mais comprendre cet affrontement crucial n’est pas assez.
Notre ère est traversée par un phénomène occulte et structurant, nous proposons de l’appeler : guerre étendue.
Cette solidarité afro-asiatique a-t-elle donc été aussi importante que peut laisser le penser un évènement comme la conférence de Bandung ? Et celle-ci existe-t-elle toujours ?
Elle a bel et bien existé, cela ne fait pas de doute. Il y a eu toute une série de conférences et de rencontres après la conférence de Bandung en 1955. L’ampleur des rencontres entre journalistes, écrivains, et beaucoup d’autres groupes professionnels africains et asiatiques, est impressionnante. Je termine le livre Revolusi avec le témoignage d’une dame qui a été interprète pendant le premier voyage des journalistes asiatiques qui ont fait un tour de l’Afrique en visitant neuf pays en l’espace de deux ou trois mois. Une jeune femme indonésienne a voyagé avec des journalistes chinois, japonais et indiens, pour visiter ces pays.
Mais très vite, je pense que les Américains ont joué un rôle assez problématique. Ce sont les Américains qui ont insisté en faveur de l’indépendance indonésienne et de toute une série d’autres pays. Et tout à coup, quand le processus s’est enclenché, ils ont commencé à avoir peur que ces pays entrent dans la sphère soviétique. Ils ont donc très fortement réprimé l’esprit de Bandung pour éviter une deuxième édition et la CIA, à partir des années 1960, a largement favorisé des régimes militaires qui servaient les intérêts américains. Il y a eu par ailleurs une influence très nette de Bandung sur les activistes américains, sur Malcolm X et Martin Luther King par exemple. Les groupes d’activistes américains pour les droits civiques ont été très inspirés par la Conférence de Bandung, alors qu’on a tendance à penser que c’était un mouvement tout à fait américain. Les Black Panthers, par exemple, ont été fortement inspirés par les idées de la Conférence, et là aussi, le FBI a tout fait pour freiner, à l’échelle domestique cette fois, ce mouvement. L’ambiance de Bandung a réellement existé, mais on a tout fait pour la contenir.
Je pense que Black Lives Matter est dans cette mouvance-là aujourd’hui. Mais la solidarité avec le continent africain est plus faible que jadis. J’estime que nous avons perdu en intrication par rapport aux dynamiques qui existaient avec le panafricanisme des années 1950, 1960, ou même au début du siècle. Je rêverais que les activistes de diasporas africaines en Europe et aux États-Unis se mobilisent plus pour l’Afrique.
Il existe toujours des réitérations de la conférence de Bandung. On voit aujourd’hui dans les rues indonésiennes les banderoles de l’anniversaire de la conférence de Bandung et de grands sommets inter-étatiques ont lieu mais c’est en fait strictement économique, c’est une espèce de conférence de Davos entre l’Asie et l’Afrique. La philosophie de Bandung est écrasée par les dogmes du néolibéralisme mondialiste.
L’ambiance de Bandung a réellement existé, mais on a tout fait pour la contenir.
David Van Reybrouck
Vous cherchez par ailleurs à remonter aux premiers temps des pays que vous étudiez et de leur colonisation. Ainsi, pour Revolusi, vous montrez le caractère progressif de la colonisation, entre 1605 et 1914. Pourquoi remonter aussi loin pour un ouvrage qui étudie la Revolusi ?
Je pense que le regard sur la longue durée est fondamental. L’École des Annales l’a d’abord mis en exergue. Je lui accorde d’autant plus d’importance que je suis préhistorien de formation, je trouve donc le long terme réellement passionnant. Je le trouve d’autant plus important quand on parle des contextes coloniaux où il y a parfois le danger de considérer ces sociétés comme statiques, où les gens vivent dans une espèce de permanence précoloniale, tandis que le moteur de l’histoire commencerait à tourner avec l’arrivée des Européens.
Eric R. Wolf a écrit un livre qui s’appelle Europe and the People without history. C’est un texte très important pour moi. On pense que l’Europe apporte l’histoire au sein de sociétés précoloniales statiques où les gens vivent dans un éternel présent où ils cultivent, chassent, et cueillent leurs baies avant de faire leurs rituels, et rien ne se passe. Si on l’étudie à la loupe, on voit que le développement des sociétés humaines se fait sur la très longue durée. Je remonte même, dans mon ouvrage, à la préhistoire, à l’homo erectus, l’homme de Java retrouvé par un docteur militaire hollandais à la fin du XIXᵉ siècle. Faire justice aux perspectives non européennes veut aussi dire faire justice à la longue durée, à l’originalité des tendances historiques.
L’historien Christian Grataloup, dans son Atlas historique mondial, fait un travail formidable en montrant à quel point la longue durée est importante, et pas seulement en Europe. L’attention que je porte à cela est aussi liée au fait que j’aime tout simplement connaître le contexte géographique, historique, le peuplement des territoires. Voir tous les mouvements, les migrations qui ont eu lieu fait relativiser toute la notion des soi-disant indigènes, de ceux qui sont natifs de certaines régions.
Vous avez également une attention aux pratiques (la chanson congolaise), aux objets (le bambou transformé en arme). Qu’est-ce que permet la compréhension de ces pratiques et objets ? Votre attention est-elle liée à votre carrière d’archéologue ?
C’est une excellente question. Je travaille beaucoup sur la culture matérielle, c’est sans doute dû à ma formation en tant qu’archéologue, mais je pense qu’au-delà de cela, si l’on interroge des témoins, il est toujours plus intéressant de leur poser des questions par rapport à leur culture matérielle que par rapport à leur vécu.
Si l’on demande en 2016 ou en 2018 à un vétéran indonésien ce qu’il pensait des Hollandais dans les années 1940, ce n’est pas sûr que ce qu’il dise reflète réellement ce qu’il pensait à cette époque. Cela peut être lié à ma présence, au fait qu’il a changé d’opinion, qu’il a vu des programmes télévisés sur ce sujet… Néanmoins, si on lui demande ce qu’il mangeait lorsqu’il était enfant, quel fusil il avait, où est-ce qu’il dormait durant la guerre d’indépendance ou encore quelles chansons il chantait, les réponses sont très souvent exactes. C’est anodin, mais il y a une très grande vérité dans les détails de la vie quotidienne. Ce sont les véritables épices de l’histoire.
J’avais rencontré une dame âgée en maison de repos, je pensais qu’elle était mourante, qu’elle n’allait plus parler et que je n’allais rester que quelques minutes. Mais tout à coup, elle a commencé à me raconter comment, à quatorze ans, elle avait quitté l’île de Java pour faire la guerre d’indépendance dans la jungle, à Bornéo. Elle me disait qu’elle avait peur des Hollandais, mais encore plus des orangs-outans. Elle dormait à même le sol et mangeait les fruits que les animaux n’avaient pas mangés, elle buvait l’eau des rivières. Puis elle a commencé à chanter des chansons de marche. Tout cela est d’une richesse incroyable, cela nous montre la motivation incroyable de ces personnes. Elle ne m’a certes rien appris de nouveau sur les enjeux diplomatiques, militaires, mais ce qu’elle a raconté apporte une compréhension nouvelle, une vivacité extraordinaire du récit.
Faire justice aux perspectives non européennes veut aussi dire faire justice à la longue durée, à l’originalité des tendances historiques.
David Van Reybrouck
Ainsi, à vos yeux, les histoires rencontrent l’Histoire, d’où votre inclination pour l’histoire orale, qui permet de laisser libre cours à cette rencontre, et de même dans vos ouvrages, les grands événements s’ouvrent d’abord par des récits de vie que l’on pourrait qualifier à première vue d’« ordinaire ».
Chaque personne avec laquelle je me suis entretenu a apporté une pépite. Il faut quelques fois creuser longuement pour trouver cette pépite, mais parfois, elle arrive dès les premières secondes. L’interview la plus courte que j’ai réalisée était avec un Indonésien qui s’appelait Nippon, du nom du Japon dans la langue japonaise. Je me présente, je dis comment je m’appelle, ce que je souhaite faire durant cet entretien. Puis, lorsque je demande à cet homme comment il se nomme, il me répond Nippon. Quand est-il né ? Quelques semaines avant Pearl Harbor. Et les Hollandais pensent pouvoir affirmer que ce sont les Japonais qui ont manipulé les esprits innocents et candides des jeunes Indonésiens ? Même avant l’arrivée des Japonais, des parents donnaient à leur enfant le nom de Nippon. Imaginons qu’en France ou en Grande-Bretagne, en septembre 1939, un jeune couple ait donné à son enfant le nom de Deutschland !
C’est absolument fascinant. Cela démontrait non seulement qu’il existait une forme de sympathie pour le Japon, mais aussi, au fin fond de Sumatra, que le Japon, que donner à son enfant le nom Nippon, représentait une forme de modernité. C’était comme installer des lampes néons dans sa maison : si l’on donne un nom international, on appartient à la modernité, et c’est quelque chose dont on peut presque se vanter.
Votre engagement est politique, mais également personnel. Vos enquêtes sont très longues, et elles sont le lieu de rencontres, et des rencontres qui vous engagent, qui vous marquent, personnellement. Comment traiter, en chercheur, ces affections personnelles ?
Ces interviews ne me laissent jamais indifférent. Je suis là, au contact de personnes qui ont 95 ans et qui me racontent ce qu’ils ont vécu de plus atroce parfois. Un homme me racontait par exemple son expérience en tant que jeune garçon pendant des massacres qui ont eu lieu dans son village, quand 300 personnes de son village ont été balayées par des mitrailleuses, par les armées coloniales. Et puis il raconte comment, le jour du massacre, il a dû enterrer avec son père, avec ses mains nues, les morts, et que les chiens revenaient, des semaines et des semaines après, se nourrir de ces cadavres mal enterrés. Tout en racontant cela, il pleurait, dans un pays où il n’est pas bien vu de pleurer en public. Non, c’est évident, cela ne laisse pas indifférent.
Je me sens par ailleurs très responsable du témoignage que les gens m’ont donné. Ce sont des rencontres magnifiques, enrichissantes et toujours très particulières, mais qui entraînent de ce fait une responsabilité vis-à-vis de ceux qui ne sont plus là. Parmi les 200 personnes avec lesquelles j’ai discuté, je pense que les deux tiers sont aujourd’hui décédés. Je suis très certainement le dernier à discuter avec eux, mais j’étais également parfois le premier. Quand quelqu’un me fait un témoignage incroyable comme celui-ci, je demande souvent si des chercheurs sont déjà venus l’interroger, et on m’a parfois répondu que j’étais le premier européen que l’on voyait depuis que les militaires hollandais étaient passés par là en 1947 ou 1948. Quand je suis parti au Népal à la rencontre des Gurkhas qui ont combattu avec les Britanniques en Indonésie dans les années 1940, je me suis rendu compte que très peu avaient pu raconter leur expérience. C’est très impressionnant de recueillir pour la première fois les témoignages de personnes qui vivent dans le piémont de l’Himalaya, et qui ont été indéniablement des curiosités de l’histoire.
Je me sens très responsable du témoignage que les gens m’ont donné. Ce sont des rencontres magnifiques, enrichissantes et toujours très particulières, mais qui entraînent de ce fait une responsabilité vis-à-vis de ceux qui ne sont plus là.
David Van Reybrouck
Congo, une histoire ; Revolusi. L’Indonésie et la naissance du monde moderne mais également Le fléau ; Zinc ou encore Odes… Vos ouvrages sont régulièrement qualifiés d’« inclassables » : y voyez-vous tout de même un principe de classement, une continuité ?
D’abord, il n’y a en fait qu’un seul pays qui considère que mes livres sont inclassables, et c’est la France. C’est plutôt un problème de classification française, où je ne rentre pas dans le principe de classement cartésien décidé par les libraires. C’est vrai que selon les classifications françaises, je suis à mi-chemin entre l’essai, le récit de voyage, le roman voire la poésie. Mais je n’ai pas de plan. Il n’y a pas une vision, une stratégie à long terme. C’est vrai cependant qu’après un certain temps, on commence à constater un fil rouge qui revient à travers mes travaux. Je n’ose pas encore employer le terme d’« œuvre », que je trouve un peu prétentieux pour quelque chose qui est encore en plein développement, en pleine évolution.
Il y a mon travail historique où je travaille beaucoup avec les témoignages oraux et, à côté, je travaille beaucoup sur l’innovation démocratique, sur les assemblées citoyennes. J’ai rencontré le président Macron au début du mouvement des Gilets Jaunes, et peut-être que la Convention citoyenne pour le Climat a été en partie inspirée de notre conversation. Mais ce qui peut frapper, c’est que dans ces deux cas, ma conviction profonde est que les gens ordinaires ont quelque chose à dire. Je n’aime d’ailleurs pas ce terme d’ordinaire, car très souvent les personnes que je rencontre sont extraordinaires. Si les gens arrivent à raconter l’histoire de leur pays, ils réussissent également à raconter le futur de leur pays. Et je trouve que les assemblées citoyennes, plus de 600 ont eu lieu à travers le monde, montrent à quel point les citoyens tirés au sort sont capables de formuler des recommandations et des mesures politiques. Il y a chez moi une véritable curiosité pour la parole de ceux qui sont moins instruits, et pourtant tellement intéressants à écouter. J’espère qu’il y a également un aspect d’empathie dans mon œuvre, montrer que des perspectives qui peuvent sembler étrangères, bizarres à première vue sont tout à fait cohérentes si on réussit à comprendre l’histoire.
Il n’y a en fait qu’un seul pays qui considère que mes livres sont inclassables : la France.
David van Reybrouck
Je travaille actuellement sur le réchauffement climatique, et il y a une idée que je trouve fondamentale, qui est que le cercle de l’empathie doit s’élargir. Il se limitait d’abord, historiquement, à l’échelle de la ville, ensuite à celle du pays, puis au continent, et ce n’est que maintenant que, petit à petit, l’empathie dépasse les frontières continentales. Nous devrions cultiver une vraie volonté de célébrer l’égalité profonde de l’humanité aujourd’hui. Mais même là, une fois que l’humanité s’est reconnue en tant que telle, il reste une inégalité profonde entre l’humanité et le reste de la planète. Je pense qu’agrandir le cercle empathique aux autres êtres vivants me semble essentiel. Christian Grataloup, dont je parlais précédemment, vient de sortir d’ailleurs un Atlas historique de la Terre, ce qui montre qu’après avoir embrassé l’histoire humaine, il dépasse l’anthropocentrisme, ce que je trouve remarquable.
Je pense néanmoins que, finalement, c’est aux autres de dégager des structures au sein du travail que je fais. J’avance, tout simplement, et c’est à un travail externe de voir quelques fils conducteurs.
L’empathie doit également s’étendre au futur, comme vous l’écrivez dans un nouveau texte chez Actes Sud — une version réécrite de votre discours lors de la Cinquantième Conférence Huzinga, intitulé Nous colonisons le futur.
Je pense en effet que cette idée est très importante. Il y a un travail, un militantisme et un intérêt très importants pour le colonialisme passé, mais beaucoup moins pour le colonialisme du futur. Or, lorsque l’on regarde sur une carte les pays les plus touchés par le réchauffement climatique, c’est presque une copie conforme de la carte coloniale. Ce sont les pays riches de l’hémisphère nord qui émettent le plus de gaz à effet de serre, et les pays du sud qui sont les plus vulnérables. Je trouve qu’il y a là un néocolonialisme dont on ne parle pas assez, alors que l’on se tourne beaucoup vers le colonialisme passé. Mais simplement regarder les injustices du passé sans regarder les injustices présentes et futures me semble être une forme de cécité.
La jeunesse a un rôle essentiel à jouer de ce point de vue. J’ai donné récemment cette même conférence en français devant 2000 personnes environ, et il y avait énormément de jeunes dans la salle. À la fin, il y a eu une standing ovation où c’était en fait les jeunes qui se levaient. Quand on dit, par exemple, que Greta Thunberg est trop jeune pour faire une différence, on oublie que des révolutions comme celle qui a eu lieu en Indonésie sont pour une grande part dues aux adolescents. J’ai d’ailleurs discuté cet été avec Greta Thunberg, et j’ai été impressionné par sa grande connaissance du sujet, sa maturité, et son immense travail, alors qu’elle n’avait que 19 ans.


