Dès 2013, le Conseil européen avait adopté le concept d’« autonomie stratégique », repris par le Président Macron à son arrivée au pouvoir, et qu’il élargit même par la suite en « souveraineté européenne », lors de son discours de l’École de Guerre le 7 février 2020 : « L’Europe seule peut assurer une souveraineté réelle, c’est-à-dire notre capacité à exister dans le monde actuel pour y défendre nos valeurs et nos intérêts. Il y a une souveraineté européenne à construire et il y a la nécessité de la construire. » Et encore lors de la conférence de presse du 9 décembre 2021 : « Une Europe plus souveraine, c’est une Europe de la défense. Depuis 2017, des avancées considérables ont été réalisées. Il faut entrer dans une phase plus opérationnelle en définissant les intérêts européens et une stratégie partagée ». Dans leur Déclaration de Versailles en mars 2022, les Vingt-Sept affirmèrent leur volonté de construire la « souveraineté européenne », dans les domaines de la défense, de l’énergie et de l’économie.
Au niveau du discours en tout cas, c’était un langage unanime, correspondant d’ailleurs programme du nouveau gouvernement allemand, formé fin 2021 : « Une Union européenne renforcée sur le plan démocratique, plus capable d’agir et stratégiquement souveraine, sera la base de notre paix, de notre prospérité et de notre liberté ».
Les déclarations du président de la République le 9 avril dernier, selon lesquelles l’Europe n’avait aucun intérêt à l’aggravation de la crise autour de Taïwan et devait établir son « autonomie stratégique » afin de devenir un « troisième pôle » entre la Chine et les États-Unis, ont pourtant suscité un tollé transatlantique et intraeuropéen. Pourtant, Paris n’est pas aussi isolé qu’on veut bien le dire : Charles Michel, le président du Conseil européen, a exprimé la même opinion, d’ailleurs partagée par de nombreux responsables dans l’ensemble de l’Union. Le vrai problème est le sens que l’on donne à ces notions d’autonomie ou de souveraineté, et les objectifs qu’on leur assigne.
Le vrai problème est le sens que l’on donne à ces notions d’autonomie ou de souveraineté, et les objectifs qu’on leur assigne.
Georges-Henri Soutou
Une difficulté sémantico-historique
Il faut bien voir qu’« autonomie stratégique » ou « souveraineté européenne » sont des nuances qui échappent à nos partenaires. Pour eux ce n’est pas différent, même si pour les Français l’autonomie paraît être un concept moins exigeant que celui de souveraineté. D’autre part, cette question est chargée d’une longue histoire, ce qui ne facilite pas les choses.
Le 20 avril 2021, Annegret Kramp-Karrenbauer, alors ministre de la Défense, avait déclaré que le vrai problème était que la France et l’Allemagne ne comprenaient pas la notion d’autonomie stratégique de la même façon. Cette remarque va au fond des choses, depuis le début de la Ve République, c’est-à-dire depuis la rencontre entre Adenauer et de Gaulle à Rambouillet en juillet 1960 et le projet d’« Union politique » des Six en 1962. Dans l’esprit du Général, celle-ci aurait été alliée aux États-Unis, mais indépendante d’eux. Le chancelier Adenauer, inquiet d’une possible négociation américano-soviétique par-dessus la tête des Européens et de la RFA, se rallia à cette conception et Bonn soutint, jusqu’à son échec en avril 1962, le projet d’Union politique interétatique, avec un volet politique extérieure et défense, communément appelé « Plan Fouchet ».
Mais Bonn, comme les autres partenaires, avait veillé très soigneusement à ce que le Plan Fouchet mentionne bien l’Alliance atlantique. C’est la modification sur ce point du projet initial, par le général de Gaulle très personnellement, le 17 janvier 1962 qui en dernière analyse conduisit à son échec en avril 1962. La RFA ne pouvant pas se permettre de remettre en cause l’intégration au sein de l’OTAN, alors que le Général faisant de cette remise en cause en fait l’un des buts majeurs de sa politique d’indépendance nationale et européenne.
Bonn, comme les autres partenaires, avait veillé très soigneusement à ce que le Plan Fouchet mentionne bien l’Alliance atlantique. C’est la modification sur ce point du projet initial, par le général de Gaulle très personnellement, le 17 janvier 1962 qui en dernière analyse conduisit à son échec en avril 1962.
Georges-Henri Soutou
Certes, le traité de l’Élysée du 22 janvier 1963, avec son important volet stratégique, paraissait reprendre à deux le projet à Six de 1962. Mais beaucoup de responsables allemands suspectaient les arrière-pensées françaises et le Bundestag ajouta au traité un préambule qui le vidait de son sens stratégique en rappelant l’Alliance atlantique.
Pour les Allemands en effet, seule une autonomie européenne au sein de l’Alliance est éventuellement envisageable, certainement pas en dehors, car comment risquer de fragiliser l’Alliance atlantique ? Sachant en outre que l’autonomie est un concept plus familier aux Allemands, à l’histoire confédérale ou fédérale, qu’aux Français, centralisateurs depuis toujours. Dès que l’on suspecte les arrière-pensées françaises, on préfère encore à Bonn en revenir à l’intégration atlantique pure et simple. Et les Allemands sont toujours restés méfiants, même si la rhétorique française est passée de l’indépendance à l’autonomie. Les autres partenaires européens sont généralement sur la même position, voire encore plus atlantistes. Pour eux aussi, l’héritage de cette histoire pèse lourd. Dans le domaine politico-stratégique, les Français auraient intérêt à s’inspirer de la formule allemande bien connue : « être, davantage que paraître ».
Dans le domaine politico-stratégique, les Français auraient intérêt à s’inspirer de la formule allemande bien connue : « être, davantage que paraître ».
Georges-Henri Soutou

Les problèmes stratégiques de l’Union européenne
Pourtant les positions a priori ne remplacent pas l’analyse stratégique. L’Union européenne connaît aujourd’hui deux grands problèmes à la fois : l’agression russe en Ukraine et l’aggravation de la rivalité entre Washington et Pékin. La première voit le retour de la guerre en Europe pour la première fois depuis 1945, avec un potentiel d’escalade considérable ; la seconde compromet les intérêts et les positions européens dans la zone Asie-Pacifique. Alors que l’Europe se retrouve en position de faiblesse, à cause de ses problèmes économiques et du coût de ses transitions diverses — climatique, démographique, etc. — et de l’inexistence d’un réel organisme de décision politico-stratégique et des moyens de puissance correspondants, elle a notamment perdu l’accès aux sources d’énergie russes — en 2018, sur l’ensemble des importations énergétiques des pays de l’Union, 40,4 % du gaz, 29,8 % du pétrole et 42,4 % des combustibles solides étaient d’origine russe — et on lui demande maintenant de risquer de compromettre son commerce avec la Chine : en 2022 celle-ci était le premier fournisseur de l’Allemagne, pour 191 milliards d’euros, et son quatrième client, pour 107 milliards.
On peut évidemment imaginer une réorganisation des courants concernés, mais pour le moment deux choses seulement sont sûres : ce sera plus cher, et les États-Unis s’en tireront beaucoup mieux, accroissant même la dépendance de l’Europe à leur égard.
D’autre part, la crise est là pour durer : une défaite de la Russie est loin d’être assurée, sa victoire sur le terrain ne peut être exclue, et dans tous les cas de figure l’arrivée à Moscou d’un pouvoir plus ouvert au dialogue avec l’Occident relève pour le moment du rêve. Il faut donc que les Européens se préparent à un affrontement majeur et de longue durée.
La crise est là pour durer : une défaite de la Russie est loin d’être assurée, sa victoire sur le terrain ne peut être exclue, et dans tous les cas de figure l’arrivée à Moscou d’un pouvoir plus ouvert au dialogue avec l’Occident relève pour le moment du rêve.
Georges-Henri Soutou
Nouvelle Guerre froide ou nouvel atlantisme ?
Une première réponse serait — et pour beaucoup de nos partenaires c’est déjà le cas — un atlantisme renforcé ou renouvelé. Cela pourrait répondre au slogan à la mode de « l’union des démocraties occidentales contre les autocraties ». Certains considèrent qu’il faut assumer cette nouvelle Guerre froide, et plaident pour une adhésion rapide de l’Ukraine et de la Géorgie, et pour la transformation de la Mer Noire en lac otanien. Certains imaginent même de provoquer la chute de Poutine, voire l’éclatement de la Fédération de Russie. Après tout, l’OTAN se trouve en état de quasi cobelligérance avec l’Ukraine, avec des livraisons d’armes importantes et même avec des forces spéciales occidentales présentes sur le terrain 1.
Certes, il y a dans la situation actuelle des aspects qui rappellent la Guerre froide — quoi qu’en un sens la situation soit bien pire. L’URSS était plus prévisible, sa politique, inspirée à la fois par une idéologie clairement proclamée et par des considérations géopolitiques que la contemplation d’une carte permettait d’imaginer, ne pouvait pas réserver des surprises stratégiques, tout au plus tactiques. D’autre part, malgré de dangereuses aventures — blocus de Berlin, guerre de Corée, installation de missiles à Cuba — elle se gardait toujours une porte de sortie : puisque la victoire ultime du communisme était « scientifiquement » certaine, pourquoi courir le risque d’une catastrophe ? Or à cause de la disparition de l’eschatologie révolutionnaire et de la transformation de la Russie en dictature « classique » moins prévisible, la situation actuelle comporte des risques considérables d’escalade — géographique ou dans le choix des moyens militaires utilisés. D’autant plus que les Occidentaux en savent souvent moins sur le fonctionnement de la Russie actuelle que sur celui de l’URSS, du moins à partir des années 1970.
À cause de la disparition de l’eschatologie révolutionnaire et de la transformation de la Russie en dictature « classique » moins prévisible, la situation actuelle comporte des risques considérables d’escalade.
Ajoutons un point essentiel de différence avec la Guerre froide : la Russie n’intervenait militairement de façon directe que dans les pays du Pacte de Varsovie, dans sa « zone d’influence » reconnue de fait depuis 1945, et en pouvant se couvrir par des soi-disant « appels » de dirigeants des pays concernés — Berlin-Est en 1953, Budapest en 1956, Prague en 1968. Ailleurs, elle s’appuyait certes sur des alliés — Nord-Coréens, Chinois, etc. — mais ne s’engageait pas directement, du moins officiellement. La guerre d’Afghanistan a constitué là une exception. De leur côté, les Occidentaux n’intervenaient pas non plus directement contre les Soviétiques, la garantie américaine n’était ferme que pour les pays du Pacte atlantique, ailleurs elle était circonstancielle — comme au Vietnam — et leur intervention ou menace d’intervention découlait directement de leurs intérêts majeurs, comme ce fut le cas lors de la crise de Cuba en 1962.
L’affrontement militaire direct était donc évité : en Afghanistan les Occidentaux aidèrent les Afghans contre l’Armée rouge, mais de façon clandestine. Avec le cas ukrainien on a à la fois l’invasion d’un pays qui ne possédait pas de lien de sécurité avec la Russie, et une aide occidentale proclamée, au bord de la cobelligérance de fait. Nous n’avons jamais été aussi près d’un risque d’affrontement militaire direct depuis la crise de Cuba en 1962. Là aussi, la situation peut être considérée comme plus grave, ou tout au moins comme plus instable que pendant la Guerre froide. D’autant plus qu’après les graves crises du Mur de Berlin (1961) et de Cuba, Américains et Soviétiques, conscients de la vitesse et de la gravité du risque d’escalade nucléaire, avaient mis en place un système de consultations rapides et toute une grammaire de gestion des d’affrontement, qui n’existe plus aujourd’hui.
Nous n’avons jamais été aussi près d’un risque d’affrontement militaire direct depuis la crise de Cuba en 1962.
Georges-Henri Soutou
D’autre part, la Chine est devenue un problème plus coriace depuis quelques années. Depuis la révolution introduite par le président Deng Xiaoping en 1978, elle avait recherché son insertion dans l’économie mondiale, ce qui a contribué à lancer une nouvelle phase de mondialisation libérale à partir des années 1980. En 2001 elle entrait à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Parallèlement elle adoptait envers les États-Unis une politique dans l’ensemble coopérative.
Les choses ont complètement changé depuis. Le président Xi Jinping a décidé une réorientation générale de la politique chinoise, dont l’économie devrait être rendue moins dépendante de l’économie mondiale. En même temps il lançait un appel à constituer un modèle alternatif au modèle occidental, tout en accroissant régulièrement la coopération avec Moscou dans tous les domaines. La guerre en Ukraine a considérablement renforcé cette orientation vers l’affirmation d’un contre-modèle, dans les deux capitales.
On rappellera que les États-Unis, à partir des années 1970, avaient consacré beaucoup d’efforts à séparer Pékin de Moscou — à partir de la visite à Pékin du président Nixon en 1972, ils y étaient même parvenus. Or aujourd’hui, c’est le contraire : leur politique pousse Moscou et Pékin à se rapprocher, alors que la Chine est devenue puissante, et même indispensable à l’économie mondiale. Dans le même temps, l’Occident est relativement moins puissant et de toute évidence moins dominant — on pourrait même dire : moins indispensable dans le monde nouveau.
En fait, les États-Unis sont hésitants : la politique de Donald Trump, aussi bien à l’égard de Moscou que de Pékin, était fort différente de l’actuelle, et un retour au pouvoir des Républicains pourrait conduire à de nouvelles orientations. Washington est pris entre de multiples engagements et des priorités difficiles à hiérarchiser, alors que le « bipartisme » qui avait caractérisé la politique américaine durant la Guerre froide est bel et bien fini. En effet, en juin 1948, le sénateur républicain Vandenberg avait fait voter une résolution, qui porte son nom, autorisant le président démocrate Truman à conclure des alliances militaires pour lutter contre le communisme soviétique. À partir de là, la politique extérieure avait été soutenue pour l’essentiel par les deux partis, malgré leurs profondes divisions en politique intérieure. Aujourd’hui, nous sommes loin du bipartisme. Et il ne reviendra pas, à cause des profondes divisions de la société américaine, fort différente de celles des années 1950, 1960 ou 1970 2.
À partir des années 1970, les États-Unis avaient consacré beaucoup d’efforts à séparer Pékin de Moscou — à partir de la visite à Pékin du président Nixon en 1972, ils y étaient même parvenus. Or aujourd’hui, c’est le contraire : leur politique pousse Moscou et Pékin à se rapprocher
Georges-Henri Soutou
L’intérêt majeur de l’Occident paraîtrait être de ne pas solidifier encore davantage la relation Russie-Chine et de ne pas les laisser attirer à eux des pays comme l’Inde, le Brésil, l’Arabie Saoudite, l’Afrique du Sud. On notera que dans ces dernières semaines, le Brésil comme l’Arabie saoudite ont accepté de libeller leur commerce avec la Chine en yuans, et non plus en dollars.
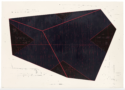
Une « coalition des motivés » ?
Certains sont conscients de ce danger, mais voudraient y répondre de façon offensive. D’où une variante à l’atlantisme, qui a d’ailleurs existé à différents moments après 1945 : les Européens contiendraient l’URSS, avec un appui plus ou moins lointain de Washington, qui se consacrerait en priorité à l’Asie. Cette tendance apparut clairement pendant la guerre de Corée, pendant la guerre du Vietnam, et même par moments sous la présidence de Reagan. On la retrouva après 2001, mais cette fois effectivement réalisée, quand les États-Unis, face aux réticences de nombreux Européens, proposèrent une « coalition of the willing », en dehors de l’OTAN, pour affronter Saddam Hussein.
Or cette variante revient en force à l’occasion de la guerre en Ukraine : certains imaginent un pacte régional unissant en particulier les Pays baltes, la Pologne, et la Roumanie, avec le soutien de la Grande-Bretagne et des États-Unis 3. Ce pacte comporterait évidemment un casus foederis plus rigoureux que l’article 5 du pacte atlantique, et serait une garantie contre les hésitations évidentes des pays de l’Europe de l’Ouest. Les pays européens les plus opposés à la Russie et les plus atlantistes tiendraient le front contre Moscou, tandis que les États-Unis « pivoteraient » vers la Chine.
Cette formule est évidemment pleine de sens pour les pays concernés, les plus fermes soutiens de l’Ukraine, car elle correspond à des tendances actuelles bien évidentes et elle n’est pas nouvelle : déjà dans les années 1930 de nombreux responsables polonais proposaient cette entente régionale pour faire pièce à l’URSS, alliance appelée alors « Intermarium », qui rappelle d’ailleurs la plus grande extension de l’État polonais au XVIIe siècle, de la Baltique à la Mer Noire. Évocation historique qui ne ferait sans doute rien pour calmer Moscou…
Si l’on veut sauver les liens occidentaux à long terme, cela ne peut pas être dans la dépendance et le clientélisme.
Georges-Henri Soutou
Mais cette seconde formule convient encore moins aux Européens que la première, celle de l’atlantisme classique, car elle les divise entre l’Est et l’Ouest du Continent. Et elle ne répond pas plus que l’orthodoxie atlantique aux problèmes de notre temps, qui ne sont pas uniquement liés à la politique russe : les incertitudes américaines, désormais structurelles, les problèmes de restructuration économique que nous devons affronter, et l’évolution de nos opinions publiques, pour lesquelles, dans de nombreux pays, le consensus autour du modèle libéral et occidental des années 1990 est fortement remis en cause. D’autre part, si l’on veut sauver les liens occidentaux à long terme, cela ne peut pas être dans la dépendance et le clientélisme.
Un retour de la tentation neutraliste ?
Le danger est d’ailleurs justement de voir renaître, en réaction, des tendances « neutralistes ». Ces tendances ne sont pas vraiment nouvelles en Europe. Certains recommandaient telle ou telle forme de neutralisme dès les années 1950. À l’époque de la « querelle de la CED », en 1953-1954, l’opinion française souhaitait la tenue d’une conférence « de la dernière chance » avec l’URSS avant de ratifier définitivement la Communauté Européenne de Défense négociée depuis 1951 et le réarmement allemand que celle-ci comportait, dans l’espoir qu’un accord avec Moscou sur l’Allemagne et la sécurité en Europe permettrait d’éviter celui-ci. Dans les milieux « progressistes », qui se situaient entre les communistes et les socialistes, on allait jusqu’à évoquer la mise sur pied d’un nouveau système européen de sécurité regroupant tous les pays du continent et garanti conjointement par les États-Unis et l’URSS, système qui aurait bien sûr écarté la perspective du réarmement allemand mais qui aurait aussi porté un coup mortel à l’Alliance atlantique 4.
Autre thème des années 1950 : le « désengagement ». En mai 1957, dans une série de conférences à la BBC qui eurent un très grand écho, George Kennan, pourtant l’inventeur en 1946 de la doctrine du « containment » face à Moscou, se déclara en faveur de la création d’une zone dénucléarisée en Europe centrale, qui serait le premier pas vers un désengagement militaire des grandes puissances dans cette région et vers la neutralisation de celle-ci. Cela aurait rendu possible, selon lui, la réunification allemande, l’équilibre étant maintenu par la garantie que les États-Unis et l’URSS apporteraient conjointement au processus. Enfin, celui-ci, selon Kennan, aurait dû permettre à l’Europe orientale, grâce à l’apaisement des tensions Est-Ouest, de retrouver une plus grande liberté 5. En 1957 Hugh Gaitskell, leader du parti travailliste, proposa un plan très semblable à celui de Kennan 6. On rappellera également, sinon l’Ostpolitik lancée par Willy Brandt en 1969, du moins certainement sa dérive neutraliste à partir de la « querelle des euromissiles » en 1978-1982 7.
Mais il faut bien noter que ces conceptions illusoires ont toujours été dépassées par les évènements — crises de Berlin, de Cuba, Prague en 1968, l’invasion de l’Afghanistan… — et que ce ne sont pas ces tendances, et en particulier les divers accords liés à l’Ostpolitik, qui ont permis la fin de la Guerre froide, mais plutôt la crise systémique du bloc soviétique et une fermeté occidentale renouvelée à partir des années 1980 — fermeté appuyée sur une supériorité occidentale dans tous les domaines, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Sans oublier une politique occidentale intelligente en direction du monde soviétique.
Les conceptions illusoires du neutralisme ont toujours été dépassées par les évènements.
Georges-Henri Soutou
Une alliance à deux piliers ou l’Europe comme troisième pôle ?
Une solution plus exigeante mais plus efficace consisterait à organiser un véritable pilier européen au sein de l’Alliance atlantique, voire à faire de l’Europe un troisième pôle mondial. Cela lui rendrait un véritable rôle international, pour accroître la force de dissuasion globale des Occidentaux avec l’aide des États-Unis mais en même temps pour ne pas en rester à une série d’affrontements que l’Occident pourrait bien perdre, du Moyen Orient à l’Afrique et pour ne pas manquer une occasion de créer une vraie personnalité européenne. En particulier, l’Europe n’a aucun intérêt à être confrontée à la fois à la Russie et à la Chine, ni à garder le fort contre la Russie tandis que les États-Unis concentreraient leurs énergies face à la Chine.

Cela entraînerait bien sûr de considérables efforts : l’Europe doit avoir une politique d’armement, ses propres moyens de renseignement et d’évaluation, une indépendance énergétique, technique et économique suffisante — sans aller jusqu’à rechercher une illusoire autarcie 8 — et des organismes de réflexion stratégique autonomes. L’Europe stratégique autonome resterait évidemment étroitement alliée aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et au Canada au sein de l’Alliance atlantique. Mais elle devrait avoir la capacité d’une prise de décision stratégique autonome, avec ses moyens propres de renseignement, sa propre industrie d’armements, ses forces, sa propre chaîne de commandement. Les accords dits « Berlin plus » conclus lors du sommet de l’Alliance à Washington en 1999 pour régler les rapports entre l’OTAN et le volet défense de l’Union européenne sont une base de départ, mais leur application a été régulièrement bloquée par la Turquie. Il faut sortir de cette impasse : on ne peut pas demander aux Européens de contribuer davantage à leur défense — à juste titre — et en même temps refuser à l’Union européenne de développer sa personnalité de défense, conformément au traité de Lisbonne. Ce serait la seule façon de permettre à l’Union de peser réellement dans le très dangereux triangle de crise qui s’est constitué entre Moscou, Pékin et Washington et de favoriser autant que possible, comme une « puissance du milieu », des issues raisonnables. Sinon, ce sont les Européens qui, finalement, feront les frais de cette situation.
On ne peut pas demander aux Européens de contribuer davantage à leur défense — à juste titre — et en même temps refuser à l’Union européenne de développer sa personnalité de défense, conformément au traité de Lisbonne.
Georges-Henri Soutou
En même temps, il faut penser au long terme, et créer les bases d’une réinsertion de la Russie et d’une complète insertion de la Chine dans le système international. Après tout, c’est ce qui s’est passé pendant la Guerre froide avec le « processus d’Helsinki », initié à partir de 1973, marqué par la Déclaration d’Helsinki en 1975, la création de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe la même année, la CSCE devenant un organisme permanent en 1990 (OSCE). Le tout réunissant les pays de l’OTAN — et donc également les États-Unis et le Canada — et ceux du Pacte de Varsovie, et donc ne posant pas les mêmes problèmes pour nos partenaires que des systèmes de sécurité européens n’englobant pas l’Amérique du Nord comme de le Général de Gaulle, ou François Mitterrand en 1990, y avaient par moments songé. Au départ, les États-Unis n’étaient d’ailleurs guère enthousiastes : ils ont fini par suivre les Européens et on reconnaît aujourd’hui que ce processus a facilité la sortie de la Guerre froide 9.
L’OSCE est certes en sommeil depuis l’invasion de l’Ukraine, mais elle pourrait avoir à un moment donné son rôle à jouer, lors de la sortie de la crise actuelle. C’est un forum qui existe, et dont les Russes ont fait savoir qu’ils ne voulaient pas être exclus. Peut-être souhaiteront-ils un jour ne pas devenir de plus en plus dépendants de la Chine, et rouvrir un canal de négociation vers l’Ouest ?De même, pour la Chine, des organismes comme le G20, ou un G7 élargi, pourraient servir à rétablir un dialogue avec les Occidentaux, en l’amenant à ne pas se limiter à des accords régionaux « indopacifiques », ce qui est sa tendance actuelle. Bien entendu il faudra de la patience, mais, à long terme, cela semble la meilleure voie possible. Il y a un risque, autrement à ce qu’à l’avenir les dirigeants européens et leurs opinions se divisent encore plus, et que certains se réfugient dans des formes d’isolationnisme ou de neutralisme qui ont souvent affleuré dès les années 1950. L’Europe risquerait alors de devenir un terrain de parcours pour toutes les ingérences russes, chinoises ou moyen-orientales — politiques, économiques, financières.
Sources
- Liveblog de la Frankfurter Allgemeine Zeitung du 12 avril 2023. Serge Sur, « Belligérance et cobelligérance », Revue de Défense nationale, février 2023.
- Cf. le Cahier n° 134 (mars 2021) de la Fondation Res Publica, « États-Unis : crise de la démocratie et avenir du leadership américain ».
- Andrew A. Michta, « UkraineWar Is A GameChanger : America Must Support The ‘Intermarium’ Region », 2 février 2023, 19FortyFive.
- Cf. par exemple des articles de Claude Bourdet en février 1954 dans le Nouvel Observateur, hebdomadaire fondé en 1950 pour défendre les idées neutralistes. Cf. Georges-Henri Soutou, La Guerre froide de la France, Texto, 2023.
- Walter L. Hixson, George F. Kennan Cold War Iconoclast, Columbia UP, 1989, pp. 144 ss.
- Georges-Henri Soutou, La Guerre froide 1943-1990, Pluriel, 2011.
- Pour comprendre à quel point ces orientations des années 1970-1980 pèsent en Allemagne aujourd’hui, cf. Reinhard Bingener, Markus Wehner , Die Moskau-Connection. Das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit, C.H.Beck, 2023.
- Yves Bertoncini, Relocaliser en France avec l’Europe, Fondation pour l’innovation politique, 2020.
- Veronika Heyde, Frankreich im KSZE Prozess. Diplomatie im Namen der europäischen Sicherheit 1969-1983, Oldenbourg, De Gruyter, 2016. Voir aussi : Nicolas Badalassi, En finir avec la guerre froide. La France, l’Europe et le processus d’Helsinki, 1965-1975, Rennes, PUR, 2014.


